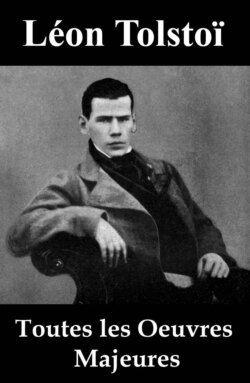Читать книгу Toutes les Oeuvres Majeures de Léon Tolstoï - León Tolstoi - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I
Оглавление«Eh bien, prince, que vous disais-je? Gênes et Lucques sont devenues les propriétés de la famille Bonaparte. Aussi, je vous le déclare d’avance, vous cesserez d’être mon ami, mon fidèle esclave, comme vous dites, si vous continuez à nier la guerre et si vous vous obstinez à défendre plus longtemps les horreurs et les atrocités commises par cet Antéchrist…, car c’est l’Antéchrist en personne, j’en suis sûre! Allons, bonjour, cher prince; je vois que je vous fais peur… asseyez-vous ici, et causons1…»
Ainsi s’exprimait en juillet 1805 Anna Pavlovna Schérer, qui était demoiselle d’honneur de Sa Majesté l’impératrice Marie Féodorovna et qui faisait même partie de l’entourage intime de Sa Majesté. Ces paroles s’adressaient au prince Basile, personnage grave et officiel, arrivé le premier à sa soirée.
MlleSchérer toussait depuis quelques jours; c’était une grippe, disait-elle (le mot «grippe» était alors une expression toute nouvelle et encore peu usitée).
Un laquais en livrée rouge – la livrée de la cour – avait colporté le matin dans toute la ville des billets qui disaient invariablement: «Si vous n’avez rien de mieux à faire, monsieur le Comte ou Mon Prince, et si la perspective de passer la soirée chez une pauvre malade ne vous effraye pas trop, je serai charmée de vous voir chez moi entre sept et huit. – ANNA SCHÉRER2.»
«Grand Dieu! Quelle virulente sortie!» répondit le prince, sans se laisser émouvoir par cette réception.
Le prince portait un uniforme de cour brodé d’or, chamarré de décorations, des bas de soie et des souliers à boucles; sa figure plate souriait aimablement; il s’exprimait en français, ce français recherché dont nos grands-pères avaient l’habitude jusque dans leurs pensées, et sa voix avait ces inflexions mesurées et protectrices d’un homme de cour influent et vieilli dans ce milieu.
Il s’approcha d’Anna Pavlovna, lui baisa la main, en inclinant sa tête chauve et parfumée, et s’installa ensuite à son aise sur le sofa.
«Avant tout, chère amie, rassurez-moi, de grâce, sur votre santé, continua-t-il d’un ton galant, qui laissait pourtant percer la moquerie et même l’indifférence à travers ses phrases d’une politesse banale.
— Comment pourrais-je me bien porter, quand le moral est malade? Un cœur sensible n’a-t-il pas à souffrir de nos jours? Vous voilà chez moi pour toute la soirée, j’espère?
— Non, malheureusement: c’est aujourd’hui mercredi; l’ambassadeur d’Angleterre donne une grande fête, et il faut que j’y paraisse; ma fille viendra me chercher.
— Je croyais la fête remise à un autre jour, et je vous avouerai même que toutes ces réjouissances et tous ces feux d’artifice commencent à m’ennuyer terriblement.
— Si l’on avait pu soupçonner votre désir, on aurait certainement remis la réception, répondit le prince machinalement, comme une montre bien réglée, et sans le moindre désir d’être pris au sérieux.
— Ne me taquinez pas, voyons; et vous, qui savez tout, dites-moi ce qu’on a décidé à propos de la dépêche de Novosiltzow?
— Que vous dirai-je? Reprit le prince avec une expression de fatigue et d’ennui… Vous tenez à savoir ce qu’on a décidé? Eh bien, on a décidé que Bonaparte a brûlé ses vaisseaux, et il paraîtrait que nous sommes sur le point d’en faire autant.»
Le prince Basile parlait toujours avec nonchalance, comme un acteur qui répète un vieux rôle. MlleSchérer affectait au contraire, malgré ses quarante ans, une vivacité pleine d’entrain. Sa position sociale était de passer pour une femme enthousiaste; aussi lui arrivait-il parfois de s’exalter à froid, sans en avoir envie, rien que pour ne pas tromper l’attente de ses connaissances. Le sourire à moitié contenu qui se voyait toujours sur sa figure n’était guère en harmonie, il est vrai, avec ses traits fatigués, mais il exprimait la parfaite conscience de ce charmant défaut, dont, à l’imitation des enfants gâtés, elle ne pouvait ou ne voulait pas se corriger. La conversation politique qui s’engagea acheva d’irriter Anna Pavlovna.
«Ah! Ne me parlez pas de l’Autriche! Il est possible que je n’y comprenne rien; mais, à mon avis, l’Autriche n’a jamais voulu et ne veut pas la guerre! Elle nous trahit: c’est la Russie toute seule qui délivrera l’Europe! Notre bienfaiteur a le sentiment de sa haute mission, et il n’y faillira pas! J’y crois, et j’y tiens de toute mon âme! Un grand rôle est réservé à notre empereur bien-aimé, si bon, si généreux! Dieu ne l’abandonnera pas! Il accomplira sa tâche et écrasera l’hydre des révolutions, devenue encore plus hideuse, si c’est possible, sous les traits de ce monstre, de cet assassin! C’est à nous de racheter le sang du juste! À qui se fier, je vous le demande? L’Angleterre a l’esprit trop mercantile pour comprendre l’élévation d’âme de l’empereur Alexandre! Elle a refusé de céder Malte. Elle attend, elle cherche une arrière-pensée derrière nos actes. Qu’ont-ils dit à Novosiltzow? Rien! Non, non, ils ne comprennent pas l’abnégation de notre souverain, qui ne désire rien pour lui-même et ne veut que le bien général! Qu’ont-ils promis? Rien, et leurs promesses mêmes sont nulles! La Prusse n’a-t-elle pas déclaré Bonaparte invincible et l’Europe impuissante à le combattre? Je ne crois ni à Hardenberg, ni à Haugwitz! Cette fameuse neutralité prussienne n’est qu’un piège3! Mais j’ai foi en Dieu et dans la haute destinée de notre cher empereur, le sauveur de l’Europe!»
Elle s’arrêta tout à coup, en souriant doucement à son propre entraînement.
«Que n’êtes-vous à la place de notre aimable Wintzingerode! Grâce à votre éloquence, vous auriez emporté d’assaut le consentement du roi de Prusse; mais… me donnerez-vous du thé?
— À l’instant!… À propos, ajouta-t-elle en reprenant son calme, j’attends ce soir deux hommes fort intéressants, le vicomte de Mortemart, allié aux Montmorency par les Rohan, une des plus illustres familles de France, un des bons émigrés, un vrai! L’autre, c’est l’abbé Morio, cet esprit si profond!… Vous savez qu’il a été reçu par l’empereur!
— Ah! Je serai charmé!… Mais dites-moi, je vous prie, continua le prince avec une nonchalance croissante, comme s’il venait seulement de songer à la question qu’il allait faire, tandis qu’elle était le but principal de sa visite, dites-moi s’il est vrai que Sa Majesté l’impératrice mère ait désiré la nomination du baron Founcke au poste de premier secrétaire à Vienne? Le baron me paraît si nul! Le prince Basile convoitait pour son fils ce même poste, qu’on tâchait de faire obtenir au baron Founcke par la protection de l’impératrice Marie Féodorovna. Anna Pavlovna couvrit presque entièrement ses yeux en abaissant ses paupières; cela voulait dire que ni elle ni personne ne savait ce qui pouvait convenir ou déplaire à l’impératrice.
«Le baron Founcke a été recommandé à l’impératrice mère par la sœur de Sa Majesté,» dit-elle d’un ton triste et sec.
En prononçant ces paroles, Anna Pavlovna donna à sa figure l’expression d’un profond et sincère dévouement avec une teinte de mélancolie; elle prenait cette expression chaque fois qu’elle prononçait le nom de son auguste protectrice, et son regard se voila de nouveau lorsqu’elle ajouta que Sa Majesté témoignait beaucoup d’estime au baron Founcke.
Le prince se taisait, avec un air de profonde indifférence, et pourtant Anna Pavlovna, avec son tact et sa finesse de femme, et de femme de cour, venait de lui allonger un petit coup de griffe, pour s’être permis un jugement téméraire sur une personne recommandée aux bontés de l’impératrice; mais elle s’empressa aussitôt de le consoler:
«Parlons un peu des vôtres! Savez-vous que votre fille fait les délices de la société depuis son apparition dans le monde? On la trouve belle comme le jour!»
Le prince fit un salut qui exprimait son respect et sa reconnaissance.
«Que de fois n’ai-je pas été frappée de l’injuste répartition du bonheur dans cette vie, continua Anna Pavlovna, après un instant de silence. Elle se rapprocha du prince avec un aimable sourire pour lui faire comprendre qu’elle abandonnait le terrain de la politique et les causeries de salon pour commencer un entretien intime: «Pourquoi, par exemple, le sort vous a-t-il accordé de charmants enfants tels que les vôtres, à l’exception pourtant d’Anatole, votre cadet, que je n’aime pas? Ajouta-t-elle avec la décision d’un jugement sans appel et en levant les sourcils. Vous êtes le dernier à les apprécier, vous ne les méritez donc pas…»
Et elle sourit de son sourire enthousiaste.
«Que voulez-vous? Dit le prince. Lavater aurait certainement découvert que je n’ai pas la bosse de la paternité.
— Trêve de plaisanteries! Il faut que je vous parle sérieusement. Je suis très mécontente de votre cadet, entre nous soit dit. On a parlé de lui chez Sa Majesté (sa figure, à ces mots, prit une expression de tristesse), et on vous a plaint.»
Le prince ne répondit rien. Elle le regarda en silence et attendit.
«Je ne sais plus que faire, reprit-il avec humeur. Comme père, j’ai fait ce que j’ai pu pour leur éducation, et tous les deux ont mal tourné. Hippolyte du moins est un imbécile paisible, tandis qu’Anatole est un imbécile turbulent; c’est la seule différence qu’il y ait entre eux!»
Il sourit cette fois plus naturellement, plus franchement, et quelque chose de grossier et de désagréable se dessina dans les replis de sa bouche ridée.
«Les hommes comme vous ne devraient pas avoir d’enfants; si vous n’étiez pas père, je n’aurais aucun reproche à vous adresser, lui dit d’un air pensif MlleSchérer.
— Je suis votre fidèle esclave, vous le savez; aussi est-ce à vous seule que je puis me confesser; mes enfants ne sont pour moi qu’un lourd fardeau et la croix de mon existence; c’est ainsi que je les accepte. Que faire?…» Et il se tut, en exprimant par un geste sa soumission à la destinée.
Anna Pavlovna parut réfléchir.
«N’avez-vous jamais songé à marier votre fils prodigue, Anatole? Les vieilles filles ont, dit-on, la manie de marier les gens; je ne crois pas avoir cette faiblesse, et pourtant j’ai une jeune fille en vue pour lui, une parente à nous, la princesse Bolkonsky, qui est très malheureuse auprès de son père.»
Le prince Basile ne dit rien, mais un léger mouvement de tête indiqua la rapidité de ses conclusions, rapidité familière à un homme du monde, et son empressement à enregistrer ces circonstances dans sa mémoire.
«Savez-vous bien que cet Anatole me coûte quarante mille roubles par an? Soupira-t-il en donnant un libre cours à ses tristes pensées. Que sera-ce dans cinq ans, s’il y va de ce train? Voilà l’avantage d’être père!… Est-elle riche, votre princesse?
— Son père est très riche et très avare! Il vit chez lui, à la campagne. C’est ce fameux prince Bolkonsky auquel on a fait quitter le service du vivant de feu l’empereur et qu’on avait surnommé «le roi de Prusse». Il est fort intelligent, mais très original et assez difficile à vivre. La pauvre enfant est malheureuse comme les pierres. Elle n’a qu’un frère, qui a épousé depuis peu Lise Heinenn et qui est aide de camp de Koutouzow. Vous le verrez tout à l’heure.
— De grâce, chère Annette, dit le prince en saisissant tout à coup la main de MlleSchérer, arrangez-moi cette affaire, et je serai à tout jamais le plus fidèle de vos esclafes, comme l’écrit mon starost4 au bas de ses rapports. Elle est de bonne famille et riche, c’est juste ce qu’il me faut.»
Et là-dessus, avec la familiarité de geste élégante et aisée qui le distinguait, il baisa la main de la demoiselle d’honneur, puis, après l’avoir serrée légèrement, il s’enfonça dans son fauteuil en regardant d’un autre côté.
«Eh bien, écoutez, dit Anna Pavlovna, j’en causerai ce soir même avec Lise Bolkonsky. Qui sait? Cela s’arrangera peut-être! Je vais faire, dans l’intérêt de votre famille, l’apprentissage de mon métier de vieille fille.