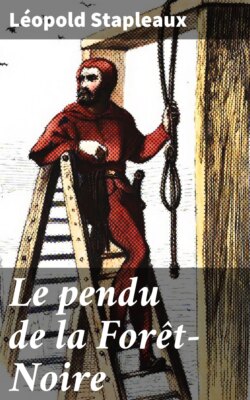Читать книгу Le pendu de la Forêt-Noire - Léopold Stapleaux - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
COCOTTES ET COCODETTES
ОглавлениеTable des matières
Bade était Bade.
Tous ceux qui l’ont visité à certaine époque comprendront ce que l’auteur veut dire.
Donc, Bade était Bade.
De plus, on avait atteint le plus beau moment de la saison.
Dès le matin un grand mouvement avait eu lieu dans les rues, relativement tranquilles d’ordinaire.
Les passants étaient nombreux, stationnant devant les principaux hôtels, ainsi qu’aux coins des carrefours.
Un soleil radieux égayait leur flânerie.
Les équipages de toutes sortes: landaus, victorias, chars-à-bancs, fiacres, coupés, chaises de poste, etc., etc., qui remplissaient les rues la justifiaient.
Tous les Badois étaient endimanchés pour la circonstance; tous les étrangers–et les hôtels regorgeaient de voyageurs,–avaient quitté leur logis pour rejoindre ou quérir un véhicule.
De vieux carrosses antédiluviens d’aspect avaient été brossés dès la veille, et leurs roues ankylosées gémissaient en tournant sur leur moyeu.
Des chevaux moribonds avaient été réconfortés, pour quelques heures, par de nombreux picotins d’avoine, afin de pouvoir fournir un dernier service avant d’être conduits chez l’équarrisseur.
Disons, sans plus tarder, le motif de tous ces préparatifs et de ce mouvement.
C’était le deuxième jour des courses d’Iffezheim, alors le plus aristocratique et le plus élégant hippodrome du monde entier.
Iffezheim, terrain neutre et d’une originalité grande par la promiscuité singulière qu’il établissait entre le vrai monde ett le demi.
Le pesage de Longchamps nous en a parfois offert autant à certaines époques, où les mesures restrictives qui le régissent aujourd’hui n’avaient pas encore été prises; mais Longchamps était trop près du faubourg Saint-Germain et du quartier Bréda pour que le rapprochement que nous signalons y ait jamais existé aussi complet qu’à Iffezheim, situé entre Oss et Bade, et offrant aux jockeys et aux sportmen un terrain des plus favorables aux grandes luttes hippiques.
Iffezheim était le rendez-vous des cocottes les plus célèbres et des cocodettes les plus élégantes et les plus réputées.
Nous ne referons pas ici l’historique des mœurs que d’aucuns ont dénommées: la corruption impériale, mais nous tracerons le plus rapidement possible certains, courants dont notre génération a subi les effets indéniables, sans se rendre bien compte peut-être de leurs véritables causes.
Après le coup d’État, au bien-être très suffisant qui s’était généralement répandu pendant les dernières années du règne de Louis-Philippe, succéda une période de prospérité fiévreuse, qui jeta dans la foule, heureux et satisfaits, un tas de gens qui, la veille, étaient plus que besogneux.
Il ressortit de cet état de choses une ardeur de satisfaction sans bornes, un culte du plaisir effréné, une envie folle de tâter de toutesles jouissanceshumaines, une inextinguible soif d’ivresses.
Le superflu devint le nécessaire, et un monde nouveau se fit place dans l’ancien.
La concurrence s’établit entre le vrai monde et le demi.
On vit trôner ce dernier aux meilleures places de nos théâtres et dans les plus élégantes voitures du Bois.
Les plus luxueuses et les plus excentriques drôlesses devinrent célèbres.
Quelques-unes cumulèrent les fonctions de fille de plaisir avec celles de mauvaise actrice, et l’on applaudit l’une parce qu’on avait aimé l’autre, ou on l’aima d’abord pour aller l’applaudir après, débitant des chansons ineptes grossièrement exprimées, faussement chantées qu’on s’empressa d’apprendre par cœur.
La Dame aux camélias–qu’avait précédée la Vie de Bohème–marqua le commencement du règne des filles.
Elles s’appelaient à cette époque: les lorettes.
La littérature consacra leur puissance.
Toto et Tata triomphèrent.
L’éclat du succès immense du beau drame de Dumas fils eut pour résultat que toute fille de portier rêva de devenir une Marguerite Gauthier et qu’il n’y eut pas un jeune homme de vingt ans qui ne caressât, comme la plus douce chimère, d’être Armand Duval un jour ou l’autre.
Jules Janin écrivit même dans je ne sais plus quelle préface:
«–Que faisait la France en18552? dira-t-on.
«–Elle pleurait sur les malheurs de la Dame aux camélias!»
Le drame de Dumas fils était fort bien fait; en outre sa forme était des plus attrayantes; il initiait aux mystères de l’existence des filles entretenues, c’est vrai; mais avec un tact si parfait que les plus choquants détails, sauvés par un esprit charmant et une incomparable légèreté de touche, furent admis, si révoltants qu’ils fussent, comme les choses les plus naturelles; en outre, il montrait un père venant supplier une fille de lui rendre son fils:
La famille luttant contre le concubinage!
Celui-ci reconnu, idéalisé, ayant pour loi suprême l’amour et, par conséquent, offrant à toute la jeunesse un irrésistible attrait.
Puis, pouvait-on en vouloir longtemps à cette pauvre Marguerite, ange déchu qui mourrait à la chute des feuilles comme la jeune malade de Mille-voye?
C’était impossible.
Les Marguerite Gauthier devinrent à la mode.
Toutes voulurent avoir un duc qui les couvrît d’or, un comte qui les menât souper et un Armand qui s’enfuit vivre avec elles à la campagne.
Si la famille d’Armand s’en mêlait un jour, eh bien! Marguerite discuterait avec le père Duval et traiterait la question de puissance à puissance.
Et si cet excellent père Duval ne pouvait donner à la rupture demandée d’aussi mauvaises raisons que celles qu’il invoque dans la comédie, on l’enverrait à la balançoire.
En attendant, on buvait du vinaigre pour maigrir et avoir le teint de l’emploi.
On apprenait à tousser angéliquement, afin de fendre le cœur des fils de famille.
Une bronchite était un vrai trésor.
Pendant plusieurs années, celles qui eurent leur petite bronchite purent étaler un luxe princier.
Tandis que se formait le demi-monde, qui devenait une classe dans l’État, les spéculations heureuses remplissaient les poches des besogneux de la veille.
L’argent s’acquérait si facilement que ceux qui opéraient sa moisson quotidienne le jetèrent au vent de tous leurs caprices aussi facilement qu’ils le ramassaient dans la corbeille des agents de change ou la cohue de la coulisse.
L’établissement et la reconnaissance publique du demi-monde d’un côté, l’abondance de l’argent de l’autre, furent les causes principales de la lutte véritable qui s’établit entre les femmes honnêtes et les drôlesses.
De leur côté, les grandes dames qui, par leur position de fortune, pouvaient, beaucoup plus que les bourgeoises, prendre part à tous les plaisirs de la capitale, se trouvèrent coudoyant presque chaque jour les filles de plaisir célèbres.
Celles-ci, afin d’entretenir l’enthousiasme de leurs galants, dépensaient des sommes folles pour leur toilette.
Ecrasées d’abord par ce luxe, que défrayait, la plupart du temps, une véritable commandite d’adorateurs, les femmes du monde augmentèrent leur budget dans des proportions considérables et finirent par adopter des mœurs si luxueuses et tellement analogues à celles que suivaient les courtisanes, qu’à moins de connaître son tout-Paris sur le bout du doigt, on pouvait prendre aisément les unes pour les autres; aussi rien n’était plus difficile que de savoir si l’on avait affaire à une drôlesse ou à une femme du monde.
Et l’on chanta dans la Vie parisienne:
–L’une est une femme à la mode
Assez commode,
Qui ne compte plus ses amants;
L’autre, ah! l’autre est une comtesse,
Et sa noblesse
Remonte à deux ou trois cents ans.
Examinez bien leur toilette,
Et puis après, voyons, parlez,
Dites quelle est la cocodette
Et quelle est la cocotte, allez!
Devenir l’amant de telle ou telle fille en renom du monde interlope, était un idéal pour certains jeunes gens égarés; triompher des exigences vénales des Aspasies idiotes, qui traînaient partout leur bêtise et leur impudence, était pour eux une suprême victoire.
Et le terrain le plus curieux pour l’observateur, fut, nous le répétons, l’enceinte du pesage des courses de Longchamps.
Là vraiment la fusion des deux castes était flagrante, ayant pour trait d’union ces petits messieurs.
On quittait Gredinette pour aller saluer la duchesse et on abandonnait celle-ci pour s’accouder devant la table où paradait Tata.
Les femmes honnêtes, les autres, celles qui étaient connues pour leurs vertus et celles qui l’étaient pour leurs vices, les cocodettes, les courtisanes du monde et celles du ruisseau, toutes les catégories enfin, venaient étaler là les inventions les plus nouvelles de Worth ou de quelque autre couturier fameux.
Disons un mot de ce personnage tout moderne, résultat d’un perfectionnement, d’un raffinement inouï, qui fit naître le couturier au détriment de la couturière.
Il semble d’abord qu’il y ait une anomalie complète dans l’adoption des hommes chargés de la toilette des femmes, et cependant, en y réfléchissant bien, on doit conclure qu’en somme, rien n’est plus logique dans l’état des choses que nous signalons.
Il est évident que, plus les mœurs sont relâchées, et plus les fonctions de la toilette, et surtout de la toilette féminine, changent de but.
Les femmes, à certains moments, ne-s’habillent plus pour se vêtir, mais pour plaire.
La coquetterie devint une véritable provocation dont la puissance résume tout le bon goût des accoutrements.
Données par les courtisanes, qui mettaient un art véritable à faire ressortir tous leurs avantages, les modes ne devaien plus être des combinaisons flatteuses et savante résultant des qualités spéciales du physique, des grâces et des charmes de celles qui les portaient, mais de véritables plans de campagne, ne reculant devant rien pour s’assurer une conquête, ayant la couturière pour chef de corps et l’émailleuse pour avant-garde.
Or, à cè point de vue, qui pouvait mieux combiner les effets à réaliser comme les moyens de les atteindre, si ce n’était une classe d’individus pris dans le sexe même qu’on voulait séduire, épater, enivrerr?
De là le couturier.
Ah! disons-le, c’est un grand personnage et son règne n’est pas près de finir.
Il peut tout, ce potentat des destinées de nos élé-, gantes.
Il pouvait tout, surtout, car les abus que nous signalons se sont un peu calmés, heureusement pour tout le monde.
Mais il fut un temps où l’imagination du couturier se montra d’une fécondité vraiment bien étonnante.
Pour certains bals masqués officiels, il trouvait des choses absolument insensées dont le décolleté téméraire faisait la quaiité principale.
On y voyait des cocodettes déguisées en neige, en rayon d’espoir, en rayon d’amour; le mot n’y faisait rien; le prix du costume et son écourté, toutt!
Et la chronique galante dans ses racontars du high-life s’extasiait devant les splendeurs des bras de Mme la comtesse, la finesse des attaches de Mme la marquise, la gorge d’albâtre de la petite baronne et vantait les faux mollets de Mme la duchesse, qui, effrontément, s’était laissé fagoter en chaste Diane.
Mais nous voilà bien loin de Bade, et il est plus que temps d’arrêter ce tableau des choses d’hier dont l’exposé, quoique sommaire, nous a entrainés beaucoup plus que nous ne lé pensions.
Heureusement que des toilettes dont nous venons de parler à l’hippodrome de Lonchamps il n’y a qu’un pas, et que de ce dernier à la plaine d’Iffezheim il n’y a qu’une nuit en chemin de fer et deux heures en voiture.
Nous ne décrirons ni le voyage de Bade à Iffezheim qu’avaient accompli, chacun d’après l’allure que lui permettaient son poids et ses chevaux, les nombreux véhicules dont s’étaient servis les Badois et les étrangers.
Nous ne parlerons ni des premières courses, ni de leurs vainqueurs, mais nous signalerons la présence à Iffezheim de plusieurs personnages, dont le lecteur ne doit pas avoir perdu le souvenir.
Au milieu de parieurs groupés autour de la tribune du milieu, se trouvait le duc d’Ambre.
Très entouré, très fêté, le duc, dans une toilette de circonstance, le carnet dans la main gauche, le porte-crayon d’or dans la droite, tenait tête à tout le monde, notant les engagements acceptés.
–Je donne Champion à quatre!
–Je le prends à cinq!
–Cent louis contre Champion à cinq!
–Tenus.
–Qui veut Trilby à égalité?
–A deux! Mademoiselle de Longchamps.
–Une poule, messieurs?
–Je donne Monseigneur!
Tels étaient les cris qui dominaient le brouhaha général, partant du groupe des parieurs qui occupait les abords de la tribune du milieu.
A l’ombre de celle située du côté opposé à l’entrée de l’hippodrome, s’étaient installées les pécheresses.
Au premier rang d’entre elles se faisait remarquer Madeleine de Berny, ou pour lui donner son nom de guerre, la Cagnotte, la maîtresse du duc d’Ambre, le septuagénaire le plus à la mode du continent.
Madeleine, malgré les huit lustres qu’accusait exactement son visage, possédait une taille élégante, souple, pleine de promesses.
Sa physionomie mélancolique avait grand air. C’était une de ces figures pâles et régulièrement graves qui font rêver, et son regard, tantôt voilé, tantôt ardent, filtrait, partant de deux grandes prunelles sombres, au travers de ses longs cils, ce qui ajoutait encore aux attraits de son visage qu’entourait une chevelure opulente qui avait emprunté ses tons vermeils à cette teinture dont font usage les dames du Lac, que l’on connait généralement sous le nom d’eau d’or.
Madeleine était une déclassée; elle avait été femme du monde.
L’histoire du passé de la Cagnotte étant le prologue indispensable des événements qui vont suivre, nous sommes forcés de la reproduire ici en renvoyant au chapitre v de ce volume intitulé: Sur le Turf, ceux qui la connaissent déjà.