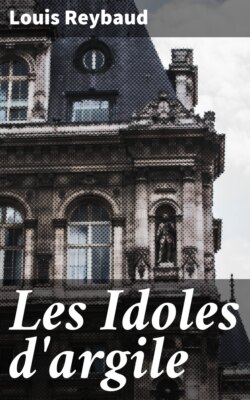Читать книгу Les Idoles d'argile - Louis Reybaud - Страница 4
II Un intérieur.
ОглавлениеLes portes de l'hôtel s'ouvrirent devant un cabriolet d'une coupe élégante et attelé d'un fort bel alezan. Un homme en descendit, gravit rapidement le perron, traversa le vestibule avec l'aplomb d'un habitué, et précédant les valets, alla droit vers un petit salon d'hiver où se tenait la famille. Trois personnes s'y trouvaient réunies: une jeune personne, assise devant un piano et tirant du clavier des gammes brillantes; un vieillard enveloppé d'une robe de chambre et à demi englouti dans un fauteuil; enfin, une femme belle encore quoiqu'elle n'eût plus l'éclat de la jeunesse. Depuis que le roulement du cabriolet avait dénoncé l'approche d'une visite, cette femme contenait mal son émotion, tandis que le vieillard élevait vers elle, à la dérobée, un regard pénétrant que voilaient d'épais sourcils. L'apparition du nouveau, venu fit seule une diversion à cette scène muette:
«M. Jules Granpré, dit un valet en annonçant.
--Ah! c'est M. Granpré, s'empressa de dire celle qui semblait être la dame du logis. Asseyez-vous, monsieur; vous prendrez, le thé avec nous, n'est-ce pas?»
Le visiteur salua tout son monde avec une aisance parfaite et ajouta:
«Madame la baronne m'excusera si je me présente si tard chez elle: je n'ai pas voulu laisser s'écouler la journée sans venir chercher moi-même des nouvelles de la santé du général.»
Au lieu de se montrer sensible à cette attention, le vieillard se retourna du côté de la cheminée, où brillait un feu clair et vif; il allongea la main pour se saisir des pincettes; puis comme son bras engourdi semblait se refuser à ce service, il retomba, dans son fauteuil et s'affaissa sur lui-même avec un geste de tristesse et de découragement. Ce mouvement n'échappa ni au nouveau venu ni à la maîtresse de la maison: ils échangèrent un regard rapide, après quoi, s'adressant à la jeune personne, qui avait quitté son piano, cette dernière ajouta:
«Petite, veux-tu donner des ordres pour qu'on nous serve le thé? On n'oubliera pas l'infusion pour ton père; veilles-y, mon enfant.»
La jeune fille sortit, et le vieillard parut désormais étranger à ce qui se passait autour de lui. Cependant l'entretien ne s'animait guère entre les deux interlocuteurs; rien d'intime, rien qui sortît de la sphère des mille propos que l'on échange dans le monde. Aussi, au lieu de s'y arrêter; vaut-il mieux jeter un coup d'œil sur les personnages qui vont figurer dans ce récit, et en fixer la position au moment où il commence.
Ce vieillard, alors plongé dans un assoupissement presque léthargique, avait été l'un des plus brillants, l'un des plus intrépides officiers des armées de l'empire. Napoléon l'avait distingué en le voyant à l'œuvre, et par un avancement rapide lui avait prouvé le cas qu'il faisait de lui. Il était fils de cultivateurs et se nommait Dalincour. L'appel aux armes qui retentit en 1792 vint, le surprendre dans ses montagnes et pénétrer son cœur d'un sentiment nouveau. Dalincour avait alors dix-huit ans, une santé de fer, un courage d'instinct; il n'hésita pas, fit un paquet de ses hardes, le mit au bout de son bâton de pâtre, embrassa sa vieille mère, et alla s'enrôler dans l'armée de Dumouriez. Il était, quelques semaines après, aux défilés de l'Argonne, où il reçut, avec le baptême du feu, une blessure qui le retînt un mois aux ambulances. Depuis ce temps jusqu'en 1813, Dalincour ne connut pas le repos; il passa par tous les grades avant d'arriver à celui de général, et fit toutes les campagnes de la république, du consulat et de l'empire. Lorsque Napoléon, par un de ces vertiges que causent les fumées du pouvoir, voulut reconstituer autour de lui une noblesse, Dalincour ne fut pas oublié et obtint un titre en rapport avec son grade; il devint baron, ce qui ne l'empêcha pas de rester, bon soldat. Il aurait sans doute poussé le dévouement jusqu'au bout et assisté, le sabre au poing, à la double agonie de l'empire, si, aux affaires de Leipzig, une balle partie des rangs de nos alliés les Saxons, ne l'eût mis hors de combat et laissé pendant près de dix-huit mois entre la vie et la mort. Tombé au pouvoir de l'ennemi et recueilli dans une maison allemande, il ne fut sauvé que par miracle et à force de soins.
Quand il revint en France, les Bourbons venaient d'être, pour la seconde fois, réintégrés sur le trône. On manquait d'officiers supérieurs; les événements en avaient compromis un si grand nombre, qu'on ne savait où en recruter. Dalincour devait à sa blessure de n'avoir pris aucune part aux derniers conflits; le nouveau ministre de la guerre jeta les yeux sur lui; on lui rendit son grade, en le nommant pair de France. Peut-être, le soldat de Napoléon aurait-il refusé cet honneur si une affection secrète n'eût alors dominé sa pensée. Ses hôtes de Leipzig avaient une fille, une adorable enfant, qui avait eu pour le blessé les attentions d'une sœur. Dalincour lui devait la vie, il le sentait: c'était une dette de cœur que couronnait un sentiment plus tendre. Il était jeune encore, beau, bien fait, et sa figure expressive semblait s'être embellie d'une balafre qui la décorait. Jamais dans le cours de ses campagnes, il n'avait songé au mariage; la carrière nomade lui semblait incompatible avec les douceurs de la vie domestique. Mais alors la paix était venue, et avec elle le repos du foyer. Plus rassuré sur l'avenir, il pouvait contracter cette union rêvée: cette considération fut décisive, il accepta tout du gouvernement nouveau. Le mariage eut lieu. Hélas! les joies en furent courtes: quatre ans après, la baronne Dalincour expirait en donnant le jour à une fille.
Longtemps le général fut inconsolable; les caresses mêmes de son enfant ne cicatrisèrent pas la plaie de son cœur. Le temps seul, avec son action lente et sourde, parvint à adoucir ce sombre regret. Emma--ainsi se nommait sa fille--grandissait, et par le son de la voix, la grâce et l'harmonie des traits, rappelait sa mère et des jours de bonheur trop vite envolés. Douze ans se passèrent ainsi, pendant lesquels le général parut absorbé dans l'affection qu'il portait à sa fille: ce sentiment semblait lui suffire. L'âge, d'ailleurs, arrivait; il touchait à la soixantaine. Ce n'est pas que l'on pût remarquer aucun affaiblissement dans ses facultés, aucun déchet dans cette vigueur qui l'avait sauvé de tant d'épreuves. C'était, à cette époque de sa vie, un fort beau vieillard, d'un air à la fois mâle et doux, ayant l'œil vif, le jarret alerte, et cachant mal sous ses cheveux blancs les goûts aventureux de la jeunesse. Ce fut là ce qui devait le perdre et empoisonner ses derniers jours. Grâce à quelques spéculations, conduites à coup sûr et à l'ombre de son manteau de pair Dalincour était devenu fort riche; on parlait de sa fortune comme de l'une des plus belles et des plus rapides qui se fussent faites depuis la restauration. A ces bruits, quelques cupidités s'éveillèrent, et il se trama autour de lui un complot dont les mailles l'enlacèrent peu à peu.
Un jour d'automne, dans l'une des allées de son parc, il rencontra une personne assez jeune encore et d'une grande beauté; elle était seule, et comme si elle eût rougi, d'être surprise, elle disparut à travers les taillis comme une biche effarouchée. Le général voulut la suivre; ses jambes le trahirent en chemin, il la perdit de vue: Cette aventure le préoccupa; il ne voulut pas en avoir le démenti, alla aux informations, et apprit que son Atalante habitait un château voisin et appartenait à la famille des Valigny, bonne noblesse de province. On devine ce qui s'ensuivit; la curiosité, puis un goût assez vif s'en mêlèrent. Du côté des Valigny, on éleva des obstacles qui ne faisaient qu'irriter les désirs du vieillard. Chaque piège était si bien tendu, si adroitement calculé, que le baron n'en évita aucun, et après six mois de négociations, vingt fois rompues, vingt fois reprises, mademoiselle Éléonore de Valigny devint baronne de Dalincour, deuxième du nom.
Éléonore était d'une beauté remarquable, mais de cette beauté sévère, presque impérieuse, qui ne parle qu'aux yeux et laisse le cœur froid. En acceptant la main d'un vieillard, elle avait fait un calcul, rien de plus. Sans fortune, elle s'était vue dédaignée dans la première fleur de la jeunesse et quand ses charmes brillaient de tout leur éclat; son cœur était sorti ulcéré de cette épreuve, et il en était résulté chez elle une haine sourde et profonde contre les hommes.
Vingt-cinq ans sonnèrent, et le désespoir acheva ce que le dépit avait commencé. Ne pouvant plus prétendre au bonheur, elle chercha autour d'elle une victime: le baron obtint la préférence. Cette grande fortune allait, entre ses mains, devenir un instrument, un moyen: maltraitée du côté du cœur, elle pourrait du moins satisfaire sa vanité, et à son tour écraser de ses dédains ces hommes qui l'avaient méconnue.
À peine arrivée à Paris, la nouvelle baronne de Dalincour mit ses projets à exécution, et réalisa ses rêves avec une persévérance infatigable. Le général ne fut pas longtemps à s'apercevoir qu'il avait pris un maître; n'essaya de lutter, mais ce fut en vain. Il trouva chez Éléonore de telles ressources d'imagination, un si complet arsenal de ruses, tant de fermeté unie à tant de souplesse, qu'il usa ses forces dans cette lutte et fut obligé de céder. Peu de mois après son mariage, M. Jules Granpré devint l'ami de la maison, et le baron, depuis ce temps, s'était vu contraint de subir cette intimité, qui inondait son cœur d'amertume et se rage.
M. Jules Granpré n'était pas ce que l'on, peut appeler un jeune homme; il avait alors quarante ans, comme Éléonore en avait trente; mais, en garçon qui voit le monde et sait le prix des avantages extérieurs, il avait su conserver presque tous les attributs de la jeunesse: de beaux cheveux, de belles dents, une taille svelte, un teint frais et coloré. Sans être remarquable, sa physionomie; avait quelque chose de fin et d'ironique, et ses traits, quoique irréguliers, ne manquaient pas de délicatesse. La carrière était, du reste, assortie à l'individu: Jules Granpré tenait à la finance et surtout au palais de la Bourse. Ses débuts n'avaient pas été complètement heureux.» peine émancipé, il s'était jeté, à l'étourdie; dans le jeu des effets publics et y avait dévoré son petit patrimoine.
Depuis lors, il poursuivait sa revanche, et ses premiers efforts n'avaient abouti qu'à une promenade assez précipitée en Belgique. L'affaire s'était arrangée pourtant, non sans quelque dommage pour l'honneur du fugitif. Enfin, grâce à la baronne, il avait pu sortir de la position secondaire que, qu'alors, il avait occupée, abandonner la coulisse, où végètent les joueurs obscurs, et devenir l'un des croupiers en titre de ce tapis vert que l'on nomme la Bourse. Il venait d'acheter une part dans un office, et était ce que l'on nomme en termes techniques un quart d'agent de change. Cela pouvait passer pour une position sociale.
Ainsi Éléonore avait pris sa revanche, et tous ses plans haineux se trouvaient réalisés. Peut-être le succès l'avait-il mieux servie qu'elle n'eût osé l'espérer. Sous le coup d'une lutte constante, la santé du baron s'était profondément altérée. La sourde amertume qui le dévorait usa chez lui les ressorts de la vie. Il voyait sa fille, son Emma, à la merci d'une marâtre, d'une femme sans cœur comme sans pudeur; il eut peur de ne pas vivre assez longtemps pour pouvoir la défendre, et de l'abandonner comme une proie à cette dangereuse tutrice. Ces sentiments qu'il comprimait, cette crainte qui l'obsédait, déterminèrent une crise: le baron fut frappé d'apoplexie. On le secourut à temps; il en réchappa. Mais cette secousse avait altéré les sources de la vie et de l'intelligence: c'était désormais un' enfant, sans puissance pour le bien; une partie du corps restait paralysée, le cerveau n'y était plus, et la langue le servait mal. Deux sentiments seuls avaient survécu à ce grand naufrage: la haine de sa femme et de son complice, l'amour de son enfant. Au moment où il semblait complètement éteint, plus d'une fois l'œil du vieillard s'anima pour lancer des éclairs de colère ou exprimer la tendresse la plus affectueuse.
Tels étaient les personnages que réunissait le salon du faubourg du Roule. On servit le thé, et Emma apporta elle-même la tasse où son père devait boire. En la voyant à ses côtés, le vieillard releva la tête avec une émotion, visible et lui baisa la main avec une joie d'enfant:
«Buvez, papa, dit la jeune fille, c'est moi qui l'ai préparé.
--Oui, mon enfant, oui, répliqua le vieillard en la dévorant du regard, oui, tu es un ange.»
Pendant ce temps, Granpré avait pris à part la baronne, et lui disait, de manière à n'être entendu que d'elle seule:
«A demain, entre une heure et deux; j'ai des choses très-importantes à vous dire.»
Il était tard, on se sépara: les portes de l'hôtel se fermèrent; et une demi-heure après, César Falempin, affublé d'un bonnet qui n'était pas celui d'un grenadier de la garde, allait s'introduire dans la couche où reposait déjà sa chaste moitié, quand un bruit sec frappé au carreau de sa vitre attira son attention.
«Qu'est-ce donc? dit-il; nous sommes au soir des surprises. Est-ce qu'il y aurait des voleurs dans la cour? Ils s'adressent bien.»
Il ouvrit la porte, et y trouva son pauvre maître qui s'était traîné jusque-là en s'aidant de deux cannes.
«Vous ici, mon général? mais vous avez donc la fièvre chaude?
--Chut! César! chut! répliqua le vieillard; on nous entendrait! Viens me trouver demain à sept heures; n'y manque pas.
--Oui, mon général, oui, j'irai.
--N'y manque pas, César, ajouta le baron en articulant péniblement ces paroles. C'est très-essentiel.»
Ses forces le trahissaient. Falempin le prit dans ses bras et le porta jusque dans sa chambre. Tout le monde dormait dans la maison; personne ne s'était aperçu de la sortie du pauvre infirme.