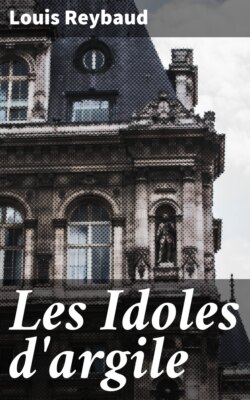Читать книгу Les Idoles d'argile - Louis Reybaud - Страница 7
V Emma et Paul
ОглавлениеDans cette atmosphère d'intrigue vivait un ange de beauté et de grâce: c'était Emma. Sa double origine se retrouvait en elle: Allemande par le cœur, Française par l'esprit, elle offrait la réunion de ce qu'il y a de plus délicat et de plus vif chez les femmes, la candeur près de la gaieté, et une certaine pétulance tempérée par des accès de mélancolie. Ses traits étaient aussi purs que son âme. De beaux cheveux cendrés entouraient un front d'une blancheur lumineuse; ses veux bleus avaient une transparence mal voilée par de longs cils noirs, et cette coupe exquise où se reconnaissent les vierges d'Albert Durer; l'incarnat des lèvres faisait mieux ressortir l'émail des dents, la souplesse des mouvements ajoutait un charme de plus à l'harmonie des proportions.
Emma n'habitait Paris que depuis quelques années; c'était une fille élevée aux champs, une enfant de la nature. Née dans le château de Champfleury, sur les bords enchantés de la Meuse, elle y avait grandi au milieu d'un paysage souriant comme elle, avec l'herbe des prés pour tapis, et les Vosges pour horizon. C'est à Champfleury que sa mère avait vécu et qu'elle était morte; son dernier vœu fut de laisser son enfant aussi longtemps que possible près de son tombeau. Retenu à Paris par ses devoirs de pair, le général n'avait pu surveiller lui-même cette première éducation; heureusement la mourante y avait pourvu. Un digne Allemand, nommé Muller, ami de sa famille, se trouvait à Champfleury au moment où elle expira. Elle lui fit promettre de rester auprès de sa fille et de lui servir à la fois de guide et de tuteur. Le baron respecta ce désir; Muller se fit un devoir d'y accéder, et dès ce moment il se fixa à Champfleury.
Le brave homme était professeur de musique, ce qui n'aurait pas suffi si, en sa qualité d'élève de l'université de Halle, il n'eût possédé en outre des connaissances fort étendues. Les sciences naturelles, les études historiques lui étaient familières; au savoir allemand il unissait une simplicité, une clarté qui rendaient tout accessible aux plus faibles intelligences. Il n'avait emporté de son pays que la bonhomie et l'érudition dégagée de ses nuages: âme droite, d'ailleurs, esprit vif, pénétrant, plein de finesse, tel était Muller.
Avec cette enfant, il eut toute la candeur, toute la naïveté d'un enfant. Loin d'envisager sa tâche comme un précepteur ordinaire qui fait retomber sur son élève le joug dont il supporte impatiemment le poids et commande avec aigreur parce qu'il sert avec répugnance, Muller s'identifia avec la charmante créature dont il avait à diriger les mouvements; il ne fut pas ennuyeux, parce qu'il n'était pas ennuyé; il prit un goût infini à voir se développer sous sa main, s'épanouir à la vie et au monde une âme aussi parfaite dans un corps aussi beau. Jamais étude ne le captiva autant que celle-là, et ne fit naître en lui une joie plus constante et plus pure.
Muller avait un système d'éducation qui ne ressemblait en rien aux méthodes ordinaires; il aimait peu les livres et encore moins le sombre aspect d'une salle de travail. Avant tout il voulait que l'étude parût légère à l'enfant, et pour cela il écartait avec soin ce qui pouvait lui en inspirer le dégoût. Lui-même se fût senti mal à l'aise sous les habits du pédagogue; il savait à quel point la routine détruit l'initiative personnelle, et combien l'esprit est absent des choses qui ne demandent qu'une attention machinale. Il voulait donc que son enseignement fût imprévu, spontané, qu'il résultât du contact de cette intelligence enfantine avec des objets nouveaux, des impressions nouvelles. Rien ne lui parut plus propre à amener ce résultat que le spectacle de la nature et des œuvres de Dieu. Ce fut dans les champs, dans les prés, dans les bois, dans ce vaste salon d'étude ouvert à l'homme, qu'il commença l'éducation de son élève, étudiant chaque jour son terrain et ne le quittant pas sans en avoir tiré quelques éléments de ce cours, professé en présence des merveilles de la création.
Pour l'histoire naturelle, aucun théâtre ne pouvait être plus riche ni plus concluant; partout le fait venait se placer à côté de la démonstration. Lorsque Emma, en courant dans les prés ou sous les ombrages de la forêt, rapportait à son précepteur une fleur, une plante, une tige d'arbuste, à l'instant celui-ci lui expliquait ce qu'était ce végétal, lui en disait le nom, la famille, les propriétés, en ayant soin d'apporter à ces détails une justesse, un soin méthodique qui ne devaient jamais laisser naître dans l'esprit de l'enfant ni le moindre trouble ni la moindre erreur. C'était tantôt un bouton d'or, tantôt un aster aux fleurs radiées, une anémone des bois ou une perce-neige, des saxifrages ou de petites bruyères roses. D'autres fois, il passait aux arbustes, puis aux arbres, ensuite aux oiseaux qui traversaient le bois en montrant leurs ailes diaprées, aux animaux que l'on voyait dans le lointain, et de là à ceux qui peuplent d'autres climats et vivent sous un autre ciel. Après les sciences naturelles venaient l'histoire et la géographie, qui fournissaient la matière de nouveaux détails, de nouveaux entretiens. Ainsi, le maître et l'élève échangeaient constamment leurs pensées à propos de toutes choses, Muller se tenant toujours au niveau de l'enfant et ne s'élevant dans la sphère des connaissances qu'au fur et à mesure qu'elle s'élevait.
C'est sous cette influence à la fois saine et forte que grandit Emma. Les raffinements, les jalousies du monde ne souillèrent pas ses oreilles; elle ne connut ni des confidences du pensionnat, ni les pensées qui naissent des entretiens de salon, même les plus réservés et les plus contenus. Aucune des délicatesses de son âme ne fut troublée, aucun soupçon d'alliage ne se mêla aux trésors que renfermait son cœur. Muller n'était rien moins qu'un petit maître; c'était un homme d'un âge mûr, d'un extérieur assez vulgaire; mais sous cette écorce se cachaient une bonté d'ange, une philosophie rare, une grâce exquise de sentiment. Rien de plus chaste que ses idées, de plus choisi que les termes dont il les révélait. Jamais un mot brutal, jamais une expression blessante; quelquefois même un langage coloré et de douces paroles à l'adresse de son élève:
«Mon beau lis de la Meuse, disait-il, je suis content de vous aujourd'hui; voilà une sonate bien exécutée.»
Aucun nuage ne passa donc sur cette enfance fortunée: cependant un souvenir assez vif s'y rattachait; Emma avait onze ans quand un neveu du général, qui en avait dix-huit, vint passer une partie de l'automne à Champfleury. On le nommait Paul Vernon; né de parents pauvres, il devait tout à la générosité de son oncle, et attendait tout de lui. C'était un garçon bien pris, doté de la physionomie la plus heureuse, fier de ses moustaches naissantes et enchanté de faire ses premières armes contre les perdrix des Vosges. Toute la journée en plaine ou dans les forêts, il revenait le soir, hâlé par le soleil et noir de poudre. Du plus loin qu'Emma l'apercevait, elle courait vers lui avec la grâce et la légèreté d'une biche, et s'emparait de son carnier, qu'elle arrangeait gravement sur son épaule. Personne qu'elle ne le débarrassai! de ses guêtres de chasse, ne veillait à la réparation de ses vêtements, endommagés par les broussailles. Elle entendait faire à son cousin les honneurs du château, veillait à ce qu'il ne manquât de rien, et lui prodiguait les attentions les plus délicates. Plus d'une fois, à la vue de ces scènes naïves, le général et Muller échangèrent un regard d'intelligence.
A diverses reprises, Paul reparut à Champfleury. Toutes les fois que ses études lui laissaient quelques semaines de répit, on était sûr de le voir accourir. Emma s'habitua à sa présence, et y trouva du charme. Chaque année, le jeune homme prenait un air plus mâle; sa taille se développait: son œil, à la fois fier et doux, avait une expression charmante; ses traits étaient nobles et réguliers; ses cheveux noirs avaient la souplesse et les reflets de la soie: c'était, en somme, un fort beau cavalier. Emma n'y voyait qu'un aimable cousin, se prêtant à ses jeux avec la meilleure grâce du monde, et donnant en toute occasion les preuves d'un excellent caractère.
Elle avait treize ans quand ces visites cessèrent d'une manière assez brusque; le souvenir qui lui en était resté ne pouvait donc altérer en rien ni la tranquillité de son cœur ni la sérénité de ses pensées. Cependant, Champfleury lui parut moins riant dès que son cousin n'en fit plus le théâtre de ses grandes chasses.
Ce qui avait causé ce changement dans les habitudes du château, c'était le mariage du général. La nouvelle baronne voulait écarter peu à peu les intimités antérieures, s'emparer de son mari, et le soustraire à toutes les influences, de manière à régner sur lui sans obstacle comme sans partage. Paul fut sacrifié à cette pensée; on l'éloigna. Quant à Emma, quelque haine que la marâtre nourrît contre elle, il fallait se résigner à subir sa présence. Mais la baronne eut bien vite pénétré le caractère de cette enfant, et compris qu'elle ne serait jamais pour elle un embarras sérieux. Elle régla sa conduite là-dessus. Quoique réservée, elle ne cessa pas d'être un instant bienveillante. Emma s'était habituée sans peine au caractère froid, aux airs empruntés de la nouvelle baronne; elle y répondit par une déférence et une douceur qui eussent touché une âme moins endurcie.
Cependant, en éloignant son neveu, le général ne l'avait point abandonné; ses bienfaits l'accompagnaient partout. Paul était alors à Paris, où il suivait le cours de la faculté de droit, mêlant les plaisirs aux travaux et quittant plus d'une fois le Digeste pour la Grande-Chaumière. Il oubliait ainsi Champfleury et ses longues battues dans les halliers et dans les plaines. Quand le moment des examens fut arrivé, il prit ses grades, et sans beaucoup de peine passa avocat. C'était le dernier terme d'une éducation libérale; il ne restait plus qu'à entrer résolument dans la plus épineuse et la plus précaire des professions. Paul l'essaya; mais les obstacles furent plus forts que son courage. Il manqua de persévérance, d'opiniâtreté pour traverser les rudes abords du barreau; il s'abandonna au découragement dès la première heure. A la vérité, il se sentait entraîné ailleurs. Près de lui, il voyait quelques amis, quelques condisciples se jeter avec une sorte de bonheur dans la carrière des lettres: on imprimait leurs œuvres, et la publicité s'emparait de leurs noms. Ce spectacle le fascina, il se crut destiné aux gloires de l'écrivain. Hélas! une suite de mécomptes l'attendait dès le début; il comptait sur la renommée, et il ne put pas même s'élever aux honneurs de l'impression. Paul composa chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre; il aborda tous les genres avec un égal succès; mais ces travaux, qui devaient le couronner de l'auréole littéraire, le porter au Capitole de la célébrité, eurent la plus triste et la plus cruelle des chances; ils restèrent ensevelis dans son portefeuille.