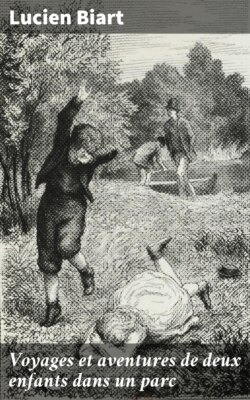Читать книгу Voyages et aventures de deux enfants dans un parc - Lucien Biart - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE III
ОглавлениеTable des matières
Les églantines et les roses.–Dans quelles occasions Mathilde est une grande personne.–Actes de bravoure de Robinson.–Effroyable combat de Paul avec un animal barbu.–Comment blanchissent les salades.–La chlorophylle.–Une expérience.
Durant au moins cinq minutes, les deux aventuriers cheminèrent d’un pas rapide et, chose des plus remarquables, sans échanger une seule parole. Soudain Mathilde se retourna et poussa un cri de surprise.
«On ne voit plus la maison, nous sommes déjà très loin! dit-elle.
–En pleine forêt, répondit Paul, qui, posant à terre la crosse de son fusil, s’appuya sur le canon de son arme, comme a dû le faire mille et une fois le grand Robinson.
–Il faut nous en retourner, dit le prudent Vendredi.
–Nous en retourner? Est-ce que tu as faim?
–Pas encore.
–Alors, pourquoi veux-tu déjà t’en retourner?
–Parce que je ne veux pas aller aujourd’hui dans les Grandes-Indes.
–N’aie pas peur; elles sont encore loin. Nous sommes toujours en Europe, puisque nous n’avons pas quitté le sentier.
–C’est vrai, dit Mathilde avec conviction. Attends-moi un peu, continua-t-elle; voilà des petites roses, et je veux en cueillir un bouquet.
–Ce que tu nommes des roses ne sont que des églantines, dit Paul avec importance.
–Des églantines!
–Oui, et l’arbuste sur lequel tu les cueilles est un églantier ou, si tu veux, un rosier sauvage.
–A quoi le devines-tu?
–Je ne le devine pas, je le sais, parce que papa me l’a dit hier; il m’a encore dit que c’est sur cet arbrisseau que l’on fait pousser les belles roses.
–Des roses qui sont des églantines... puis des églantines qui ne sont pas des roses. ça n’est pas très clair», dit Mathilde en arrangeant son bouquet.
La chose ne paraissait probablement pas très claire à M. Paul lui-même, car il réfléchit un instant.
«J’ai compris et tu vas comprendre, dit-il enfin; la chicorée sauvage est-elle de la barbe-de-capucin? Réponds.
–Non, puisque la barbe-de-capucin est de la chicorée cultivée.
–Eh bien, reprit Paul, l’églantine est une petite rose qui, pour devenir une grande rose, a besoin d’être greffée.
–Griffée! cela veut dire qu’on leur met des épines?
–J’ai dit greffée! cria Paul de toutes ses forces, sans doute pour se mieux faire comprendre.
–Tu n’as pas besoin de te mettre tout rouge pour me parler, je ne suis pas sourde; greffer, qu’est-ce que ça, greffer?
–Je ne le sais pas encore assez bien pour te l’expliquer, reprit l’élève horticulteur sur un ton moins animé; mais, en rentrant, nous irons trouver M. Antoine, et tu verras que j’ai raison. Ce qui est sûr, c’est qu’il y a plus de mille sortes de roses, et qu’elles ont toutes pour origine un églantier.
–Alors l’églantier, c’est le père Adam des roses? dit Mathilde.
–Tiens, c’est vrai. Je n’y avais pas pensé. Une chose que tu ne sais peut-être pas non plus, ajouta le jeune professeur, c’est que le fruit rouge qui pousse sur les églantiers se nomme cynorrhodon, qu’il sert à fabriquer des confitures pour les enfants, et qu’on le met dans l’eau-de-vie pour le donner à manger aux grandes personnes.»
Mathilde ayant terminé sa récolte de fleurs, Paul replaça son fusil sur son épaule et continua d’avancer. Au bout de trois minutes de marche, on s’arrêta de nouveau. Le sentier se divisait en deux branches; l’une allait à droite, l’autre à gauche, et nos voyageurs ignoraient laquelle de ces routes était la bonne pour gagner directement les Grandes-Indes.
«Allons-nous-en», dit Mathilde, toujours disposée à battre en retraite.
Robinson remua si énergiquement la tête pour dire: «non» qu’il fit tomber son bonnet.
«Attends-moi là, dit-il, je vais grimper tout en haut de ce gros arbre et tâcher de découvrir notre chemin.
–Ça, je ne veux pas! s’écria Mathilde avec vivacité.
–Tu ne veux pas? Et pourquoi?
–Parce que je resterais toute seule pendant que tu seras là-haut, et je ne veux pas rester toute seule.
–Tu resteras avec mon fusil.
–J’aurai encore plus peur; allons-nous-en.
–Tu parles toujours de t’en aller, dit Paul, tu n’es pas un bon Vendredi.
–Robinson n’a jamais laissé Vendredi en bas des arbres, répondit Mathilde; puis Vendredi était un homme.
–Tu es une femme, et c’est bien plus drôle.
–Je ne suis pas une femme, je ne suis qu’une petite fille.
–C’est cela! dit Paul d’un ton dédaigneux. A table, tu demandes un grand couteau, une grande fourchette, un verre au lieu d’une timbale, et, sous prétexte que tu es une grande personne, tu ne veux pas que l’on attache ta serviette sous ton menton. Mais à présent qu’il faut être Vendredi, tu n’es plus qu’une petite fille.»
Après ce beau discours, Robinson s’engagea sur le sentier de gauche, sans même regarder s’il était suivi.
Le craintif Vendredi, n’osant retourner seul en arrière, eut bien envie de se mettre à pleurer; craignant sans doute de ne pas attendrir Robinson qui était déjà loin, il courut le rejoindre.
Du reste, Robinson ralentissait peu à peu son pas, –peut-être n’était-il rassuré qu’à demi lui-même. On ne voyait de tous les côtés que des arbres, des arbustes, des arbrisseaux, des sous-arbrisseaux, des plantes grimpantes et des herbes. Des bruits singuliers se faisaient entendre. Par moments, on eût dit qu’on frappait sur une planche avec un marteau; l’instant d’après, résonnait le tin, tin, tin d’une clochette; puis, enfin, on entendait un sourd murmure, semblable à celui que produit l’eau lorsqu’elle tombe en cascade.
«Ce doit être la mer qui fait ce bruit-là, dit Mathilde en parlant à voix basse.
–Je ne crois pas, répondit Paul sur le même ton; cependant nous avons marché si vite que...»
Robinson n’acheva pas sa phrase; un animal, le corps couvert de longs poils, le front armé de cornes et le menton garni d’une grande barbe, venait d’apparaître sur le sentier.
«Un lion! cria Mathilde, qui saisit son frère à bras-le-corps.
–Lâche-moi! dit impérieusement l’intrépide Robinson; si tu me tiens comme cela, je ne pourrai pas nous défendre.
–Défendons-nous en nous sauvant.»
Paul reprit vite son sang-froid.
«Ne vois-tu pas que ton lion est une chèvre, dit-il, et que c’est elle qui va avoir peur de nous et se sauvera?
–Mais c’est une chèvre sauvage!
–Elle ne doit pas être tout à fait sauvage, puisqu’elle a une clochette au cou.
–Ça ne fait rien, j’aime mieux m’en aller.»
La chèvre disparut, et les craintes de Mathilde se calmèrent pour renaître bientôt; car les coups de marteau, entendus d’abord, résonnèrent avec plus de violence, et cette fois, presque au-dessus de la tête des deux enfants. Par bonheur, en levant le nez, Paul découvrit un beau pic-vert qui, cramponné au tronc d’un arbre, le frappait de son bec pour effrayer les insectes cachés sous l’écorce et les dévorer. L’oiseau grimpeur était connu de nos voyageurs; aussi passèrent-ils un quart d’heure à le regarder courir autour des grosses branches en décrivant des spirales, frapper à coups redoublés comme un menuisier qui enfonce un clou, et enlever des lambeaux d’écorce à l’aide de son bec taillé en forme de coin. Sa chasse terminée, l’oiseau s’enfuit de ce vol lourd et saccadé qui lui est particulier. Le bruit de la mer restait donc seul inexpliqué; mais, en continuant d’avancer, on arriva au pied d’un sapin. La brise, en se glissant entre les minces feuilles de l’arbre, produisait la rumeur qui avait inquiété Mathilde.
«Tu vois, dit Paul à sa sœur, si nous nous étions sauvés, nous n’aurions pas su ce qui nous avait fait peur.
–Tu as donc eu peur aussi? dit Mathilde.
–Pas tout à fait; la preuve, c’est que je me suis souvenu que papa dit qu’il faut toujours marcher droit sur ce qui effraye, parce que, vus de loin, les objets ont souvent un air terrible qui disparaît lorsqu’on les voit de près. Ainsi tu prenais une chèvre pour un lion.
–Je n’avais vu que sa crinière, dit Mathilde.
–Sa crinière! Où cela?
–Sous son menton, donc.
–On a une crinière sur le cou, dit Paul; lorsqu’elle est placée sous le menton, c’est une barbe.»
Tout en causant, les voyageurs avançaient. Ils se trouvèrent à l’improviste sur le bord d’un fossé au fond duquel coulait un filet d’eau.
«Hé! m’sieu, madame, voulez-vous me renvoyer Jeannette qui est passée dans votre champ? cria une petite paysanne de sept à huit ans, assise sur le revers du fossé.
–Qui ça, Jeannette? demandèrent à la fois Paul et Mathilde, surpris de trouver un habitant dans ce désert.
–Ma chèvre donc, qui broute là, près de vos peupliers. Chassez-la, elle aura bien vite sauté pour me rejoindre.»
PAUL SE MIT A FUIR ENTRAINANT VENDREDI.
III
Paul se dirigea vers Jeannette, et, levant les bras et poussant de grands cris, il essaya d’effrayer le ruminant. Jeannette redressa la tête, regarda le petit garçon, puis, sans tenir compte de ses cris, continua d’éplucher un sarment de vigne sauvage. Mathilde se rapprocha afin de prêter main-forte à son frère; alors Jeannette, qui avait sans doute entendu le principe posé par Paul qu’il faut marcher droit sur ce qui effraye, sauta, cabriola, se dressa sur ses pattes de derrière, et fondit tête baissée sur Vendredi, qui se mit à fuir. Robinson, intrépide et résolu, courut au secours de son fidèle associé; sans se laisser intimider, Jeannette fit volte-face et tournoya autour de Robinson. Celui-ci, battant en retraite, reçut au bas du dos un coup de tête qui le fit trébucher, envoyant son sabre à droite, son bonnet à gauche, et son fusil on ne sait où.
Pour le coup, Paul crut la chèvre enragée. Abandonnant, comme le poète Horace, ses armes sur le champ de bataille, il se mit à fuir, entraînant Vendredi qui poussait des cris de détresse. En moins de quatre minutes, on fut hors de la forêt, un peu rassuré à la vue de la maison.
«Je te l’avais bien dit que cette chèvre était sauvage! s’écria Mathilde en essuyant les deux ruisseaux de larmes qui lui inondaient les joues.
–Pourquoi l’as-tu poussée de mon côté?
–Moi, je me sauvais; c’est toi, au contraire, qui l’as poussée du mien.»
Paul ne répondit pas ; il se frottait le visage, sans songer qu’il défrisait ses moustaches et les faisait empiéter sur son nez.
«Viens! dit-il en saisissant Mathilde par la main et en se dirigeant vers le bois.
–Non, s’écria la petite fille, je n’en veux plus de tes Grandes-Indes!
–Il faut pourtant que nous allions chercher mon fusil et mon bonnet.
–Pour cette fois, vas-y tout seul,»
En ce moment, on crut entendre résonner de nouveau un bruit de clochette, et l’on reprit le chemin de la maison.
Un peu remis de leur alerte, les deux voyageurs, errant de droite à gauche, se trouvèrent près du potager; ayant aperçu Émile accroupi devant une plate-bande, ils se dirigèrent de son côté. Arrivés près de lui, ils virent qu’il relevait les feuilles des chicorées et qu’il nouait chaque plante avec un brin de paille.
«A quoi t’amuses-tu là? demanda Paul à son frère.
–Je ne m’amuse pas précisément, répondit Émile, je travaille à lier les chicorées.
–Pourquoi les lies-tu?
–Afin de les blanchir, ce qui les rendra plus tendres.
–Les blanchir! répéta Mathilde. Est-ce que tu vas les savonner?
–Non, certes; mais je veux empêcher les feuilles de voir la lumière et changer ainsi leur couleur verte en belle couleur d’or.
–Et pourquoi les feuilles changeront-elles de couleur?
–Parce que la chlorophylle, cette matière végétale qui colore les plantes en vert, ne pourra plus se développer.
–C’est la chloro... phylle qui teint les feuilles en vert?
–Oui, à la condition, ainsi que je viens de le dire, qu’elles subissent l’action de la lumière.
–Alors, si on plantait un chêne dans une cave, ses feuilles pousseraient donc blanches?
–Un chêne ou tout autre végétal.
–C’est drôle, dit Paul qui demeura un instant pensif. Veux-tu que je t’aide? demanda-t-il au bout d’un instant.
–Merci; il faudrait recommencer ton ouvrage, et ce serait du temps perdu.
–Alors, dis-moi, les chèvres sont donc des animaux féroces?
–Non pas; ce sont des herbivores, des ruminants, qui sont originaires de la Perse. C’est avec leur poil soyeux, tu dois savoir cela, que l’on fabrique les belles étoffes dites de Cachemire.
–Mais les chèvres sont méchantes? dit Mathilde.
–Les chèvres, comme presque tous les animaux, ne deviennent méchantes que si on les tourmentete; elles donnent alors des coups de tête très violents.
–Je le sais, dit Paul en se frottant le dos.
–Moi aussi, dit Mathilde.
–Vous vous êtes donc battus avec une chèvre?
–Oui, avec une chèvre sauvage.
–Seriez-vous par hasard allés jusqu’en Perse?
–Presque», dit Mathilde.
Emile se mit à rire de la réponse et continua à lier ses chicorées, tandis que Robinson et Vendredi se dirigeaient vers une haie. Là, ils se mirent à creuser un trou pour déraciner une plante qui ressemblait à un petit arbre. L’opération terminée, on se dirigea vers la maison et l’on rôda autour de la cave. A force de s’enhardir mutuellement, Robinson et Vendredi se hasardèrent à pénétrer dans le sombre réduit, et le végétal qu’ils avaient déraciné fut soigneusement planté dans un coin obscur. On voulait s’assurer si Émile avait dit vrai, et voir ce que deviendrait la chlorophylle privée des rayons du soleil.
BIEN QU’A L’ABRI, MATHILDE RECULA.
IV