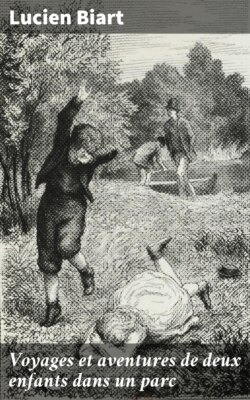Читать книгу Voyages et aventures de deux enfants dans un parc - Lucien Biart - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCHAPITRE V
Table des matières
La couleuvre de verre.–Un crapaud noir.–Rat d’eau et rat des champs. –Les vrais amphibies.–Échecs et grains de blé.–Singulière trouvaille de Mlle Hélène.–Les canards domestiques.–Du danger d’entre-bâiller une porte lorsqu’il y a quelqu’un derrière.
Par bonheur, Mlle Hélène n’avait pas été mordue, et ce fut d’elle-même qu’elle promit à sa grande sœur de ne plus fouiller à l’avenir dans les poches qui ne lui appartenaient pas. La frayeur qu’elle avait eue devait, en effet, la rendre plus prudente ; mais elle resta un peu fâchée–et non sans raison–contre son frère Paul, qui cachait de si vilaines choses dans son sac. Si la peur exagérée des animaux, même des animaux rampants, est absurde, il n’en est pas moins vrai qu’une trop grande confiance peut aussi avoir ses dangers.
Le boa, examiné par Lucien, se trouva être un orvet, ou serpent de verre. Ce nom de serpent de verre attira les enfants.
«Il n’est pas du tout en verre, puisqu’on ne voit pas clair à travers son ventre, dit Mlle Hélène, les yeux encore pleins de larmes; c’est un vrai serpent, et Paul, a fait exprès de le mettre dans son sac pour qu’il me morde.
–Je ne pouvais pas savoir que tu fouillerais dans mes affaires, dit l’accusé.
–Si, tu le savais...
–Elle a raison, reprit Mathilde; tu sais bien qu’elle veut tout voir et qu’elle grimpe sur les chaises ou sur les tables pour prendre ce qui est placé trop haut.»
Paul avait bonne envie de répliquer, mais le serpent de verre l’intriguait, et il demanda d’où venait ce singulier nom donné au reptile.
«De la fragilité de son corps, répondit Lucien, car, d’après les naturalistes, le moindre choc suffit pour le briser.
–Paul croyait avoir trouvé un boa, dit Mathilde.
–C’est trop d’imagination; il n’y a de boas qu’en Asie, en Afrique ou en Amérique. Au résumé, cette petite couleuvre est très jolie avec sa robe argentée.
–Mord-elle? demanda Mathilde.
–Non, elle est inoffensive et vit d’insectes. Néanmoins, vous me ferez le plaisir de laisser en paix les serpents que vous rencontrerez; vous pourriez mettre la main sur une vipère, et les vipères, dont les crochets distillent du venin, font des morsures dangereuses, bien que rarement mortelles.
–Et comment les reconnaît-on, les vipères? demanda Paul.
–A leur tête qui a la forme d’un fer de lance et qui est plus large que leur corps; mais, encore une fois, laissez en paix les reptiles que vous trouvez sur votre route ; ce sont de mauvaises connaissances qu’il faut fuir.
–Et ma grenouille noire, la trouves-tu jolie? demanda Mathilde à son frère aîné.
–Ta grenouille noire est simplement un crapaud.
–Un crapaud! s’écrièrent les enfants en reculant d’un pas.
–Oui, un crapaud commun, parent de la grenouille et amphibie comme elle dans sa jeunesse. De ces vilaines pustules qui lui couvrent le dos, suinte une humeur visqueuse qui, appliquée sur la peau, y fait venir des cloches. Il ne faut pas reculer devant l’expression de la vérité. Le crapaud, comme tous les reptiles, doit être laissé dans son coin ; on ne peut rien gagner à le fréquenter.
–Comme il doit être malheureux d’être si laid! dit Mathilde avec commisération.
–Il n’est pas laid du tout; il est un crapaud, répliqua judicieusement Mlle Hélène. Est-ce qu’il mord, Lucien? demanda-t-elle ensuite.
–Non; il n’a pas de dents, et c’est un des points qui le distinguent de la grenouille.
–Comment fait-il pour manger du sucre, s’il n’a pas de dents?»
On se mit à rire, et Mlle Hélène fut embrassée à la ronde pour cette belle question.
«Nous avons vu tout à l’heure une chose très drôle, dit Mathilde à Lucien, nous avons vu une bête qui se promenait au fond de l’eau.
–Un poisson ou une écrevisse sans doute.
–Non, une bête avec quatre pattes et une queue grande comme celle des rats.
–Alors vous avez vu un rat d’eau, et si vous aviez bien regardé, vous auriez remarqué que sa queue est velue au lieu d’être lisse comme celle des rats ordinaires. Le rat d’eau est le frère du campagnol, ce rat des champs qui désespère les cultivateurs par le nombre d’épis qu’il coupe et dévore.
–Pourquoi le rat d’eau se promène-t-il au fond des rivières? Est-ce pour manger des poissons? demanda Paul.
–On le croit chasseur d’écrevisses, répondit Lucien; en réalité, il paraît se nourrir exclusivement de plantes aquatiques.
–Comment fait-il pour respirer lorsqu’il est au fond de l’eau?
–Il ne respire pas. De même que la loutre, le phoque, le morse, le crocodile, l’hippopotame, que l’on nomme à tort des amphibies, il retient sa respiration pendant un temps plus ou moins long; mais, sous peine de se noyer, il lui faut remonter fréquemment à la surface de l’eau pour respirer. Les véritables amphibies sont les animaux qui ont à la fois des poumons, organes respiratoires des mammifères, et des branchies, organes respiratoires des poissons. L’axolotl, cet étrange poisson mexicain pourvu de pattes, que tu as vu au Jardin des Plantes, est un véritable amphibie.»
Lucien s’étant chargé de remettre le serpent de verre et le crapaud en liberté, Paul et Mathilde s’établirent dans un coin du salon et se perdirent dans les combinaisons d’une partie d’échecs qui demeura indécise.
«Qui donc a inventé ce jeu-là? demanda Paul à Lucien, tout en rangeant les rois, les reines et les pions dans leur boîte.
–Un Indien, selon la tradition la plus accréditée. On rapporte même une curieuse anecdote à propos de cette invention.
–Raconte-nous-la, dis?
–Volontiers. On prétend que l’Indien inventeur du jeu d’échecs fit hommage de son invention au roi de Perse. Ce souverain, dans son admiration pour les ingénieuses combinaisons du jeu, voulut que l’inventeur choisît lui-même sa récompense.
–Après?
–L’Indien demanda que l’on mît un grain de blé sur la première case de l’échiquier, deux sur la seconde, quatre sur la troisième, huit sur la quatrième, et que le nombre des grains fût ainsi doublé jusqu’à la soixante-quatrième case, déclarant ne vouloir d’autre récompense que le nombre des grains de blé résultant de cette opération.
–Il n’était pas exigeant, cet inventeur-là, dit Paul.
–Le roi de Perse pensa comme toi, aussi accorda-t-il à l’Indien la récompense demandée. Mais, le compte fait, il se trouva que la Perse entière ne possédait pas assez de blé pour payer l’inventeur.
–C’est impossible! s’écria Paul.
–Bien qu’il soit un peu tard, reprit Lucien, es-tu encore assez éveillé pour faire quelques multiplications?
–Oui», dit Paul, qui saisit le crayon et la feuille de papier que lui tendait son frère.
Et, se mettant à l’œuvre, le petit garçon trouva à la dixième case cinq cent douze grains de blé.
«Continue.
–542,288, dit Paul arrivé à la vingtième case.
–Et quel nombre trouves-tu pour la quarantième?
–Il est si gros que je ne peux pas le compter; regarde.»
Le calculateur présenta à son frère la rangée de chiffres suivante:
549,755,813,888.
«Cela fait, dit Lucien, cinq cent quarante-neuf milliards, sept cent cinquante-cinq millions, huit cent treize mille, huit cent quatre-vingt-huit grains de blé. Laisse-moi achever le calcul... Tiens, il donne ce joli chiffre:
9,223,372,036,854,775,808,
dont l’énoncé écraserait ton imagination, car il s’agit d’environ neuf milliards de milliards. Or il faut130,000 grains de blé pour remplir un boisseau; il eût donc fallu trouver soixante-dix mille milliards de boisseaux de blé pour payer l’Indien, ce qui est impossible.»
Paul alla se coucher en se promettant, si jamais quelqu’un lui offrait une récompense, de mettre à profit le curieux calcul de l’inventeur du jeu d’échecs.
Le lendemain, après avoir guetté la petite Catherine sur la route et lui avoir remis les friandises gardées pour elle, Paul et Mathilde revenaient vers la maison prêts à bien s’amuser,–on a toujours l’âme satisfaite après une bonne action,–lorsqu’ils aperçurent Hélène qui sortait en courant de la basse-cour. La petite fille tenait son tablier relevé par les coins.
«Que portes-tu donc là? lui cria Mathilde.
–Une jolie chose que j’ai trouvée.
–Fais voir.
–Non, tu me la prendrais.
–Dis-nous au moins ce que tu as trouvé, si tu ne veux pas nous le montrer, dit Paul d’un ton caressant.
–Eh bien, j’ai trouvé un œuf de lapin.
–Un œuf de lapin! s’écrièrent à la fois Paul et Mathilde.
–Oui, un œuf de lapin, reprit Hélène, et je le porte à Florence pour qu’elle le fasse cuire pour mon déjeuner.
–Les lapins sont des animaux mammifères, originaires du nord de l’Afrique, et ils ne pondent pas d’œufs, dit Paul.
–Ils en pondent, puisque j’ai trouvé celui-ci dans leur cage, dit Hélène qui, écartant les coins de son tablier, montra à son frère et à sa sœur un bel œuf verdâtre taché de points jaunes.
–C’est un œuf de cane! s’écria Paul en riant.
–Tu es bête! dit sans façon Mlle Hélène. Comment veux-tu qu’une canne, qui est en bois, puisse pondre des œufs?»
Égayés par la méprise de leur petite sœur, Paul et Mathilde se mirent à rire si fort que celle-ci s’éloigna indignée.
«Elle est si petite qu’elle ne peut pas encore tout savoir, dit Mathilde d’un ton plein d’indulgence.
–Et toi, sais-tu d’où viennent les canards domestiques? demanda Paul.
–Oui, répondit Mathilde.
–Dis un peu, pour voir?
–Eh bien, les canards sont des palmipèdes, des parents des cygnes et des oies ; il y en a de beaucoup d’espèces, et ils émigrent durant l’été.
–Mais le canard domestique?
–C’est un canard apprivoisé qui a perdu l’habitude de voyager. Je sais encore, continua la petite fille, que l’on plume les canards deux fois par an pour avoir leur duvet, dont le plus fin sert à faire des édredons.
–Et comment se nomme le canard qui donne le véritable édredron? demanda encore l’examinateur.
–Eider. Il vit dans les contrées glaciales, et ce sont les Irlandais et les Norvégiens qui nous procurent ces grands oreillers que l’on met sur les lits.
–Je croyais être seul à savoir tout cela! s’écria Paul, surpris de la science de sa sœur.
–J’étais là lorsque Émile t’a raconté l’histoire.
–Tu étais loin, près de la fenêtre, en train de coudre.
–Tu crois donc que cela rend sourd, lorsque l’on coud? Dis donc, si nous allions voir dans la cabane aux lapins? Il y a peut-être encore des œufs de cane.
–A quoi cela nous servira-t-il? Il est défendu d’y toucher.
–Nous n’y toucherons pas, nous les regarderons.»
On se dirigea vers la basse-cour, et après avoir jeté quelques poignées d’herbe aux lapins, Mathilde s’approcha d’une cabane de planches d’où partaient de sourds grognements.
«C’est le porc qui demeure là, dit la petite. Est-il gros?
–Je ne sais pas, je ne l’ai pas encore vu, répondit Paul.
–Si nous ouvrions un peu la porte, nous pourrions le regarder.
–Et s’il se sauve, nous serons grondés.
–Il ne se sauverait pas si tu tenais bien la porte; et si tu étais assez fort.
–Je suis assez fort, répondit Paul.
MATHILDE EUT BEAU POUSSER DE TOUTES SES FORCES.
V
–Tu le dis, mais je ne le crois pas», répliqua Mathilde.
Il n’en fallut pas davantage pour que Paul se rapprochât de la cabane, et tout doucement enlevât la traverse qui assujettissait la porte. Celle-ci s’entre-bâilla, et Mathilde put regarder à son aise un porc énorme qui, les oreilles rabattues sur les yeux, et remuant son groin, poussa la porte et parut dans l’entre-bâillement. Paul se raidit, mais il ne tarda pas à reconnaître que le groin était très fort, car on le voyait s’avancer insensiblement. Mathilde, dont l’assistance fut requise, eut beau pousser de toutes ses forces, la porte, rejetée avec violence au dehors, renversa Paul sur Mathilde, tandis que maître Habillé de soie,–ainsi que le nommait la fille de basse-cour,–jetait un cri de triomphe et passait sur le corps des deux vaincus.