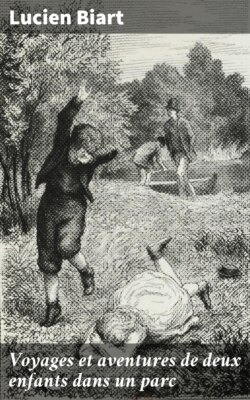Читать книгу Voyages et aventures de deux enfants dans un parc - Lucien Biart - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE IV
ОглавлениеTable des matières
Traité de paix avec Jeannette.–Les betteraves.–Les descendants de l’Auroch.–Tanneurs et corroyeurs.–Départ pour la Sibérie.–Ce que l’on peut faire pour un sou.–Rencontre d’un boa.–Un pays extraordinaire.–La curiosité punie.
Le lendemain de leur premier voyage dans la direction des Grandes-Indes, voyage si malencontreusement arrêté par l’agression de Mlle Jeannette, Paul et Mathilde, armés chacun d’une tartine beurrée, se tenaient près de la grille d’entrée du parc. Tout à coup ils aperçurent la petite paysanne qu’ils avaient entrevue la veille. Elle s’avançait sur la route en chassant devant elle cinq ou six chèvres, au nombre desquelles, reconnaissable à la clochette qui lui pendait au cou, marchait la terrible Jeannette. Bien qu’à l’abri derrière une grille, Mathilde recula de trois pas au moment où les ruminants passèrent devant elle.
«Bonjour, monsieur, madame; vous avez donc peur de Jeannette? dit la petite paysanne.
–Non, répondit Paul, qui se sentait protégé par le treillage de fer.
–Mais hier vous avez eu peur d’elle; Jeannette n’est pourtant pas méchante, allez! Je joue avec elle à cache-cache, et nous jouerons ensemble quand vous voudrez.
–On ne joue pas à cache-cache en donnant des coups de tête, surtout quand on a des cornes dessus, répliqua Paul; aussi j’aime mieux ne pas jouer.
–Jeannette frappe pour rire et ne fait pas de mal, vous allez voir.»
Et, appelant ses chèvres, la petite gardienne se mit à courir et à sauter, suivie de toute sa bande qui cabriola autour d’elle.
«Ça doit être bon, ce que vous mangez là, madame?» dit-elle en revenant tout essoufflée près de la grille.
Mathilde rougit de plaisir; être appelée madame était une de ses ambitions, et elle trouvait la petite paysanne parfaitement élevée. Elle se rappelait bien que la veille elle l’avait déjà gratifiée de ce titre; mais, la veille, les circonstances étaient si critiques, que cette qualification avait perdu la moitié de sa valeur.
Passant son bras à travers les barreaux de la grille, Mathilde offrit sa tartine à la gardeuse de chèvres, qui la remercia par une belle révérence.
Paul, un peu enhardi, ouvrit la porte du parc, et Jeannette s’avança aussitôt vers lui, non plus menaçante, mais en bêlant avec une petite voix cassée très douce et très amusante. Sans que les deux enfants eussent pu dire comment cela était arrivé, tant les choses se passèrent naturellement, le père Antoine les trouva un quart d’heure plus tard qui sautaient et qui gambadaient avec les chèvres dans les fossés de la grande route, et déjà liés d’une amitié si profonde avec les ruminants et leur gardienne qu’il fallut parler haut pour les séparer.
«Rentrez, monsieur Paul! rentrez, mademoiselle Mathilde! répétait le père Antoine. Votre papa vous gronderait s’il vous voyait hors du parc sans sa permission. Toi, ma petite Catherine, conduis tes chèvres près de la lisière du bois, et ne les laisse pas s’égarer.»
Catherine s’éloigna en criant:
«Adieu, monsieur, madame; adieu, monsieur Antoine,
–Est-ce que Catherine va jouer tous les jours avec ses chèvres dans les bois? demanda Mathilde au jardinier.
–Catherine ne doit pas jouer, répondit celui-ci, mais prendre soin des bêtes dont elle a la garde. Catherine n’a plus de père ; il faut qu’elle travaille pour aider sa mère qui n’est pas riche.
–Les chèvres ne sont donc pas à elle?
–Non; elles appartiennent à la mère Thibaut, et Catherine est simplement chargée de les mener brouter.
–Alors elle gagne beaucoup d’argent? dit Paul.
–Un sou par jour, et parfois seulement un morceau de pain.
–Avec des confitures dessus?
–Non, tout sec.
–Pauvre Catherine! Vous avez pourtant dit qu’elle a une maman? reprit Mathilde.
–Mais une maman pauvre, qui, loin de pouvoir lui donner des confitures, ne peut pas toujours lui acheter des sabots, car vous avez dû remarquer qu’elle marche nu-pieds.»
Pendant un instant, Paul et Mathilde suivirent silencieusement le jardinier; chacun d’eux semblait réfléchir; puis, avec la mobilité des enfants, ils luttèrent de vitesse pour rejoindre leur frère Lucien qu’ils venaient d’apercevoir.
«Où donc as-tu trouvé les gros radis que tu portes? demanda Paul, arrivé le premier.
–Ce ne sont pas des radis, mais des betteraves, répondit Lucien.
–Est-ce que tu vas fabriquer du sucre?
–Non; je vais simplement couper ces racines par tranches et les offrir à Babonnette afin qu’elle nous donne de bon lait.
–C’est pourtant avec ces betteraves-là qu’on fabrique du sucre, dis?
–Pas précisément, car j’ai là une betterave rouge, et c’est de la betterave blanche, introduite en France en1815 par Mathieu de Dombasle, que l’on extrait aujourd’hui le sucre. C’est une plante bien précieuse que la betterave: on la mange en salade, on prépare du sucre, de l’alcool, des confitures avec son jus, et l’on fabrique du papier avec sa pulpe.
–Lequel est le plus sucré, le sucre de betterave ou le sucre de canne? demanda Mathilde.
–Lorsqu’ils sont raffinés, il n’y a aucune différence entre eux; c’est par préjugé que tu entendras dire le contraire.
–Qui donc a découvert le sucre de betterave?
–Margraff, en1747; en France, c’est à M. Benjamin Delessert que l’on doit l’exploitation de ce produit, une des richesses de nos départements du Nord.»
On alla voir manger Babonnette, jolie vache noire marquée d’une étoile blanche sur le front. Grâce à Lucien. on apprit que Babonnette était un ruminant, tout comme Mlle Jeannette, et que ladite Babonnette et ses pareilles descendent de l’auroch, taureau de taille énorme, qui, après avoir vécu longtemps en Europe, ne se trouve plus guère aujourd’hui que dans les monts Carpathes.
«Les vaches et les taureaux, ajouta Lucien, sont peut-être les animaux les plus utiles à l’homme, et la richesse agricole d’un pays est le plus souvent en rapport avec le nombre de bestiaux qu’il possède. La vache nous fournit en abondance du lait avec lequel on fabrique plus de cent espèces de fromages, et la chair du bœuf est la base de notre nourriture. Avec la peau de ces animaux, préparée avec plus ou moins de soin et transformée en cuir, on fabrique des harnais, des malles, des soufflets, des souliers et des vaches de voitures. Avec ses cornes et ses os, les tourneurs façonnent des boutons, des peignes, des dominos, des poires à poudre et mille autres objets. La vache, il est bon que vous sachiez cela, était adorée en Égypte sous le nom d’Isis, et les Grecs la respectèrent longtemps avant de l’offrir en sacrifice à leurs dieux. De nos jours, la vache est vénérée par les Indiens, encore très ignorants, qui croient que l’âme des morts se réfugie dans le corps de ces quadrupèdes; c’est donc pour eux un sacrilège que de les égorger. La grande révolte des Indiens contre les Anglais, en1857, eut pour motif principal le bruit habilement répandu que les cartouches distribuées aux cipayes, ou soldats indigènes, étaient préparées avec de la graisse de vache.
–Comment fait-on pour que la peau des vaches devienne du cuir? demanda Paul.
–On met les peaux que l’on veut préparer en contact avec du tan, ou écorce du chêne réduite en poudre grossière. Le tan contient une substance nommée tannin, qui possède la propriété de se combiner avec la matière animale de la peau des animaux et de rendre ces peaux souples et imputrescibles.
–Alors on frotte les peaux avec du tan, et elles se changent en cuir?
–L’opération est plus compliquée que cela, reprit Lucien; il faut d’abord laisser tremper les peaux pendant plusieurs jours dans l’eau courante, puis les faire macérer dans une nouvelle eau contenant de la chaux délayée, afin de les débarrasser de leurs impuretés. Une fois bien nettoyées, les peaux sont placées dans des cuves, couvertes de tan, et, au bout de trois mois de macération, elles se trouvent tannées. Il ne reste plus qu’à les livrer au corroyeur chargé de leur donner le brillant et la souplesse nécessaires.»
On fut rappelé vers la maison par la cloche qui annonçait le déjeuner. A l’heure du dessert, on remarqua que Paul et Mathilde mettaient de côté les biscuits et les fruits qu’on leur offrait. Sans s’être donné le mot, les deux enfants songeaient à la petite Catherine qui ne mangeait que du pain sec, et ils se proposaient de guetter son retour des champs pour lui remettre les friandises dont ils se privaient à son intention.
Vers quatre heures de l’après-midi, le frère et la sœur se trouvaient de nouveau sur la lisière du bois, du côté opposé à celui qu’ils avaient visité la veille. Pour cette fois, Paul avait renoncé à son bonnet, à sa peau de mouton, à ses moustaches, et, armé de son fusil, que lui avait rapporté le père Antoine, il se contentait d’être un simple chasseur.
«Tu sais que je ne veux plus aller sur la route des Grandes-Indes, dit résolument Mathilde.
–C’est pourquoi je t’ai amenée par ici, répondit Paul. As-tu bien chaud?
–Pourquoi me demandes-tu cela?
–Parce que nous allons tourner le dos aux Grandes-Indes et marcher vers les pays froids.
–Je vais courir chercher mon manchon.
–Ça nous mettrait trop en retard, dit Paul en retenant sa sœur par le bras ; la Sibérie est pas mal loin, et nous n’avons pas de temps à perdre. «
Mathilde, il faut le dire, avait d’abord refusé d’accompagner son frère; mais elle rêvait d’acheter une paire de souliers à Catherine, et Paul avait solennellement promis de donner à sa sœur tous les sous qu’il pourrait récolter si elle se montrait docile. Voilà pourquoi Mathilde consentait à se rendre en Sibérie.
On venait de dépasser les premiers arbres, lorsque Trompette, auquel on ne songeait pas, se joignit à la caravane; fêté, caressé, le chien précéda sur le sentier nos intrépides explorateurs.
La présence de Trompette rassura la timide Mathilde; faut-il s’en étonner? L’homme lui-même se sent plus fort lorsqu’il est accompagné par le fidèle et vaillant animal que l’on nomme un chien. On dort d’un sommeil moins inquiet, gardé par ce vigilant ami, toujours prêt à se dévouer et incapable de trahir.
«Quel bon Vendredi ferait Trompette! dit Paul. C’est dommage qu’il ne sache pas parler. Toi, continua-t-il en jetant un regard tant soit peu méprisant vers sa sœur, tu marches derrière moi, tandis que Trompette court à droite, à gauche, en arrière, en avant, et regarde partout pour s’assurer qu’il n’y a pas d’anthropophages dans les buissons.
–Qu’est-ce que c’est que ces bêtes-là? demanda Mathilde.
–Ce ne sont pas des bêtes, mais des hommes qui en mangent d’autres.
–Tout crus?
–S’ils les mangeaient tout crus, ce seraient par-dessus le marché des cannibales.
–Mangent-ils aussi les femmes?
–Je ne crois pas; dans la leçon qu’il m’a donnée hier, Émile m’a expliqué que le mot anthropophage vient d’anthropos, homme, et de phago, je mange.
–Alors ce sont des ogres?
–Si l’on veut; seulement, tu sais qu’il n’y a pas d’ogres pour de vrai?
–Verrons-vous des pophages en Sibérie?
–Non; mais je te préviens qu’il faut dire anthropophages! parce que pophages ne veut rien dire du tout.
–Et si je veux dire pophages, moi?
–Personne ne te comprendra.
–Ça m’est égal, j’aime mieux dire pophages que thropophages.
–Anthropophages! cria Paul de toutes ses forces.
–J’entends bien, des pothophages», riposta la malicieuse petite fille, qui s’amusait en ce moment de la gravité de son frère.
Une interminable discussion se serait engagée, si un aboiement de Trompette n’eût causé une diversion. Le chien, une patte en l’air, semblait en arrêt devant un objet long et noir étendu sur le sol.
Paul s’avança rapidement.
«Un boa!» s’écria-t-il.
Sans la présence de Trompette, Mathilde se serait enfuie. Elle s’approcha peu à peu et vit un serpent étendu sur le sol.
«Il est tout petit, ton boa, dit-elle avec dédain.
–Heureusement; s’il était gros, nous serions déjà mangés.
–Les boas sont donc aussi des pophages?»
Les circonstances étaient trop graves pour que Paul daignât répondre à cette provocation. Il s’approcha doucement du reptile, long de40centimètres environ, et qui demeurait immobile. Moins prudents que Trompette, qui se tenait à distance respectueuse, Paul et Mathilde, armés de petits bâtons, chatouillèrent l’animal, qui ondula sans toutefois essayer de fuir. Saisi d’une idée subite, Paul prif son sac de toile, le posa sur le sol, et le maintint ouvert, tandis que Mathilde poussait le serpent à l’aide d’un bâton. Trompette protesta en vain, par des aboiements plaintifs, contre l’imprudence des deux enfants. Tourmenté par la baguette de la petite fille, le reptile s’engouffra dans le sac, qui fut aussitôt refermé. Alors, avec une hardiesse sans pareille, Paul replaça la poche à son côté.
A cent pas plus loin, on se trouva, comme la veille, sur le bord d’un ruisseau. On s’assit, et une grande demi-heure se passa à jeter dans l’eau des morceaux de bois, des feuilles sèches, des brins d’herbe que le courant emportait. Cet exercice était si amusant, qu’on serait resté plus longtemps si un gros rat, se promenant au fond de l’eau limpide, ne fût apparu soudain. Les deux enfants n’en pouvaient croire leurs yeux; c’était bien un rat, un vrai rat, qui, là, tout au fond de l’eau, se promenait comme un poisson. Ce phénomène parut peu rassurant, et Mathilde proposa de sortir au plus vite d’un pays où les rats couraient au fond de l’eau, et où l’on allait peut-être voir des poissons perchés sur les arbres se mettre à gazouiller. On avait fait à peine cent pas, lorsque Trompette tomba de nouveau en arrêt devant un animal étrange: on s’approcha avec précaution, et l’on découvrit une belle grenouille noire. La poche de toile fut aussitôt posée sur le sol, et l’on vit, au fond, le boa qui semblait dormir. On profita de son sommeil pour lui donner un compagnon, car, savamment poussée par de petits bâtons, la grenouille noire s’engouffra à son tour dans la poche, dont trois épingles fermèrent aussitôt l’entrée.
Cette belle opération terminée, et la poche remise à sa place ordinaire, on reprit la route de la maison. Le voyage avait duré plus qu’on ne le croyait, car on arrivait à peine sur la lisière du bois, lorsque l’on entendit retentir la cloche qui sonnait l’heure du dîner. Il fallut presser le pas, afin d’éviter une réprimande; aussi, en atteignant la salle à manger, Paul n’eut que le temps d’accrocher sa poche au dos d’une chaise et de courir se laver les mains.
Le repas touchait à sa fin, lorsqu’un cri de terreur, poussé par Mlle Hélène, effraya tous les convives.
«Mon boa! s’écria Paul.
–Ma grenouille!» s’écria Mathilde.
Entraînée par la curiosité, souvent si fatale, qui conduit, les enfants à toucher à tout, Mlle Hélène s’était avisée de décrocher la poche, y avait plongé la main, et avait poussé un cri d’épouvante à la vue de deux reptiles qui se promenaient maintenant en liberté sur le parquet.