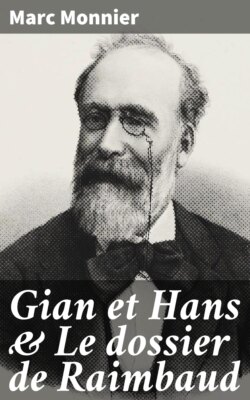Читать книгу Gian et Hans & Le dossier de Raimbaud - Marc Monnier - Страница 6
III
ОглавлениеLa Chouette s’enfuit effarouchée comme si on venait de la prendre en faute. Hans nous reçut avec un certain embarras et crut devoir s’excuser en nous racontant des choses inexactes; on ment quelquefois, même quand on est né en Poméranie; il y a des pécheurs partout. Il nous assura qu’ayant appris notre départ, il avait voulu nous suivre, mais qu’il s’était arrêté à Heilbronn, retenu par une fête musicale à laquelle assistait Uhland.
«Le grand poète, nous dit Hans, m’a fait très bon accueil et, m’offrant une bouteille de rudesheimer, m’a chanté une de ses chansons à boire, celle oùil fait rimer Wein et Schwein (bouchon et cochon). De là je suis venu à l’auberge de Degerloch, où j’ai vu ces dames.
–Nous y sommes venus nous-mêmes, et elles n’y étaient pas.
–C’est que vous ne les avez pas demandées.
–Si fait, dit Gian; j’ai demandé Frau Kreutzer, et on m’a ri au nez.
–Frau Kreutzer? s’écria Hans en cacardant comme une oie.
–N’est-ce pas le nom que vous m’avez dit?
–Hach! hach! hach! fit le vieux boursch! il faut que j’aie pris une monnaie pour une autre. Ce n’est pas Frau Kreutzer qu’on la nomme, c’est Frau Pfennig. Hach! hach! hach!»
Les kreutzer, en effet, étaient les petits sous de Heidelberg, valant, soyons exact, trois centimes et six dixièmes; le pfennig comptait à Berlin pour un centime environ. Hans avait pu se tromper, ou se moquer de nous, ce qui me semblait plus probable; j’étais furieux, mais Gian ne pensait qu’à Lenchen.
–Où est-elle? demanda-t-il au boursch, en fouillant toutes les allées du jardin, toutes les fenêtres de la maison. Il avisa tout au haut du pignon, sous la pointe du toit, une petite croisée ouverte en dehors de laquelle un rideau bleu, agité par le vent, flottait comme une bannière. Il rentra aussitôt dans l’auberge, et, trouvant l’escalier, monta en quatre sauts jusqu’aux combles où une porte entre-baillée attira son regard. Il vit alors tout ce que Faust avait vu dans le nid de Gretchen, même le grand fauteuil de cuir qui devait sans doute avoir reçu les aïeux dans ses bras ouverts et entendu bourdonner tant de petits enfants autour de sa vétusté patriarcale; un tapis était soigneusement tiré sur la table, le plancher saupoudré de sable reluisait. Gian souleva un rideau du lit et il lui vint des pensées ivres qui se dispersèrent bientôt, honteuses d’être nées «dans ce mélancolique et chaste paradis.»
«Ah! si elle entrait tout à coup, s’écria-t-il, comme j’expierais mon sacrilège! Que je serais misérable près d’elle! Oserais-je seulement tomber à ses pieds?»
Il voulut fuir, mais s’assit dans le fauteuil, retenu par un charme, et regarda mieux autour de lui: tout ce qu’il voyait lui révélait une vertu de Lenchen. Le miroir était petit, donc elle n’avait pas de coquetterie; la chambre nue et propre, elle serait donc bonne ménagère et ne dépenserait pas son argent en futilités. La fenêtre donnait sur du vert: c’était donc là tout le luxe de la jeune fille qui, accoudée sur l’appui, pouvait contempler par delà la cloison du jardin, des vergers chargés de fruits, des pentes couvertes de maisons blanches et la capitale du Wurtemberg s’épanouissant au soleil. Sur un meuble près-du lit il n’y avait qu’un livre, la bible de Luther: c’était donc la lecture du soir et celle du matin; la pieuse enfant s’endormait et s’éveillait en’ prière. Il ouvrit le livre au hasard et tomba sur-ce passage: «L’amour excuse tout, il croit tout, espère tout, supporte tout; l’amour ne périt jamais.» Gian devint aussitôt luthérien et se donna cœur et âme à Lenchen.
En ce moment, la porte s’ouvrit toute grande, et une femme entra, Frau Pfennig. Sa voix faisait le bruit d’une horloge qu’on remonte.
«Qu’est-ce que cela? s’écria-t-elle. Que faites-vous ici?
–Je suis venu, gracieuse dame, répondit-il en se levant et en saluant très bas avec une grâce d’Italien; je suis venu vous demander la main de mademoiselle votre fille.
–Potz tausend! gronda-t-elle (c’était son juron). que me contez-vous là? Et vous êtes venu pour ce motif jusque dans ma chambre à coucher?
–Votre chambre à coucher?» bégaya-t-il avec la mine d’un chasseur qui s’en revient bredouille. Ce n’était donc pas le nid de Lenchen, c’était e trou de la Chouette!
Aussitôt l’endroit lui parut hideux, le plancher malpropre, le lit suspect; il vit une reprise au tapis, le fauteuil de cuir rendait une odeur de vieille semelle, le petit miroir renvoyait un profil d’oiseau de proie, la Bible de Luther devint un livre de vieille femme, enfin la fenêtre ne donnait plus que sur un jardin d’auberge où, en ce moment même, Lenchen apportait deux chopes de bière qu’un étudiant français (c’était moi) avait commandées pour lui et pour Gian. Un étudiant poméranien (c’était Hans) lançait par plaisanterie une bouffée de fumée à la figure de Lenchen et buvait une des deux chopes de bière. En voyant cela, Gian sortit tout à coup, en plantant là Frau Pfennig, qui le soupçonna, non sans raison, d’avoir le timbre un peu fêlé. Il se laissa rouler comme une cascade jusqu’au bas de l’escalier; quand il arriva au jardin, Lenchen n’y était plus, et les deux chopes étaient vides.
«Puisque vous avez tout bu, nous dit-il, je vais aller moi-même au tonneau.»
Il rentra aussitôt dans l’auberge et fit tant et si bien qu’il trouva Lenchen dans la basse-cour, où elle était en train de donner à manger aux poules; il songea aussitôt à la Charlotte de Werther, offrant la becquée à une nichée d’enfants, et il tendit ses mains avec une profonde émotion. La jeune fille ne parut pas surprise de le voir et remplit de grains de maïs les deux mains qu’il lui avait tendues.
«Aidez-moi, lui dit-elle.»
Et tous deux se mirent à la besogne, égayés par les poules, qui piquaient hâtivement leur repas avec un petit salut saccadé. Puis ils causèrent.
«Vous m’attendiez donc?… demanda Gian.
–Je vous savais ici. C’est pour vous voir que j’ai porté moi-même au jardin.
–Ma chope? un autre l’a bue. Sic vos non vobis...
–… mellificatis, apes, dit Lenchen, achevant le vers.
–Vous savez du latin?
–Ce qui ne m’empêche pas de donner à manger aux poules.»
Gian tombait de surprise en surprise. Il fut plus étonné encore quand Lenchen lui dit:
«Venez dans ma chambre, nous causerons mieux.»
Cela ne se fait pas en Italie. Cependant il se hâta de suivre la jeune fille et fut ébloui de ce qu’elle lui montrait. Il y avait des dentelles aux rideaux, des étagères chargées de livres, un piano, un chevalet portant une ébauche de paysage dont Gian reconnut le sujet: c’était la rive du Neckar, où il l’avait rencontrée.
«C’est vous qui avez fait cette peinture? demanda-t-il.
–Les dentelles aussi,» répondit-elle.
Et elle ajouta, tirant d’un placard un grand plat de pâtisserie:
«Et aussi cela.»
Puis, courant au piano, elle joua divinement (je l’entendis du jardin) une barcarolle italienne. Peut-être y mit-elle un peu d’ostentation, mais elle était si jolie! Gian sentit ses yeux se mouiller en entendant cette musique de son pays jouée pour lui seul par de belles mains, qui étaient peut-être un peu rouges, mais il ne le remarqua pas; il ne remarquait que ce qu’il voulait. Quand elle le vit ému, elle chanta; rien ne rend fou comme un air de Schubert sur des paroles de Gœthe. Quand elle eut fini, Gian se roulait à ses pieds en sanglotant; Lenchen se leva toute grande avec un beau sourire d’Omphale.
«Me voulez-vous, lui dit-il, éternellement?
–Il faut d’abord apprendre à nous connaître.»
Quand Gian me raconta cette scène, je lui fis des observations qui me parurent très sensées.
«Cette jeune personne, lui dis-je, a des talents variés, et il est remarquable assurément qu’elle ait pu apprendre tant de choses dans une auberge de village. Il n’en résulte pas que tu doives l’épouser.
–Je l’ai demandée à sa mère.
–Qui ne t’a répondu que: Potz tausend! Tu n’as pas le sou et tu n’es bon à rien. Lenchen, en revanche, est un peu propre à tout, ce qui ne me va pas; je n’approuve guère qu’on chausse en même temps des bas bleus et des sabots, qu’on mêle le latin a la cuisine. Observe, de plus, qu’elle sait beaucoup de choses, outre les langues mortes: tout cela ne s’apprend pas sans maître, et les maîtres ne sont pas tous vieux. Elle est bien jolie, c’est vrai, mais la beauté, qui est une qualité en amour, devient souvent un gros défaut en mariage; elle a pourtant des mains rouges.
–Blanches comme du lait.
–Rouges comme du vin, mon cher. Regarde plutôt.»
En effet, Lenchen était en ce moment dans un coin du jardin, cachée derrière des nappes mouillées qu’elle pendait à une corde haute: on ne voyait par-dessus le linge blanc que des pattes de homard. Gian s’écria:
«La rougeur de la jeunesse!
–Enfin, dans tout ce qu’elle t’a dit, un seul mot m’a fait plaisir: Il faut apprendre à vous connaître.
–C’est là au contraire ce qui n’a pas le sens commun. Ah! vous êtes bien tous des gens du Nord! Chez nous, tu regardes une femme à son, balcon, au théâtre, à l’église; si elle te rend ton regard, elle se donne pour la vie. On a du sang dans l’œil.
–Ici, mon cher garçon, une jeune fille vous mène dans sa chambre à coucher, vous montre les dentelles de son lit et vous dit après: «Il me reste à faire votre connaissance.» Que diable! le fond de l’homme et de la femme est le même partout, il faut bien qu’il y ait un peu de différence dans les manières. Sans quoi pourquoi voudrais-tu reprendre Venise aux Allemands?»
Pendant que nous causions, Hans était assis dans l’embrasure d’une fenêtre ouverte, au rez-de-chaussée, le dos tourné au jardin; la Chouette, debout à côté de lui, minaudait, lutinait, faisait la roue; lui, placide, les pieds sur le dossier d’une chaise, fumait. Ma conversation avec Gian finit comme d’ordinaire en dispute: il me déclara, en me tournant le dos, que l’Amérique avait des singes, mais que l’Europe avait des Français. C’était encore du Schopenhauer. Je montai dans une chambre que nous avions retenue pour la nuit, et, comme le jour baissait, je me mis à lire auprès de la fenêtre. Je me trouvais juste au-dessus de la Chouette et de Hans, qui, n’entendant pas de bruit, causaient librement.
–«Vous ne voulez donc pas, disait-elle, que je la donne à cet Italien?
–Trois fois non. La race latine est infecte; ces gens-là se marient pour huit jours et se sauvent après en emportant la caisse. Ne la donnez d’ailleurs ni à lui ni à aucun autre, quel qu’il soit. Elle est trop jeune, On ne doit se marier qu’à votre âge.
–Hélas! cher Dieu (ach lieber Gott)! vous voulez rire.
–Point du tout, vous êtes encore très appétissante; songez d’ailleurs qu’il faut un homme dans votre maison. Passe encore à Degerloch, où vous avez plusieurs domestiques avec vous, mais vous allez vous retirer à Bonn, une ville d’étudiants. deux femmes seules!.
–Dieu dans le ciel (Gott im Himmel)! vous me faites trembler.
–Mariez-vous donc, Frau Pfennig, ou prenez un pensionnaire.
–Pourquoi ne viendriez-vous pas avec nous, digne monsieur Schloukre?
–Moi, je suis trop pauvre. Je ne pourrais vous payer qu’une mince pension.
–N’est-ce que cela? Vous n’en paierez aucune et vous donnerez des leçons à Lenchen.
–Nous y réfléchirons.»,
En ce moment, une nuée d’étudiants, venant à pied de Tubingue et profitant, comme nous, des congés de Pentecôte, fit irruption dans le jardin en chantant deux vers d’Uhland:
Frau Wirthin, hat sie gut Bier und Wein:
Wo hat sie ihr schœnes Tœchterlein?
«Dame hôtesse, avez-vous de bonne bière et de bon vin? Où est votre jolie fille?
–La voilà,» gazouilla Lenchen, qui accourut si légèrement que je ne l’avais pas entendue venir.
Les étudiants se pressèrent autour d’elle en agitant leurs casquettes bariolées qu’éclairaient çà et là, car il faisait déjà nuit, les lumières de la maison.
–«Hourrah, Lenchen! hourrah haut!» cria cette jeunesse.
Puis un boursch la coiffa de son pilus (bonnet plat), un autre lui passa autour du corsage un ruban à deux couleurs, insignes d’une société quelconque, et, séance tenante, elle fut proclamée Fuchsinn (étudiante en herbe). Elle était charmante ainsi; mais Gian, qui l’avait suivie, ne paraissait pas content du tout. Après Lenchen, Hans eut son ovation: un vieux boursch le reconnut et le nomma tout haut en le montrant à ses camarades. Je pus constater que notre ami Schloukre avait laissé à Tubingue un glorieux souvenir à la suite de ses démêlés avec la police; nul n’ignorait l’histoire du quatuor nocturne qu’il avait chanté tout seul en sortant du cabaret. La princesse royale, fort belle personne, en avait ri, le vieux roi de Wurtemberg s’en était fâché: deux succès légendaires. Aussi Hans fut-il acclamé par ces jeunes gens, qui voulurent faire un Commers en son honneur; nous y fûmes invités, Gian et moi, comme hospites. Hospites est le pluriel d’un mot latin qui veut dire hôte, mais je ne compris pas bien ce que pouvait être un Commers.
«Je n’en sais rien non plus, me dit Gian, mais je suis sûr qu’on y boira de la bière.»
Une demi-heure après (car il fallut le temps de décorer la scène), nous fûmes introduits dans une salle vaste, mais basse, meublée d’une table en fer à cheval. Une centaine de jeunes gens se trouvaient là, coiffés de casquettes ou de pilus, décorés de rubans qu’ils portaient en bandoulière; les coiffures et les décorations étaient blanches, bleues, rouges. vertes, amarante ou terre de Sienne brûlée, bicolores ou tricolores selon les diverses sociétés (il y en avait dix ou douze), qui se chamaillaient d’ordinaire, mais qui fraternisaient ce soir là. Quelques étudiants portaient des insignes distinctifs: brassards ou cocardes, gros gants d’escrime, le veston à brandebourgs, la rapière au côté, des bottes fortes armées d’éperons, bien qu’ils fussent venus à pied, mais un air de cavalerie fait toujours bien; c’est tout ce qui reste de la chevalerie. Des panoplies et des drapeaux brodés décoraient les murs; il y avait sur la table sans nappe, outre les chopes à couvercle, des coupes d’argent où pendaient des médailles, et de grandes cornes évidées où l’on buvait à la ronde: c’était peu régalant, mais démocratique et sacerdotal. Les jeunes étudiants portant le titre de foucs (Fuchs, renard) servaient de domestiques aux plus âgés, qui avaient atteint le grade de Bursch (grand garçon); le renard en chef, le Fuchs major, paraissait fort affairé: c’était lui qui commandait le service. Hans présidait et pontifiait. Il fit d’abord un ’discours très sérieux pour nous présenter, Gian et moi, à l’assistance; après quoi, dirigeant l’enthousiasme, il commanda en notre honneur un double hourrah. L’enthousiasme obéit au commandement: le double hourrah partit avec un ensemble si parfait qu’on l’eût dit poussé d’une seule-voix: les étudiants satisfaits s’applaudirent eux-mêmes.
La cérémonie commença. Quand je dis cérémonie, je n’exagère pas: c’était un divertissement solennel et même un peu lugubre. Ces jeunes gens en vacance, réunis pour s’amuser, chantèrent d’abord en latin un chœur sépulcral:
Gaudeamus igitur
Juvenes dum sumus:
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem,
Nos habebit humus.
Après quoi ils se recueillirent gravement; la salle portait au silence; c’était celle où, la veille, nous avions assisté aux joies muettes des notables de Degerloch. Chaque étudiant avait sa pipe en porcelaine ornée de devises, d’écussons peints et bourrée d’un affreux tabac jaune appelé kanastre, du latin canistrum, me dit mon voisin de droite, parce que ce végétal, importé d’Amérique, était-emballé dans des paniers.
«N’est-ce pas plutôt les paniers que vous fumez?» demandai-je à mon voisin, qui rentra en lui-même.
Après quatre ou cinq chopes, les langues se dérouillèrent; mon voisin de gauche, apprenant que j’étais Français, me dit que son père avait été à Paris en1815et me raconta la bataille de Leipzig. Des conversations particulières s’étaient engagées çà et là: il m’en revenait à travers la fumée quelques mots confus, tous savants: déterminisme, suiconscience, subhastation, parémiologie, célidrographie, cucurbitacées, aptérodictères, trapèzoèdre, paradigme, paragoge et parembole, que sais-je encore? je n’ai pas tout retenu. Hans égayait quelques jeunes gens suspendus à ses paroles en leur décrivant le corps d’une jeune fille asphyxiée qu’il venait de voir à Heilbronn: raideur des membres et du tronc, contraction invincible des mâchoires, peau décolorée, livide et humide, surtout au front, au cou et dans les angles oculo-palpébraux;… je passe le reste. Je remarquai que Lenchen écoutait de ses deux oreilles et avait l’air de suivre toutes les conversations. Je compris d’où lui venait sa science. Ils buvaient tous éperdument; la causerie tourna en discussion; çà et là, haussant la voix, la discussion s’échauffa en dispute, mais tous ces jeunes gens étaient sérieux comme des croque-morts.
«Ce qui m’afflige surtout chez vous, reprit mon voisin de gauche, c’est que vous êtes des esprits chagrins. Je connais vos auteurs, même ceux qui passent pour des comiques: les deux plus grands, Molière et Paul de Kock, me font pleurer. La vraie joie est germanique, elle vient d’une conscience pure. Voyez cette salle: quel débordement de jeunesse et de gaieté!»
Je regardai la salle et j’observai que les trois quarts des étudiants portaient des lunettes. Mon voisin de droite, muet depuis une heure, rompit le silence et me demanda d’un air grave:
«Pourquoi dites-vous que nous fumons des paniers? Je ne comprends pas.»
Cependant les chopes succédaient aux chopes; quand ils en eurent englouti dix ou douze, les étudiants se mirent à chanter comme les notables de Degerloch. C’était beau: les voix sonnaient d’accord, mais quelles chansons lamentables! Dans l’une, le Bon Camarade, il était question d’un pauvre garçon mort à la guerre; dans l’autre, Notre Asile, il s’agissait d’une blanche maison qu’on avait bâtie et que des méchants étaient venus renverser. Une autre, intitulée Tempora mutantur, roulait sur cette idée noire que la vie est un songe; Frères, il faut mourir. Après quoi vint le Commers proprement dit: encore une cérémonie auguste. Tous les-étudiants se levèrent, la rapière à la main, et entonnèrent un hymne patriotique et religieux; puis Hans, qui présidait, chanta seul:
Vibre encore,
Chant sonore
De l’épée et du drapeau!
Que notre âme se relève !
Qu’à la pointe de son glaive
Chaque bras perce un chapeau.
Au bruit de ces paroles, qui en allemand ne sont pas drôles, les étudiants croisaient le fer par-dessus la table et chacun fit un trou dans la casquette de son vis-à-vis. Cet acte s’accomplissait avec ferveur, et les deux jeunes gens qui venaient d’échanger des coups de pointe dont leur coiffure seule avait pâti se juraient amitié jusqu’à la mort. Lenchen n’avait pas le droit de prendre part à la cérémonie, mais debout devant la porte, une rapière à la main, le pilus sur l’oreille et les yeux au plafond, à travers le nuage bleu qui remplissait la salle, elle paraissait héroïquement inspirée comme Jeanne, la bonne Lorraine, «qu’Anglois bruslèrent à Rouen.» Tout cela, vu de loin, après la guerre, me divertit ou m’agace; mais si je cherche à raviver mes impressions d’alors, eh bien! malgré moi, je trouve dans ces jeunes têtes blondes, échauffées par le houblon, par le kanastre, mais aussi par une forte et fière émotion, dans cette musique sévère, si bien chantée, qui recouvrait des paroles nobles, dans ces refrains à boire où entrait le sentiment national et chrétien, dans l’attitude extatique de la jeune fille, je ne sais quelle kermesse austère, gravement folâtre, où l’orgie, soumise à des rites, devenait une communion.
Par malheur, l’enthousiasme s’oublie quelquefois; en poussant le dernier cri du chant funèbre qui accompagne le Commers (ce dernier cri est hourrah!) un boursch qui était près de Lenchen. Il importe de noter que la jeune fille inspirait beaucoup de respect aux étudiants, qui l’appelaient mademoiselle (Fræulein); elle leur donnait sa main à serrer, rien de plus, et si l’un d’eux serrait cette main un peu trop fort, elle le foudroyait d’un regard méprisant qui rendait Gian fou de joie.– Je disais donc qu’un boursch qui était près d’elle, en criant: Hourrah! crut devoir accompagner cette exclamation d’un geste triomphal: il enlaça d’un bras la taille de la jeune fille et allait, je le crains, l’embrasser, quand une forte main le prit en arrière par les cheveux et le coucha violemment à terre. Le boursch, se relevant furieux, bondit sur Gian, qui l’attendait de pied ferme. L’Italien saisit l’Allemand par les deux poignets et les tordit avec tant de force qu’il le fit tomber à genoux devant Lenchen.
–Demandez-lui pardon, cria-t-il d’une voix qui aurait dominé tout le chœur du Commers.
Le sang lui sortait des yeux, il avait littéralement les regards rouges. Je dois reconnaître que le boursch se tint bien; il blémissait, écumait, devait souffrir comme un torturé qu’on tenaille, mais il ne poussa pas un cri, ne dit pas un mot. La galerie ne bougeait point, ne voulant pas intervenir; tous regardaient, anxieux, et laissaient éteindre leurs pipes. Lenchen, radieuse, rougissait. Au bout d’un moment, trop long peut-être, elle dit à Gian:
«Laissez-le; je lui pardonne.»
Mais cela ne pouvait finir ainsi. Le duel eut lieu le lendemain.