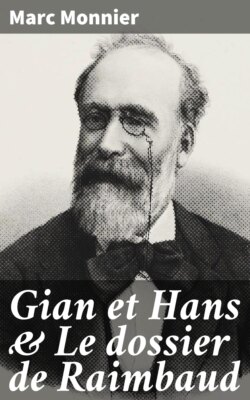Читать книгу Gian et Hans & Le dossier de Raimbaud - Marc Monnier - Страница 7
IV
ОглавлениеCe duel fit le plus grand honneur à Hans. On se battit de grand matin dans un hangar qui était au fond du jardin et qui servait de salle de danse. Il y avait à l’auberge, habituée à de pareilles fêtes, tout ce qu’il fallait pour un combat singulier entre étudiants: des plastrons, des gantelets, des brassards, des cuissards, des jambières, des coussinets de toute espèce, le tout soigneusement rembourré. Hans dirigeait la toilette de Gian qui riait aux larmes.
«Mais si on me met ainsi dans du coton, demandait-il, où entrera le fer?
–On ne vise ici qu’au visage, et la visière de la casquette garantira vos yeux.
–Singulier combat!» s’écria Gian.
Jamais de sa vie il n’avait touché une rapière, mais il comptait faire bonne figure et monter en grade aux yeux de Lenchen. Les choses n’allèrent pas comme il aurait voulu. Le duel était réglé comme l’orgie: on devait se battre durant vingt-cinq minutes au plus et s’arrêter au premier sang. Les adversaires faisaient une ou deux passes, puis s’arrêtaient un moment; c’étaient les seconds qui paraient les coups. Hans était le second de Gian. L’Italien, qui s’escrimait comme un diable et faisait un moulinet furibond, se découvrait si étourdiment qu’il eût été balafré vingt fois sans la dextérité de Hans, brétailleur émérite, expert en contre-passes, en contre-pointes, en contre-dégagements, en contre-appels, en contre-ripostes: le vieux boursch eut fort à faire et dut même une fois ou deux rabattre le fer de Gian, qui faillit lui crever un œil. Grâce à lui, les vingt-cinq minutes passèrent sans effusion de sang: l’honneur étant satisfait, les combattants s’embrassèrent, et l’un des témoins dit à Gian avec emphase:
«Remerciez le grand Schloukre, car sans lui vous auriez le crâne fendu.»
Gian remercia le grand Schloukre en lui répétant sa phrase ordinaire: «C’est entre nous à la vie à la mort.» Hans eut une nouvelle ovation; la jeune bande lui offrit la bière du matin (Frühbier) et aurait voulu l’emmener à Tubingue; Lenchen cueillit, une branche de laurier qu’elle lui attacha sur le front. Je regardai Gian, qui me dit philosophiquement:
«Elle lui doit bien ça, puisqu’il a sauvé ma tête!»
Hans était donc le héros du duel; tout le monde l’admirait, même la jeune fille, et personne ne lui en voulait; il avait ce que les étudiants du pays appelaient alors «du cochon,» c’est-à-dire de la chance. Quand les Tubingiens furent partis, je dis à Gian qu’il était temps de retourner à Heidelberg.
«Point du tout, cria-t-il, je reste ici.
–Pour quoi faire?
–Pour épouser Lenchen.
–Avec quoi?
–J’ai à peu près cinq mille ducats (une vingtaine de mille francs) en rente de Naples; je vais les vendre. En attendant, prends ceci et tâche de nous faire à Stuttgart un peu d’argent que tu m’enverras.»
Là-dessus il me tendit ses bagues et décrocha la chaîne de sa montre. Je l’invitai à garder sa bijouterie et, de peur qu’il ne fit quelque sottise, je pris le parti de ne point le quitter. Il tenait de la bonne fée qui lui avait ouvert les yeux des émotions vives, mais courtes. Fort agité après son duel, il consentit à faire une promenade dans la campagne; après un quart d’heure de marche, il était gai comme les oiseaux qui s’égosillaient dans les buissons. Pour faire comme eux, il se mit à répéter les chants d’étudiants qu’il avait entendus la veille; seulement, en passant par sa bouche, ces marches funèbres hâtaient le pas, couraient la poste, prenaient des ailes, voletaient, dansaient. Puis il se roula dans l’herbe et s’endormit profondément, car il s’était levé beaucoup plus tôt que d’habitude. Je le laissai couché à l’ombre touffue d’un tilleul et je rentrai à l’auberge dans l’intention d’y chercher Lenchen et de causer avec elle très sérieusement. Quand je traversai l’allée, je passai devant la Chouette et Hans, qui ne se quittaient guère; je n’entendis que la fin du duo: 1
«Digne monsieur Schloukre, vous viendrez donc à Bonn?
–Oui, chère madame Pfennig, je viendrai.»
Lenchen, assise près d’une fenêtre, faisait tourner son rouet en chantant la chanson de Marguerite; je la regardai un instant, et je crois bien qu’elle sentit mon regard; en tout cas, elle tressaillit et son visage prit une expression qui me fit penser à Diane surprise au bain, honteuse et fâchée. Elle rentra dans sa chambre et je me repentis de mon indiscrétion: je savais déjà que les femmes n’aiment pas qu’on les voie quand elles se croient seules: elles s’imaginent qu’on a découvert ce qu’elles pensaient. Cependant, une minute après, Lenchen était descendue au jardin, où elle vint droit à moi pour me demander sans préambule:
«Pourquoi me regardez-vous?»
Je pensai qu’elle voulait un compliment, et j’allais le lui tourner; il paraît qu’elle lut dans mes yeux, car elle me dit avec un petit sourire un peu brusque:
«Pas de galanterie, monsieur le Français; ici, c’est de l’esprit perdu. Je vois que vous m’observez et que vous ne m’aimez pas,–non, vous ne m’aimez pas et vous n’aimerez jamais aucune femme: vous êtes trop curieux pour cela. Mais vous avez la tête d’un honnête homme et vous m’inspirez de la confiance. Asseyons-nous là et causons.»
Elle me conduisit vers un petit banc caché derrière un rideau de charmes. Là elle reprit avec abandon:
«Vous voulez savoir qui je suis, je vais vous le dire. On prétend que les filles ressemblent à leur père; le mien, simple ouvrier, tenait à s’instruire et serait devenu savant s’il avait vécu. Mais fatiguer ses bras tout le jour et sa tête toute la nuit, c’est trop pour un homme. La phtisie le prit et consuma aussi tous mes frères et sœurs, qui sont morts. Le pauvre saint homme, qui m’avait appris beaucoup de choses les dimanches, me légua ses goûts et ses livres; je les ai tous lus plusieurs fois. Ma mère, une vaillante femme dont vous vous moquez à tort, –ne le niez pas, je suis curieuse aussi, et je regarde,–ma mère ouvrit une auberge qui prospéra; cette maison qui lui appartient, elle l’a construite pierre par pierre, et c’est de la poésie aussi, je vous en réponds. Hier soir, quand les étudiants chantaient, je pensais à elle, en écoutant ces’ paroles:
Nous l’avions bâtie
La blanche maison…
–Et je vous ai vue essuyer une larme…
Et vous vous êtes moqué de moi. Je vois tout et je me suis avisée que vous n’aimiez pas mes mains rouges. Savez-vous pourquoi vous ne serez jamais amoureux?
–Vous me l’avez déjà dit…
–Je ne vous ai donné qu’une raison; en voici une autre qui vous flattera davantage, c’est quevous avez trop d’esprit. Vous cherchez partout des contradictions qui vous amusent. Dans votre opinion, les mains rougies ne vont pas avec les cheveux dorés. Vous tracez avec la canne que voici une ligne sur le sable et vous dites: «Ici est la poésie, ici la prose.» Vous ne voulez pas que l’un et l’autre soient ensemble et ne fassent qu’un.
–Ne fassent qu’un? par exemple!
–Vous voyez bien, vous vous récriez. La poésie pour vous flotte toujours en dehors et au-dessus de la vie, et-vous-ne vous doutez pas qu’elle est dans la vie même, que l’acte le plus vulgaire en est plein, pourvu qu’on y mette un peu de cœur. Vous n’admettez pas qu’une pauvre fille cause quelquefois avec ses mains, comme faisait l’empereur Chademagne, et qu’elle leur dise: «Toi, tu serais Manche si je voulais? il suffirait de te laisser oisive, de te frotter le soir avec un onguent quelconque et de t’enfermer dans des gants pendant huit jours. –Oui, répond la main, mais, si tu veux m’épargner, que deviendra la propreté du ménage, honneur de la maison? Les servantes n’en ont cure: il faudra que ta mère fasse tout: elle est déjà lasse, ta mère, et, si elle avait voulu garder des doigts pâles, tu n’aurais ni ton piano, ni tes dentelles, ni tes heures de recueillement et de liberté.» Voilà la chanson de la main rouge. Avouez que si c’était dit en jolies strophes, ce ne serait pas si mauvais.
–Au fait, on a bien mis en vers le carré de l’hypoténuse.
–Vous n’êtes pas encore converti? Peu importe au fond, si vous vous sentez heureux comme vous êtes. Nous, pour être heureuses, nous devons mettre du beau partout. Aimer ce qu’on fait, c’est toute la sagesse et toute la poésie de la vie. Le malheur est que, même occupée, la vie est longue, quand on est toute seule; on a trop de temps pour penser; la pensée se fatigue, s’endort, et quand elle dort, elle rêve. Voilà pourquoi l’autre jour, à Heidelberg, j’ai fait comme les petites filles, j’ai interrogé une marguerite au bord du Neckar. C’est alors que j’ai vu votre ami, une belle tête italienne. Il est venu au bon moment, et j’ai cru l’aimer.
–Vous ne l’aimez donc pas?
–Oui et non, laissez-moi tout vous dire. Le soir, en dansant avec lui, je me croyais sienne, mais j’ai passé trois jours sans le voir et j’en ai conclu qu’il ne pensait plus à moi. C’est que, dans le métier que je fais, je vois ici beaucoup d’oiseaux de passage et plusieurs d’entre eux, en se posant une heure sous le toit, avaient entonné pour moi la chanson que vous connaissez tous. Après le premier couplet, ils se sont envolés, sans rien laisser ici qu’une chose légère, la trace d’une aile. Quand vous avez passé l’autre hier à Degerloch, un soir de pluie, nous étions sorties ma mère et moi. Quand je l’ai revu hier, c’était dans un mauvais jour; je sais mes défauts; le plus gros, c’est l’orgueil. Que voulez-vous? on m’a gâtée. Ma mère ne voit que par mes yeux, je passe pour un phénix dans le village. La vérité est que je suis une petite luciole volante, et que je brille beaucoup ici parce qu’il y a beaucoup de nuit. J’ai l’air de savoir bien des choses, mais je ressemble à la bibliothèque de mon père, où il y a du latin, même de l’hébreu, mais bien des vides et quantité de livres dépareillés. Puis rien n’est rangé dans ma tête…»
M’étant toujours défié des femmes,–en quoi j’ai eu tort: il y en a pour le moins deux qui ne m’ont jamais trompé,–je me demandai pourquoi cette jeune fille, à première vue, se confiait si ingénument à moi; je cherchais des dessous et j’en trouvais mille. Elle continua:
«Hier donc, j’ai voulu plaire à votre ami, je lui ai montré mes petits talents, j’ai mis ma robe bleue, j’ai servi les étudiants, ce que je ne fais guère, parce qu’il était là et que je me sentais admirée; j’ai remarqué sa tristesse quand on a mis un pilus sur ma tête, et sa jalousie ma fait plaisir; je l’ai vu accourir à ma défense et son indignation m’a rendue fière; je me serais sentie fort humiliée s’il ne s’était point battu pour moi. Tout cela est fort mal. La nuit porte conseil; je tremblai pour lui ce matin en pensant qu’il pouvait être défiguré par une balafre au visage; c’est pour lui que j’avais cueilli une branche de laurier,–et, s’il n’y avait pas eu là-haut tant de monde, je l’aurais attachée à son front, non à celui du bon Hans. Tout à l’heure encore, je pensais à lui en chantant la chanson de Gretchen:
Quand il n’est pas là, c’est pour moi la tombe,
Et le monde entier m’est amer.
Voilà pourquoi vous m’avez si fort troublée en me regardant.–Eh bien? non, je ne l’aime pas: ce mariage est impossible.
–Voyons, ma chère enfant, raisonnons.
–Oui, raisonnons, reprit-elle fort agitée. Vous êtes mon ami, mon seul ami (et elle me prit les deux mains), raisonnez pour moi, je m’y perds. Dites-moi que c’est impossible: s’éprendre d’un homme, parce qu’il a de beaux yeux noirs, n’est-ce pas que c’est bête et lâche? Que sais-je de lui? qu’il est pauvre? tant mieux; je ne voudrais jamais d’un riche. Mais qu’y a-t-il dans son âme, je n’ose y regarder. Toutes ses impressions ont l’air d’être des ressouvenirs: il me parle en citations, m’appelle Charlotte ou Dorothée. Mais ma vie, ma vie entière qu’il me demande, qu’est-ce qu’il en fera? Voit-il quelque chose dans ce long chemin où il se lance étourdiment? Se doute.-t-il seulement de ceci, que, pour vivre ensemble, il ne s’agit pas seulement d’unir du blond et du noir, mais qu’il faut avant tout deux pensées, deux consciences pleinement d’accord: non l’illusion, l’émotion d’un jour, mais ce profond respect mutuel qui reste, dure sans fin, survit à tout, jeune encore sous des cheveux blancs, beau toujours, même après la beauté morte? Non, il ne le sait pas, c’est un enfant. Sauvez-nous l’un et l’autre, moi de lui, lui de moi qui demain le mépriserai peut-être: je me sens déjà plus forte que lui, plus mûre, et je ne veux pas d’un homme pour le dominer. Si je me donne, ce ne sera jamais qu’à un vainqueur.»
Tout cela, outre beaucoup de choses qu’elle me dit, me parut très sage et très digne; je remarquai que, dans sa tirade, elle était revenue du français à l’allemand, ce qui était une preuve de sincérité. On n’est tout à fait vrai que dans sa propre langue.
«Je crois, lui dis-je, que vous avez du sens et du cœur; de plus, il me plaît de vous entendre parler si bravement d’amour et de mariage; les jeunes filles du monde où j’ai vécu ne m’y avaient pas habitué. Il est certain que, pour vous, en ce moment, Gian est trop jeune, un défaut dont il guérira vite: encore faut-il qu’il en soit guéri. Seulement le difficile sera de lui faire entendre raison. Si je lui répète ce que vous venez de me dire et comme vous me l’avez dit, il se mettra en éruption, car il a l’image nation vésuvienne. C’est un méridional qui, au pays du soleil, s’est épris de la lune: il est venu ici pour la voir et il croit l’avoir trouvée, je ne lui connais pas d’autre opinion. Comme les trois quarts des Italiens, il n’a pas de religion. Quand il entra au collège, il mit sa conscience en dépôt dans la main d’un moine, qui en prit soin; en le quittant, il a oublié de se la faire rendre. La philosophie est pour lui une bulle de savon; il est très vertueux, parce qu’il vit dans le froid des nuages, mais il n’a aucune idée en morale, ne sait rien des hommes, encore moins des femmes, et n’a jamais pensé au lendemain. Au demeurant le plus sympathique, le plus passionné, le meilleur fils du monde. Pour le détacher de vous, je ne vois qu’un moyen, le jeter dans une lubie, le faire passer, par exemple, du blond au noir. Je connais justement à Heidelberg une brune assez alerte…
–Non! s’écria Lenchen.
–En ce Gas, cherchons autre chose, essayons de le dégoûter de vous.. Si je lui disais par exemple que... vous aimez le vieux Hans.»
Je pensais la faire rire, elle devint plus sérieuse.
«Ne jouons pas à ce jeu-là, me dit-elle, on risque d’y perdre. J’avais à Plieningen une amie qui, pour décourager un soupirant ou peut-être pour l’attirer, feignit de s’attacher à un autre. Eh bien! elle a fini par épouser cet autre, qui la bat tous les soirs en sortant du cabaret.
–Craignez-vous, repris-je en riant, de vous attacher au vieux Hans?
–Pourquoi non?
–Il est laid, lent, lourd.
–Il pare assez bien les coups de rapière.
–Regardez-vous donc près de lui dans une glace.
–On ne passe pas sa vie à se regarder. Il y a des beautés qu’on ne voit qu’en fermant les yeux.
–Et en se bouchant le nez. Hans a toujours la pipe à la bouche.
–Je suis faite à cette odeur. Si vous l’observiez en dedans, vous verriez des choses qui vous frapperaient d’admiration. Je le connais beaucoup, il venait ici quelquefois quand il était à Tubingue. C’est un enfant trouvé, ramassé dans la rue: on le mit à l’école, où il devint myope à force de lire; depuis lors et jusqu’à présent (il a passé la trentaine), il n’a fait qu’étudier. Il n’a pas d’argent et ne se soucie pas d’en avoir. De quoi vit-il? on l’ignore; je sais seulement qu’une fois il est resté huit jours sans manger. Sa chaussure ne lui coûte rien, il donne des leçons de sanscrit au fils d’un bottier de Manheim. Je ne lui ai jamais connu d’autre habit que celui qu’il porte en ce moment. Au cabaret, à l’auberge on se ferait scrupule de lui apporter la carte à payer. Mendiant! dites-vous avec mépris, parce que ce n’est pas dans vos mœurs.–Oui, mendiant comme Homère.»
Elle s’exaltait et allait s’éprendre tout de bon du vieux Hans. Je détournai le courant par cette question nette:
«Que faut-il dire à Gian?
–Dites-lui qu’il mûrisse. Je ne veux pas le voir, encore moins lui parler moi-même; je faiblirais peut-être, et il ne le faut pas. Puis ma mère m’a défendu de l’écouter, et je dois obéir à ma mère. Elle va venir me chercher pour faire des visites d’adieu, car nous quitterons bientôt Degerloch: elle veut retourner à Bonn, où elle est née. Dites-le à votre ami, mais qu’avant de venir à Bonn il ait fait quelque chose pour lui et pour moi. qu’il ait étudié, travaillé, qu’il soit au moins. docteur en philosophie!»
En ce moment, Frau Pfennig apparut au fond du jardin, en chapeau jaune et en robe rose; elle faisait de grands efforts pour introduire ses grosses mains dans des gants noirs.
«Adieu! mon meilleur ami, me dit Lenchen: vous m’écrirez, n’est-ce pas, et vous me parlerez de lui?»
Elle ajouta d’une voix très émue:
Lebe wohl, lebe wohl, mein Freund!
Muss noch heute scheiden.
Puis elle m’embrassa très sérieusement. Je n’ai pas la fatuité de croire que ce baiser fut pour moi, mais cela fait toujours plaisir.
Quand Gian revint après un bon somme, il me trouva fort embarrassé; je ne savais trop comment lui communiquer l’étrange et compliqué message de la jeune fille. Je craignais de le fâcher, on de l’affliger, ou de passer à ses yeux pour un faiseur de dupes. Le moyen, en effet, de faire comprendre à un amoureux, à un Italien, un raisonnement comme celui-ci:
«Elle t’aime, mais ne veut pas t’aimer encore, sa mère le lui a défendu; elle te prie donc de t’en aller. Elle part pour Bonn, où elle emmène ton ami Hans, et te permet de l’y rejoindre, mais à une condition, c’est que tu sois docteur en philosophie; sinon, non.»
Tout cela manquait de suite; il me fallut beaucoup de bourre pour calfater la barque et la mettre à flot. A mon grand étonnement, Gian partit d’un éclat de rire:
«Docteur en philosophie! s’écria-t-il, pas autre chose? Mon Dieu! rien n’est plus facile. Retournons à Heidelberg.»
Je payai la note de l’auberge, non sans remarquer qu’on y avait mis le Frühbier des Tubingiens; il paraît que c’est moi qui l’avait offert. Gian allait prendre congé de Hans qui était en train de disséquer une poule en buvant et en fumant.
«Mon ami, lui dit-il, je suis le plus heureux des hommes et je le dois à toi; je n’oublierai jamais que tu m’as sauvé la vie. Lenchen m’a donné sa foi, à la condition que je sois docteur en philosophie; je le serai d’ici à trois mois. En attendant, je retourne à Heidelberg pour préparer ma thèse. Donne-moi un sujet.
–Laisse-moi y réfléchir, répondit Hans, qui devint rêveur et garda le silence pendant vingt-cinq minutes. Après quoi, il reprit:
–J’hésite entre deux questions très importantes; l’une est philosophique et la voici: de la Transsubstantiation dans ses rapports avec la Métempsycose. Mais tu es trop ignorant, ce serait difficile pour toi. L’autre question est philologique, très simple et particulièrement séduisante: de la Déclinaison du substantif dans la langue d’oïl, notamment dans le dialecte picard…
–Va pour la déclinaison,» dit Gian.
Et nous partîmes. Hans ouvrit une fenêtre et nous rappela.
«Étudie bien, cria-t-il, les types de flexion.
–Je n’y manquerai pas,» répondit le Lucanien, qui fit une cabriole.
Le retour fut d’une gaieté folle: nous bouffonnions comme des écoliers. A Stuttgart, nous vîmes, au coin d’une rue, un harpiste aveugle qui égratignait de ses doigts calleux l’ouverture d’Oberon. C’était un jour de fête; le soleil ruisselait sur la foule endimanchée qui sortait d’une église. Gian prit la harpe du musicien et, la maniant en maître d’une main légère et frémissante, il chanta des airs de son pays. On s’amassa pour écouter ce beau jeune homme qui avait tant de caresses dans les yeux et dans la voix; la quête fut superbe et enrichit pour longtemps l’aveugle. Un carrosse aux armes royales s’était arrêté derrière la foule; Gian se présenta résolument à la portière, le chapeau à la main:
«Qui êtes-vous donc? lui demanda une belle princesse qui le regardait avec étonnement.
–Pour le moment, madame, je ne suis rien, mais dans trois mois je serai docteur en philosophie.»