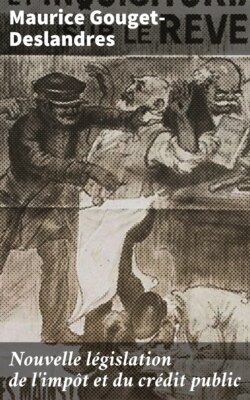Читать книгу Nouvelle législation de l'impôt et du crédit public - Maurice Gouget-Deslandres - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE PREMIER.
ОглавлениеTable des matières
Du budjet. — L’impôt n’est qu’une avance. — Du principe de l’impôt. — Des finances anciennes. — Des finances modernes. — Sur la réduction des rentes anciennes. — De l’atteinte portée au crédit. — Du gouvernement irrégulier en matière de finances. — Dernier mot sur le budjet.
TANDIS que la discussion s’établit de toutes parts sur le budjet, c’est-à-dire, sur la somme qui doit être imposée, sur le mode de contributions et sur les résultats que peut produire la loi importante que l’on attend de la sagesse et d’une lente méditation; pendant que cette matière, si intéressante pour la société, occupe tous les économistes, qu’elle réveille l’attention de nos écrivains, sera-t-il permis à celui qui a écrit, il y a près de trente ans, sur le système de l’impôt , de reproduire ses idées, et de présenter à l’attention du public quelques nouvelles discussions sur cette partie si difficile de l’administration? Soutenu par la pureté de ses intentions, il osera entreprendre de traiter encore des rapports de l’impôt avec tous les liens de la société. En effet, il est impossible de proposer un plan de finances sans le rattacher à toutes les considérations qui tiennent à un système plus vaste, sans le rapporter au crédit public; il faut composer de toutes les parties un ensemble, et n’en faire plus qu’un seul édifice: autrement, le but est manqué.
On a besoin d’une longue patience; il faut plusieurs tentatives, il faut soutenir bien des combats, pour faire réussir une idée neuve, et pour disposer les esprits à adopter un plan généreux: que de persévérance, que de courage il faut avoir! que d’assauts il faut soutenir pour ne pas se laisser abattre par le dédain de tous les administrateurs qui repoussent tout ce qui ne vient pas d’eux, et qui n’ont de confiance que dans leurs propres conceptions! C’est par une telle insouciance, c’est par l’effet de cet orgueil inné dans ceux qui ont le pouvoir et les places, qu’ont péri les finances du plus beau royaume: cependant c’est au milieu de nos ruines, c’est en présence de ces hommes qui ont creusé devant nous tant de précipices, qu’il faut prendre une résolution. Ce n’est plus le moment de s’agiter pour se combattre: le temps s’écoule; il consume tout: nous pouvons périr si on ne se hâte de recourir à des remèdes violens, si on refuse d’abord de se réunir et de s’accorder; enfin, si on tarde d’en appeler aux véritables et aux seules ressources: heureusement elles ne sont point encore toutes épuisées. Devant le saint amour de la patrie, que les passions se taisent, que la plus parfaite harmonie règne au milieu de ceux chargés de ses intérêts les plus chers, et que, de l’accord universel qui fera le désespoir de nos ennemis, résulte enfin pour cette grande nation si cruellement et si long-temps agitée, la sécurité permanente dont il faut qu’elle jouisse et dont elle est digne!
Habitans des campagnes, propriétaires, cultivateurs, manufacturiers; vous tous qui formez la partie la plus active et la plus précieuse de la société, on vous offre des réflexions sur la dette la plus sacrée, sans doute, que tout individu contracte envers l’état. On va parler de l’impôt et du système général de l’impôt.
Lorsqu’on s’est appliqué à étudier cette partie difficile de l’administration, on trouve d’abord que les contributions de toute nature, quelque onéreuses qu’elles paraissent, ne sont cependant qu’une avance que l’on fait au corps politique. Cette vérité est fondée en principes; mais, pour les accréditer et pour obtenir les bienfaits de leur application aux choses, on a cru qu’il n’y avait pas de mesuré plus efficace que celle qui dirige tous les hommes, l’AMOUR DE SOI; et on a jugé que la loi la plus salutaire pour arriver au but, serait celle qui assurerait aux cultivateurs les fruits de leurs travaux; aux propriétaires, les jouissances de leur propriété ; aux industrieux, leur subsistance, leurs bénéfices, et une aisance assurée pour la vieillesse; que ce serait celle qui rendrait les habitans d’un même état solidaires de tous ces avantages les uns envers les autres. Ne serait-elle pas une belle loi de finances et une belle loi d’économie politique, celle qui aurait pour but la réparation ou l’indemnité de tous les désastres que les gelées, la grêle, le feu, les inondations, ont jusqu’à présent répandus sur les propriétés de ceux qui en ont été les victimes?
Appelés désormais, dans la personne des députés des départemens, à la formation du système; assurés que l’impôt ne sera employé qu’à sa destination, convaincus qu’il ne sera proportionné qu’aux besoins, et qu’il peut devenir le dispensateur de tous les autres avantages de la société, nous ne pouvons plus avoir de motifs pour nous refuser de coopérer à une dépense parfaitement commune, qui seule peut assurer la liberté publique avec la liberté individuelle; qui peut nous garantir les productions de la terre et les jouissances de l’industrie qui, dans quelques mains qu’elles se trouvent placées, constituent le domaine de ce beau royaume.
Au défaut de l’exercice d’une puissance publique, ne pourrait-on pas être exposé à voir détruire et ravager nos campagnes, à voir enlever nos troupeaux, incendier nos habitations? Ce sort est réservé au peuple qui ne s’est pas constitué de manière à posséder un trésor public qui lui suffise pour salarier ceux qui sont appelés à servir l’état et à assurer la tranquillité de la société : Nec quies gentium sine armis, nec arma sine stipendiis, nec stipendia sine tributis. (Tacite) Hist. lib. 4. )
Exister sans représentation nationale, sans monarque, sans armée, sans magistrats, sans police, sans lois protectrices et répressives, ce n’est plus l’ordre social: comment alors se garantir des maux de l’anarchie qui dévore tout? comment se défendre de tous les malheurs qui nous ont si cruellement accablés pendant l’absence du gouvernement paternel et légitime?
On ne le met point en doute; personne n’aura plus l’intention de se dispenser de payer les différentes contributions, lorsqu’elles seront bien assises, lorsqu’elles auront été librement consenties; mais, si un nouveau plan de finances pouvait être établi sur des moyens qui pussent en faire un système protecteur de toutes les fortunes, de toutes les prospérités, le salut de l’état serait dès-lors certain.
L’ÉDUCATION des peuples, ce bienfait de la paternelle sollicitude des rois, résultat de cette instruction qu’ils ont protégée et qu’ils ont fait répandre, doit produire ces heureux avantages. Notre monarque règne sur des peuples éclairés, faits pour jouir d’une liberté sage; il est convaincu que la force des nations existe dans le dévouement à la chose publique. C’est à Sa Majesté, qui place la véritable grandeur dans ce sentiment sublime, qu’il appartient de vouloir un plan de finances qui aurait pour objet principal de présenter des motifs de consolation, et pour celui qui est chargé de faire percevoir les contributions, et pour le peuple qui doit en supporter le poids.
Lorsque l’esprit de conquête faisait l’unique grandeur des monarques, ils étaient obligés de s’attacher exclusivement à l’art de commander les armées, à la science de créer des soldats. Souvent les limites trop resserrées des différens royaumes, la stérilité des terres, l’excessive population, l’âpreté des climats, toutes ces choses pouvaient faire considérer comme vertus les actes de la violence qui tendaient à se procurer ce que la nature avait refusé.
Mais dans un pays tel que là France, qui réunit encore à son étendue actuelle et à sa position topographique, une grande fertilité, une belle température, et tous les avantages d’une population en rapport avec son territoire; dans un tel pays, la science des rois ne doit plus embrasser que deux grands objets, celui de se faire respecter au dehors, celui de se faire vénérer au dedans par tous ceux qui mettent leur confiance au pied du trône, et qui la placent dans la sagesse des lois.
Sans doute, c’est de la sagesse de l’administrateur que dépendent aujourd’hui le bonheur des peuples et les jouissances des princes appelés à gouverner.
Tout nous dit que les regards de l’auguste chef du gouvernement, fixés avec bonté sur toutes les institutions, pour y porter ce qui appartient à l’esprit d’économie, d’ordre et de justice, et pour le diriger; tout nous assure que, débarrassée de cette pompe inutile, funeste aux vertus, réprouvée par Sa Majesté, elle pourra, par le résultat d’une administration paternelle, obtenir toutes les jouissances qui ne se rapportent qu’au bonheur des hommes.
Sa Majesté sachant parfaitement qu’un système de finances doit influer immédiatement sur tout ce qui constitue les avantages de la société, sur l’agriculture, sur l’industrie, sur les relations politiques, devait s’attendre que dans des circonstances aussi graves, aussi pénibles peut-être que celles où se trouve l’état, son ministre des finances présenterait les bases d’un édifice qui offrirait tous les moyens de soutenir le courage de la nation et de ressusciter le crédit.
On n’a vu, dans la proposition du ministre, qu’une énumération des sommes nécessaires pour couvrir l’arriéré de la dette, pour répondre aux dépenses de l’année courante, et, à la vérité , les moyens de former, mais avec trop peu de largesse, une caisse d’amortissement, ce qui tiendrait déjà tant soit peu à un commencement de système de nuances; mais ce qui est encore fort loin de pouvoir le compléter.
On a vu, dans ce qu’on appelle le budjet, une demande de plusieurs impôts disséminés et sur les matières premières, et sur les objets de consommation; on y a vu une augmentation sur tous les anciens impôts: c’est un propriétaire qui renouvelle ses baux, qui augmente le prix annuel de ses fermes, qui se fait donner de gros pots-de-vin, et qui ne s’aperçoit pas qu’il enlève à son fermier tous les fonds d’avance si nécessaires à une exploitation, et qu’il sera ruiné avant la troisième année du bail.
Un tel budjet n’est point un système de finances: dans ce moment toutefois, il devait être au moins l’énumération de tous les moyens de protection, de circulation, de reproduction qu’on pouvait mettre en mouvement, et dont nous avons un besoin si urgent pour plusieurs années, puisque sans eux, il sera impossible, on ne dit pas seulement à la bonne volonté des citoyens, mais à leur dévouement le plus entier, de satisfaire aux contributions qui vont peser sur eux pendant cinq ans.
Si un budjet est le tableau des dépenses et des ressources, il est aussi un travail qui doit avoir pour objet de présenter la comparaison de l’état précédent du trésor avec sa situation actuelle, et encore mieux de développer les conséquences à tirer du système de finances qui existe: or, ces comparaisons ne peuvent point encore avoir lieu, puisqu’il n’y a pas en France un plan établi et soutenu dont on puisse suivre et juger les effets par son application aux choses. Ce budjet ne peut être encore aujourd’hui qu’un compte rendu, parce que, jusqu’à ce que nous nous soyons donné une réelle consolidation par un plan de finances, il sera impossible de faire l’exposition des effets bons ou mauvais qu’aurait pu produire un système qui n’existe pas.
Un plan de finances est cependant ce que semble exiger l’opinion publique, qui se plaint hautement de ce qu’on ne fait en France que se traîner depuis des siècles dans la même ornière. Tant qu’on a pu vendre, on a vendu; tout ce qu’on a pu emprunter par la création et la distribution du tiers consolidé, on l’a emprunté ; tout ce qu’on a pu rejeter des liquidations a été l’objet des atermoiemens: on a renvoyé à des temps plus heureux le paiement des dettes, comme si ces temps plus heureux étaient à notre disposition, et que nous puissions, par notre seule volonté, nous défendre de la dépense imprévue que peut occasioner une guerre.
Un bon plan de finances ne peut sortir que d’un tout autre mode de consolider la dette, et surtout d’un système régulier pour les impositions. Les contributions qu’exigent les circonstances dans lesquelles la nation française se trouve engagée, seront sans doute long-temps fatigantes et beaucoup trop pesantes pour la nation déjà épuisée par vingt-cinq ans de malheurs: cependant, s’il est besoin d’exemples et de faits pour encourager à supporter le poids de la dette, nous devons jeter les yeux sur toutes les charges que d’autres peuples ont été condamnés à supporter, et qui entrent autant dans l’histoire de leur épuisement, que dans celle de leur dévouement et de leur amour pour leur gouvernement.
L’homme réuni en société doit savoir qu’à la somme de ses besoins privés il doit ajouter celle des besoins publics, et que c’est un devoir sacré que d’y pourvoir.
Mais c’est toujours moins le poids de l’impôt que l’inégalité de sa charge qui chagrine et qui révolte. Les impôts, dans un état, sont les voiles d’un vaisseau, pour le conduire, pour l’assurer, pour l’amener au port, mais non pas pour le trop charger, pour le tenir toujours à la même hauteur en mer, et enfin pour le faire submerger. Il est un principe, que quand l’état proportionne sa fortune à celle du peuple, l’aisance du peuple fait bientôt monter la fortune de l’état: quand cette justice distributive est rendue, tout citoyen reste pénétré de cette vérité, que plus il possède, plus il doit payer, parce que plus il possède, plus il sent qu’il est intéressé à la conservation de la chose publique: tandis que, lorsqu’on ne gouverne à l’égard des impôts que par l’absence de toute justice, la défiance et la haine du fisc affaiblissent et finissent par anéantir l’esprit public, et font perdre absolument de vue les précieux rapports qui doivent exister entre le trésor de l’état et l’intérêt commun de la société.
Sully, en traitant des finances, disait en propres termes: «que c’était le point le plus essentiel et le plus intéressant d’un gouvernement; que c’était par le moyen des finances que l’on faisait tout; que sans elles on ne saurait rien faire; que de là dépendait le soulagement ou l’accablement des peuples; que de là dérivaient les bons et les mauvais succès des desseins et de toutes les entreprises; que l’état des finances était ce qui causait ou la grandeur ou la ruine des empires.»
On se plaint des impôts: mais les impôts ont été institués avec le premier gouvernement. Le premier gouvernement a dû être le premier berceau de la science économico-politique. Quand les gouvernemens n’avaient pas un revenu privé et patrimonial, ou quand les gouvernemens ne savaient pas faire suivre leurs conquêtes par des contributions levées sur les peuples vaincus, ils étaient réduits à surcharger les leurs.
Les annales de l’histoire font remonter bien haut l’établissement des impôts. Ils étaient immenses chez les Babyloniens; l’histoire n’en donnerait pas le témoignage, qu’elle le ferait toujours supposer, quand elle nous rend compte du luxe et des dépenses étonnantes fournies par ce peuple. Les immenses frais qu’avaient entraînés l’établissement des routes, celui des levées et des ponts, ces quais si magnifiques établis sur les bords de l’Euphrate, les monumens de Babylone, ses murs, les jardins de Sémiramis et tant d’édifices superbes, tant de monumens dont les seuls vestiges ont étonné le monde, tout donne la preuve que ces peuples étaient prodigieusement imposés.
En 1520 avant l’ère chrétienne, Sésostris, qui voulait apporter quelque soulagement à ses états beaucoup trop surchargés, faisait contribuer l’Éthiopie et une partie de l’Inde: la Judée même fut rangée au nombre de ses tributaires. Si c’était là un soulagement pour les peuples d’Égypte, d’autres peuples en étaient foulés davantage, et la Judée n’en payait pas moins les tributs consolidés sur la dîme de tous les fruits de la terre, et sur la production de tous les animaux. On lit au Livre des Rois: Hic erit jus regis qui imperaturus est vobis, et segetes vestras et vinearum reditus addecimabit, et greges quoquè vestros addecimabit.
La république d’Athènes et toutes celles de la Grèce n’étaient point exemptes de l’impôt; il était porté sur les terres, sur les marchandises, sur toutes les consommations; les contributions y furent même élevées à une hauteur prodigieuse au temps où Athènes se rendit la métropole de la Grèce. Xénophon, Démosthène et Pisistrate s’en expliquent. Ces historiens nous apprennent que l’accroissement de l’impôt devint si prodigieux pour ces pays réunis, qu’on fut obligé d’opposer au mécontentement général l’administration d’un sage; il n’en fallut pas moins pour obtenir le consentement du peuple à payer l’impôt.
Ce fut Aristide qui fut chargé de cette répartition: les historiens du temps nous instruisent qu’il s’acquitta avec tant de justice de la tâche honorable qui lui avait été confiée, qu’il obtint les applaudissemens du peuple. Son système d’imposition fut si parfait, qu’il eut l’avantage de plaire, et même de devenir si agréable à toute la Grèce, qu’Aristide en obtint une si grande popularité , que les républicains farouches disaient de lui: Nous sommes las d’entendre toujours citer sa probité.
Les Romains, qui envahirent toute la terre, établirent quelques principes réguliers sur les impôts. Cette régularisation ne devint indispensable que parce qu’ils étaient déjà immenses et d’un poids insupportable. Le trésor public était déposé dans le temple de Saturne ouvert à tout le monde, afin que le peuple pût savoir ce que devenait le produit des impôts, tant on redoutait l’effet du mécontentement qui pouvait résulter de l’idée qu’il était possible d’en abuser, et de le dissiper par des profusions.
Servius Tullius, sixième roi de Rome en l’an 577 avant l’ère chrétienne, fit faire un dénombrement des terres et des richesses de toutes les classes de citoyens, afin d’établir la balance la plus sévère dans la répartition de l’impôt.
Dans des temps moins éloignés, sous les règnes de César et d’Auguste, on forma un cadastre, afin d’assurer à tous les contribuables une division plus parfaite et plus équitable de toutes les contributions publiques: c’est qu’on était déjà pénétré de cette vérité, que c’est moins le poids de l’impôt, que l’inégalité de sa charge, qui chagrine et qui révolte.
César nous apprend que les impôts étaient si excessifs dans les Gaules, que les habitans vendaient leur liberté pour s’y soustraire. Ce n’est donc pas de nos jours seulement que l’impôt fatigue et désespère les peuples!
Clovis, après avoir chassé les Romains des Gaules, maintint les tributs publics établis par ces anciens vainqueurs. Mais Clotaire qui éprouva de la résistance pour la levée des impôts, se trouva obligé de convoquer, en 615, une assemblée à Paris: ce roi y reçut les représentations les plus vigoureuses sur les taxes dont le peuple était écrasé. Cela n’empêcha point la continuité de ces taxes. Des impôts de tous les genres, de toutes les espèces, sur toutes sortes de marchandises, furent maintenus et établis. Ces impôts, tous conservés, se trouvent énumérés dans des chartes de Pepin et de Charlemagne.
Louis-le-Jeune fit créer, en 1147, la perception du premier vingtième sur toutes les terres; et la dîme, dite saladine, fut imposée par Philippe-Auguste en 1188: on ajouta même à ces impôts le dixième des biens meubles et immeubles. On exigeait cinq pour cent du capital des meubles, de sorte qu’une commode estimée 100 fr. devait supporter 5 fr. de taxe.
En 1190, les besoins de l’état obligèrent de recourir à de nouvelles taxes, qui furent étendues sur tous les produits de l’industrie, sur tous les moyens par lesquels le peuple pouvait se procurer sa subsistance: on imposa jusqu’aux poules. Ainsi les abus étaient arrivés à leur comble, et ce ne fut que sous saint Louis qu’ils furent réprimés par les sages décrets de ce monarque, publiés en 1254 et 1256. Ce prince compléta ces lois par un règlement général sur la taille, publié en 1270; c’est un modèle de justice et de modération.
Mais bientôt la sagesse du système fut effacée sous le règne de Philippe-le-Hardi. La mobilité de l’impôt, son arbitraire, reprirent leur règne, et de ce système irrégulier sortit la capitation, moyen hardi, sans mesure, par lequel on pouvait frapper arbitrairement chacun des contribuables.
Cependant les mécontentemens se manifestaient, et Louis Hutin, troisième roi après saint Louis, jugeant de tous les effets que pouvaient amener la gravité des événemens et cet arbitraire si absolu, déclara, par ses lettres du mois d’avril 1315, qu’à l’avenir on ne leverait plus de nouveaux impôts que du consentement des Etats Généraux: c’était déjà reconnaître les principes.
Ces principes furent confirmés par son successeur, Philippe-le-Long, en 1318; aussi le premier impôt sur le sel établi par ce prince reçut-il l’approbation des États.
Pendant dix ans les contributions furent très-mobiles; mais le principe fut conservé , et Philippe de Valois le consacra de nouveau en 1328, par un édit remarquable.
Le roi Jean, qui lui succéda, jugea de même qu’il ne pouvait obtenir des impôts que par le consentement de la nation; et lorsqu’il eut besoin d’obtenir de nouvelles taxes, il convoqua les États Généraux à Ruelle. Ce fut à la suite de cette convocation, qui eut lieu en 1355, qu’on ajouta aux autres impôts celui des aides, établi par le moyen des barrières et des séparations de province à province.
Tous ces impôts furent continués sous le règne de Charles V, au moins jusqu’à sa mort, époque où son écomomie l’avait mis dans la possibilité de les réduire. Ils avaient continué d’avoir l’attache des États Généraux: ainsi les principes avaient été respectés sous une autorité sage et prudente.
Mais l’autorité arbitraire reprit tout son empire sous Charles VI. Ce fut sans le consentement des peuples que l’on créa une nouvelle multitude d’impôts. Le duc d’Anjou, régent du royaume pendant la maladie morale de Charles VI, sut abuser de tout. Ce n’était plus assez de maintenir le dixième sur les terres, de maintenir la taxe sur le sel et les perceptions sur les aides, on imposa supplémentairement tous les fruits de la terre, les herbages, les légumes, les œufs, le fromage, etc. Tous ces impôts furent à peu près maintenus sous les trois règnes suivans.
L’un des successeurs de ces rois fut Louis XII. Ce bon prince s’occupa sans relâche de diminuer les taxes. II chercha des ressources ailleurs que dans la subsistance des peuples. Il créa les charges de finances, qui fournirent des capitaux pour les dépenses des guerres. Il versait souvent des pleurs sur les impôts dont les peuples étaient accablés. Charles V, qu’il avait pris pour modèle, avait laissé de grands trésors dans les coffres de l’état. Louis XII voulut le surpasser, il voulut aussi laisser de grands trésors, mais de plus précieux, dans la bourse de ses sujets: aussi l’histoire et la voix des nations, qui enseignent hautement les devoirs des rois, viennent nous apprendre que, tandis que l’on s’attache à relever les faits héroïques des guerriers, les larmes des peuples arrosent la cendre de ces princes qui ont été ménagers de la fortune de l’état, et dont la gloire s’est modestement bornée à consacrer le règne de la prospérité publique.
Mais, abandonnons pendant quelques momens les impôts, les contributions et les moyens qui avaient été jugés convenables pour les créer, pour les lever, pour les augmenter, et plaçons, sous les yeux de nos lecteurs, les faits qui peuvent nous faire remonter à l’origine du discrédit qui a commencé à l’époque même où l’on avait voulu mettre en usage la puissance du crédit, par la mesure des emprunts. Après avoir indiqué à peu près toutes les matières imposables anciennement frappées par l’esprit de fiscalité, pour nous mettre à même de comparer les temps présens avec les temps passés, il est bon de rappeler aux rentiers de l’état combien de fois la rente a subi de ces atteintes qui sont toujours si funestes à la chose publique.
Il résulte, d’un règlement fait par l’immortel Sully en 1604, que, dès 1375, c’est-à-dire sous le règne dé Charles V, il avait été déjà créé des rentes. Ce règlement avait pour objet la vérification de toutes les rentes qui étaient dues par l’état, et celles créées en 1375 s’y trouvent comprises.
Ce règlement n’avait point pour objet de les réduire, à plus forte raison de les supprimer; c’était pour établir de l’ordre dans les finances; c’était pour disposer à l’avance les capitaux assignés aux remboursemens; c’était pour établir le crédit. Les efforts de ce grand ministre furent très-rapidement couronnés d’un plein succès: pourquoi de pareils hommes apparaissent-ils si rarement?
C’est en arrivant au règne de François Ier. que nous touchons plus particulièrement à ce nouveau système des emprunts publics, qui n’avait point encore été trop adopté.
Ce fut en 1552 que ce roi emprunta le crédit de l’hôtel-de-ville. de Paris, pour créer pour 64,000 francs. de rentes environ, le marc d’argent étant de 12 à 14 francs.
Ce fut sous son règne que fut établi le système des douanes, présenté sous le rapport de servir utilement le commerce du royaume.
Ainsi marchaient de front les emprunts et les impôts.
Nous ne parlerons plus guère que des emprunts, puisque nous avons pour objet de faire connaître très-brièvement comment on les a fait tourner au discrédit de l’état.
Henri II créa, à trois différentes fois, de nouvelles rentes. François II en créa à quatre époques différentes, le marc d’argent à 14 et 15 francs.
Le règne de Charles IX. nous donne vingt-sept créations de rentes sur l’état, le marc d’argent à 17 francs.
Le règne de Henri III nous offre sept créations de rentes, le marc d’argent à 19 francs.
Le règne de Henri IV ne présente aucune création de rentes. On reconnaît déjà à ce premier mot l’administration de Sully. Le roi, débarrassé de la guerre intérieure, se hâta de convoquer les Notables. L’assemblée eut lieu à Rouen en 1589. On y détermina les octrois des villes et des bourgs. Sous Henri, les économies de son ministre furent si fructueuses, qu’on put rembourser trois cent millions de dettes, et qu’on racheta pour soixante millions de domaines. Il faut ajouter que toutes les parties de l’administration furent toujours parfaitement bien servies, et que l’éclat de là couronne n’en fut que plus brillant.
Le ministère de Sully fut suivi, après quelque intervalle, d’un autre ministère fameux, celui du cardinal de Richelieu. Ce ministre fut prodigue au lieu d’être économe; il ne s’occupa des finances que pour les consacrer à sa politique. La profusion et les dépenses furent telles, que, suivant M. Talon, on prodigua plus de trésors sous le règne de Louis XIII qu’on n’en avait dissipé depuis l’établissement de la monarchie. Les revenus publics des trois années qui suivirent la mort de Louis XIII étaient plus qu’entièrement absorbés.
Des emprunts. successifs avaient été ouverts en 1621, 1625, 1627, 1630, 1631, 1636. Depuis cette première époque de 1621, on n’avait pas cessé d’ajouter impôt sur impôt, pour se procurer les moyens de couvrir les intérêts de toutes ces nouvelles dettes: ainsi, tandis que d’un côté on empruntait, on créait de l’autre de nouvelles taxes.
On avait hypothéqué les anciennes rentes sur les gabelles et sur les aides; les nouvelles rentes furent hypothéquées sur les gabelles, sur les cinq grosses fermes, sur les aides, et sur les recettes générales.
Les intérêts d’une nouvelle création de rentes faite en 1634 furent assignés sur les gabelles et sur les tailles.
Nous touchons à cette époque où l’infatigable Colbert vint, au milieu de cette ruine publique, rétablir la prospérité nationale. Ce ministre veut imiter Sully; il suit les plans que ce grand homme s’était tracés. Quel encouragement ne donne pas un tel modèle! Aussi Colbert, plein de ce même amour pour la patrie, qui crée une heureuse audace, s’opposa seul à une conjuration presque générale tramée contre les revenus de l’état. Il établit bientôt des règlemens d’équité et d’ordre sur toutes les parties de la finance; il s’occupa ensuite des grandes routes; il fit ouvrir le canal du Languedoc; il ranima la marine, rétablit le commerce de la pêche, celui des colonies; il stimula les arts et les manufactures; et, comme on le dit de ce grand administrateur, il donna à la terre de nouveaux hommes à nourrir, et aux propriétaires de nouveaux objets de jouissance. L’éclat que les finances prirent pendant son ministère a ébloui, même pendant plusieurs années après sa mort.
Mais bientôt l’ordre et l’économie disparurent avec le ministre. On rappela toutes sortes de nouveaux impôts, et surtout cette taxe arbitraire dite la capitation, qui en avait été supprimée.
Les rentes sur l’état n’étaient plus garanties par le consentement du peuple, elles étaient remises entièrement à la disposition des ministres; il n’y avait nulle sûreté nationale pour leur consolidation, nulle assignation régulière pour le paiement dès intérêts; on devait plusieurs années d’arrérages.
Colbert en avait fait racheter intégralement pour beaucoup de sommes pendant les années 1664 et 1665; c’est ce qui fait l’éloge dn ministre beaucoup mieux que l’histoire rendant compte des autres actes de son administration.
On jugea cependant, d’après Colbert, que c’était une chose utile de rembourser les rentes; mais, comment a-t-on mis en pratique ce moyen d’économie? Le voici: on s’occupa de les réduire d’abord de moitié, puis ensuite d’un cinquième sur ce qui en restait. A ces premières réductions succédèrent d’autres réductions: cependant, pendant qu’on procédait à ces extinctions par la violation, par l’arbitraire, on recréait beaucoup d’autres rentes.
Depuis 1668 jusqu’en 1699, on créa pour trois cent trente-cinq millions de rentes à des taux différens. On ne peut pas s’imaginer comment ces emprunts ont pu être remplis, car on avait contracté la désastreuse habitude de réduire les capitaux et les intérêts, quand on ne pouvait point payer. C’était la finance du siècle.
La confiance fut tellement détruite en 1704, que les effets d’une caisse dite d’emprunts perdirent jusqu’à 80 pour cent. On fut contraint de fermer cette caisse, qui avait été ouverte pour recueillir des capitaux dont on offrit inutilement 10 pour cent.
Les édits d’octobre et de décembre 1715 vinrent encore réduire les rentes, qui déjà avaient été fortement diminuées.
Mais en 1721, époque à laquelle la dette publique s’élevait à un milliard sept cent millions, on réduisit encore les rentes au denier quarante, et l’on fut, nonobstant, obligé de recourir à une augmentation de toutes les impositions. Les années se succédèrent au milieu des mêmes désastres. Celles de 1725 et de 1733 ont été marquées par les plans les plus vicieux qu’on exhuma d’anciens systèmes, de tous ceux qui avaient été les plus funestes à l’état. On employa à la fois tous les moyens les plus contraires au crédit: on vendit d’un côté les revenus de l’état à des compagnies qui firent des fortunes énormes: on créa de nouvelles rentes sur les gabelles, sur les tailles, sur les postes: on ouvrit en même temps des emprunts viagers, et l’on imagina le système des tontines.
On était dans cette confusion quand la guerre de 1740 vint redoubler toutes les crises: alors on taxa toutes les charges de l’état; on en créa de toute nature; on établit les communautés de métiers; on érigea en charges plusieurs états mécaniques; on établit des octrois partout, et on imposa la cire, le suif, le papier, le carton et la poudre à poudrer, etc., etc., etc. Cependant, le 21 novembre 1763, on avait eu la sagesse d’imaginer une caisse d’amortissement, et en 1764 on publia un règlement sur cette caisse, qui devait pronostiquer le crédit et réparer tous les malheurs sous lesquels l’état avait fléchi. Mais, en 1770, cette caisse d’amortissement fut fermée. Les épargnes qu’elle avait déjà procurées furent employées scandaleusement à des profusions et à des dépenses sans mesure. Les tontines furent supprimées, converties en rentes viagères, c’est-à-dire qu’on détruisit en un moment la source des emprunts dont le mode était si productif à l’état, puisqu’il le rendait héritier ou donataire des capitaux placés sur lui.
Il n’y a pas de doute que le discrédit de l’état ne remonte à ces époques fatales où déjà les ministres ne rougissaient plus de consacrer par des lois et par des édits publics la déloyauté et des vols manifestement avoués.
Il serait trop long de donner le détail de tous les manques de foi des ministres; mais on ne peut passer sous silence les époques de 1770 et 1771, où l’on porta une si forte atteinte au crédit, par la réduction de moitié d’une grande partie des effets publics, par celle des intérêts d’un très-grand nombre d’autres capitaux, par la suspension du paiement des billets des fermes, des rescriptions, et d’autres engagemens plus respectables encore, tels que les pensions.
Certes, ce n’est point par de telles révolutions en finances que l’on établit la confiance et que l’on fait respecter une nation, lors même que les moyens de s’être approprié des capitaux, auraient pu procurer de grands avantages politiques. Un peuple est toujours plus puissant par son économie et par sa loyauté dans ses engagemens, qu’il ne le devient par des victoires passagères, par des triomphes qui, en laissant la trace des routes par lesquelles on a marché contre l’ennemi, indiquent aussi celles par lesquelles il peut revenir sur le vainqueur.
Mais la main invisible du temps amenera par degrés une nation loyale, qui plus que jamais doit être économe, à obtenir une autorité sur le continent, bien plus durable que cette autre domination qui est le fruit des perfidies et des combats. Cette même main saura abaisser et réduire le peuple qui exerce cette domination, quand il ne doit ses succès qu’à des emprunts et à une dette publique énorme; parce que toute guerre faite avec des impôts et des emprunts, prépare sa ruine, et que les emprunts et les impôts déplacent toujours le travail, et le distribuent d’une manière inégale et oppressive.
Les réductions dont on vient de parler, faites de temps à autre, nous amènent assez rapidement à l’époque de 1786, où les rentes s’élevaient à la somme de cent quarante millions en perpétuel, et à celle de vingt millions en viager.
Cette somme était sans doute très-élevée: mais c’était peu de chose pour un aussi grand état que la France. Cette somme représentait toute la dette qu’il était alors si facile de couvrir et de racheter par la seule abolition des priviléges, et par une parfaite égalité dans la répartition des impôts de tous les genres.
Mais les invitations du meilleur et du plus malheureux des rois ne furent point entendues, et de là cette révolution qui a dévoré inutilement tant de trésors et tant de victimes. C’est ici que toutes les mémoires doivent être fidèles; c’est ici que les reproches ne doivent retomber que sur ceux qui les ont encourus. Si l’on n’eût pas été sourd à des paroles augustes et paternelles, combien on eût évité de calamités et de fléaux! Cette révolution, entreprise dans son principe pour remédier à tous les maux de l’état, et à laquelle tant de passions ont fait prendre une fausse route, qu’a-t-elle produit? une dette plus considérable encore qu’elle n’était en 1786: cependant, c’était pour la payer qu’on distribuait tous les domaines de l’état. Comment cette dette publique a-t-elle été payée?
C’est ici qu’on ne peut point passer sous silence cette loi spoliatrice de Cambon, qui a réduit toutes les rentes à un simple tiers du revenu: c’était là cependant ce que l’on osait nommer un système de finances! Pourrait-on se plaindre aujourd’hui, quand on doit être persuadé qu’on n’osera plus avoir recours à ces honteux et funestes dépouillemens qui amènent la ruine des particuliers et celle des empires?
Le gouvernement qui vient de finir a eu cependant ses jours d’éclat pour les finances, il faut l’avouer: c’est-à-dire qu’il a eu de grands et d’immenses trésors à sa disposition: mais, ce luxe de finances, qu’a-t-il produit? Ce luxe a-t-il été étalé pour payer les créanciers de l’état, pour solder la dette, pour la consolider? Non; on ne reconnaissait sous la domination usurpée qu’une seule nature de dettes, et l’on ne préparait des paiemens que pour les services présens, que pour ceux du moment. Les dettes anciennes et les salaires des anciens services étaient ajournés indéfiniment, par la force, par la violence, par la puissance d’une tyrannie qui ne devait plus avoir de bornes que celles où se serait arrêtée l’ambition de celui qui l’exerçait si audacieusement.
Sous le règne de cette tyrannie si honteusement tolérée, et avec d’immenses trésors, indignes fruits de guerres injustes, on n’a pas su se conduire différemment que sous les gouvernemens transitoires qui l’avaient précédé. Cependant, à entendre les ministres de Bonaparte, celui des finances, celui de l’intérieur, tout prospérait par la guerre; la population se développait par la conscription; l’État était heureux et florissant. Sans doute que ces Excellences plaçaient l’État tout entier dans leurs domaines, dans leurs palais; que, selon eux, la prospérité de la nation et le crédit public existaient dans la jouissance de ces dotations acquises parle sang des peuples, vendu et livré à leur maître. O honte! ô scandale!... Etait-ce donc là le crédit? Est-ce encore le crédit après lequel soupire une certaine classe de partisans? Ah! bannissons-le de nos fastes et de nos lois de finance, avec tout ce qui peut en rappeler le souvenir. Attachons-nous à celui que va recréer une foi donnée, moins pompeusement publiée, mais plus solide, mais qui sera plus religieusement observée, et qui aura pour objet et en vue la justice de n’accorder aucune préférence, de ne consacrer aucune de ces distinctions qui font toujours des privilégiés au milieu des créanciers de l’état
Il fallait rapprocher tous ces faits historiques en finance, pour présenter des objets de comparaison sur les temps et les choses, et pour mettre à même de juger la différence des situations. Nous ne sommes plus au temps des odieuses banqueroutes, puisque l’on ne s’occupe que des moyens de payer. Il fallait surtout appeler l’attention sur ces continuelles réductions de rentes arbitraires par un gouvernement irrégulier.
On ne veut pas dire ici que les gouvernemens de nos Rois aient jamais été irréguliers. Mais le gouvernement d’un État peut être légitime, quand celui de ses finances peut être fort irrégulier. Celui des finances a été toujours irrégulier quand l’impôt était levé sans le consentement des contribuables; il était encore irrégulier quand le compte de l’emploi des fonds n’était pas rendu public. Cette communication ouvre toujours une voie facile à une confiance invariable. Instruire les peuples de l’usage que l’on fait de leurs économies, c’est les disposer à continuer leurs sacrifices. Enfin, le gouvernement des finances n’est plus régulier quand l’arbitraire, substitué à la loi, établit une diminution, une réduction sur le produit d’une rente; quand il fait un véritable déplacement de propriété, injuste, intolérable, et qui laisse la fâcheuse perspective de voir ruiner le crédit, même celui de la postérité.
Le gouvernement n’aura donc plus une administration irrégulière pour ses finances, puisque cette administration ne sera plus confiée aux dispositions d’un seul homme; puisque la loi sera toujours l’intermédiaire entre l’agent public et celui qui traite avec lui.
Il ne pourra plus y avoir aujourd’hui, sur des créances légitimes, de ces réductions, de ces suspensions, de ces annihilations qui dans tous les temps n’ont été que des vols publics. Les intérêts, les remboursemens, tous les fonds dus, à quelque titre que ce puisse être, seront acquittés avec exactitude: c’est la puissance publique qui le veut.
On ne risquera plus d’essayer de mesurer les avantages d’un retard avec les inconvéniens qui en naissent; on ne fera plus un jeu de la confusion qui opérait toujours la dégradation du crédit: une conduite désormais simple et soutenue par les principes, déterminera cette opinion qui fera la conquête de la confiance, ce sentiment libre comme celui de l’estime. L’engagement créé par la loi, garanti par la probité publique, contracté par l’honneur, fidèlement exécuté , créera enfin une puissance politique dont l’État ne peut point être trop jaloux.
Comment en douter? Toutes ces espérances sont certaines, tous nos moyens sont à la disposition du gouvernement que la Providence nous a restitué. Une première victoire en finance appellera de nouvelles victoires; et nous devons infailliblement jouir, sous le règne d’un descendant d’Henri IV, du bonheur et de la prospérité. Mais il faut réunir tous nos moyens; il faut les combiner et en faire une sage distribution.
Notre première matière, de laquelle nous nous sommes un peu écarté , par des épisodes nécessaires et préparatoires, nous ramène à ajouter un mot avant de terminer ce premier chapitre.
Loin de combattre le travail du ministre sous le rapport ni de son exposition de l’état des choses auquel il faut croire, ni sous celui de la demande qu’il forme en contributions, nous disons qu’on doit lui savoir gré de la première de ces choses, et que l’on doit tout faire pour se mettre en mesure de fournir la somme que demande le ministre, lorsque les besoins de l’état auront été régulièrement constatés et arrêtés. Mais, afin d’arriver glorieusement à un résultat, afin de pouvoir profiter utilement des moyens qui nous restent, il faut créer un crédit qui puisse jeter bientôt des racines profondes, propres à mettre l’état à l’abri des secousses intérieures; qui ait pour objet de réunir toutes les classes de la société sous nos véritables bannières, et de nous assurer en l’Europe, et dans l’intérêt du repos du monde, la place que la France doit naturellement et politiquement occuper.