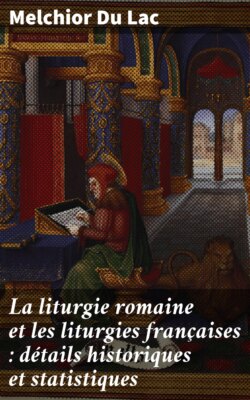Читать книгу La liturgie romaine et les liturgies françaises : détails historiques et statistiques - Melchior Du Lac - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
OPINIONS DIVERSES SUR LA QUESTION LITURGIQUE.
ОглавлениеEu étudiant les Liturgies diverses aujourd’hui en usage dans les Eglises de France, et eu examinant les écrits publiés sur la question liturgique, depuis quelques années, on reconnaît que, sur cette question, un assez grand nombre d’opinions différentes se partagent les esprits. Il y a d’abord les défenseurs de la Liturgie romaine et les partisans des Liturgies françaises; mais ceux-ci, si l’on y prend garde, se divisent en quatre groupes fort distincts, et, sans tenir compte des nuances, on a à choisir, non pas entre deux, mais bien entre cinq systèmes.
1°. Système de l’unité paroissiale, d’après lequel l’unité, en fait de Liturgie, n’est obligatoire que dans l’enceinte de la paroisse; chaque curé ayant le droit, sinon d’y implanter une nouvelle Liturgie, du moins de conserver celle qu’il y trouve établie, alors même que l’Evêque en impose une autre au diocèse et que le Saint-Siège en a donné une pour toutes les Eglises. Ce système n’est pas, que je sache, soutenu par écrit, mais il est pratiqué, et l’on rencontre en France un assez grand nombre de paroisses dont la Liturgie n’est ni la Liturgie romaine, ni la Liturgie du diocèse auquel elles appartiennent. D’ailleurs, les principes qui justifient cette théorie et qui y conduisent directement sont soutenus ex professo et avec beaucoup de chaleur par certains écrivains. Si en effet, dans les formules et dans les actes liturgiques, on ne doit voir, comme on l’affirme, que de pures formes, de soi indifférentes, sans rapport intime et naturel avec la doctrine dont elles sont l’expression, sans autre valeur qu’une valeur conventionnelle et toute relative; il n’y a vraiment pas de raison tirée du fond des choses, il n’y a que des raisons de forme qui puissent faire préférer telle Liturgie à telle autre, et la Liturgie n’est plus qu’une affaire de goût, ou, si l’on veut, d’attrait particulier. Dés lors, pourquoi chaque curé, pourquoi chaque Prêtre, ne fabriquerait-il pas sa Liturgie particulière? On ne saurait s’étonner s’il a plus de goût, plus d’attrait pour ses propres œuvres que pour l’œuvre de son Evêque, de même que l’Evêque se sent plus d’attrait pour son œuvre ou pour l’œuvre de ses prédécesseurs, que pour l’œuvre de l’Eglise. On peut appliquer à toutes les parties de la Liturgie cet axiôme désormais célèbre: Le meilleur Bréviaire est celui que l’on dit le mieux, et chacun ajoutera: «Mon Bréviaire à moi est le meilleur; celui de l’Evêque n’en approche point, car je le dis beaucoup plus mal.»
2°. Système de l’unité diocésaine, d’après lequel l’unité en fait de Liturgie est obligatoire, et ne l’est que dans le diocèse où toutes les églises doivent suivre la Liturgie de la Cathédrale, tandis que chaque diocèse peut avoir sa Liturgie particulière et en changer à volonté ; l’Evêque ayant toujours le droit absolu et souverain de la conserver ou d’en prendre une autre, de la faire, de la défaire et de la refaire quand il lui plaît et comme il l’entend. C’est en vertu de cette théorie qu’ont été introduites au dix-huitième siècle les Liturgies françaises qui restent encore, sans compter beaucoup d’autres qui ont déjà péri. Chaque Prélat jouissant du même privilége que ses prédécesseurs, a pu, et cela est arrivé maintes et maintes fois, détruire ce que ceux-ci avaient bâti, et élever un édifice que ses successeurs pourront à leur tour démolir. La plupart des écrivains qui s’opposent en ce moment au rétablissement de la Liturgie romaine, semblent se rattacher à ce second système.
3°. Système de l’unité métropolitaine, d’après lequel l’unité en fait de Liturgie est obligatoire, et ne l’est que dans une même Province ecclésiastique, les Evêchés suffragants devant tous adopter la Liturgie de leur Métropole, et chaque Métropole pouvant avoir une Liturgie différente. Le Métropolitain garderait-il le droit de modifier et même de transformer entièrement sa Liturgie, de créer une Liturgie nouvelle? Ses suffragants seraient-ils obligés de le suivre dans ses variations? Ces questions offrent bien quelques difficultés; on n’a pas songé à les résoudre. C’est que le système n’existe réellement qu’en projet. M. l’Archevêque de Toulouse, le seul écrivain à notre connaissance qui, de nos jours, l’ait formellement proposé, était parvenu à l’établir dans sa Province où il a régné cinq ans (cette Province ne comprenant que quatre diocèses, la chose y était plus facile que dans les Provinces composées d’un plus grand nombre d’églises): Toulouse, Pamiers et Montauban avaient, à diverses époques, adopté le Parisien; Carcassonne, qui suivait la Liturgie du Mans, l’abandonna en 1842 pour embrasser le même rite et afin de se conformer au principe d’unité indiqué par M. l’Archevêque; mais cette année même 1847, Montauban est revenu au Romain, et l’unité métropolitaine se trouve de nouveau rompue dans la seule Province qui l’eût acceptée. Si ce troisième système pouvait prévaloir, il aurait l’inconvénient de réduire à quinze le nombre des Liturgies que nous possédons, tandis que le système de l’unité diocésaine nous laisse l’espoir d’avoir un jour quatre-vingt-une Liturgies.
4°. Système de l’unité nationale, d’après lequel l’unité, en fait de Liturgie, est obligatoire, et ne l’est que dans l’étendue du territoire soumis à un même Gouvernement temporel; chaque nation ayant le droit d’avoir une Liturgie propre et distincte; chaque Gouvernement pouvant et devant imposer à toutes les Eglises situées dans son empire la Liturgie de sa Capitale, et exiger, bien entendu, que cette Liturgie soit, en tout, conforme aux lois, mœurs et coutumes du royaume, aux progrès des lumières, à l’esprit du siècle, au génie particulier de la nation, etc., etc. De là, par une conséquence inévitable, toutes les modifications et transformations que selon les temps et les circonstances la politique jugera nécessaires ou utiles. Ce système, né sous la monarchie absolue, et qui, instinctivement poursuivi, avait fait adopter la Liturgie de Paris dans un si grand nombre d’Eglises, fut, pour la première fois, nettement formulé en 1801, par les Evêques de l’Eglise constitutionnelle, dans leur second et dernier concile. Grégoire fit le rapport, il rattacha ce projet d’organisation liturgique au système de nivellement et de centralisation sur lequel avait été fondée la République . Une pareille idée devait plaire à Napoléon; il ne l’oublia pas dans les Articles Organiques, où il est dit en termes exprès, ARTICLE 39: Il n’y aura qu’une Liturgie pour toutes les Eglises de l’Empire français. Grégoire et ses collègues blasphémaient la Liturgie romaine; cette Liturgie était suspecte à l’Empereur et à ses courtisans; il leur fallait une Liturgie unique pour la France, et une Liturgie exclusivement française: la Liturgie de Paris, célébrée par Grégoire, devint celle de la Cour impériale et des Ecoles militaires ; Napoléon n’eut pas le temps d’accomplir les desseins qu’il avait sur elle et de la faire prévaloir dans toutes les parties de l’Empire.
Ecclésiastiquement, l’Eglise de Paris n’a aucun litre à un tel honneur: loin de tenir le premier rang entre les Eglises de France, elle ne compte que depuis peu parmi les Métropoles; mais, il s’agissait d’établir une Liturgie politique, le titre de Capitale était le meilleur. D’ailleurs, le Gouvernement impérial comptait parmi ses conseillers des hommes capables d’apprécier les qualités et les mérites intrinsèques par lesquels la Liturgie parisienne séduisit les Evêques de l’Eglise constitutionnelle; qualités et mérites qui sous l’ancienne monarchie avaient déjà fait sa fortune. Dès sa naissance, on reconnut en effet que cette Liturgie joignait à l’inappréciable avantage de distinguer la France de Rome, celui de se rapprocher plus que toute autre des opinions nouvelles, de se conformer aux décisions de la critique moderne sur les actes extraordinaires et les miracles des Saints, de se prêter au goût du temps pour l’usage exclusif de l’Ecriture sainte, pour la substitution d’une latinité mondaine à la langue parlée par l’Eglise durant tant de siècles, etc. Voilà ce qui la mit en vogue, ce qui la fit adopter dans tant de diocèses, elle menaçait de tout envahir: si les bouleversements de la fin du siècle, ne l’avaient pas arrêtée dans sa marche ascendante, elle aurait très probablement conquis l’une après l’autre toutes les Eglises de France, à peu près de la même manière que la Liturgie de Constantinople s’imposa jadis à toutes les Eglises de la langue grecque. Ce n’est point, toutefois, qu’elle n’eût rencontré en beaucoup de lieux de la résistance: d’un côté, la Liturgie romaine, au nom de l’unité, de l’antiquité, de l’autorité blessées, réclamait par la bouche de quelques Prêtres, de quelques Chapitres, de quelques Evêques, mais surtout par le cri des populations qui ne pouvaient sans douleur se voir ravir les prières et les chants transmis par les aïeux; d’autre part, beaucoup d’Archevêques et d’Evêques trouvaient très bon de répudier la Liturgie antique et universelle que leurs prédécesseurs avaient reçue du souverain Pontificat, mais ils n’étaient pas d’humeur à l’échanger contre celle de l’Archevêché de Paris. Ils se croyaient un droit pareil à faire du neuf; ils en usèrent, et le système de l’unité diocésaine se développa dans les faits parallèlement au système de l’unité nationale. Celui-ci, nous l’avons dit, l’eût sans doute emporté ; mais là Révolution vint, qui balaya tout.
Lorsqu’il plut au Seigneur de rétablir ses autels par la main de Napoléon, beaucoup d’Eglises demeurèrent ensevelies sous leurs ruines; les Eglises nouvelles que la Papauté érigea reprirent, celles-ci la Liturgie romaine, celles-là la Liturgie parisienne, les autres leurs Liturgies particulières, et comme la circonscription des diocèses était changée, dans le plus grand nombre toutes ces Liturgies reparurent ensemble. C’est ainsi que s’établit en fait, le système de l’unité purement paroissiale, auquel jusque-là personne n’avait songé, qu’on n’ose pas soutenir théoriquement, mais qui se maintient encore en beaucoup de lieux. Alors commença un double mouvement: presque partout les Evêques tendirent à établir l’unité diocésaine; l’Empereur n’oublia pas qu’il avait décrété l’unité nationale, et si l’Empire eût duré, il serait parvenu, selon toute apparence, à la réaliser. Sous la restauration, la Liturgie romaine fut rétablie dans les chapelles royales: depuis Henri III, la Cour de France la gardait comme un honneur et un privilége, et Louis XVIII la reprit comme une tradition de sa dynastie. Cependant le gallicanisme et à sa suite la Liturgie parisienne eurent les sympathies et la protection de la plupart des cabinets qui se succédèrent de 1815 à 1830; le haut clergé leur était également favorable, et dans le cours de cette période le Parisien conquit quelques Eglises, et sur la Liturgie romaine et sur les Liturgies diocésaines. Le système diocésain eût aussi ses victoires: des Liturgies tout-à-fait nouvelles remplacèrent dans certaines Cathédrales ou la Liturgie universelle, ou le rit de Paris; Rome seule perdait. On sait comment depuis 1830, ce mouvement d’abord ralenti s’est ensuite changé en un mouvement tout contraire.
Les systèmes que nous venons d’exposer reposent tous quatre sur ces données communes: 1° que la Liturgie ne tient par aucun lien intime et essentiel au fond de la religion, dont elle est pourtant la forme extérieure et sensible, que dès lors elle n’a aucune racine dans la tradition, qu’elle est toute relative aux temps, aux lieux, aux circonstances, et doit se tans-former perpétuellement selon les besoins et les goûts particuliers de chaque pays et de chaque siècle; 2° que l’Eglise n’a rien décidé, rien réglé pour la Liturgie, que les décrets des Conciles et les constitutions des Souverains Pontifes sur cette matière, ou n’obligèrent jamais, ou sont tombés en désuétude, qu’en un mot la liberté sur ce point demeure entière et n’a été restreinte par aucune loi positive et obligatoire; 3° que la Liturgie est une chose à part dans l’Eglise, que si dans tout le reste l’Eglise s’attache à faire prévaloir l’unité, l’antiquité, l’autorité, la sainteté, par compensation, en fait de Liturgie, elle préfère la variété, la nouveauté, l’indépendance, et ce qu’on décpre du nom de beauté classique; 4° que les limites à cette variété, à ces changements, à cette indépendance, à ces préférences littéraires, ne peuvent être déterminées que par des raisons de bon ordre, de police intérieure, pour ainsi parler, de convenances et d’égards pour le siècle et le pays dans lequel on se trouve, et nullement par des raisons tirées de la nature même de la Liturgie, des dogmes qu’elle exprime, de la tradition qui les perpétue, de l’autorité des pouvoirs chargés d’en conserver le dépôt: car si l’on voulait avoir égard à de telles raisons, on serait amené logiquement à limiter la variété par l’unité, la nouveauté par l’antiquité, l’indépendance par l’autorité, le libre choix du bon goût humain par le sentiment surnaturel des choses divines, c’est-à-dire manifestement à remplacer la limite par la destruction.
Ces principes posés, on comprend que les motifs du choix entre les quatre systèmes sont purement arbitraires: pour prouver la nécessité de l’unité nationale, ses partisans répètent aux partisans de l’unité métropolitaine, qui le répètent aux partisans de l’unité diocésaine, lesquels le répètent eux-mêmes aux partisans de l’unité paroissiale, tout ce que les défenseurs de la Liturgie romaine ont pu dire sur les inconvénients de la variété. Mais, à son tour, la paroisse dit au diocèse, le diocèse à la Métrople, la Métropole à la Capitale, ce que celle-ci adresse à Rome sur les avantages et la beauté de cette même variété. La paroisse trouve que la variété fait bon effet dans le diocèse, le diocèse juge qu’elle sied à la Province, la Province décide que la variété ne dépare pas le Royaume, le Royaume déclare que rien ne va mieux à l’Eglise. Si la Capitale ne reconnaît aucune loi qui oblige à conserver ou à reprendre la Liturgie de l’Eglise mère et maîtresse, la Métropole n’en connaît pas qui l’oblige à recevoir la Liturgie de la Capitale, le diocèse voudrait voir celles qui l’astreignent à subir en ce point le joug métropolitain, et la paroisse nie que la Liturgie diocésaine lui soit canoniquement imposée. Le diocèse, la Métropole et la Capitale ont peut-être des textes ou du moins des antécédents à faire valoir; mais comme ils ne peuvent rien alléguer, pas même à la paroisse, d’aussi fort, d’aussi clair et d’aussi formel que les paroles du Concile de Trente et les constitutions de saint Pie V et des Papes ses successeurs, dont ils refusent tous quatre de tenir aucun compte, il n’est guère étonnant que, poussé par le même esprit, chacun refuse de se rendre aux raisons des trois autres. Si les questions liturgiques se décident dans l’Eglise par voie d’autorité, l’autorité la plus haute a parlé, et tous, sans exception, doivent se soumettre; si ces questions se décident au contraire par voie d’examen particulier, la dernière succursale a le droit, tout aussi bien que la première des Métropoles, d’examiner de discuter et de choisir. On choisit en effet, et chacun trouve que la Liturgie de son choix est la plus belle, la plus poétique, la plus digne des hommes et de Dieu.
5°. A côté des quatre systèmes, et contre tous, s’élève la doctrine de l’unité catholique. Elle prend ce nom et croit le justifier en disant que catholique est synonyme d’universel, que, dès lors, ni l’unité paroissiale, ni l’unité diocésaine, ni l’unité métropolitaine, ni l’unité nationale, n’y peuvent prétendre et ne sauraient, avec quelque apparence de raison, le contester à l’unité universelle.
Les principes sur lesquels repose cette doctrine sont. 4°. Que les formes liturgiques doivent être régardées comme l’expression et pour ainsi dire comme le corps de la croyance; que dès lors, bien que distinctes des dogmes qui se manifestent par elles, elles leur sont unies comme la parole à la pensée, comme le corps à l’âme; que, par conséquent, le choix n’en saurait être arbitraire, ni dépendre uniquement des besoins et des goûts changeants des siècles et des peuples; qu’en un mot, la Liturgie doit être reçue des mains de la tradition, et non refaite à neuf suivant la fantaisie de chaque nation et de chaque époque,
2°. Qu’en droit l’Eglise, est compétente pour régler sa Liturgie; qu’en fait l’Eglise a prononcé ; que le Concile de Trente, et les constitutions des Papes sur cette matière, ont toujours eu et ont encore force de loi; qu’on ne peut opposer à ces lois générales et régulièrement promulguées, aucune prescription, aucun prétexte d’ignorance; que des difficultés matérielles et la tolérance du Saint-Siége peuvent bien excuser et légitimer jusqu’à certain point, le maintien provisoire des changements introduits, mais ne détruisent en aucune manière, ni la force de la loi, ni l’obligation de s’y conformer, dês qu’on pourra sortir de cet état irrégulier et transitoire.
3°. Que pour la Liturgie, comme pour tout le reste, l’Eglise tient à l’unité, à l’antiquité, à l’autorité, à la sainteté. Que des Liturgies introduites au détriment de l’unité, (par une violation des lois émanées de l’autorité suprême), dans lesquelles l’antiquité est répudiée, et dont les auteurs se montrent inspirés, les uns par l’hérésié, les autres et les meilleurs par les muses profanes bien plus que par la piété chrétienne; que de telle Liturgies n’ont aucun des caractères auxquels on reconnaît les œuvres de l’Eglise.
4°. Que l’unité liturgique souffre des exceptions; mais que d’abord ces exceptions doivent être en petit nombre, afin que l’unité même ne soit pas détruite; en second lieu, que ces exceptions, pour être légitimes, doivent être reconnues, avouées par l’Eglise, c’est-à-dire par l’autorité qui la régit et la représente; et, enfin, que ces exceptions doivent être motivées, et l’être, non par des raisons tirées du changement des idées et des goûts de tel ou tel peuple, mais, au contraire, par des raisons tirées de la valeur intrinsèque de la Liturgie qu’il s’agit de conserver, de son antiquité, de son origine et de l’utilité qu’elle peut avoir, soit en rendant témoignage de la foi de l’Eglise dans les anciens âges, soit en facilitant le retour des peuples égarés qui gardent une Liturgie analogue ou même identique.
5°. Que l’unité liturgique est une unité vivante et progressive; c’est-à-dire que, loin d’être immobile, tout en demeurant constamment, quant au fond, identique à elle-même, elle se développe, s’enrichit, grandit incessamment, en consacrant par des solennités nouvelles et des rites nonveaux: ou le souvenir des bienfaits extraordinaires que le Sauveur accorde à la sainte Eglise; ou la gloire des serviteurs de Dieu qui, dans chaque siècle, font briller d’un plus vif éclat les vertus héroïques et la puissance surnaturelle du christianisme; ou les développements de lumières, les expansions d’amour qui, à quelques époques, donnent aux hommes une connaissance plus profonde de certaines vérités, inspirent aux peuples une dévotion plus ardente et plus tendre pour les Saints, pour la Mère de Dieu, pour le Sauveur caché sous les voiles du Très-Saint Sacrement, etc., etc. Que par la même raison, l’unité n’empêche nullement les Eglises particulières de surajouter au fonds commun les témoignages spéciaux de leur amour et de leur reconaissance pour les Saints qui sont leur honneur et leur gloire. Et, enfin, que l’unité n’exclut pas, mais exige, au contraire, le retranchement des abus, la correction des fautes et des altérations que mille causes peuvent amener par le laps du temps.
Ces principes posés, les défenseurs de l’unité liturgique universelle ajoutent que la Liturgie romaine remplit toutes les conditions exigées: qu’elle est antique, puisque son origine se confond avec l’origine même de l’Eglise de Rome et du christianisme; qu’elle est une, puisqu’elle est demeurée substantiellement la même depuis les premiers siècles jusqu’à nos jours; qu’elle est universelle, puisqu’elle est pratiquée dans toutes les parties de la terre; qu’elle est autorisée, puisqu’elle émane de l’autorité souveraine; qu’elle est sainte, puisqu’elle a été créée, conservée, défendue et développée par les Saints, puisqu’elle est consacrée par la tradition d’où elle sort, par le souverain Pontificat, qui la garantit et la promulgue; qu’elle est progressive, puisque les Souverains Pontifes l’ont enrichie de siècle en siècle sans la transformer.
Les défenseurs de l’unité liturgique disent encore que les Liturgies orientales et la Liturgie ambrosienne se trouvent dans le cas de l’exception légitime, puisque leur origine remonte à la plus haute antiquité et ne fut point viciée par une révolte manifeste contre les lois alors en vigueur; puisque chacune d’elles est un témoignage vivant et irrécusable de la foi immuable de l’Eglise; puisque les Liturgies de l’Orient restent comme un lien entre la véritable Eglise et des nations perdues dans les voies de l’erreur; puisqu’elles sont toutes reconnues et avouées par l’Eglise souveraine.
Les mêmes écrivains prétendent encore que les Liturgies françaises ne réunissent ni les conditions qui légitiment l’exception, ni les caractères qui distinguent la Liturgie catholique. Ces Liturgies ne sont point antiques, car elles datent toutes du XVIIIe siècle, et ne ressemblent pas plus à l’anciene Liturgie gallicane qu’à la Liturgie romaine. Elles ne sont ni reconnues ni avouées par l’Eglise, puisque l’Eglise maintient les lois qu’on a dû violer pour les mettre au jour. Bien loin d’être un lien, elles seraient plutot une cause d’éloignement, un relâchement des liens de l’unité. Elles portent comme une tache originelle, car elles sont nées de la violation des lois. Elles n’ont ni unité, ni stabilité, puisque, en vertu du principe même auquel elles doivent l’existence, chaque Evêque peut chaque jour les changer ou les abolir. Il est cruel pour elles d’avoir à rougir de leurs auteurs; dont plusieurs ont vécu et sont morts dans l’hérésie. Enfin, leur multiplicité au sein d’un même royaume est un fait anarchique jusqu’à présent sans exemple dans l’Eglise catholique, etc., etc.
Tels sont les principaux reproches qu’adressent aujourd’hui aux Liturgies françaises les hommes dévoués au principe de l’unité universelle. Sous la Restauration, les écrits de MM. de Maistre, de Bonald et de La Mennais avaient imprimé aux esprits un mouvement très prononcé de retour aux doctrines romaines; si alors la question liturgique eût été soulevée, nul doute qu’elle n’eût attiré l’attention au même degré que la controverse sur les principes généraux du gallicanisme; déjà, à cette époque, il n’était pas rare de rencontrer des ecclésiastiques qui se demandaient pourquoi on n’avait pas en France la même Liturgie que dans le reste du monde catholique. Mais, si je ne me trompe, ce fut seulement quelques mois avant les événements de 1830 que la question fut, pour la première fois, attaquée ex professo. Des articles fort remarqués parurent dans le Mémorial catholique. L’Ami de la Religion s’en indigna, et la discussion ainsi engagée aurait très probablement pris de plus grands développements si la révolution de juillet ne fût survenue .
Les mouvements qui suivirent cette grande secousse, et surtout l’impulsion donnée par M. l’abbé de La Mennais, dont les efforts avaient pour résultat de concentrer exclusivement sur des questions de philosophie et de politique l’attention et l’activité des catholiques, détournèrent le clergé, pendant quelques années, d’études plus sérieuses, plus pratiques, plus véritablement profitables. La question liturgique fut donc naturellement éliminée de ces discussions, et il faut en méconnaître étrangement là nature, il faut oublier tout ce qui se passa alors, pour essayer de l’y rattacher, pour vouloir absolument qu’elle y ait été compromise.
Lorsque le calme commença à renaître dans la société civile, lorsque la voix du Saint-Siège eut mis fin, dans la société spirituelle, aux divisions produites par le Lammennaisianisme, un état d’atonie et de langueur succéda, du moins en apparence, à ces agitations stériles. Les hommes que l’Avenir avait entraînés se méfiaient d’eux-mêmes; ceux qui les avaient combattus semblaient croire que, la nouvelle école détruite, il n’y avait plus rien à faire. Ce fut comme un temps de repos après une course trop hâtée: chacun cherchait sa voie, la voie la plus sûre pour servir utilement l’Eglise de Dieu. Toute question paraissait à jamais éteinte, et bien plus que toute autre la question liturgique, pour laquelle, depuis un siècle, la France n’avait pas eu un moment d’attention. Les choses en étaient là lorsque, en 1839, M. l’Evêque de Langres rétablit dans son diocèse la Liturgie romaine. Initiative heureuse! que le Seigneur a bénie, mais que les hommes n’ont point assez louée. Depuis cent soixante ans, les Evêques français faisaient des Liturgies; depuis cent soixante ans, ils répudiaient, l’un après l’autre, la Liturgie de l’Eglise mère et maîtresse; l’habitude était prise, établie, consacrée, et personne ne songeait même plus à s’en étonner. Le premier, M. de Langres secoua le joug de cette coutume invétérée, le premier il brisa la chaîne de celle longue tradition; le premier, foulant aux pieds les préjugés de son temps et de son pays, il comprit l’importance de la Liturgie: la portée de son action extérieure comme enseignement, comme élément de la force sociale et civilisatrice; la puissance de son action intérieure comme prière, comme élément de la force religieuse et surnaturelle; le premier, il vit que morceler cette force, là diviser à l’infini, que lui donner sans cesse de nouvelles formes et la manipuler sans respect, ainsi que l’un change et que l’on rechange un objet de vil prix, c’était la dissiper et faire perdre à la mystérieuse essence toute sa vertu; le premier, il reconnut que sous ce rapport comme sous tant d’autres; la nouveauté et sa fille la multiplicité ne valent rien, et que la puissance de la Liturgie, pour la conservation et le développement de la vie religieuse des peuples, est en raison directe de son antiquité et de son unité. Aujourd’hui, la controverse a rendu ces vérités vulgaires; en 1839, elles étaient universellement ignorées; pour les retrouver, pour les appliquer, il fallait à un Evêque plus que du savoir, plus que de l’intelligence; il lui fallait ou ce coup d’œil de l’intuition qui fait les hommes supérieurs, ou cette lumière de l’amour qui éclaire les serviteurs de Dieu et leur montre les plaies cachées à tous les yeux, les remèdes efficaces auxquels nul ne songe.
Cependant, l’auteur des articles du Mémorial n’avait point délaissé la science sacrée, objet de ses premiers travaux: rien n’avait pu l’en séparer, ni l’oubli universel où cette science était tombée parmi nous, ni les controverses passionnées qui préoccupaient alors tous les esprits, ni même l’œuvre difficile et laborieuse à laquelle il vouait sa vie. D’autres construisaient des systèmes, lui réédifiait sur le sol de la France, couvert de ses ruines, l’Ordre de Saint Benoît; d’autres s’égaraient dans le tortueux labyrinthe d’une philosophie humaine, lui s’enfermait dans l’enceinte sacrée de la doctrine sainte; d’autres cherchaient le secret de l’avenir dans les eaux troubles et agitées de la politique, lui recueillait les leçons du passé dans les monuments immuables de la tradition. Il les avait long-temps et patiemment explorés, lorsque les Institutions Liturgiques parurent, le premier volume en 1840, le second en 1841. Nous avons dit les attaques dont cet ouvrage a été l’objet, et comment, au lieu de nuire, ces attaques ont grandi le succès, l’influence du livre; quelle peut être la raison de ce fait? Il s’explique par une cause plus générale et plus profonde: un livre peut féconder des germes préexistants; quand ces germes n’existent pas, un livre n’a jamais la puissance de les créer; il ne suffit pas de jeter une bonne semence, il faut encore qu’elle ne tombe ni sur le roc aride, ni sur une terre dévorée par les ronces; il ne suffit pas de présenter la vérité aux hommes, il faut encore que les hommes soient disposés à l’accueillir; lés principes les plus salutaires demeurent sans action et sans vertu sur les âmes que dominent des principes mauvais; les faits les plus grands n’apportent aucun enseignement aux esprits incapables d’en apprécier la valeur. Voilà ce qui rendit inutiles au dix-huitième siècle les efforts et les écrits des Evêques et des Prêtres éminents qui combattirent pour le maintien des saines traditions liturgiques, avec un zèle et un talent dignes d’un meilleur sort. Les ouvrages du T. R. P. Abbé de Solesmes n’auraient pas obtenu de nos jours plus de succès; livres savants, les hommes instruits les auraient consultés, mais ils seraient demeurés sans action immédiate, pratique et réelle, si un grand changement dans les idées et dans les penchants de la nation ( je parle de cette partie de la nation qui est restée ou redevenue catholique ) n’avait de longue main préparé les esprits, fait disparaître une foule de préjugés et incliné les cœurs vers Rome, vers tout ce qui vient de Rome, par un mouvement dont personne ne peut assigner la cause première, mais dont tout le monde constate à chaque instant les effets innombrables. La preuve de ce que je dis est facile à faire: prenez un homme au hasard parmi les défenseurs de l’unité liturgique, vous pouvez affirmer que cet homme est sur tous les points dévoué aux doctrines romaines; prenez un partisan des Liturgies modernes, vous pouvez affirmer avec non moins de certitude qu’il est plus ou moins infecté de gallicanisme. Telle est la nature de l’esprit humain que, même sans se rendre compte d’une manière bien nette de ses idées et de ses doctrines, éclairé par je ne sais quel instinct logique, il discerne tout d’abord ce qui leur est favorable ou contraire; combien de personnes ne s’étaient jamais occupées de Liturgie, et se sont immédiatement rangées d’un côté ou de l’autre, dès que là question a été soulevée? Au dernier siècle les Liturgies nouvelles prévalurent, parce que les idées gallicanes dominaient; de nos jours la Liturgie romaine prévaut, parce que les doctrines romaines dominent: à celle époque, l’attaque la plus habile et la plus vive contre les organes et les défenseurs des idées dominantes n’avait jamais d’autre résultat que de passionner en leur faveur la majorité du public; il en est encore ainsi maintenant, la fortune des Institutions Liturgiques l’atteste.
La loi de l’esprit humain que nous venons de constater, explique aussi les exagérations et les injustices de la plupart des hommes dans leurs jugements sur les écrits et sur les auteurs contraires aux idées et aux doctrines qui régnent au fond de leurs âmes. Un illuminé, Saint-Martin, a dit: Savoir lire est plus difficile que savoir écrire; cela est très vrai, car on écrit sa pensée et le mouvement naturel, instinctif, de la parole la rend presque toujours fidèlement, alors même que l’écrivain n’a pas pleinement conscience de tout ce que cette pensée et cette parole renferment; mais on lit la parole et la pensée d’autrui, et on la voit toujours à travers le voile plus ou moins épais de sa pensée propre, des idées, des principes qui dominent en nous. Relisez aujourd’hui un livre que vous avez lu il y a dix ans; si ce livre a quelque valeur, si vous-même n’êtes pas demeuré complètement immobile, vous le comprendrez tout autrement, vous y verrez des choses que vous n’y aviez pas vues, et ce que vous aviez cru y voir Vous ne l’y verrez plus: l’intelligence de l’homme est comme un vase, elle ne reçoit les doctrines que selon la mesure de sa capacité. De plus, si le vase est rempli du vin de l’erreur, la vérité qu’on y mêle s’altère et se corrompt; de là, pour le dire en passant, l’absurdité et le souverain danger du droit que le protestantisme donne à tous d’interpréter les Livrés sacrés; chacun y trouve non la pensée de l’Esprit-Saint, mais la pensée qu’il porte en soi-même. Il ne faut donc pas s’étonner si la pensée et même quelquefois les expressions de certains livres, sont étrangement interprétées, complètement dénaturées. Ceux qui louent un ouvrage doivent se souvenir qu’ils l’apprécient d’après un ensemble d’idées, de principes et de doctrines que le livre suppose ou confirme, et dont leur esprit est tout pénétré, tandis que les critiques le jugent d’après un ensemble d’idées, de principes et de doctrines différentes et contraires. Or: bien lire sa propre langue est déjà malaisé, mais bien lire une langue étrangère est presque impossible; en d’autres termes, peu d’hommes ont la puissance de comprendre les doctrines qu’ils professent, mais on en rencontre à peine quelques-uns en état de comprendre les doctrines qu’ils combattent, et d’apprécier avec justice les écrits où ces doctrines ennemies se trouvent clairement exposées et vigoureusement défendues. Pour faire une application de ce principe, disons qu’on a grand tort, par exemple, d’attribuer à la mauvaise foi certaines interprétations forcées, certaines falsifications grossières de divers passages des Institutions Liturgiques, certaines accusations, ridiculesd’exagération et de violence, dirigées contre leur auteur: elles procèdent de cette force instinctive qui trouble la vue de l’esprit, et à laquelle obéit sans le savoir l’homme incapable de gouverner son intelligence.
Je ne crois pas m’être écarté de mon sujet; en tout cas, j’y reviens en marquant la date de la Lettre à M. l’Archevêque de Reims sur le droit de la Liturgie, publiée en 1843, avec l’assentiment et à la prière de ce Prélat. L’appui ainsi publiquement donné à la cause de la Liturgie romaine par un Evêque d’une si grande autorité, aurait suffi pour déterminer les esprits incertains et irrésolus; mais ce ne fut pas tout: M. de Reims avait consulté le Saint-Siège, il voulut que les catholiques de France connussent la pensée du Chef de l’Eglise; le Bref de S. S. Grégoire XVI, en date du 6 août 1842, inséré textuellement dans le nouvel écrit du T. R. P. Abbé de Solesmes, et reproduit ensuite par tous les journaux, apprit aux fidèles combien le Saint-Siège déplore, juge périlleuse, la variété des livres liturgiques, combien il désire le retour à l’unité, la soumission loyale, pleine et entière aux Bulles de Saint Pie V; de ce moment, on put regarder comme perdue la cause des Liturgies françaises.
Celte cause a rencontré pourtant des défenseurs dont elle n’était pas digne: on a vu au chapitre précédent comment la discussion recommença, et quel effet produisirent les ouvrages de M. l’Archevêque de Toulouse et de M. l’Evêque d’Orléans; nous n’y reviendrons pas. Quant à l’éloquent traité de M. l’Evêque de Langres, à la lettre de M. l’Evêque de Montauban, à la première et à la Nouvelle Défense des Institutions liturgiques, tout le monde a lu ces écrits et sait à quelle hauteur ils ont porté la controverse .
Il faut espérer que la discussion se maintiendra sur ce terrain et que les défenseurs des Liturgies modernes au lieu de s’arrêter à des questions secondaires de personnes, de style, d’exactitude historique; au lieu de perdre le temps à incriminer les intentions, à disputer sur les mots, à contester de petits faits et de petits détails sans valeur et sans portée, sentiront la nécessité de remonter aux principes. Nous sommes convaincus qu’il n’en faudrait pas davantage pour les amener peu à peu à reconnaître eux mêmes leur illusion; dans tous les cas, ils obligeraient ainsi leurs adversaires à de nouveaux combats, et la vérité ne pourrait qu’y gagner: quand l’erreur a été scrutée jusqu’au fond, quand elle a été examinée sous toutes ses faces, discutée sous toutes ses formes, analysée dans tous ses éléments, la vérité apparaît avec plus de force, de puissance et d’éclat.
Pendant que la question est débattue théoriquement devant le public, plusieurs Prélats la résolvent pratiquement dans leurs diocèses. En 1844, M. l’Evêque de Périgueux; en 1845, M. l’Evêque de Gap; en 1846, M. l’Evêque de Rennes; enfin cette année même 1847, N. N. S. S. les Evêques de Saint-Brieuc, de Troyes et de Montauban ont rendu à leurs Eglises la Liturgie romaine; d’autres Evêques, dont nous pourrions dire les noms, préparent la même mesure et la réaliseront dans un avenir prochain. Ces actes des premiers Pasteurs, les Lettres pastorales et les Mandements qu’ils publient en ces occasions, les Brefs de félicitation que leur adresse le souverain Pontife, tout concourt à accroître le mouvement réparateur, à redoubler l’ardeur des défenseurs de l’unité liturgique, à décourager les partisans de l’anarchie introduite au dernier siècle, à en diminuer le nombre, à les resserrer dans un cercle de jour en jour plus étroit et plus silencieux. Peu à peu les difficultés s’aplaniront, les obstacles disparaîtront partout et, selon la parole de Grégoire XVI, par la bénédiction de Dieu, tous les Evêques de France suivront tour à tour l’exemple de leurs vénérables collègues: Confidimus equidem, Deo benedicente, futurum ut alii deinceps atque alii Galliarum Antistites memorati Episcopi exemplum sequantur .