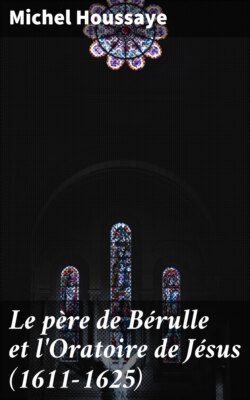Читать книгу Le père de Bérulle et l'Oratoire de Jésus (1611-1625) - Michel Houssaye - Страница 10
M. DE BÉRULLE VISITEUR DES CARMÉLITES.
Оглавление1614-1616.
Bref de Paul V, 8 septembre 1606. — Ses inconvénients. — Nouveau bref de Paul V, 17 avril 1614, qui nomme M. de Bérulle visiteur. — Entrée de madame Acarie au Carmel d’Amiens. — Première visite du grand couvent, 16 août 1614. — Les Religieuses et le noviciat. — Acte de visite. — M. de Bérulle se rend à Pontoise. — Réunion des états généraux. — Déclaration du tiers état. — Mécontentement du Nonce. — Intervention de M. de Bérulle. — Il donne l’habit à madame Acarie, 8 avril 1615. — Élection au grand couvent de Sœur Marie de Jésus (marquise de Bréauté). — M. de Bérulle visite le monastère de Chalons, celui de Dôle. — M. Jean Lejeune. — Fondation de l’Oratoire à Tours, 27 septembre 1615. — M. de Bérulle dédie à la Reine la Vie de saint Charles Borromée. — Double conversion. — Visite du monastère de Tours. — Voyage à la Rochelle, Saintes, Bordeaux. — Retour à Paris.
Tandis qu’en France, malgré les efforts de ses adversaires, l’Oratoire prenait chaque jour un nouvel accroissement, à Rome, le Souverain Pontife, prévoyant quels services l’Église pouvait attendre de M. de Bérulle, s’empressait de lui donner, avec une marque éclatante d’estime, la plus douce récompense que dans son zèle pour les Carmélites le saint prêtre pût ambitionner.
On se rappelle que Clément VIII, par la même bulle qui établissait supérieurs de ces Religieuses MM. Gallemant, du Val et de Bérulle, avait ordonné qu’il y aurait un visiteur chargé de l’inspection des monastères, lequel serait le commissaire général des Carmes déchaussés, et jusqu’à l’établissement des Carmes en France, le prieur des Chartreux. Les Chartreux ayant décliné cette commission, Paul V, successeur de Clément VIII, avait réglé, par son bref du 8 septembre 1606, que les trois supérieurs généraux des Carmélites présenteraient deux sujets à son nonce en France, lequel choisirait l’un des deux pour être visiteur; que le visiteur serait nommé pour trois ans, avec la faculté d’être continué dans sa charge pour trois autres années; enfin que cette forme de gouvernement subsisterait, «encore que lesdits Frères déchaussés eussent par
» aduenture à présent des couvents à Paris ou autres lieux
» en France, ou vinssent à y en avoir par après .» C’était révoquer expressément le pouvoir de visite attribué aux Carmes par Clément VIII.
Les inconvénients du nouveau règlement ne tardèrent pas à se faire sentir. Le changement triennal du visiteur semblait exclure une conduite uniforme, et exposait la discipline elle-même à de fâcheuses variations. Madame Acarie, consultée par les supérieurs et par M. de Marillac, jugea nécessaire d’en informer le Pape, et approuva le mémoire que l’on dressa à ce sujet. Après en avoir pris connaissance, Paul V résolut de rendre le visiteur des Carmélites perpétuel, et de commettre cette charge au P. de Bérulle et à ses successeurs, dans là fonction de supérieur général de la Congrégation de l’Oratoire. Tel fut l’objet de son bref du 17 avril 1614.
Après y avoir exposé rapidement l’état des choses à partir de Clément VIII jusqu’à son temps, Paul V continue:
«Ayant érigé depuis peu en France la Congrégation des
» clercs appelée de l’Oratoire, et sur icelle érigé et insti-
» tué pour supérieur général notre cher fils Pierre de Bé-
» rulle, homme dont la piété et la probité de vie nous sont
» très-recommandables par des témoignages dignes de foy,
» et sachant que ladite Congrégation est composée de prêtres
» remarquables par leur piété et par leur doctrine, gens
» graves par leurs mœurs ainsy que par leur âge, zélés
» d’ailleurs envers la Religion et le Saint-Siège, et qu’elle
» fait de grands fruits dans la vigne du Seigneur, en sorte
» qu’il y a tout lieu d’espérer que ledit Pierre et ses succes-
» seurs, dans la charge de supérieur général de ladite Con-
» grégation, s’emploieront aux fonctions de la visite et cor-
» rection de l’ordre des Carmélites avec un grand fruit
» spirituel pour les abbesses, prieures et couvents de ces
» ordres, si nous luy commettions cette charge. Nous donc,
» de notre propre mouvement, non à l’instance dudit Pierre,
» ou de la Congrégation, ou des abbesses, prieures, cou-
» vents du susdit Ordre, et de notre science certaine, pou-
» voir et autorité apostolique, révoquons et annulons par
» la teneur des présentes le pouvoir accordé cy-devant à
» notre Nonce, le Cardinal (Maphée Maffeo), et à celuy
» qui dans la suite serait notre Nonce en France, de dé-
» puter, confirmer et révoquer les visiteurs dudit ordre des
» Carmélites. Et en outre, nous soumettons et assujettis-
» sons à perpétuité, sous le bon plaisir du Saint-Siège
» apostolique, le susdit monastère des Carmélites et tous les
» autres, tant jusqu’à présent érigés en France que ceux
» qui cy-après s’y érigeront, au soin, visite, correction et
» supériorité dudit Pierre et de celuy qui, selon le temps,
» sera supérieur général de la Congrégation de l’Oratoire.»
Et comme s’il avait prévu l’avenir, le Saint-Père, dans une longue énumération de tous les droits et de tous les devoirs du P. de Bérulle, lui reconnaissait le pouvoir de visiter lesdits monastères, abbesses, prieures, religieuses, tant dans le chef que dans les membres, de s’informer diligemment des vie, mœurs, façons de faire et discipline de chacune, de corriger, réformer tout ce qu’il connaîtrait en avoir besoin, d’établir même de nouveau tout ce qui ne serait point contraire aux canons et instituts réguliers de l’Ordre; de réprimer par les censures et autres peines ecclésiastiques, et par tous les remèdes convenables,- de droit et de fait, celles qu’il trouvera délinquantes et rebelles, sans faire cas des appellations; d’ajouter même, s’il le fallait, la peine de l’interdit, et d’implorer le bras séculier, si besoin était, et ce nonobstant toutes lettres apostoliques et autres constitutions .
Lorsque le bref qui modifiait si heureusement le gouvernement des Carmes fut communiqué à M. de Bérulle, celle qui avait énergiquement insisté pour l’obtenir ne se trouvait plus à Paris. C’est dans un Carmel de province où elle était allée cacher sa sainteté, que madame Acarie apprit une nouvelle qui répondait à tous ses désirs.
Depuis la mort de M. Acarie, enlevé par une maladie courte et cruelle au mois de novembre de l’année précédente, rien ne retenait plus la sainte veuve dans le monde que le règlement de quelques affaires. Il lui tardait de se donner à l’Époux immortel de son âme, et d’ouvrir en même temps le ciel à celui dont elle avait été la joie et la couronne sur la terre. Mais quand il fallut décider de sa vocation, une lutte s’engagea entre elle et M. du Val. Fidèle aux ordres de sainte Thérèse, elle n’ambitionnait que le rang et le titre de Sœur converse, et réclamait comme un privilége d’être envoyée dans le monastère le plus pauvre. M. du Val ne pouvait se résoudre ni à éloigner de Paris celle dont les lumières éclairaient si souvent les supérieurs du Carmel, ni à placer au-dessous des Sœurs de chœur la femme admirable qui, par sa sainteté, n’était inférieure à aucune. Mais la postulante insistait. M. du Val, craignant de résister à la volonté de Dieu, lui promit d’en conférer avec M. de Bérulle . Celui-ci n’avait point oublié la vision de Saint-Nicolas du Port. Il conclut qu’il fallait laisser madame Acarie suivre en liberté un attrait qui venait du ciel. Puis on choisit pour sa résidence le couvent d’Amiens, à la fondation duquel M. Acarie avait contribué. Transportée de joie à la nouvelle de son admission chez les Carmélites, comme s’il lui eût été possible d’en douter un seul instant, elle visita quelques sanctuaires pleins de souvenirs pour son cœur, fit ses adieux à de rares amis, et le 13 février, jour des Cendres, quitta Paris pour n’y plus rentrer. Le triste état de sa santé ne lui permettait pas de supporter la voiture, on la fit voyager en litière: Edmond de Messa, si longtemps son fidèle serviteur, maintenant confrère de l’Oratoire, l’accompagnait. M. de Bérulle apprit par lui les moindres circonstances de ce voyage, durant lequel madame Acarie, toute perdue en Dieu, ne sortait de la contemplation et de l’extase que pour entrer en des abaissements plus étonnants aux yeux de ses compagnons, que les faveurs mêmes dont elle était prévenue. La peine de n’avoir pu la conduire lui-même à Amiens fut adoucie pour M. de Bérulle par l’espoir de la retrouver bientôt, lors de la visite de tous les couvents.
Il commença cette visite par le premier monastère de l’Ordre, où il se rendit le 18 août 1614. La Mère Madeleine de Saint-Joseph, réélue prieure par le consentement unanime de ses filles, y achevait alors son second triennat, et la Mère Marie de Jésus, sous-prieure ,se préparait sans le savoir, sous la fortifiante direction d’une sainte, à lui succéder un jour. M. de Bérulle examina dans le plus grand détail l’état du monastère. Puis il se fit rendre compte par chaque Religieuse de ses dispositions. Après la Mère Madeleine de Saint-Joseph, le modèle de toutes les Sœurs par son héroïque détachement et son union sublime avec Jésus-Christ, après la Mère Marie de Jésus, qui d’un regard éclairé par l’amour, pénétrait plus profondément chaque jour dans les mystères du Sauveur, M. de Bérulle vit passer successivement devant lui toutes ces âmes en qui le Saint-Esprit opérait tant de merveilles.
Sœur Marie des Anges, dont l’obéissance réglait tous les mouvements, ne put, cette fois, s’interdire, comme elle l’avait fait si souvent, le plus grand bonheur que lui offrît désormais la terre, celui de s’entretenir de Jésus avec son fils devenu son père . Madame d’Autri, dont les deux filles, madame de Gourgues et mademoiselle Séguier, étaient maintenant l’une au ciel, l’autre au Carmel, et qui avait échangé son nom contre celui de Sœur Marie de Jésus-Christ , vint se montrer à son neveu telle qu’elle était: loyale, généreuse, sensible encore au point d’honneur, attachée parfois à son propre sens, malgré des efforts magnanimes pour se vaincre, et un courage incroyable dans l’acceptation des reproches, des humiliations que M. de Bérulle multipliait avec une implacable persévérance . D’une nature moins haute, longtemps dominée par des habitudes plus molles, la sœur du cardinal de la Rochefoucauld, madame de Chandenier (Sœur Marie de Saint-Joseph), trouvait aussi, dans l’obligation de se plier à la règle, la matière d’un continuel sacrifice. Mais elle était si pénitente, si obéissante; elle avait pour Jésus-Christ au Saint-Sacrement un amour si tendre; elle se réfugiait auprès de la Mère Madeleine avec une simplicité si filiale, que M. de Bérulle, admirant tant de générosité et de persévérance chez une femme qui avait passé quarante-huit ans dans toutes les délicatesses de la cour, lui prodigua les plus paternels encouragements.
Pour Sœur Marie de Saint-Jérôme, elle n’avait conservé aucun lien avec le monde, qui ne lui avait jamais inspiré que du dégoût. Depuis son entrée au Carmel, où elle était venue offrir à Dieu un cœur de dix-huit ans, dont aucun souffle n’avait terni la pureté, elle s’avançait d’un pas sûr dans les voies de la plus haute perfection. M. de Bérulle put reconnaître en l’entendant, combien était fondé le jugement de la Mère Marie de Jésus, qui la comparait à ces anciennes Religieuses suscitées par le ciel pour commencer les Ordres ou les réformer.
A la suite de Sœur Marie de Saint-Jérôme, M. de Bérulle vit venir à lui Sœur Marie de la Croix, connue dans le monde sous le nom de mademoiselle Deschamps. Un jour, pendant son noviciat, la Mère Isabelle des Anges l’ayant aperçue, ne put s’empêcher de s’écrier: «La niña es muy » linda!» Que cette petite est jolie! A travers ses traits, elle avait vu son âme. Cette innocente séduction, Sœur Marie de la Croix l’exerçait sur toutes ses compagnes. Son air, son maintien, sa parole, tout en elle attirait irrésistiblement. Il lui suffisait de laisser s’épancher son âme, pour remplir les autres de Jésus-Christ. M. de Bérulle, qui estimait la jeune Religieuse, elle n’avait encore que trente et un ans, «un des esprits les plus fermes et les » plus déliés de l’Ordre,» se promettait de l’employer avant peu. «Elle saura bien démêler les affaires embrouillées», disait-il. Sa vie était un grand exemple. D’une fidélité à la règle qui ne se démentait jamais, d’une mortification d’autant plus méritoire qu’elle immolait un corps exténué, Sœur Marie de la Croix justifiait le nom qu’elle portait par son amour aussi tendre que généreux pour Jésus crucifié.
Nulle ne marchait d’un pas plus ferme et plus rapide dans cette âpre voie que Sœur Marguerite du Saint-Sacrement. Chez elle, la haine de la chair était devenue une passion qui lui avait fait oublier parfois les limites de la prudence, et sa soif des humiliations était si ardente qu’elle prenait à tâche de se ruiner dans l’estime de ses compagnes. Elles n’en demeuraient pas moins sous le charme austère de sa vertu. Mais madame Acarie, qui ne connaissait les états intérieurs de sa fille que par le compte que celle-ci lui en rendait, en avait été si effrayée avant son départ de Paris, qu’il avait fallu, pour la rassurer, le témoignage des Religieuses du grand couvent, et surtout un mot échappé à Sœur Marguerite et qui révélait toute son expérience des voies de Dieu. M. de Bérulle ne s’y était jamais trompé ; mais cette visite lui montra, plus beaux encore, les trésors dont le ciel se plaisait à enrichir l’âme de Marguerite .
Sœur Catherine de Jésus lui parut supérieure encore à elle-même. Depuis son entrée au Carmel, malgré des souffrances physiques qui n’étaient rien auprès des douleurs dont l’accablait l’amour divin, elle avait mené une vie angélique, soutenue par des visions fréquentes, tellement absorbée en Dieu, qu’elle était tout étonnée ensuite de se retrouver parmi ses Sœurs, soupirant après la mort afin d’aller jouir plus tôt de la vue de son Sauveur. Néanmoins, au moment où M. de Bérulle fit la visite, elle commençait à être élevée à un état plus extraordinaire et plus sublime encore. Consacrée à l’enfance de Jésus-Christ, abandonnée sans réserve à sa conduite, elle demeurait sans lumière dans l’esprit pour se regarder ou pour considérer son Dieu, sans consolations dans le cœur parmi des épreuves très-cruelles, tant le divin Époux était jaloux de cacher au monde et à elle-même, pour la réserver à lui seul, cette âme qu’il associait aux secrets les plus intimes de sa vie.
M. de Bérulle, que le spectacle de vertus si héroïques pouvait rendre difficile, jugea le noviciat digne de tout ce qu’il venait d’admirer. Il est vrai qu’à la tête de ces jeunes Religieuses se trouvait l’amie de Sœur Marguerite Acarie, sœur Anne du Saint-Sacrement. Pour porter ses filles vers Notre-Seigneur, cette fervente et sage maîtresse mettait tout en œuvre. A des entretiens pleins de lumière et de grâce sur les mystères, elle joignait, afin de soulager l’esprit, des cérémonies simples et émouvantes, et pour dompter la chair, de rigoureuses mortifications. La veille des fêtes, elle faisait jeûner les novices au pain et à l’eau, puis elle les conduisait pieds nus à travers les cloîtres et les jardins, vers l’ermitage consacré au mystère ou au Saint dont on célébrait la mémoire. Avec l’agrément de la prieure, elle avait institué la pieuse cérémonie qui se renouvelait chaque année le dimanche des Rameaux. Après le Benedicite, la porte du réfectoire s’ouvrait, et trois Religieuses, dont l’une portant un grand crucifix, s’avançaient lentement. Couvertes de leurs longs voiles noirs, elles chantaient d’un ton grave et triste quelques strophes de la Passion, tandis que la prieure distribuait à la communauté des sentences écrites sur des billets en forme de croix. Mais ce qui mieux encore que les plus émouvantes cérémonies animait la ferveur des novices, c’était l’exemple de la pénitence de Sœur Anne du Saint-Sacrement, de son amour immense pour Jésus-Christ, de sa prudence, vraiment surprenante chez une si jeune Religieuse; c’était sous des dehors sévères une douceur, une tendresse qui la rendait toute-puissante.
Avant de se retirer, M. de Bérulle laissa, comme souvenir de son passage, une admirable ordonnance. Le dessein qu’il s’y propose est surtout de rappeler aux Sœurs deux obligations spéciales à leur Ordre. «La première est d’honorer
» d’un honneur et dévotion particulière la très-sainte
» Vierge Marie, Mère de Dieu et Souveraine sur tout ce
» qui appartient à son Fils en la terre et au ciel. La
» seconde est d’offrir leurs prières, leurs actions et leur
» pénitence, à la divine majesté pour les besoins de l’Église,
» épouse du Fils de Dieu en la terre.» Il insiste d’autant plus sur ces deux points qu’il y voit comme la marque distinctive du Carmel. Aussi ordonne-t-il aux maîtresses des novices «de mettre dans leurs esprits un zèle d’amour
» et d’honneur à la très-sainte Mère de Jésus, et un esprit,
» de charité envers l’Église» ; aux professes, «d’oublier
» leurs pensées particulières pour y substituer ces deux
» dévotions principales et essentielles à l’Ordre.»
Par de tels enseignements, M. de Bérulle ne faisait que leur inculquer l’esprit même de sainte Thérèse; il leur montrait la sagesse du gouvernement de la Mère Madeleine, qui ne cessait de les inviter à cette double dévotion: il répondait aux attraits de ces grandes âmes, si vraiment filles de la Sainte Vierge et de la sainte Église. Pour que dans ces «petits colombiers de la Vierge», comme disait sainte Thérèse, règne une union plus étroite encore à Marie, il ordonne de faire fréquemment l’office ou les mémoires de la très-sainte Vierge, de sonner l’Ange-lus avant même l’oraison; il veut que toutes les Sœurs aient soin d’offrir leurs premières et dernières actions et pensées à Jésus-Christ et à la Vierge, «finissant et
» commençant le jour par ceux à qui leurs jours et leur
» vie appartiennent». Après quoi il leur recommande une dévotion spéciale à saint Joseph et à saint Jean-Baptiste, à cause de l’union de ces grands Saints avec Marie, et à sainte Madeleine, afin «qu’elle les introduise toutes dans
» les voyes d’amour et d’intériorité où elle a été si éminente
» et singulière, et où elle a reçu de Dieu et de son Fils
» unique Jésus-Christ Nostre-Seigneur tant de puissance
» et privilége.» Puis, après être entré dans les détails les plus minutieux sur la vie qu’elles mènent et les vertus qu’elles doivent pratiquer, il les exhorte en finissant,
«à honorer par ces voyes Jésus-Christ Notre-Seigneur et
» sa très-sainte Mère, à laquelle elles doivent appartenir
» toutes à jamais, si elles correspondent à l’institution de
» cet Ordre, à leurs obligations spéciales, et aux volontés
» particulières de Dieu sur leurs âmes.»
Dès le mois suivant, M. de Bérulle se rendit à Pontoise, second couvent des Carmélites; sa visite coïncida avec les élections. La Mère Marie de la Trinité, cinquième professe de l’Ordre, alors à Rouen, fut élue: mais parce qu’elle ne pouvait venir sur-le-champ, M. de Bérulle et M. du Val ordonnèrent à la Mère Agnès, prieure déposée, de continuer ses fonctions, «ce qu’elle fit avec sa prudence » et charité ordinaire». Comme le couvent était d’une grande régularité, que M. du Val y dirigeait tout, M. de Bérulle se renferma strictement dans ses fonctions de visiteur, et revint à Paris. Les sept autres monastères de France se réjouissaient déjà de sa visite et se préparaient à recevoir les grâces qui y étaient attachées, lorsqu’une circonstance des plus graves interrompit brusquement ses voyages.
Les états généraux, réclamés depuis si longtemps et avec tant d’instance, venaient de s’ouvrir. Le clergé y comptait 140 députés, dont 5 cardinaux, 7 archevêques, et 47 évêques. Les intérêts du Carmel, aussi bien que ceux de l’Oratoire, exigeaient en un tel moment la présence de M. de Bérulle à Paris. Il y trouvait l’évêque de Luçon, M. de Richelieu, déjà préoccupé d’attirer les Pères de l’Oratoire en son diocèse; M. de l’Aubespine, qui leur ménageait un établissement à Orléans; l’évêque d’Angers, Charles Miron, désireux de leur confier le pèlerinage de Notre-Dame des Ardilliers, près de Saumur; le cardinal de Joyeuse, qui, après avoir établi la Congrégation à Dieppe, se montrait rempli de bienveillance pour les Carmélites de Rouen. Avec M. Cyrus de Thiart, M. de Bérulle pouvait s’entretenir du monastère de Châlons; avec l’évêque nommé de Langres, M. Sébastien Zamet, de ce couvent de Dijon où s’étaient succédé les plus saintes prieures de l’Ordre. Toutefois, sa sollicitude pour les deux congrégations dont il était le supérieur cessa bientôt d’être le principal motif de son séjour prolongé à Paris. Au couvent des Grands-Augustins se débattaient les questions les plus redoutables; on pouvait tout craindre, si la modération ne finissait point par triompher. Telle était dès lors l’autorité de M. de Bérulle, que, sans autre mission que la confiance de tous, il contribua puissamment, par ses démarches et ses conseils, à conjurer le péril.
Les états étaient assemblés depuis deux mois, lorsque le tiers ordre fit lire le premier article du cahier de Paris. Cet article, décoré du titre ambitieux de «loi fondamen-
» taie», proclamait: «Que le Roi de France, tenant sa
» couronne de Dieu seul, il n’y a puissance sur terre,
» quelle qu’elle soit, spirituelle ou temporelle, qui ait au-
» cun droit sur son royaume pour en priver les personnes
» sacrées des Rois, ni dispenser ou absoudre leurs sujets
» de la fidélité ou obéissance qu’ils lui doivent, pour quel-
» que cause ou prétexte que ce soit.» On ajoutait que l’opinion contraire, à plus forte raison «celle qu’il soit loi-
» sible de tuer et déposer les Rois, s’élever et se rebeller
» contre eux, secouer le joug de leur obéissance pour quel-
» que occasion que ce fût», serait déclarée impie et détestable, et que «s’il se trouvoit aucuns livres ou discours
» écrits par étranger, ecclésiastique ou d’autre qualité, qui
» contînt proposition contraire directement ou indirecte-
» ment à ladite loi fondamentale, seroient les ecclésiastiques
» du même ordre établis en France obligés d’y répondre,
» les impugner et contredire incessamment, sans respect,
» ambiguïté, ni équivocation, sur peine d’être punis du
» même châtiment comme fauteurs des ennemis de l’État.»
La chambre ecclésiastique, tout en déclarant «qu’elle
» étoit prête à signer un article de commune main et intel-
» ligence, qui seroit mis sur les portes des villes et des
» maisons, et inscrit en lettres d’or dans son cahier, pour
» proclamer la défense de toucher à l’oint du Seigneur», protesta contre cette étrange prétention du tiers état de trancher des questions théologiques. La noblesse partagea l’avis du clergé, et le 2 janvier, M. du Perron, suivi des députés des deux ordres, se rendit dans la chambre du tiers pour essayer de le ramener à des sentiments plus modérés. Mais le président Miron répondit que la compagnie ne pouvait se départir de son article, et qu’il resterait dans le cahier.
M. de Bérulle était inquiet. Et comment ne l’être pas? Le Parlement, comme le prouva son arrêt rendu le même jour; les calvinistes, ainsi que le soupçonnait M. du Perron; les partisans de Richer, quoique celui-ci affectât de déclarer l’article parfait en soi, mais inopportun ; tous ceux en un mot qui évoquaient volontiers le spectre de la Ligue pour faire triompher leurs préjugés contre l’autorité de l’Église, semblaient s’être donné le mot. Au point où en étaient les choses, le clergé, l’eût-il voulu, ne pouvait plus reculer.
Le nonce, M. de Bérulle le savait par l’auditeur Scappi, ne cachait pas son profond mécontentement. Quelques mois plus tôt, on avait fait brûler à Paris, par la main du bourreau, l’ouvrage de Suarez: Defensio fidei catholicæ, composé sur l’ordre du Pape et honoré par lui du bref le plus élogieux. On prétendait maintenant définir les limites des deux puissances par l’autorité de laïques et de gens du palais, lesquels, disait Richelieu, «mesurent d’ordinaire
» la puissance du Roi par la forme de sa couronne, qui étant
» ronde, n’a point de fin.» Le Saint-Siége ne pouvait accepter une telle situation, et Ubaldini parlait de quitter la France.
C’est alors que M. de Bérulle, dont le nonce et le cardinal du Perron estimaient également la sagesse, mit tout en œuvre pour empêcher un éclat dont les suites pouvaient être désastreuses. Ses prières, ses conseils ne furent point inutiles. Bientôt on lui remit la copie d’un arrêt par lequel le Roi, séant en son conseil (6 janvier), déclarait «éuocquer à sa propre personne» les différends survenus en l’assemblée des trois ordres sur l’article de l’un d’eux; faisait «expresses inhibitions et deffenses ausdits estats
» d’entrer en aucune nouvelle délibération sur ladite ma-
» tière», et à sa cour «d’en prendre aucune jurisdiction ny
» cognoissance, ny passer outre à la signature, prononcia-
» tion et publication de ce qui a été délibéré en icelle ledit
» iour second de ce présent mois.» Le clergé ne s’étant pas montré satisfait, le Roi, par une nouvelle concession, manda au tiers état d’avoir à lui envoyer l’article; ce qui équivalait à sa suppression et mettait fin aux débats. On apporta, le 16 février, à la chambre du clergé et à celle de la noblesse, deux brefs du Pape qui félicitaient l’une et l’autre de leur zèle pour la liberté de l’Église. Le 23, les états présentèrent leurs cahiers: après quoi, découragés par les lenteurs de la cour, les députés quittèrent Paris.
Libre enfin, M. de Bérulle ne pensa plus qu’à reprendre le cours de ses visites interrompues et à les pousser jusqu’en Franche-Comté. Un nouveau monastère s’élevait à Dôle, depuis le 16 août de l’année précédente. Pour répondre aux vœux du fondateur, le capitaine Béreur, et aux prières de ses filles, Sœur Louise de Jésus (madame Jourdain) s’y était rendue, abandonnant bien à regret son cher couvent de Dijon . A peine installée, elle avait conquis déjà des disciples à l’Oratoire: aussi M. de Bérulle lui écrivait-il: «J’ai reçu vos lettres, et encore que
» je diffère d’y répondre, ie vous prie ne laisser pourtant
» d’escrire ou de rescrire. Car ie ne néglige pas ce que
» vous ne mandez, mais i’estime estre obligé de le consi-
» dérer beaucoup et recommander à Dieu et à sa sainte
» Mère avant de rien entreprendre en la naissance de ma
» congrégation. Je commence à incliner à un establisse-
» ment à la Comté. Vous en pouvez assurer M. Béreur et
» mesdemoiselles ses filles.» Et il ajoutait: «Je vous
» prie de recommander à la Sainte Vierge le lieu où elle et
» son Fils veulent un établissement, Dôle ou Besançon ou
» Poligny, et me mandez vos pensées.» Dans cette lettre, où M. de Bérulle témoignait à la Mère Louise une confiance si bien justifiée par sa prudence, son esprit et sa sainteté, il lui annonçait en finissant «qu’il feroit, incon-
» tinent après Pasques, un voyage exprès à Dôle et à Poli-
» gny pour prendre résolution.
Mais plus encore que Dôle, Amiens avait des droits à sa visite. Là, depuis une année, madame Acarie offrait à toutes les Sœurs le modèle achevé de la perfection religieuse. Un amour pour la pauvreté qui lui faisait ambitionner des vêtements qu’on n’aurait osé donner à personne; une mortification que ne pouvaient diminuer ses cruelles et incessantes maladies; une obéissance à la règle et aux supérieurs qui ne connaissait point de bornes; une humilité dont les anéantissements semblaient incompréhensibles aux témoins de son héroïsme: telles étaient les vertus qui attiraient sur la sainte novice les dons de Dieu les plus rares. Des parfums célestes, des accords angéliques, des visions, des extases multipliées, abrégeaient pour cette âme bienheureuse les heures de l’exil et lui permettaient de goûter par moments les joies de la patrie. Elle n’en était que plus petite à ses propres yeux. «J’ai l’habit de religieuse, disait-elle, mais je n’en ai point les œuvres.» Elle s’estimait indigne même du voile blanc. M. de Bérulle en jugea bien autrement, et il se réserva la consolation de l’en revêtir. La cérémonie de la profession fut fixée au mercredi de la semaine de la Passion, 8 avril 1615, en la fête de saint Albert, patriarche de Jérusalem. Madame Acarie était malade et hors d’état de se lever. On dut porter son lit dans une des chambres de l’infirmerie qui donnait sur l’église. Elle communia, puis M. de Bérulle reçut ses vœux en présence de la communauté : elle en prononça trois fois la formule suivant l’usage, d’une voix très-distincte, et en signa l’acte de sa main. Rien ne peut donner l’idée des transports de son amour à la vue de ce voile blanc, objet de tous ses désirs, symbole de sa donation totale à Jésus-Christ. Les paroles du psaume LXXXII: «Je chanterai éternellement les miséricordes du Seigneur», se retrouvaient sans cesse sur ses lèvres. Sa vie n’était plus qu’une action de grâces. M. de Bérulle quitta le monastère du Saint-Esprit, ravi de tout ce qu’il venait d’y entendre et d’y voir, et revint à Paris, rappelé par les élections du grand couvent.
Le 25 mai était le jour où la Mère Madeleine de Saint-Joseph devait, d’après la règle, être déposée, et ses filles ne pouvaient s’habituer à la pensée de perdre une prieure si sainte et si aimée. Émue de leur douleur, elle s’efforçait de les consoler, en élevant leurs cœurs au-dessus de la terre; elle les conjurait d’immoler la volonté propre au bon plaisir de Dieu. Avec un accent où la force prêtait un charme de plus à la douceur, blâmant affectueusement leurs larmes: «Vous êtes filles, il est vray, disait-elle,
» mais vous êtes filles de Dieu, et vous ne devez pas vous
» laisser aller à toutes ces tendresses comme filles, mais estre
» fortes et courageuses comme filles de Dieu.» Puis elle pria et fit beaucoup prier, afin que Dieu lui-même dirigeât les votes des Religieuses. Ses vœux furent exaucés. La Mère Marie de Jésus, qui avait été sous-prieure pendant tout le temps de sa supériorité, fut élue en sa place. C’était continuer la Mère Madeleine dans sa charge que de la remplacer par une si grande Religieuse, celles de toutes qui était entrée le plus avant dans son âme: c’était assurer au monastère de l’Incarnation le précieux avantage d’une conduite uniforme. Car si la Mère Madeleine, dans sa joie de n’avoir plus qu’à obéir, rendait à sa nouvelle supérieure les mêmes respects que la dernière des novices, la Mère Marie de Jésus ne se regardait, en présence de son ancienne prieure, que comme une enfant; elle en avait la confiance et la docilité : en tout, elle prenait ses conseils et ne pouvait rien lui cacher. Jours heureux, mais courts. Dans sa sollicitude pour tous les couvents du Carmel, M. de Bérulle n’estimait pas juste de réserver au seul monastère de l’Incarnation les biens qui découlaient du gouvernement de la Mère Madeleine, et il allait bientôt soumettre la tendresse de ses filles aux douleurs de la séparation. Pour lui, il prit aussitôt la poste et se rendit en toute hâte à Châlons, où d’autres élections, importantes aussi, allaient avoir lieu.
Depuis quatre années environ, ce monastère, dont la ferveur égale à la pauvreté causait l’admiration du vertueux M. de Brétigny, était gouverné par la Mère Thérèse de Jésus. Amie de cœur et d’âme de la Mère Louise, dont elle avait été la sous-prieure à Dijon, et qu’elle remplaçait dans la supériorité de Châlons, la Mère Thérèse était digne de cette intimité. Une communion de chaque instant et de tout son être aux souffrances inconnues du Fils de Dieu la réduisait à un crucifiement vraiment universel, et moins encore par ses paroles que par ses exemples, elle entraînait ses filles à sa suite sur les sommets du Calvaire, d’où, parfois, la nue se déchirant, il leur était donné de soupçonner la gloire du ciel. Fières et heureuses d’une telle mère, les Carmélites tremblaient qu’on ne la leur enlevât. Aussi, lorsqu’en présence de M. de Bérulle on procéda à de nouvelles élections, leurs votes unanimes continuèrent-ils la Mère Thérèse dans la charge de prieure. Mieux que personne, M. de Bérulle, qui avait voulu payer sa dot lorsqu’elle avait pris l’habit au couvent de Dijon en 1605, connaissait le mérite de la Mère Thérèse, et ne pouvait consentir à se priver de son concours. Avant de ratifier son élection, il spécifia donc que, dans le cas d’une fondation à Besançon, elle ou sa sous-prieure en serait chargée.
C’est à Dôle que devait se conclure cette affaire et plusieurs autres. La Mère Louise de Jésus, dont M. de Bérulle mettait sans cesse en œuvre la rare capacité et l’infatigable dévouement, rentrée à Dijon après la fondation de Châlons, n’avait point tardé, on se le rappelle, à quitter cette ville pour Dôle, où elle venait d’ériger le monastère de Sainte-Madeleine. Ce couvent, que M. de Bérulle trouva florissant, avait pour fondateur un brave officier, M. Béreur. Veuf et déjà âgé, cet homme de bien mettait toute sa joie dans ses deux filles. A la prière de la plus jeune, il avait généreusement donné les fonds nécessaires pour établir les Carmélites dans son pays; mais il ne pouvait se résoudre à lui accorder l’autorisation de prendre elle-même l’habit de sainte Thérèse: la sœur aînée encourageait son père dans sa résistance. M. de Bérulle les vit et triompha de leur affection. Le monastère de Sainte-Madeleine put bientôt ouvrir ses portes à mademoiselle Béreur, et Sœur Louise de Jésus lui donna avec l’habit son propre nom . Bien loin d’en vouloir à M. de Bérulle, qui venait de lui enlever sa chère fille, le bon vieillard s’occupa, de concert avec lui et avec la prieure de Dôle, du moyen d’envoyer une colonie du Carmel à Besançon. Ensemble, ils examinèrent à quels prêtres on pouvait confier la conscience des Sœurs, et dans quel quartier de la ville leur couvent devait s’élever. La foi vive et agissante de M. Béreur ne bornait pas ses générosités au Carmel. Lui et «mesdemoiselles ses » filles» voulaient contribuer à l’établissement d’une maison de l’Oratoire. M. de Bérulle, désireux de s’étendre dans la Comté, hésitait entre Besançon, Poligny et Dôle. «Votre » maison et l’Université me feroient désirer Dolle», disait-il à la Mère Louise, «mais ne sachant si c’estoit la volonté de
«Jésus et de sa Mère, et ne voulant rien que pour eux et
» par eux «, il n’osait prendre résolution. On conçoit qu’il inclinât vers cette dernière ville. L’Oratoire lui devait déjà, grâce au conseil de la Mère Louise, un sujet bien remarquable.
On l’appelait Jean Lejeune. Fils d’un conseiller au Parlement de Dôle, mais privé de son père dès le bas âge, il avait été préparé, par les exemples de sa mère, aux vertus qui font les vrais prêtres, et par ses récits, à la vigueur de caractère qui fait les citoyens. C’était sa joie d’entendre à la veillée cette femme forte lui raconter comment les magistrats de Dôle, se voyant refuser une satisfaction qui leur était due, avaient déposé leur robe rouge, déclarant que désormais, par leur vêtement noir, ils porteraient le deuil de leur autorité méprisée. Se sentir l’héritier de tels hommes est une grande grâce; elle s’alliait chez Jean Lejeune à une piété rare, à des connaissances déjà étendues. Il achevait ses études théologiques à l’université de Dôle, et il était même pourvu d’un canonicat dans l’église d’Arbois, lorsqu’il s’ouvrit de ses désirs de perfection et d’apostolat à une sainte Ursuline, Anne de Saintonge, et à la Mère Louise de Jésus. Toutes deux lui parlèrent de l’Oratoire, et, sur les assurances de la prieure des Carmélites, il partit pour Paris. M. de Bérulle le reçut avec une joie extrême, et découvrant dans son âme la semence des plus héroïques vertus, il la cultiva avec autant de vigilance que de tendresse. Quelques mois seulement s’étaient écoulés depuis l’entrée de Jean Lejeune à l’Oratoire, lorsqu’il fut atteint d’une fièvre pourprée. On craignait la contagion, et on défendit à tous, sauf au médecin et au confrère qui le servait, l’entrée de sa cellule. Ceci se passait au commencement de l’année 1615. M. de Bérulle, quoique fort préoccupé alors des affaires de l’Église et de l’État, ne manqua pas un seul jour de venir visiter son cher fils, de le consoler, de le servir de ses propres mains, poussant l’humilité et la charité jusqu’à faire lui-même son lit.
M. de Bérulle remercia la Mère Louise de lui avoir envoyé un ecclésiastique si plein de promesses, et il lui donna ses pouvoirs pour l’admission de nouveaux membres. La Franche-Comté semblait préparer à l’Oratoire, avec des ouvriers d’élite, une abondante moisson.
Tandis qu’à Dôle la Mère Louise de Jésus travaillait si heureusement à l’établissement de l’Oratoire, la Mère Madeleine de Saint-Joseph s’en occupait à Tours avec non moins de succès.
Les craintes des Mères du grand couvent s’étaient réalisées dès le mois de juillet. Les supérieurs ayant jugé à propos de retirer, pour le bien de l’Ordre, plusieurs Religieuses de la maison de Tours, M. de Fontaines manifesta un vif regret de cette décision. On pensa alors que le plus sûr moyen de le satisfaire et d’établir dans ce couvent la même perfection que dans celui de Paris, était d’y envoyer pour quelques mois la Mère Madeleine. Elle obéit, et quoique percluse de douleurs, et travaillée intérieurement par des peines très-cruelles, elle se consacra tout entière à l’œuvre qu’on lui confiait. En même temps, avec son tact habituel, elle disposait en faveur de l’Oratoire les gens de bien de la ville qui la vénéraient. Depuis quelques mois déjà, à sa sollicitation et à celle de M. de Fontaines, les PP. Jérôme Beauquemard et François Aubert étaient venus se loger auprès des Carmélites. Par leurs prédications, leur assiduité au confessionnal, leurs travaux apostoliques dans les campagnes environnantes, ils avaient conquis l’estime publique. Aussi, lorsque après une courte halte à Orléans, dont le peuple lui parut «peu disposé à profiter des
» petits labeurs» de sa compagnie, M. de Bérulle vint à Tours, il trouva aplanies toutes les difficultés que l’on croyait d’abord fort grandes. Les habitants eux-mêmes étaient étonnés, et disaient que, «de mémoire d’homme, ne s’estoit
» résolue d’affaire en leur corps de ville avec un si grand
» consentement. Car l’assemblée estant fort solennellement
» convoquée et fort grande, il ne s’en estoit trouvé un seul
» qui n’eût conclu favorablement».
Afin de hâter l’établissement, M. de Fontaines s’inscrivit pour un don de six mille livres. M. de Bérulle dédia la maison «à la vie languissante du Fils de Dieu en la
» croix.» — «O quelle vie!» disait-il, «ô quelles langueurs! ô
» quelles souffrances! ô quels effets ordonnés pour cette vie-
» là, par cette vie-là ! Si nous pouvions faire un monde en
» l’honneur d’un si grand et si divin suiet, nous le devrions
» faire! Et ie me tiens heureux du moyen et de la pensée
«que Dieu nous donne de lui dédier et offrir une mayson
» en l’honneur spécial de chose tant mémorable et tant
» honorable.» C’est de Saumur, où il se trouvait le 10 septembre, que M. de Bérulle écrivait en ces termes à M. Gibieuf. Depuis près d’un an, il était question de confier à l’Oratoire la chapelle de Notre-Dame des Ardilliers. L’évêque d’Angers, Charles Miron, avait donné son consentement le 11 février, et les habitants de Saumur y avaient souscrit le 30 avril. Néanmoins M. de Bérulle dut quitter cette ville sans avoir rien conclu. Il gagna Nantes, dont l’évêque et le grand vicaire, M. Louytre, étaient les dévoués protecteurs de la Congrégation, et revint aussitôt à Paris .
Depuis son retour de Rome, M. de Soulfour, maintenant prêtre de l’Oratoire, occupait ses loisirs, par le conseil de son supérieur, à la traduction de deux ouvrages italiens. L’un était une vie de saint Charles Borromée, par Giussano; l’autre, un recueil de sermons sur les devoirs des prélats, par l’évêque de Casale 1. Lorsque le premier de ces livres fut imprimé, M. de Bérulle jugea naturel de l’offrir à la Reine mère, et c’est ce qu’il fit dans une belle et large dédicace. Après avoir exposé à Marie de Médicis à combien de titres ce livre lui appartenait, puisqu’il avait pour objet un saint dont elle était parente, et pour auteur un prêtre d’une congrégation dont elle était la fondatrice, il convie les évêques à étudier la vie d’un si grand homme, parmi les vertus duquel il a soin de distinguer son «respect singulier » envers le Saint-Siège», allusion manifeste aux derniers événements, et «une vigilance et résidence perpétuelle » sur leur troupeau» ; leçon fort utile, en l’année 1615, aux prélats français. Puis, dans sa légitime fierté d’appartenir à une Église qui produit de tels prêtres, M. de Bérulle présente hardiment ce saint des derniers temps, cet homme puissant en œuvres, aux regards des protestants, chez lesquels «il n’y a non plus de sainteté que de vérité », et «dont la foy est une foy sans œuvres, tant elle est ré- » formée;» et revenant à la Reine, il lui adresse en termi- nant ces graves paroles: «Honorez-le, Madame, car la » grandeur des Saints surpasse la grandeur des Roys, plus » que le ciel ne surpasse la terre, et leurs cendres mêmes » sont vénérables aux Roys. Priez-le, car la charité luy » donne vouloir, et sa qualité luy donne pouvoir d’obtenir » de Dieu ce qui sera convenable pour l’estat de vostre
Arch. nat., M. 220, cote C, p. 40. — MORÉRI, art. SOULFOUR.
» ame, pour la prospérité de nostre Roy, pour le bien de la
» France. Imitez-le, car c’est un exemple rare et domes-
» tique qui vous sollicite et convie puissamment et souëfve-
» ment de tendre à la perfection de la vertu royale et
» chrestienne, afin qu’étant coniointe en la terre à ce grand
» saint par le sang et la nature, vous lui soyez coniointe
» au ciel par la grace et la gloire.»
Tandis que M. de Bérulle parlait un si ferme langage à la Reine, il mettait toutes les industries de sa charité au service d’une victime de la Cour et du monde. C’était une dame parfaitement belle, d’un esprit vif et plein d’agrément. Son instinctif dégoût pour tout ce qui abaisse lui prêtait un charme de plus et paraissait devoir sauvegarder sa vertu. Elle avait accoutumé de dire qu’elle demandait à Dieu de la préserver de tout péché, un seul excepté.
«Pour celui-là,» ajoutait-elle, «je l’ai en telle horreur que je
» m’en garderai bien moi-même.» Il lui restait à apprendre quelle fragile défense l’honneur, même le plus délicat et le plus vaillant, oppose aux entraînements du cœur. Elle eut le malheur d’inspirer une passion que son devoir et sa dignité lui défendaient de partager. Après avoir lutté longtemps, trahie par elle-même, elle succomba. Mais fière jusque dans sa chute, elle n’eut désormais qu’un souci: conserver dans l’estime des hommes cet honneur qui n’existait plus aux yeux de Dieu. Vainement une très-grave maladie, la clouant sur la croix, vint réveiller en elle avec les sentiments d’une foi toujours vivante, la crainte des éternels châtiments. Elle ne pouvait se résoudre à chercher la paix dans l’aveu de sa faute. En même temps, cette infortunée apprit que l’auteur de tant de maux ne l’épargnait pas dans ses discours, et la haine succédant alors à l’amour, mit le comble à son supplice. Plusieurs Religieux de grande vertu, appelés successivement auprès d’elle, avaient vainement essayé de faire rentrer l’espérance dans ce cœur ulcéré. On se tourna vers M. de Bérulle, qui reçut d’abord le même accueil que ses prédécesseurs. Rien ne put lasser son courage. S’apercevant que sa présence donnait quelque relâche à cette malheureuse, il passait à son chevet des jours sans nourriture et des nuits sans sommeil. Enfin, l’ennemi fut obligé de fuir, la grâce rentra dans ce cœur naturellement élevé, et qui, broyé par le repentir, se dilata dans la charité. Avant que la pécheresse, devenue une grande pénitente, quittât une terre arrosée de ses larmes, M. de Bérulle voulut qu’elle rendît son amitié à celui dont elle n’aurait jamais dû accepter l’amour. Il vint donc, conduit par le serviteur de Dieu. A la vue de cette femme autrefois si spirituelle et si belle, maintenant méconnaissable et agonisante, il fut rempli d’une telle émotion, que se jetant aux pieds de M. de Bérulle, il lui fit la confession de toute sa vie . Douloureuse histoire qui, en révélant de nouveau au supérieur de l’Oratoire les amertumes, les désenchantements et les hontes dont le monde est rempli, lui rendait plus doux encore le spectacle des vertus qui s’épanouissaient au Carmel. Les âmes prédestinées qui l’habitaient réclamaient sa visite. Il quitta Paris au plus tôt, et dès le 9 novembre il était à Tours.
La prieure qu’on y avait envoyée de Paris était la Mère Marie de Saint-Gabriel, Religieuse de beaucoup d’esprit et de courage, mais un peu sévère; aussi lui avait-on donné pour sous-prieure la Mère Marguerite du Saint-Sacrement. Soutenue encore par l’autorité pénétrante de la Mère Madeleine de Saint-Joseph, qui se trouvait avec elle à Tours, l’admirable fille de madame Acarie n’avait point tardé à conquérir la confiance des Religieuses. La visite de M. de Bérulle, qui fut longue, car, commencée le 9 novembre, elle ne se termina que le 14, acheva d’établir dans le monastère une discipline sans laquelle la ferveur des commencements se dissipe rapidement. Dans l’acte de visite écrit de sa main, M. de Bérulle signale avec précision et bannit avec fermeté les défauts qu’il a remarqués parmi les Sœurs. Il ordonne que «les
» usages et observances de cette mayson seront resduites
» à l’ordinaire de cette sainte religion, et que tout ce qui
» est d’estranger et d’inuention priuée en sera osté.» Il recommande le silence, et déclare que «celles qui y man-
» queront cy-après seront notées de quelque pénitence
» particulière, pour remettre en vigueur cette sainte obser-
» vance très-utile à conserver la présence de Dieu en l’âme
» et sa sainte opération.» Il insiste pour que «l’esprit de
» charité, simplicité, obéissance, soit établi et renouvellé
» dedans les Sœurs, n’y ayant rien désormais, ny en leurs
» pensées deuant Dieu, ny en leurs actions et parolles deuant
» les Sœurs, qui ne ressente ces dispositions intérieures.» Mais surtout il veut que «la déuotion envers la très-sainte
» Vierge Marie soit grandement cultiuée et soigneusement
» augmentée dedans les âmes. Et qu’à cet effet, iusques
» au temps de la prochaine visite, chaque Sœur fleschira
» le genoulx une fois le soir devant la très-sainte Vierge,
» en ses dévotions particulières, 1° pour rendre hommage
» aux grandeurs et souuerainetés de la très-sainte Mère de
» Dieu; 2° pour luy offrir son estre et son estat, sa vie et
» ses actions; et 3° pour la supplier qu’elle daigne la dis-
» poser à luy rendre l’honneur et l’amour spécial qu’elle
» requiert de ses filles et servantes en la terre, et lui faire
» part de l’appartenance singuliere en laquelle elles
» doiuent entrer en cette qualité ;» et il ajoute que
«chaque Sœur aura soin de communier une fois le
» moys pour l’accomplissement des désirs de la très-
» sainte Vierge sur la terre, pour l’établissement de son
» honneur dedans les âmes, et notamment dedans cet
» Ordre.»
La visite de Tours achevée, M. de Bérulle se dirigea vers la Rochelle. Aux environs de cette ville demeurait une dame de grande piété, qui, ayant entendu parler de l’expérience de M. de Bérulle dans les voies intérieures, désirait lui ouvrir son âme. Elle n’eut pas besoin de lui exposer son état: il prévint ses demandes par ses paroles, et lui fit voir ainsi combien il était rempli de l’Esprit de Dieu, qui connaît, avant même qu’ils les expriment, les pensées des hommes. L’établissement que l’Oratoire possédait à la Rochelle était considérable, et M. de Bérulle n’eut qu’à bénir Dieu qui lui avait offert le moyen de l’honorer dans le boulevard même du calvinisme. De la Rochelle, il vint à Saintes, tellement décidé à n’y point faire de séjour, qu’il avait défendu à un homme dont il était accompagné de parler de sa présence à l’abbesse de Notre-Dame ni à ses Religieuses. Mais étant monté à l’autel pour célébrer, il en redescendit dans des pensées toutes différentes, et se fit incontinent conduire à l’abbaye. Là, il eut avec les Religieuses, mais surtout avec l’abbesse et avec M. Despruets, son confesseur, un entretien manifestement béni du ciel, et quand ils se quittèrent, ils sentirent qu’entre leurs âmes Notre-Seigneur venait de former des liens que l’éloignement ne pourrait relâcher, que la mort elle-même serait incapable de rompre.
Bordeaux appelait M. de Bérulle. Dans le monastère de Saint-Joseph, il allait retrouver, tout vivant encore, le souvenir de sa fondatrice, la jeune présidente de Gourgues, et sous le gouvernement de la Mère Isabelle des Anges une communauté régulière et fervente. Vénérée dans tout Bordeaux, exerçant sur les gens les plus haut placés de la ville le même ascendant que sur ses Sœurs, «la vaillante Espagnole» ne se servait de son crédit que pour rétablir la paix dans nombre de familles divisées. Mais bien qu’un emploi si digne d’un cœur tout brûlant de charité lui donnât quelque consolation, la pieuse prieure en souffrait cependant, parce qu’il l’arrachait à sa chère solitude et lui attirait les applaudissements du monde. Aussi souhaitait-elle d’aller en une ville où «il
» n’y eût point de parloir pour elle». Instruit de ses désirs, M. de Bérulle, que l’on pressait alors de fonder un monastère à Toulouse, résolut de confier cette mission à la Mère Isabelle. C’était assurément imposer une grande épreuve au monastère de Saint-Joseph; mais l’esprit des Religieuses y paraissait si excellent, M. de Bérulle voyait dans la Mère Marie de la Trinité, professe de Rouen, une prieure si capable de continuer les traditions de la Mère Isabelle, qu’il crut pouvoir faire cette faveur à Toulouse sans trop nuire à Bordeaux .
Dans l’espace de quatorze mois, M. de Bérulle avait visité les monastères de Paris, de Pontoise, d’Amiens, de Châlons, de Dôle, de Tours, de Bordeaux. Partout il avait trouvé florissantes la piété, la pauvreté, l’obéissance. Partout il avait admiré, se détachant sur ce fond commun de la régularité religieuse, quelque merveille plus délicate de la grâce. Ce fut donc la joie et la consolation dans le cœur qu’il rentra à Paris, où le rappelaient les intérêts de sa Congrégation.