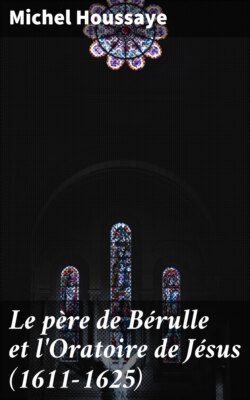Читать книгу Le père de Bérulle et l'Oratoire de Jésus (1611-1625) - Michel Houssaye - Страница 6
LA BULLE D’INSTITUTION.
Оглавление1612-1613.
Supplique de la Reine mère au Pape. — Les cardinaux Mellini, Arigoni, Lancelotti, désignés pour l’examiner. — Agitation des esprits en France; entreprises de Richer et de ses disciples contre l’autorité du Pape. — Objections des cardinaux commissaires au projet de M. de Bérulle. — Réponses de celui-ci. — Lettres à M. de Soulfour. — Dispositions bienveillantes de plusieurs évêques de France. — M. de Bérulle rend compte de son dessein à quelques prélats. — Discours qu’il leur tient. — Peines de M. de Soulfour. — On envoie à M. de Bérulle le projet de bulle. — Ses observations. — Bulle Sacrosanctœ, 10 mai 1613. — Comment M. de Bérulle conçoit l’Oratoire. — Liaison qu’il doit avoir à Jésus-Christ. — A la très-sainte Vierge. — Règles et usages prescrits par M. de Bérulle pour resserrer cette union. — Mort de madame de Gourgues, 28 mai 1613.
Dès le 19 août 1611, la Reine mère et M. de Gondi avaient fait demander au pape Paul Vune bulle d’institution en faveur de l’Oratoire. La supplique rédigée au nom de la Reine par M. de Bérulle expliquait avec une telle précision la manière dont il convenait de dresser la bulle, les instances de Marie de Médicis étaient si pressantes, que l’on se flattait d’un prompt succès.
M. de Bérulle fut bientôt détrompé. La supplique avait été remise entre les mains de deux cardinaux, Mgr Mellini et Mgr Arigoni. Ils l’examinèrent avec le soin que réclamait une affaire de cette gravité, peut-être aussi avec la défiance que leur inspiraient la nouveauté du projet et la patrie de son auteur. Mgr Pompée Arigoni surtout, fort dévoué à l’Espagne, dont il avait autrefois plaidé les affaires, en qualité d’avocat consistorial, se montra si difficile, que M. de Bérulle désira et obtint, grâce aux bons offices du nonce Ubaldini, qu’on lui substituât Horace Lancelotti, récemment promu au cardinalat.
Ce changement ne produisit pas le prompt résultat que s’en étaient promis les amis de l’Oratoire. A Rome, où l’on connaissait par la nonciature tout ce qui se passait en France, on se montrait inquiet, et à bon droit, des agitations dont l’Université de Paris était le théâtre. Le syndic Richer, profitant de la minorité du Roi, spéculant sur toutes les passions populaires et parlementaires qu’exaspéraient les souvenirs de la Ligue et l’assassinat de Henri IV, ne prenait plus la peine de dissimuler ses attaques contre le Saint-Siège. Lors des thèses fameuses soutenues le 27 mai 1611 chez les Jacobins, un de ses disciples avait osé qualifier d’hérétique la doctrine qui soutient la supériorité du Pape sur le Concile: et cela en présence du nonce. Puis, sous prétexte de défendre son ami, Richer lui-même venait d’entrer en lice par la publication d’un opuscule intitulé : De ecclesiastica et politica potestate, lequel était une nouvelle insulte au Saint-Siége. Il est vrai que les huit évêques de la province de Sens, réunis à Paris, sous la présidence de M. du Perron, avaient porté du livre une censure publiée dans toutes les chaires de la capitale . Il est vrai aussi que l’on faisait espérer au nonce, pour le retenir en France, d’où il menaçait de s’éloigner, la déposition de Richer. Mais Richer n’était point seul, Ubaldini le savait et l’écrivait à sa cour. Celle-ci se demandait naturellement s’il était sage de choisir, pour approuver une compagnie de prêtres séculiers tout dévoués aux évêques, le moment où un trop grand nombre d’ecclésiastiques français, soutenus par la magistrature, se montraient si animés contre les prérogatives du Saint-Siége, et rêvaient, avec le syndic de la faculté de théologie, une aristocratie épiscopale, destinée à ruiner l’autorité pontificale. Ne voulant pas cependant répondre par un refus formel, les cardinaux Mellini et Lancelotti tâchaient de gagner du temps.
Les mêmes événements faisaient naître chez M. de Bérulle une conviction opposée. Essayer de fonder une congrégation directement soumise au Saint-Siége, c’était, à ses yeux, tenter une entreprise impossible. Car dans l’état de surexcitation où les menées de Richer et des protestants entretenaient les esprits, une telle société se verrait aussitôt suspectée et attaquée par l’Université, le Parlement, et cette immense quantité de gens qui étudient les questions graves dans les pamphlets et les nouvelles à la main. Par une de ces habiletés aussi détestables que grossières, mais auxquelles, hélas! le peuple se laisse toujours prendre, on agitait sans cesse devant lui le couteau ensanglanté de Ravaillac, en lui répétant que le Pape et les Jésuites avaient sinon armé la main de l’assassin, au moins approuvé son infâme attentat. Sous les piliers des Halles et dans la grande salle du Parlement; sur les bancs de l’Université et dans les escaliers du Louvre, on se passait» l’arrêt de la cour contre le livre de Mariana, «l’Anti-Coton, la Prosopopée de l’Université de Paris» ;on dévorait ces pages pleines de fiel, calomnieuses, ordurières, parfois spirituelles, éloquentes même, et nombre de gens croyaient sur parole l’auteur du «Tocsin», lorsqu’il s’écriait:
«France, il est temps que le tocsin batte fort et sans cesse
» en tous les cœurs de tes enfants, pour esueiller et don-
» ner l’alarme à ceux qui te doivent défendre, puisque le
» cardinal Bellarmin, jésuite, autant impudemment que
» injustement, a choisi ceste nuict de la minorité de ton
» Roy pour donner l’escalade à ta souveraineté et pour
» mestre le pétard aux portes de ta majesté toujours in-
» violée .» Ces propos de la rue étaient appuyés par les arrêts de la cour et les déclamations en Sorbonne de Richer, traduites du latin en français pour la plus grande commodité du public . Dans un pareil état de choses, ce qui paraissait possible et nécessaire, c’était d’entourer les évêques de prêtres instruits et pieux qui ne leur donnassent aucun ombrage, puisqu’ils leur seraient entièrement soumis, et qui, en même temps, formés à la plus filiale obéissance envers le Saint-Siège, combattissent par leur enseignement et leur conduite les déplorables doctrines de Richer et de ses disciples.
Après bien des mois d’attente, M. de Bérulle reçut enfin du nonce un mémoire que lui adressaient les cardinaux Mellini et Lancelotti. Toutes les objections que soulevait à leurs yeux son projet s’y trouvaient développées. Il était facile d’y répondre.
L’utilité de la nouvelle société semblait d’abord douteuse aux deux cardinaux. Pour la leur démontrer, M. de Bérulle se contenta de tracer à grands traits le triste tableau de l’état du clergé en France, et de montrer comment par sa dépendance des prélats et sa soumission au Pape, l’Oratoire offrirait l’exemple de l’obéissance hiérarchique; par la sûreté de sa doctrine, combattrait la licence des opinions en vogue; par son zèle, remédierait à la tiédeur et à l’inutilité de tant d’ecclésiastiques ; par la perfection sacerdotale enfin, et par la direction des séminaires, lutterait contre le débordement des mœurs dans le clergé.
Mais à supposer que la nouvelle société soit utile, est-elle possible? continuaient les deux cardinaux. Vous voulez la soumettre aux évêques, comment dès lors lui assurer une forme fixe? Ne voyez-vous pas qu’un évêque aura toujours la liberté de modifier l’œuvre de son prédécesseur? Aussi, répondit M. de Bérulle, la nouvelle congrégation ne relève-t-elle des évêques que pour l’exercice des fonctions du ministère, nullement pour la conduite et la direction du corps, lequel ne dépend que du Pape. Et cette double dépendance, bien loin d’être une contradiction, ajoutait-il en répondant à la troisième difficulté soulevée par les cardinaux, s’accorde parfaitement, et grâce à elle l’Oratoire se trouve lié à l’ordre hiérarchique tout entier, aux évêques et au Pape. Comme l’écrivait M. de Bérulle au cardinal de la Rochefoucauld: «Cette compa-
» gnie, moyenne entre les séculiers et les réguliers, doit
» nécessairement avoir quelque chose des uns et des autres,
» et ce tempérament se trouve dans cette dépendance du
» Pape pour les statuts et dans la soumission aux prélats,
» pour l’exercice de nos fonctions. Vous savez le peu de
» pouvoir qu’ont nos évêques de France sur les ecclésias-
» tiques séculiers pour les employer hors des charges de
» lucre et d’honneur que nous leur abandonnons volon-
» tiers, et sur les religieux pour les contenir et les empê-
» cher, au lieu que cette congrégation désire se rendre
» religieuse d’esprit et d’intention, et se soumettre aux pré-
» lats, quant à l’employ des fonctions. C’est un secours
» qui pourra être d’usage à ceux qui voudront de nous, et
» qui ne peut porter préjudice à ceux qui n’en voudroient,
» puisqu’il est en leur pouvoir de nous appeler, au lieu
» qu’il n’est pas au nôtre de travailler, s’ils ne nous appel-
» lent et ne nous employent .»
Passant ensuite à un autre ordre d’idées: Pourquoi, demandaient Mgrs Mellini et Lancelotti, puisque vous prenez le même titre que les disciples de saint Philippe de Néri, ne point adopter leur règle? Parce que, répondait M. de Bérulle, ce qui est excellent pour l’Italie peut être moins bon pour la France. On comprend que dans l’Italie, partagée entre plusieurs petits États souverains, l’indépendance des maisons les unes des autres, telle que la pratique l’Oratoire de saint Philippe de Néri, soit très-conforme aux besoins du pays, tandis qu’en France, où toutes les provinces obéissent à un pouvoir unique, il semble naturel qu’une congrégation comme l’Oratoire relève d’un seul chef. N’est-il point d’ailleurs bien difficile parfois de trouver dans chaque maison un chef capable de la conduire, chose nécessaire pourtant si chaque maison est laissée à elle-même? Ne vaut-il pas mieux les unir et donner ainsi au supérieur la liberté de choisir dans tous les corps les sujets, et de les placer selon leurs aptitudes et les besoins de la compagnie?
Restait une dernière difficulté. M. de Bérulle avait insisté pour que le Pape, par la bulle d’institution, lui accordât le pouvoir de fonder non-seulement la maison de Paris, mais toutes celles qui dans la suite lui seraient offertes en France. La raison qu’il donnait à M. de Soulfour de sa demande, c’est «qu’on n’a pas toujours ni argent tout
» prêt, ni députés, ni crédit, ni loisir pour traiter avec
» Rome, et y demander de nouvelles bulles pour chaque
» maison qu’il faudra fonder.» Les cardinaux commis- saires avaient peine à accepter cette clause, parce qu’on ne voyait pas, disaient-ils, où M. de Bérulle trouverait les revenus nécessaires à ces nouveaux établissements. La maison de Paris étant de fondation royale, répondit M. de Bérulle, ce serait faire injure à la libéralité de la Reine mère que de mettre en question si elle veillerait à sa subsistance , déjà assurée, d’ailleurs, par plus de trente mille écus, dus à la générosité de différents particuliers. Quant aux maisons futures, on était bien résolu à n’en accepter aucune sans les avoir pourvues d’un revenu suffisant, soit qu’on l’obtînt des fondateurs, soit qu’il fut donné par les membres de la congrégation, lesquels jouissant de leur patrimoine, et ayant presque tous de l’aisance, pouvaient travailler sans lui être à charge. D’ailleurs, ajoutait M. de Bérulle, non plus dans sa réponse aux cardinaux, mais dans une lettre confidentielle à M. de Soulfour: «Faites,
» s’il vous plaît, considérer à ces messieurs-là que ne vou-
» lant nous établir nulle part que du vouloir des évêques
» et appelés d’eux, c’est leur faire tort, et non pas à nous,
» et ne pas se fier à eux, que de prétendre nous obliger
» d’obtenir un nouveau pouvoir pour entrer dans leurs
» diocèses, comme si leur agrément ne suffisait pas.» Et dans l’inquiétude que lui causait l’irritation des esprits en France, avec toute la franchise de son dévouement pour le Saint-Siège, il priait M. de Soulfour de représenter aux cardinaux «que ces rigueurs et ces sujétions donnent
» sujet aux évêques de se passer des Romains le plus
» qu’ils peuvent, et de rechercher en eux-mêmes ce qu’on
» leur fait acheter si cher; ce qui diminue d’autant la
» liaison qui doit être entre le Saint-Siège et eux, surtout
» en France, où l’on tient qu’en vertu de l’ancien droit
» nos évêques ont le pouvoir de faire beaucoup de choses
» que Rome se rend difficile à leur accorder.»
Cependant nombre d’évêques se montraient chaque jour plus favorables à M. de Bérulle. M. de Bourgneuf, évêque de Nantes, «l’un des plus doctes et plus vertueux prélats » de France», offrait aux Oratoriens une maison, des revenus et sa bibliothèque, estimée six mille écus: il songeait même à se retirer parmi eux. M. de Richelieu, qui, malgré son désir de ne point s’éterniser dans «le plus crotté des » évêchés de France», l’administrait avec autant d’intelligence que de vigueur, sollicitait M. de Bérulle d’accepter la conduite du séminaire de Luçon. M. de la Rocheposay, évêque de Poitiers, lui proposait la cure de Sainte-Opportune, à laquelle était attachée la chaire de théologie de l’Université. Mais, pour passer des traités définitifs, tous attendaient que le Saint-Siège eût approuvé le nouvel institut.
D’autres évêques, qui ne voyaient pas clairement l’utilité de la congrégation naissante, ou qui doutaient de son avenir, trouvaient un nouvel argument à l’appui de leurs préventions dans la difficulté que Rome mettait à se prononcer en sa faveur. Quelques-uns de ces derniers, de passage à Paris, eurent la pensée de mander M. de Bérulle, afin de se rendre compte par eux-mêmes de son esprit et de ses projets. Pénétré du plus religieux respect pour ceux qui ont reçu la plénitude du sacerdoce, le pieux fondateur s’empressa de répondre à un appel qui ne pouvait être un ordre. Il commença par leur représenter humblement qu’en tout ceci il n’agissait que par la volonté expresse de son supérieur, M. l’évêque de Paris. Les prélats insistèrent, et lui dirent que puisqu’il vivait déjà en communauté, avec le dessein de travailler à la réforme du clergé, il devait avoir des règles, et qu’il les leur fît connaître. A cette demande, M. de Bérulle, qui n’en avait encore rédigé aucune, se sentit un peu interdit. Mais se remettant aussitôt, il tira de sa poche le Nouveau Testament, l’ouvrit au hasard, et tomba sur ces paroles de saint Paul, qu’il lut à haute voix:
«Modestia vestra nota sit omnibus hominibus: Dominus enim
» prope est. Nihil solliciti sitis, sed in omniratione et obsecra-
» tione, cum gratiarum actione petitiones vestrœ innotescant
» apud Deum». «Voilà ma règle», ajouta-t-il en fermant le livre. Les évêques, édifiés de la réponse, ne lui posèrent plus aucune question, et l’exhortèrent même à continuer l’œuvre qu’il avait si heureusement commencée.
De retour à l’hôtel du Petit-Bourbon, M. de Bérulle raconta à ses confrères l’entretien qu’il venait d’avoir avec les évêques, son embarras pour leur répondre, et le secours inattendu qu’il avait trouvé dans le texte de saint Paul. Puis, commentant ces paroles, il leur fit voir qu’elles étaient comme une règle indiquée par Dieu même, puisque, dans leur laconisme, elles contenaient toutes les maximes de la vie sacerdotale. Retenue et gravité dans le maintien, la démarche, les rapports avec le monde; détachement des biens de la terre; ferveur toujours croissante dans l’oraison et l’oblation du sacrifice: n’étaient-ce point là les traits auxquels on devait les reconnaître, et qui légitimaient leur titre de Prêtres de l’Oratoire de Jésus ?
A Rome, pendant ce temps, M. de Soulfour poursuivait sa négociation avec une patience invincible. Après avoir mis le ciel dans ses intérêts par de continuelles prières aux autels des Apôtres et aux tombeaux des martyrs, il allait visiter les cardinaux chargés de rédiger la bulle, répondait à leurs difficultés, puis informait exactement M. de Bérulle de ses craintes et de ses espérances. Celui-ci le remerciait, mais à la manière des saints: «Je ne
» puis me résoudre à vous faire des excuses, lui disait-il,
» des peines que nous vous donnons. Puisqu’il a plu à
» Dieu de vous disposer de le servir avec nous, il est bon
» que vous ayez part à la croix et aux souffrances, comme
» j’espère que vous l’aurez à la consolation qui est jointe
» au service d’un aussi bon maître qu’est Jésus-Christ.
» Il faut, en une œuvre semblable, que les uns sèment et
» labourent, et que les autres moissonnent et partagent le
» fruit de leurs travaux.» De son côté, M. de Soulfour tâchait de rassurer M. de Bérulle, en lui expliquant les motifs qui retardaient toujours l’expédition de la Bulle.
«Ils sont dans ce pays-ci», lui écrivait-il le 3 août 1612,
«si rebutés de toutes les mauvaises affaires et des diffé-
» rends à régler qui leur naissent tous les jours au sujet
» de la multitude d’Ordres et de congrégations toujours
» en guerre avec leurs supérieurs ou entre elles, qu’ils au-
» roient voulu pouvoir abolir une partie de celles qui sont
» déjà établies, loin de songer à en ériger de nouvelles.» M. de Soulfour disait vrai, mais il ne cachait pas néanmoins que la pierre d’achoppement aux yeux des cardinaux était toujours cette obéissance partagée entre le Pape et les évêques. Par leurs longueurs, les cardinaux espéraient réduire M. de Bérulle à mettre sa congrégation dans la dépendance absolue du Saint-Siège. C’était mal le connaître. Il se borna à rédiger un nouveau mémoire, où il répétait avec plus de force et d’insistance les arguments déjà exposés dans le premier, et il attendit. Sa constance fut couronnée de succès. Le cardinal Borghèse, neveu du Pape, lui fit enfin savoir par le nonce que la bulle ne tarderait pas à être expédiée conformément à ses intentions; on lui communiqua même le projet, et il eut la liberté d’y faire ses observations. Elles se réduisirent à une seule, et de peu d’importance .
Sur deux points, cependant, Paul V s’écartait des vues de M. de Bérulle. Le fondateur de l’Oratoire avait demandé que les statuts et règlements qu’il comptait donner à sa congrégation fussent soumis à l’examen et à l’approbation de l’évêque de Paris; mais il désirait que ce prélat ne pût le faire qu’en vertu d’une commission du Saint-Siège, mentionnée dans la bulle d’institution. Le Pape jugea plus à propos d’accorder à M. de Bérulle lui-même le pouvoir de dresser ces statuts et règlements, sous la réserve d’en obtenir du Saint-Siége la confirmation. Dans sa supplique, M. de Bérulle avait excepté des fonctions de l’Oratoire «celles qui regardent l’instruction de la jeu-
» nesse dans les belles-lettres, ou qui engageraient ses
» sujets dans des grades ou dans une juridiction temporelle
» et contentieuse.» Il craignait pour ses disciples la dissipation presque inséparable de la direction des collèges: il appréhendait que le goût des belles-lettres ne diminuât en eux celui qu’ils devaient avoir pour l’Écriture sainte et pour la théologie. On n’avait point tenu compte de ces exceptions. Ainsi Rome accordait non-seulement plus qu’il ne demandait, mais même ce qu’il ne désirait pas. Adorant la volonté de Dieu dans celle du Vicaire de Jésus-Christ, M. de Bérulle se tut et accepta.
La bulle que l’on sollicitait depuis deux ans ne se fit plus attendre: le 10 mai 1613 elle fut publiée. Paul V y approuve la nouvelle société sous le nom de Congrégation de l’Oratoire de Notre-Seigneur Jésus-Christ en France. Le Pape dit que la fin du nouvel institut est d’honorer et d’imiter Notre-Seigneur Jésus-Christ, de le prendre pour modèle dans son esprit d’oraison, d’avoir pour lui une dévotion spéciale et supérieure à celle du commun des fidèles. Il ajoute que cet institut est purement ecclésiastique, qu’il doit se composer de prêtres et d’aspirants au sacerdoce que ne liera aucun vœu solennel, et de personnes destinées à les servir. Le Pape déclare ensuite que les fonctions de la nouvelle société pourront s’étendre à tout ce qui est propre et essentiel à l’exercice du ministère ecclésiastique, et nommément à la conduite des séminaires; que les membres de cette congrégation ne dépendront que des seuls évêques pour lesdites fonctions; mais que tout le reste, les statuts, la forme du gouvernement, ce qui concerne l’office divin, la conduite du corps et des particuliers, la discipline intérieure, sera soumis à l’autorité du Souverain Pontife, et sous lui, à celle de M. de Bérulle. Paul V entend qu’en vertu de cette bulle la Congrégation de l’Oratoire puisse s’établir dans tous les lieux où elle sera appelée du consentement des évêques. Enfin, il confirme M. de Bérulle dans sa qualité de supérieur général, et l’établit instituteur et premier supérieur, «avec
» pleine et entière faculté, puissance et autorité de faire et
» exécuter toutes et chaque chose que peuvent faire et
» exécuter tous les autres instituteurs des ordres approu-
» vés, et tout ce qui est laissé au pouvoir de tous les supé-
»rieurs, même généraux, soit de droit ou par l’usage, soit
» par privilège ou autrement.»
Pour comprendre l’importance que M. de Bérulle avait attachée aux différents points spécifiés dans la bulle d’institution, il ne faut pas perdre de vue la trempe particulière de son esprit. Jamais en effet, chez le jeune fondateur, une disposition pratique n’était autre chose que l’application d’un principe dogmatique. Si donc il avait insisté avec tant d’énergie, au risque de compromettre l’existence de son œuvre, pour que l’Oratoire fût soumis aux évêques, pour que l’absence de tout vœu solennel le distinguât essentiellement des Ordres monastiques et religieux, ce n’était pas seulement parce qu’il se rendait un compte très-exact des besoins de la société et de l’état des esprits en France en l’année 1611. Sa pensée s’élevait plus haut, et remontant jusqu’à Jésus-Christ, il cherchait dans l’institution même du sacerdoce l’idée première et le sublime idéal de sa compagnie.
L’Église, disait-il, est divisée en deux parties, toutes deux saintes, mais dont l’une reçoit la sainteté, tandis que l’autre la communique, le peuple et le clergé, «et dans
» les temps plus proches de sa naissance, de ces deux
» parties sortoient les troupes des vierges, des confesseurs,
» des martyrs, qui bénissoient l’Eglise, rémplissoient la
» terre, peuploient le ciel, et répandoient en tout lieu
» l’odeur de la sainteté de Jésus.» Mais avec les années le relâchement est venu, et c’est dans le peuple qu’il s’est introduit d’abord. «Et lors d’entre le peuple quelques-
» uns se sont retirés pour conserver à eux-mesmes la
» sainteté propre à tout le corps, et ç’ont été les moines,
» lesquels, selon saint. Denys, sont la partie du peuple
» la plus haute et plus parfaite, qui étoient régis par les
» prêtres en la primitive Église, recevant d’eux la direc-
» tion et perfection de la sainteté, à laquelle ils aspiroient
» par-dessus le commun... Lors le clergé, composé de pré-
» lats et de prêtres, portoit hautement gravées en soy-
» mesme l’authorité de Dieu, la sainteté de Dieu, la
» lumière de Dieu... Dieu unissant en un mesme ordre
» authorité, sainteté et doctrine, et unissant ces trois per-
» fections en l’ordre sacerdotal, en l’honneur et imitation
» de la sainte Trinité où nous adorons l’authorité du Père,
» la lumière du Fils, et la sainteté du Saint-Esprit, divi-
» nement liées en unité d’essence.» Peu à peu la tiédeur et l’ignorance se sont glissées du peuple dans le clergé ; alors, ce qui était uni à l’origine, s’est trop souvent divisé par le malheur des temps. «L’authorité est demeurée aux pré-
» lats, la sainteté aux religieux, et la doctrine aux acadé-
» mies, Dieu, en ce divorce, conservant en diverses parties
» de son Église ce qu’il avoit un y en l’estat ecclésiastique.» Or, pourquoi des prêtres se réunissent-ils sous le nom de compagnie de l’Oratoire? «Pour reprendre leur héri-
» tage, pour rentrer en leurs droits, pour jouir de leur suc-
» cession légitime, pour avoir le Fils de Dieu en partage,
» pour avoir part à son esprit, et en son esprit à sa lumière,
» à sa sainteté et à son authorité, communiquée aux
» prélats par Jésus-Christ, et par eux aux prêtres .»
C’est de cette conception grande et simple que tout le reste découle. Pour obtenir le résultat immense qu’il poursuit, une réforme complète du clergé, M. de Bérulle se borne à lui rappeler ses origines, à le ramener sans changement, sans adjonction, à la pureté de son institution.
Aussi l’Oratoire, différent en cela des Ordres religieux, ne reconnaîtra d’autre patron principal que Jésus-Christ, «l’auteur de la prêtrise, et le chef des prêtres».
On ne s’y proposera pas l’imitation, l’adoration d’une vertu, d’un état particulier du Sauveur, ainsi qu’il se pratique dans les monastères, où les Chartreux honorent son silence, les Franciscains sa pauvreté, les Frères Prêcheurs sa science, les Carmes sa contemplation: on s’efforcera d’entrer dans l’universalité des sentiments de Celui que Tertullien appelle le Prêtre universel, catholicum Patris Sacerdotem .
On n’y sera lié par aucun vœu solennel de religion, non certes que M. de Bérulle ne professât la plus haute estime pour ces saints engagements, lui qui avait pendant tant d’années désiré et sollicité inutilement l’habit religieux; mais il était frappé de voir que Notre-Seigneur n’eut demandé de vœux ni aux Apôtres, ni aux évêques, ni aux prêtres; et dans cette disposition du Sauveur, il adorait la liberté souveraine avec laquelle il choisit les prêtres comme il lui plaît, et ne se laisse pas choisir par eux. Et se laissant entraîner par le mouvement habituel de sa pensée, de même, disait-il, que dans l’union sublime de la Divinité avec l’humanité en la substance du Verbe, il n’y a point d’autre lien que l’amour qui unit les deux natures, ainsi entre Jésus-Christ et le prêtre qui s’engage à imiter ses vertus et sa vie en entrant à l’Oratoire, aucun autre lien n’est nécessaire que celui de la charité. Rien, en effet, après la sainte humanité du Seigneur, n’est grand comme le sacerdoce Il est l’origine de toute la sainteté répandue dans l’Église, de telle sorte que, sans lui, le monde de la grâce ne pourrait subsister: il ne reconnaît pour fondateur que le Saint des saints, le Verbe incarné lui-même: il est Jésus-Christ se survivant à travers les âges, et achevant par la main de ses prêtres l’œuvre dont il a posé les fondements aux jours de sa vie mortelle. Le prêtre, suivant une expression familière à M. de Bérulle, «est un instrument conjoint à l’humanité glorifiée » du Sauveur ».
Dès lors, l’idée de la perfection se confond dans son esprit avec la notion même du sacerdoce. Pour conduire le prêtre au sommet de la sainteté, il suffit de lui faire comprendre, aimer, adorer l’étendue et l’intimité de son union avec Jésus-Christ.
Le caractère distinctif des prêtres de la nouvelle congrégation est donc la profession qu’ils font d’être dévoués, consacrés, liés à Jésus-Christ, comme à leur chef, comme au souverain Prêtre avec lequel ils ne forment qu’un seul Prêtre, étant rendus participants de la même onction, et cette participation à son onction divine, cette appartenance à son humanité, les séparent du commun des hommes, de toutes les créatures, d’eux-mêmes, les approprient à la personne du Verbe, les consacrent avec son humanité, et par elle à la gloire de l’auguste Trinité . Nourri de saint Thomas, «en qui on entend toute l’Ecole », et dont il tenait à honneur d’être l’humble et fidèle disciple, M. de Bérulle savait parfaitement que le principe sur lequel reposait tout son dessein, et qui s’illuminait à ses yeux de clartés plus pures encore que celles de la théologie, était enseigné par tous les docteurs. Il se rappelait ce passage de la «Somme» où saint Thomas établit avec sa netteté magistrale que le prêtre étant essentiellement un médiateur dont la mission est de distribuer au peuple les dons divins et d’offrir à Dieu le sacrifice du peuple, Jésus-Christ, Homme-Dieu, est excellemment prêtre. En liant sa congrégation au sacerdoce de Jésus-Christ, en ne voulant lui donner d’autres règles que celles qui ont été léguées par le souverain Prêtre, il la liait donc à la sainte humanité du Verbe, il donnait pour base à sa société le mystère des mystères, celui qui «enclôt Dieu et l’homme», et les réduit à la plus adorable unité, le mystère de l’Incarnation.
Aussi la pensée unique, on peut le dire, de M. de Bérulle, était de porter ses frères à regarder Jésus, à imiter Jésus, à vivre dépendants de Jésus, à se laisser, dans le plus riche des dénûments, envahir, pénétrer, transformer par la vie même de Jésus. Cette haute et forte doctrine, il ne se contentait pas de l’inculquer en toutes circonstances, d’y revenir dans toutes ses exhortations, il la rendait sensible, il lui donnait un corps par les dévotions et les solennités dont il établissait l’usage à l’Oratoire.
Tout, en effet, dans l’existence d’un Oratorien, lui rappelle le Verbe incarné. Aux fêtes nombreuses qui font de l’année ecclésiastique une continuelle méditation de la vie du Sauveur, M. de Bérulle songe dès lors à en joindre de nouvelles, dont l’objet est ou Notre-Seigneur lui-même, comme «la solennité de Jésus», qui rend hommage à ses trois naissances, et l’adore en tous ses mystères et en tous ses états; ou des saints que leur intimité avec Jésus-Christ rend plus vénérables au cœur de M. de Bérulle, saint Siméon, sainte Anne la prophétesse, saint Joseph d’Arimathie, sainte Madeleine surtout, «le choix le plus rare de
» l’amour de Jésus, le plus digne objet de ses faveurs,
» le chef-d’œuvre de ses grâces .»
Chaque jour l’Oratorien devra réciter ou chanter les litanies de Jésus et les oraisons qui les suivent. Il ne manquera jamais de dire, avec une foi ardente, cette courte mais substantielle prière: «Faites-nous la grâce, nous
» vous en supplions, Seigneur, de célébrer sans cesse cette
» ineffable et divine vie du Verbe dans l’Humanité et de
» l’Humanité dans le Verbe de vie .» Trois fois, dans la journée, il se présentera devant son Sauveur, pour lui rendre ses devoirs intérieurs d’adoration, de charité, d’oblation de lui-même et de toutes ses actions. Et pour faciliter ce commerce ininterrompu de prières avec Jésus-Christ, il devra méditer continuellement sa parole, portant toujours sur lui le Nouveau Testament, et ne laissant jamais la nuit venir sans en avoir lu un chapitre avec une attention et un respect religieux.
Mais comme à un Dieu anéanti dans la chair, la chair elle-même doit par la pénitence protester de sa soumission, le prêtre de l’Oratoire jeûnera la veille de toutes les fêtes de Jésus, il s’abstiendra de viande pendant tout l’Avent, il s’imposera des mortifications particulières chaque vendredi, il y pratiquera l’humiliation et le silence en l’honneur du silence et des humiliations de son Dieu.
Les Ordres religieux ont leurs armoiries: celles des Frères Prêcheurs rappellent le songe mystérieux de la mère de Dominique, celles des Carmes, le zèle dont brûlait Élie leur père. Pour blason, l’Oratoire prend les noms de Jésus et de Marie, et ces noms sacrés par la couronne d’épines qui les entoure montrent au disciple de M. de Bérulle qu’en se consacrant au service de Jésus et de Marie, il s’engage à vivre dans les épines et sur la croix .
Jamais on n’avait professé vis-à-vis de la très-sainte Vierge une dépendance plus absolue qu’à l’Oratoire, et pouvait-il en être autrement? les prêtres ne continuent-ils pas, à travers le monde, l’œuvre de Marie? Comme elle, ils enfantent, comme elle, ils offrent au Père éternel, comme elle, ils donnent aux hommes le Verbe incarné, et c’est par elle qu’ils reçoivent de toutes les grâces celle qui rappelle le plus l’incomparable privilége de la maternité divine, la grâce du sacerdoce. Aussi M. de Bérulle établit-il une fête spéciale destinée à célébrer les grandeurs de Marie; il ordonna que chaque jour on chanterait ou l’on dirait les litanies . Il y ajouta même une oraison qui relève admirablement la dignité sublime de la Mère de Dieu, le plus beau de tous ses titres, celui sous lequel plusieurs fois par jour le prêtre de l’Oratoire honorait Marie. Il ne devait même commencer aucune action de quelque importance sans la lui avoir offerte, protestant ainsi de son respect, de son amour, de sa filiale et irrévocable dépendance vis-à-vis de celle qui a porté en ses chastes entrailles le Fils de Dieu.
Le Fils de Dieu! tel est le mot qui se retrouve sans cesse sur les lèvres de M. de Bérulle, qui est au fond de toutes ses pensées, qui est la fin de toutes ses démarches. Former des prêtres qui, par leur fidélité à leur institution primitive et leur union au Prêtre éternel, expriment et rendent sensible Jésus-Christ, voilà toute son ambition. Paul V vient d’y donner une consécration qui ne peut venir que du successeur de saint Pierre. A M. de Bérulle, maintenant, de répandre sur ses frères dans le sacerdoce la vie de Jésus qui déborde de son âme.
Au moment même où le fondateur de l’Oratoire apprenait par la nonciature que son institut avait reçu la souveraine approbation du Saint-Siège, et où il sentait peser de tout son poids sur ses épaules le fardeau de la supériorité, Notre-Seigneur, pour le consoler, daigna lui montrer, dans une lumière miraculeuse, avec quelle promptitude il exauçait ses prières. Ce fut auprès du lit de douleur où gisait à Paris sa cousine germaine, la fille de madame d’Autri, cette jeune et courageuse présidente de Gourgues, dont tout Bordeaux connaissait la sainteté.
M. de Bérulle s’était toujours senti attiré vers mademoiselle d’Autri. Alors qu’elle était toute petite, il ne la rencontrait jamais chez sa mère ou chez sa tante sans la bénir. Quand l’enfant était devenue jeune fille, à cet âge aimable et périlleux où le monde et Jésus-Christ se livrent dans un cœur de dix-huit ans de secrets et si redoutables combats, il avait été son guide fidèle. Ne la croyant pas appelée à la vie religieuse, quelque désir qu’elle en manifestât, il avait approuvé son mariage avec un homme de foi, d’honneur, d’antique probité, M. Antoine de Gourgues, et lui-même avait voulu consacrer leur union. M. de Gourgues comprit quel trésor Dieu lui confiait en ce jour. Bénis dans leur mutuelle tendresse par la naissance d’une enfant à laquelle ils donnèrent le nom de Marie, et qu’ils dédièrent à sainte Thérèse, ils offrirent, eux aussi, leur sacrifice au Seigneur. Sous le souffle de la grâce, leur amour déjà saint se transforma en une céleste amitié. Ils s’appelaient frère et sœur: Dieu et ses Anges leur en reconnaissaient le droit. Dans leur foi ardente et capable de toutes les immolations, ils songeaient même, si jeunes encore, à se séparer pour le temps, afin d’être plus étroitement unis dans l’éternité. M. de Gourgues pensait à entrer dans la Compagnie de Jésus; madame de Gourgues espérait revêtir bientôt l’habit de sainte Thérèse.
A des désirs si purs madame de Gourgues joignait les œuvres. Sa passion pour la pauvreté égalait son amour pour les pauvres. On avait vu la jeune et noble femme essayant, mais en vain, de dissimuler sous des haillons d’emprunt son rang et sa distinction; tendant, pour recevoir l’aumône, une main qui la trahissait, entreprendre et poursuivre, les pieds ensanglantés par la marche, le lointain pèlerinage de Notre-Dame de Garaison. «Serons-nous
» point obligés un jour à demander l’aumône pour l’amour
» de Dieu?» disait-elle à son mari, devenu le confident des généreuses aspirations de son âme. Le président l’admirait en silence, et respectant dans un être si cher les opérations de Dieu, il n’osait pas s’opposer aux macérations dont son amour pour Jésus-Christ accablait sans relâche un corps trop délicat.
De loin comme de près, M. de Bérulle conduisait madame de Gourgues. On avait remarqué cependant en elle, depuis un voyage à Paris qui lui avait permis de conférer longuement avec son vertueux parent, un redoublement de ferveur. En cette année 1613, elle revint au lieu de sa naissance, qui devait être celui de sa mort. Minée par une fièvre lente, atteinte d’une inflammation au poumon, elle demeura cinq mois couchée sur le même côté, souffrant de terribles douleurs, mais laissant voir sur son visage amaigri une paix si céleste, qu’on était tenté d’envier son bonheur. Dans les derniers jours d’avril, son état empira, et madame Acarie, sa cousine, la prévint que l’heure approchait. La joie d’aller voir «le beau pays», comme elle disait en son aimable langage, ne l’empêchait point d’éprouver une double peine, celle de ne pas mourir sous l’habit de sainte Thérèse, et celle de n’être point assistée à sa dernière heure par M. de Bérulle, alors en voyage. Mais Dieu la consola par le retour de M. de Bérulle, et par les indulgences de l’Ordre, qu’en sa qualité de fondatrice elle reçut des trois supérieurs des Carmélites. Les yeux fixés sur un portrait de sainte Thérèse, que lui avait envoyé la Mère Madeleine de Saint-Joseph, et sur son crucifix, s’entretenant avec M. Bence de l’Oratoire, ou avec M. de Bérulle, elle appelait, de toutes les ardeurs de son cœur, le moment de sa réunion suprême à Jésus-Christ. Les médecins avaient pensé à lui ouvrir le côté ; l’espérance de cette opération la remplissait de joie: «Mon
» Père», disait-elle à M. Bence, «priez bien Dieu que les
» médecins concluent qu’on m’ouvre le côté, afin que je
» meure dans cette conformité avec Notre-Seigneur Jésus-
» Christ.» Mais l’heure de la mort prévint celle de l’opération. Elle avait conjuré M. de Bérulle de lui obtenir la grâce de la paix dans ses derniers moments: sa prière fut pleinement exaucée. Un peu avant de rendre le dernier soupir, se tournant vers M. de Bérulle: «Mon cousin», dit madame de Gourgues, «je ne manquerai point de demander
» à Dieu toutes les choses dont vous et ma cousine m’avez
» chargée.» Et comme madame Acarie s’inquiétait de sa- voir si rien ne lui faisait peine: «Rien», répondit la jeune mourante, «je ne fus jamais si contente que je suis
» de me voir si proche d’un si grand bien.» Peu de temps après elle expira. Elle avait vingt-trois ans.
Onze heures du soir venaient de sonner; tous ceux qui avaient assisté à une si belle et si douce fin se retirèrent, M. de Bérulle seul resta. Il se sentait obligé de ne point quitter ce corps vaincu par la mort avant d’avoir assuré à son âme le triomphe de la vie. Comme Jacob, il lutta pour elle jusqu’à l’aurore, prosterné dans la prière. A quatre heures du matin, il se leva et partit. Madame de Gourgues était au ciel.
Madame d’Autri l’ayant supplié d elui dire, quelques jours après, s’il croyait que sa chère fille fût encore en purgatoire, il lui répondit aussitôt: «Oh! qu’elle n’y a
» guère esté ! Aussitôt qu’elle eut rendu l’esprit, je connus
» qu’elle avait besoin de moi et que j’étais obligé de
» demeurer auprès de son corps à prier pour elle, et j’y
» demeurai tant, que je sentis qu’elle n’en avait plus af-
» faire, ce qui fut à quatre heures du matin.» A la même heure, un Père Jésuite de grande vertu, qui avait connu madame de Gourgues à Bordeaux, crut la voir monter au ciel au milieu d’une troupe de Carmélites. C’était le 28 mai 1613.
M. de Bérulle pouvait affronter les combats de la terre. De nouveau, il venait d’éprouver que Dieu était avec lui.