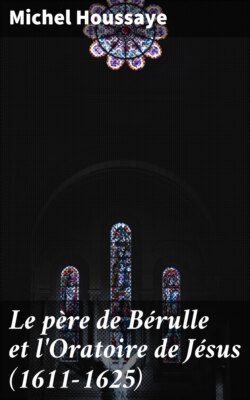Читать книгу Le père de Bérulle et l'Oratoire de Jésus (1611-1625) - Michel Houssaye - Страница 8
L’ORATOIRE ET L’UNIVERSITÉ.
Оглавление1613-1614.
Entrée à l’Oratoire de M. Bertin. — Son portrait. — Caractère de Richer. Il déclare la guerre à l’Oratoire. — Démarches tentées auprès de lui par M. Bishop, par M. Bertin. — Proposition de Richer dans l’assemblée du prima mensis (mai). — Lettre de M. de Gondi. — Interrogatoire des Pères Bence et Bertin, 17 mai. — Richer se rend à la Faculté des arts. — Discours qu’il y fait contre l’Oratoire. — Le recteur Saulmont. — Intervention du Parlement. — M. de l’Aubespine en Sorbonne. — Protestation de Richer. — Arrêt du Parlement. — Les Pères de l’Oratoire renoncent à se pourvoir contre l’arrêt. — Triomphe de Richer. — Factum contre l’Oratoire. — Calomnies du P. Deschamps. — M. Odet de Saint-Gilles, ses vertus et sa mort. — Établissement de l’Oratoire à Dieppe. — Fondation de la Rochelle.
M. de Bérulle avait lieu de bénir le ciel. Il voyait l’existence de la Congrégation désormais assurée. La Reine mère s’en était déclarée la fondatrice; le Parlement avait enregistré sans difficultés ses lettres patentes et celles du Roi; l’évêque de Paris ne cherchait pas à cacher ses sympathies pour une œuvre qui honorait son épiscopat ; le Saint-Père, enfin, par la bulle Sacrosanctæ, venait de conférer à la nouvelle communauté un titre, une existence et des droits. A Paris, depuis le 15 août 1613, jour où l’on y avait commencé les offices publics, la chapelle du Petit-Bourbon était trop étroite pour la foule qui s’y pressait. Chaque dimanche, alors même que ni le Roi ni la Reine ne venaient par leur présence exciter la curiosité, plus de trente carrosses stationnaient à la porte de la maison de l’Oratoire . Tant ces pieux ecclésiastiques, par le sérieux de leurs prédications, la gravité de leur maintien, une dignité et une ferveur trop rares dans les saintes cérémonies de l’Église, avaient promptement conquis l’estime et la confiance des gens de bien!
Déjà, cependant, la calomnie s’attaquait au maître et à ses disciples, et une guerre ouverte leur était déclarée par l’Université. L’entrée à l’Oratoire d’un des membres de la Faculté de théologie, M. Bertin, en avait été l’occasion.
M. Claude Bertin, fort jeune encore et docteur depuis 1609 seulement, s’était déjà acquis une grande notoriété en Sorbonne par de brillantes études, l’amitié du syndic Richer, son attitude enfin lors de la discussion fameuse dont le couvent des Jacobins avait été le théâtre. Dans la chaleur de la dispute, il s’était laissé entraîner jusqu’à taxer d’hérétique l’opinion de ceux qui soutiennent la supériorité du Pape sur le Concile, comme contraire, affirmait-il, aux décrets des Pères de Constance . Mgr Ubaldini, nonce du Pape, et le cardinal du Perron, présents à cette discussion, avaient été choqués et à bon droit des qualifications dont usait le jeune docteur, qui avait même dû les adoucir sur-le-champ. M. Bertin ne tarda pas à revenir sur des affirmations si absolues. Plein de foi, profondément pieux, il ne lui coûtait pas d’avouer qu’il s’était trompé. Modéré par principes et par tempérament, il avait été entraîné à son insu, ainsi qu’il arrive parfois aux esprits les plus éloignés des extrêmes, quand les doctrines et les hommes ne leur sont pas assez connus. Il n’avait vu que les excès d’un parti, et pour les combattre il s’était laissé entraîner par les passions d’un autre. Mais lorsque Richer eut publié son opuscule De ecclesiastica et politica potestate, la lecture de ce factum, des réponses qui y furent faites, commença à ouvrir les yeux à M. Bertin. Les protestations motivées des plus excellents professeurs, de M. Filesac, de M. de Gamaches, de M. Isambert, de M. Duval; la condamnation solennelle de cet ouvrage par M. du Perron, archevêque de Sens, et les huit évêques de sa province (3 mai 1612), achevèrent de détacher du parti de Richer le jeune docteur. Les manières hautaines, l’humeur batailleuse, l’insupportable roideur du syndic, ne pouvaient manquer d’ailleurs de le rebuter. A la fois bienveillant et fin, M. Bertin ne désirait employer sa rare sagacité qu’au service de la vérité et pour le bien de la paix. Sa politique était toute tempérée de charité, et la conquête des âmes le grand mobile et l’unique objet de son ambition. Il rompit avec son ancien maître et vint se présenter à l’Oratoire, où M. de Bérulle le reçut avec joie.
A cette nouvelle, Richer ne se contint plus, et sa violence, qui était extrême, ne lui permit pas de juger sainement les choses. D’une grande austérité de mœurs, d’un réel savoir, travailleur infatigable, le syndic de la Faculté de théologie mettait au service d’idées fausses, de doctrines erronées et dangereuses, une volonté de fer et une indomptable persévérance. Il n’atteignait jamais un but, il le dépassait toujours. Ligueur dans sa jeunesse, il était devenu bientôt royaliste, et la passion qui l’avait poussé autrefois à glorifier l’assassin de Henri III, lui faisait poursuivre maintenant, avec un égal acharnement, ceux qui, en d’autres temps, auraient paru modérés auprès de lui. Les religieux des différents Ordres, les Pères Jésuites surtout, avaient trouvé en Richer un adversaire redoutable, non-seulement par l’audace de ses affirmations, l’habileté de ses manœuvres, mais encore par la faveur dont il jouissait au Parlement. Tel était l’homme que l’entrée de M. Bertin à l’Oratoire rendit l’ennemi déclaré de M. de Bérulle et de sa congrégation.
L’Oratoire était une communauté ; son fondateur passait pour l’ami des Pères Jésuites, de M. du Val, de M. du Perron; les doctrines qu’on y professait étaient opposées à celles que l’ancien syndic s’efforçait de faire prévaloir, trois motifs bien suffisants pour exciter sa colère contre le nouvel institut, alors même qu’un de ses plus chers disciples ne l’eût pas quitté afin d’entrer à l’Oratoire. Cet abandon de M. Bertin coïncidait en outre avec la déposition de Richer, qui, sur les ordres de la cour, fut remplacé dans le syndicat par M. Filesac (25 août) . M. de Harlay de Chanvallon, abbé de Saint-Victor, qui obtint cet ordre, était lié avec M. de Bérulle. Dès lors, se laissant aller à toute la violence de son imagination, Richer se représenta la maison de Sorbonne comme déjà ruinée par l’Oratoire, où soixante docteurs, disait-il, allaient bientôt s’enfermer, et il ne négligea rien pour grouper autour de lui les gens décidés à la lutte. Néanmoins, sa première prise d’armes ne fut pas heureuse. Le nouveau syndic, M. Filesac, M., du Val et quelques-uns des docteurs les plus zélés, ayant proposé aux membres de la Sorbonne de vivre désormais en commun, à l’imitation des ecclésiastiques réunis à l’hôtel du Petit-Bourbon, leur projet fut adopté ; en sorte que Richer eut la douleur de voir offrir pour modèles à la Sorbonne ceux qu’il travaillait avec tant d’ardeur à bannir outrageusement de son sein.
Informé des dispositions de Richer, M. de Bérulle fit tout ce qu’il put pour l’éclairer et l’adoucir. Parmi les docteurs les plus recommandables, se trouvait un Anglais nommé Guillaume Bishop, qui avait M. de Bérulle en grande vénération. Il se rendit chez l’ancien syndic, et s’efforça de lui persuader qu’il se méprenait complétement sur l’esprit du nouvel institut: que si le fondateur de l’Oratoire était l’ami et l’élève des Pères Jésuites, sa congrégation n’en demeurait pas moins complétement différente par son objet et sa constitution de la Compagnie de Jésus: qu’on ne voyait pas dès lors de quel intérêt pouvaient être pour l’Université, la poursuite, l’expulsion d’une société de prêtres séculiers réunis dans le seul but de se rendre plus dignes par leur vie du sacerdoce dont ils étaient revêtus. M. Bishop échoua dans sa mission conciliatrice. Quelques jours après, M. Bertin tenta de son côté une démarche. Elle ne pouvait être bien accueillie. Non-seulement M. Bertin avait cessé de fréquenter son ancien maître, mais il avait complétement abandonné les opinions de Richer. Il venait même de signer avec M. du Val, le 8 janvier 1613, l’approbation de l’Epitome des Annales de Baronius par M. de Sponde, ouvrage où les disciples de Richer trouvaient des propositions qu’ils dénonçaient au public, et contre lesquelles ils essayaient d’animer encore le Parlement. A ce crime, M. Bertin en joignit un autre. Il crut devoir, dans son entretien, faire allusion au crédit dont jouissait M. de Bérulle auprès de la Reine mère et des plus intègres magistrats. Déjà profondément irrité par la vue d’un disciple infidèle, Richer éclata à ces mots en violentes récriminations contre M. Bertin, en grossières injures contre le supérieur et tous les membres de l’Oratoire. Il comprenait parfaitement quelle lutte allait engager contre son système subversif de la hiérarchie catholique, une société appuyée sur le Saint-Siège, favorisée par l’épiscopat, hautement protégée par la cour, faisant profession de se tenir dans ce milieu exact et difficile à garder, qui satisfaisait à la fois Rome par la pureté des doctrines et la simplicité de l’obéissance, et le gouvernement par un éloignement constant pour des opinions dont la discussion ne sert presque jamais qu’à soulever de stériles et redoutables orages. Mais rien n’est plus propre que la modération à irriter certains esprits. Richer voulait la guerre, et il avait résolu de la pousser à outrance.
Il le prouva bientôt. Les Pères de l’Oratoire, qui avaient pris leurs degrés en Sorbonne, s’étant rendus à l’assemblée du 1er avril, Richer ne les eut pas plus tôt aperçus qu’il demanda qu’on les déclarât déchus de leurs droits et priviléges de docteurs ou bacheliers en théologie, à partir du jour de leur entrée à l’Oratoire, proposition qu’il réitéra dans l’assemblée du prima mensis de mai. Vainement on lui représenta que ceux qu’il dénonçait n’étaient que de simples prêtres, que leur nouvelle dénomination ne changeait rien à leur état, et qu’ils ne cessaient pas d’être toujours membres du clergé séculier; Richer persista dans sa demande, et avec tant de vigueur, que la Faculté céda en partie à ses instances. Dans l’assemblée du 2 mai 1613, elle consentit à nommer des commissaires devant lesquels les dénoncés se présenteraient par députés, pour être interrogés sur leur nouvel état.
M. de Bérulle et M. de Gondi, Richer le savait sans doute, étaient alors absents de Paris. Mais comme l’évêque se trouvait aux environs, dans une terre de sa famille, à Villepreux, les Pères l’avertirent de ce qui se tramait contre eux, et lui demandèrent conseil. Le prélat leur répondit aussitôt: «Je suis d’avis, si Messieurs de la
» Faculté vous appellent, qu’un couple de docteurs d’i-
» celle, qui sont parmi vous, y comparoissent, et sur ce
» qui sera proposé, vous les assuriez que vous n’avez nulle
» constitution qui vous sépare ou vous interdise les
» fonctions de quelque corps ecclésiastique que ce puisse
» être; qu’en votre qualité (nouvelle) vous vous sentirez
» heureux de rendre à la Faculté le service que vous luy
» avez voué, tant qu’elle l’aura pour agréable; que votre
» retraite n’est que pour vous y rendre plus utiles, ainsy
» qu’à la gloire et au service de Dieu; et si on vous re-
» quiert plus particulièrement comme on m’écrit que vous
» le serez, si vous êtes séculiers ou réguliers, quelles sont
» vos règles et constitutions, si vous êtes approuvés du
» Pape ou de l’évêque, je crois que vous devez répondre,
» que cela n’est point du fait de la Faculté, et n’importe
» qu’à moy, qui dois répondre des assemblées ecclésias-
» tiques qui se font dans mon diocèse. Ce sont les propo-
» sitions que l’on me mande qui doivent vous être faites,
» sur lesquelles ayant appris que vous désiriez mon avis,
» j’ai cru devoir vous donner celuy-cy .»
C’est le 16 mai que M. de Gondi écrivait cette lettre à «Messieurs de la Congrégation». La lettre leur fut-elle remise trop tard, ou ne se crurent-ils pas en droit de protester contre la sommation qu’ils avaient reçue? Toujours est-il que le lendemain 17, les Pères Jean Bence et Claude Bertin comparurent devant la Faculté. Le doyen, M. Roguenaut, leur adressa en latin les questions suivantes:
«Messieurs, êtes-vous venus ici avec la permission de votre supérieur? — Notre supérieur n’est pas en ce moment à Paris; mais il agréera et approuvera notre démarche et nos réponses. — La Faculté désire savoir si vous faites partie de cette nouvelle société que l’on appelle, dans le public, la Congrégation de l’Oratoire? — Par la grâce de Dieu, nous y avons été appelés et nous en faisons partie. — Cette Congrégation est-elle approuvée par le Saint-Siège? — Nous n’avons pas encore reçu son approbation et nous l’aurons bientôt. Mais nous avons déjà celle de notre révérend seigneur l’évêque de Paris. — Votre Congrégation est-elle reçue en France par l’autorité royale? — Oui. — Avez-vous, sur ce sujet, des lettres du Roi? — Nous en avons. — Ont-elles été enregistrées au Parlement? — Oui. — Montrez-nous les lettres du Roi et l’enregistrement au Parlement. — Nous ne les avons pas apportés. — Est-ce une congrégation de réguliers ou de séculiers? — De séculiers. — Avez-vous une règle ou quelques statuts à l’aide desquels vous puissiez prouver que vous êtes des séculiers et non pas des réguliers? — Tout notre institut le prouve; nous n’avons aucune règle ou statuts écrits, mais seulement des usages et des coutumes, et nous vivons sous l’obéissance d’un supérieur. — Lui êtes-vous lié par un vœu d’obéissance? — Nullement. — Vous voulez jouir des droits et priviléges attachés au doctorat et au titre de membres de l’Université de Paris? — Nous voulons et désirons ardemment rendre nos services à la Faculté, jouir de nos droits de docteurs dans l’Université de Paris, et remplir tous les devoirs imposés par cette Faculté. Nous affirmons hautement que rien dans notre congrégation ne s’oppose à l’accomplissement des devoirs de la Facuité.»
M. Bence et M. Bertin signèrent leur déclaration, ainsi que le doyen Roguenaut; puis on alla aux voix. Le parti de Richer était peu nombreux. Toute la maison de Navarre opina en faveur des Pères de l’Oratoire, ainsi que la plupart des membres de la Sorbonne. Il fut donc décidé à une grande majorité que les Pères Bence et Bertin, et autres de la même congrégation, continueraient à être «ré-
» putés vrais docteurs, capables des prérogatives attachées
» à leurs grades et à leur titre, et que la Faculté les recon-
» naissait pour ses membres.» On leur donna acte de cette conclusion le même jour, 17 mai 1613. Richer avait proposé qu’avant de conclure on exigeât du P. de Bérulle une déclaration formelle que rien dans son institut n’était un obstacle à la profession de docteur. Son but était si évidemment de gagner du temps, afin d’en profiter pour augmenter, à l’aide d’intrigues, le nombre de ses partisans, que la Faculté rejeta sa proposition, taxée même par certains de grave inconvenance. Néanmoins, M. de Bérulle, qui ne désirait que la paix, informé, dès son retour à Paris, de la nouvelle exigence de Richer, donna la déclaration qu’il demandait, et dans les termes les plus clairs et les plus précis. Il l’envoya le jour même en Sorbonne, où elle fut reçue avec un universel applaudissement, le 31 mai.
Richer, qui ne s’attendait point sans doute à cette concession, jugea bien que la conclusion du 17 mai serait infailliblement confirmée dans l’assemblée du 1er juin. Abandonné par la Faculté de théologie, il chercha dans la Faculté des arts des partisans plus zélés ou plus complaisants. Le recteur de l’Université était alors Jean Saulmont, homme faible, et dont la déférence pour Richer dégénérait en servilité. Celui-ci n’eut pas de peine à lui persuader qu’il devait convoquer les trois autres Facultés, celles des arts, de médecine et de droit, et les mettre en état de former une opposition à la conclusion de la Faculté de théologie. Saulmont se rendit. L’assemblée fut convoquée. Richer, dans un discours long et véhément, s’efforça de faire partager à ses auditeurs la violence et l’amertume de ses préjugés. Jamais, à l’en croire, il ne s’était présenté de congrégation que l’Université dût craindre autant que l’Oratoire. Les autres Ordres, disait-il, sont composés de Religieux, lesquels étant liés par des vœux, ne peuvent enlever aux suppôts de l’Université ni les prérogatives qu’ils possèdent ni les bénéfices qu’ils espèrent. Il n’en est pas de même des compagnons du P. de Bérulle, capables, en leur qualité de prêtres séculiers, de posséder toutes sortes de bénéfices, et les charges des colléges et de l’Université. L’évêque de Paris, qui s’est déclaré leur protecteur, les autres prélats du royaume sous l’obéissance desquels ils font profession de vivre, pour capter leur faveur, les préféreront à tous les autres. Pénitenciers, théologiens, curés, grands maîtres, proviseurs, principaux de collége, régents, administrateurs d’hôpitaux, directeurs de communautés, ils seront bientôt partout. L’Oratoire ne semble institué que pour ravir aux pauvres qui travaillent dans l’Université, ce que l’avidité des Jésuites leur laissait encore à glaner; et il sera facile à M. de Bérulle de s’emparer de toute la maison de Sorbonne et de toute l’Université, ce qui n’a pas été possible aux Jésuites. Richer ajouta que si les Pères de l’Oratoire demeuraient tranquilles possesseurs du doctorat, ils ne manqueraient pas de répandre dans la Faculté les doctrines enseignées par la bulle In cœna Domini, attentat grave à l’autorité du Roi, car cette bulle soustrait les ecclésiastiques à la juridiction des magistrats. Puis il conclut et fit conclure au recteur et à tous ses suppôts assemblés qu’on formerait opposition, au nom de l’Université, à la dernière délibération de la Faculté de théologie; que celle-ci ne pourrait plus délibérer séparément sur cette affaire, et qu’elle serait sommée de répondre aux trois autres Facultés pour agir avec elles de concert.
La conclusion fut adoptée, et Saulmont la fit signifier le lendemain, 1er juin, au syndic de Sorbonne; celui-ci n’en ayant tenu compte, M. Saulmont, sans avoir prévenu, vint en Sorbonne pour y donner lecture de la conclusion. Mais comme il s’élançait à la place du doyen, et voulait présider, il fut accueilli par des sifflets et des huées, et obligé de fuir honteusement. On ne voulut pas même mentionner sur les registres son arrivée, ni l’objet de sa démarche . Cette scène produisit cependant un résultat favorable aux entreprises de Richer. Marie de Médicis avait fait dire à la Faculté par son confesseur, le P. Roger, grand vicaire général des Augustins, qu’elle souhaitait que ce même jour la conclusion du 17 mai fût confirmée en Sorbonne. L’apparition subite du recteur causa un tel trouble, que la délibération fut renvoyée au prima mensis de juillet.
Le recteur profita de cet intervalle pour porter ses plaintes au Parlement. Il réclamait d’abord une réparation égale à l’injure qu’il avait reçue; il demandait ensuite que deux conseillers se transportassent avec lui à l’assemblée du prima mensis suivant, pour lui obtenir audience sur la proposition qui avait été le motif de sa démarche. Le Parlement n’eut égard qu’à sa première requête. Il décida sur la seconde: «Que le sieur Saulmont ne pourroit proposer
». de vive voix chose aucune touchant les prêtres de l’Ora-
» toire, dans l’assemblée prochaine; ains que s’il préten-
» doit et désiroit quelque chose à cet égard, il seroit tenu
» de le bailler par écrit, pour être communiqué à la Faculté,
» laquelle, après en avoir délibéré, bailleroit pareillement
» ses réponses par écrit, pour, le tout communiqué au pro-
» cureur général et vu par la cour, y être pourvu ainsi
» qu’il appartiendroit.» (26 juin 1613.)
Le 1er juillet suivant, le recteur s’étant présenté, Jean Filesac, alors syndic, suivi des anciens de la Faculté, alla au-devant de lui, le pria d’oublier ce qui s’était dit et fait le 1er juin, et exhorta les assistants à manifester en toutes choses leur respect pour la dignité du recteur. Saulmont se déclara satisfait, et demanda acte de cette réparation. Après quoi Filesac se démit du syndicat et se retira de l’assemblée, suivi de beaucoup de docteurs.
A peine était-il sorti qu’on introduisit M. de l’Aubespine, évêque d’Orléans . Muni des ordres du Roi, il fit observer en peu de mots et avec une grande politesse à l’assemblée, qu’elle avait à délibérer sur cette simple question: «Le nom seul de prêtre de l’Oratoire est-il un motif pour dépouiller du titre et des droits de docteur des hommes à qui on les avait accordés auparavant?» — «Je
» n’en dirai pas davantage sur ce sujet», ajouta-t-il, «je ne
» vous représenterai pas même que ceux dont il s’agit sont
» très-chers au Roi et à la Reine, de peur de donner quelque
» entrée à l’envie et de rendre odieux des ecclésiastiques
» qui ne veulent que la justice .» Il est vrai que les ordres du Roi dont il donna aussitôt communication n’avaient nul besoin de commentaire. Le Roi y disait que la Congrégation de l’Oratoire était sous sa protection spéciale; qu’il l’avait en affection singulière, et cela pour plusieurs considérations importantes au bien de l’Église et de l’État: qu’il entendait donc que les docteurs de la Faculté conservassent, en y entrant, tous les droits attachés à leurs degrés: c’était d’ailleurs l’intérêt de la Faculté elle-même, qui s’assurait, par cet acte de justice, le concours d’ecclésiastiques de mérite et l’accroissement de la bienveillance royale . Lecture faite de ces ordres, M. de l’Aubespine se retira dans une salle voisine, pour ne point gêner par sa présence la liberté des suffrages.
Aussitôt Richer prit fa parole, et soutint hautement que la Faculté ne pouvait délibérer, attendu qu’elle était sans syndic, M. Filesac ayant abdiqué, et sans doyen, M. Roguenaut étant absent. On répondit que celui-ci était suffisamment remplacé par Hugues Burlat, président d’office, doyen de droit, et pouvant en exercer les fonctions par privilége d’ancienneté, même en présence du sieur Roguenaut; ce que d’ailleurs il avait déjà fait, sans aucune opposition de la Faculté, en deux circonstances semblables. Mais Richer et ses adhérents étaient décidés à ne rien entendre. L’assemblée dégénérait en tumulte. Cela durait depuis une heure et demie; on fit prier M. de l’Aubespine de rentrer. Le calme se rétablit peu à peu. Quand il fut complet, le prélat, qui était accompagné de deux notaires royaux chargés de rédiger la délibération, ordonna à M. Burlat de faire délibérer et de recueillir les voix. M. Burlat obéit, et somma «les sages maîtres, de dire leur avis.
Sur soixante-deux opinants, les prêtres de l’Oratoire eurent quarante-huit suffrages. Quatorze docteurs seulement s’étaient prononcés contre eux. Mais ceux-ci ne se regardèrent pas comme battus, et, stimulés par Richer, ils formèrent contre la conclusion que l’on venait de voter une nouvelle opposition. Ils y répétaient qu’on n’aurait pas du délibérer en l’absence du syndic et du doyen ordinaire, qu’à l’assemblée avaient manqué nombre de docteurs qui n’eussent pas été de l’avis des quarante-huit; que les ordres du Roi et la présence du prélat commissaire avaient diminué la liberté des suffrages; qu’il s’était trouvé à l’assemblée plus de Religieux qu’on n’avait coutume d’en voir, et qu’on les avait mandés exprès pour se procurer un plus grand nombre de voix favorables. Comme plusieurs de ces raisons étaient dénuées de preuves, et les autres de nulle valeur, on n’y eut aucun égard, et l’opposition fut regardée comme non avenue. Quelques jours après, le 11 du même mois de juillet, la Faculté de droit revenant à des sentiments plus équitables, déclara qu’elle se conformait à la décision de la Faculté de théologie, et reconnut qu’on ne pouvait pas frustrer un docteur des droits attachés à sa qualité pour le seul fait d’être entré à l’Oratoire.
Tout ce qu’il y avait de sensé et de judicieux dans Paris pensait de même. Mais Richer, une fois engagé dans une affaire, n’était pas homme à reculer. Vaincu en Sorbonne, il espéra triompher au Parlement. Par ses conseils, le recteur présenta une nouvelle requête à l’effet d’obtenir que Burlat et ses adhérents fussent-tenus de comparaître à la grand’chambre pour y rendre compte de leurs procédés et y voir annuler leur décision. La Faculté répondit par un mémoire propre à dissiper tous les griefs, tant il exposait avec simplicité et clarté les faits incriminés. Aussi était-on en droit d’attendre du Parlement un jugement définitif et favorable. Il ne fut précisément ni l’un ni l’autre. La cour «appointa» l’affaire, et elle prononça, le 15 juillet, que quant au principal différend concernant les prêtres de l’Oratoire, elle verrait le procès-verbal (de l’assemblée du 1er juillet), «et ce que les parties voudroient » mettre par devers elle, pour ce fait et communiqué au » procureur général du Roy, ordonner ce qu’il appartien- » droit, faisant cependant deffences, jusqu’à ce qu’autre- » ment fût ordonné, tant au recteur qu’au collége de » Sorbonne, de faire sur ce aucune délibération .
Par cet arrêt, le Parlement, il était facile de le voir, avait voulu prendre un moyen terme. Il lui répugnait de condamner Richer, dont les doctrines, si favorables aux envahissements de la jurisprudence séculière, étaient en grand honneur chez beaucoup de magistrats. Il ne désirait nullement désobliger une congrégation naissante, dont le fondateur avait pour oncle un de ses présidents, M. Séguier, et qui était trop ostensiblement protégée par le Roi et la Reine mère pour que l’intérêt, chez quelques-uns, ne servît pas la même cause que la justice. Néanmoins, cet arrêt portait un réel préjudice aux Pères de l’Oratoire. Ils auraient pu se pourvoir contre un pareil jugement: ils préférèrent s’y soumettre. L’unique démarche qu’ils se permirent fut de se présenter avec deux notaires à l’assemblée de la Faculté du 1er août suivant, et d’y protester que, s’ils discontinuaient à l’avenir de paraître en Faculté, c’était par le seul amour de la paix et pour ne point donner lieu à de continuelles divisions, mais sans que leur retraite pût préjudicier à leurs droits. M. de Bérulle s’était donné beaucoup de peine afin de sauvegarder les intérêts des siens. A partir de ce moment, d’accord avec ses disciples, il résolut de ne plus s’occuper de cette affaire, qui de sa part n’eut point d’autre suite.
Un succès incomplet ne fit au contraire qu’exciter l’ardeur de Richer; il voulut enlever à ses adversaires jusqu’à l’espoir de se voir rendre un jour la justice qui leur était pour le moment déniée, et malgré l’arrêt qui venait d’être rendu, malgré la défense qui y était portée de délibérer sur cette affaire, il dressa, dès le 14 du mois, un nouveau statut, qu’il engagea Gabriel Saulieu, prieur de Sorbonne, à faire adopter dans sa maison. On y déclarait: 1° que ceux qui ont quitté la maison et société de Sorbonne pour passer dans la Congrégation de l’Oratoire, sont ipso facto déchus de tous les droits et priviléges de la société et privés de voix active ou passive, sans espérance d’être rétablis; 2° que la même peine sera décernée contre ceux de ladite maison et société que l’on nomme en Sorbonne socii ou hospites, qui entreront soit dans la même Congrégation, soit dans toute autre où l’on vit sous un chef commun, si, après trois mois de séjour, sommés d’en sortir, ils ne se retirent point; 3° enfin, que tous ceux qui postulent pour être admis dans la maison et société de Sorbonne prêteront serment qu’ils n’ont point dessein de passer ensuite dans ces nouveaux Ordres. Ce statut, injuste en lui-même, contraire à l’arrêt du Parlement, fut reçu cependant par la Sorbonne. Le Parlement n’y mit aucun obstacle: le triomphe de Richer ne lui déplaisait pas.
La passion, une fois lancée, ne s’arrête plus. Il ne suffisait pas d’avoir exclu de la Sorbonne les Pères de l’Oratoire, il fallait les perdre complétement dans l’opinion. Pour atteindre ce but, les partisans de Richer n’eurent pas honte de recourir aux libelles les plus calomnieux. Un certain Pierre Cosmier, du diocèse d’Angers, écrivain d’ailleurs fort méprisable, fit imprimer à Caen, en 1614 , un factum dont le titre seul est une injure: «Avertissement aux perturbateurs de l’Université de Paris.» C’est, bien entendu, sur les Pères de l’Oratoire que retombe la responsabilité des troubles arrivés à leur occasion. Que sont-ils du reste? Des gens qui n’ont cherché, en se retirant de la Sorbonne, qu’à la faire passer pour une maison mal réglée, qui espèrent en imposer à la foule par une modestie affectée, une manière inusitée de se vêtir, la nouveauté de leurs offices et de leur chant; qui, avec de belles paroles de paix, sont en vérité semblables à ces essaims d’abeilles qui, sorties récemment de leurs ruches, remplissent l’air de leurs bourdonnements. Le pamphlétaire termine en les exhortant, puisqu’ils ne peuvent demeurer tranquilles, à aller rejoindre les Pères Jésuites et prêcher la foi avec eux chez les Topinambous. Pierre Cosmier eut des imitateurs. Pendant quelques mois, les pamphlets en vers et en prose firent fureur; mais à en croire un contemporain, «ce furent
» flots de calomnie qui, après tous leurs efforts, se rendirent
» en écume.» M. de Bérulle n’eut pas à se repentir de les
avoir méprisés.
Il fut plus sensible à une attaque qu’il ne pouvait prévoir et qu’il ne méritait pas davantage. Un prêtre de la Doctrine chrétienne, le P. Deschamps, était venu à Paris, dans l’espoir d’y établir sa congrégation. Comme le nonce du Pape et M. de Gondi se montraient fort peu favorables à son projet, il s’imagina que M. de Bérulle fomentait sous main leur opposition. Sans chercher à s’en éclaircir davantage, il décria partout le supérieur de l’Oratoire, écrivant jusqu’à Rome que c’était un ambitieux et un intrigant, ennemi de toute œuvre dont il n’était pas l’instigateur. L’accusation du P. Deschamps était si peu fondée que, au moment même où il s’exprimait avec tant d’amertume sur le compte de M. de Bérulle, celui-ci songeait à un plan de réunion de la société de la Doctrine chrétienne avec l’Oratoire: projet que n’encouragea pas du reste Dom Sans de Sainte-Catherine, et qui ne put aboutir .
M. de Bérulle connaissait le prix des souffrances; il savait que toutes les œuvres de Dieu naissent et se développent à l’ombre de la croix: il laissa dire. Si, d’ailleurs, les hommes calomniaient ses intentions et insultaient à son ouvrage, Dieu le protégeait manifestement et choisissait cette heure même pour lui amener, des bancs de l’Université, un jeune étudiant destiné à être la plus douce gloire de l’Oratoire naissant.
Il se nommait Odet de Saint-Gilles. D’une bonne noblesse de province, neveu de l’évêque d’Avranches, M. Péricard, qui le destinait à l’Église, il était venu étudier à Paris, et n’avait pas tardé à imiter les tristes exemples que lui donnaient beaucoup de ses condisciples. Comme il entendait souvent parler de l’Oratoire, la curiosité le prit de constater par lui-même la vérité des éloges qu’on lui en faisait. La chose était facile, un de ses cousins venait d’entrer dans la Congrégation; il n’avait qu’à l’aller trouver. M. de Saint-Gilles se rendit en effet à l’hôtel du Petit-Bourbon. C’est là que le ciel l’attendait. Il fut si touché des discours de son parent, qu’il résolut de faire une retraite sous la direction de M. de Bérulle. Elle dura quinze jours, et il en sortit tout à Dieu. L’obligation d’acquitter ses dettes put seule le décider à retourner dans le monde pour quelque temps encore. Mais il commença dès lors à y mener la vie la plus solitaire et la plus pénitente, occupant dans la maison de Sorbonne une modeste chambre que lui prêtait un pieux bachelier, nommé M. de Condren. M. de Bérulle, témoin de sa fidélité, abrégea le temps de son épreuve, il acquitta le reste de ce qui était dû par Odet de Saint-Gilles, et celui-ci entra à l’Oratoire le mercredi des cendres 1613.
M. de Saint-Gilles ne fut pas plus tôt revêtu de l’habit de la cléricature qu’il sembla changé en un homme nouveau. Il ne vivait plus que pour Jésus-Christ, dont il ne pouvait, ni le jour, ni la nuit, quitter l’autel; et en même temps qu’il réduisait son corps en servitude par une guerre implacable, son âme, dont rien ne retardait l’essor, jouissait d’une paix que la terre ne donne pas. M. de Bérulle était ràvi de tant de grâces et d’une si belle fidélité : «Les » voyes les plus saintes et les plus esleuées», disait-il à ses confrères, «dont je me sens obligé, selon Dieu, de faire
» ouverture à notre confrère de Saint-Gilles, lui sont si
» faciles et si aplanies, qu’il semble qu’elles soient pour luy
» un chemin tout frayé et tout battu..... Ce bon confrère
» est un géant, et nous ne sommes que des nains auprès
» de lui.» Et se ressouvenant de ce qui se passait à la Cour:
» Dieu le traite,» ajoutait-il, «ainsi que les princes font
» leurs favoris, qu’ils élèvent tout d’un coup sans les faire
» passer par les degrés ordinaires de la fortune.»
Au couvent de l’Incarnation vivait alors, on se le rappelle, une admirable Religieuse, Sœur Catherine de Jésus. Presque du même âge que M. de Saint-Gilles, objet, comme lui, des prévenances les plus miséricordieuses et les plus tendres de Jésus-Christ, la terre était pour elle un exil, que la joie d’y souffrir pour son Époux lui rendait seule supportable. La jeune Carmélite et le jeune sous-diacre ne s’étaient jamais vus; mais leurs âmes se connurent, et M. de Bérulle, qui n’ignorait pas quelle force puisent dans leur union deux cœurs dont le Fils de Dieu est l’unique amour, bénit des liens formés par Jésus-Christ même. Il voyait avec bonheur ces enfants de son âme s’aider par de continuelles prières, se soutenir par de mutuels sacrifices, s’animer dans leur vol vers le ciel. Le ciel en effet allait bientôt s’ouvrir.
M. de Saint-Gilles tomba malade. A cette nouvelle, Sœur Catherine de Jésus redoubla de pénitences, de prières, de supplications. Le mal empirait toujours, et elle ne tarda pas à apprendre qu’il fallait renoncer à l’espoir de conserver celui dont elle se sentait si véritablement la sœur en Jésus-Christ. Quelle que fût sa soumission à la volonté de Dieu, elle ne put dominer à ce moment une vive douleur. Interrompu trop tôt dans sa course, M. de Saint-Gilles pourrait-il atteindre à la perfection, dont un plus long séjour sur la terre lui aurait permis de gravir les sommets? Pleine de confiance en son Sauveur, Sœur Catherine se tourna vers lui. Elle savait quelles semences admirables de grâce il avait jetées dans l’âme de M. de Saint-Gilles. Elle le conjura, puisqu’il le rappelait avant l’heure, de lui donner avant le temps aussi une pleine maturité. M. de Bérulle faisait les mêmes prières, et toute sa congrégation se joignait à lui: quant à la conservation d’une vie si précieuse, averti par une lumière prophétique, il avait refusé de la demander au ciel.
M. de Saint-Gilles mourut. C’était le 7 août 1614, à midi. Le même jour, Sœur Catherine de Jésus était en oraison, lorsque tout à coup elle le vit apparaître. Il la remercia de ses prières, lui annonça qu’elles étaient exaucées; qu’il entrait dans la gloire et en un lieu très-éminent: vision dont fut également favorisée la Mère Madeleine de Saint-Joseph, tandis qu’on offrait le saint Sacrifice pour le jeune Oratorien au couvent de l’Incarnation.
M. de Bérulle donna aussitôt avis de cette grande perte à ses confrères de Dieppe . «Dieu disposoit M. de Saint-
» Gilles à cette mort», dit-il, «par les faveurs qu’il lui a
» données depuis le premier jour de son entrée dans nostre
» Congrégation jusqu’au dernier. Si cet accident ne nous
» estoit adoucy par la puissance et suavité de la providence
» de Dieu, il nous causeroit beaucoup de regret pour la
» perte d’un si bon sujet et qui estoit de si grande espé-
» rance.» Ses espérances étaient réalisées. Rappelé à la première heure, le jeune ouvrier avait emporté une gerbe aussi pleine que s’il eût travaillé jusqu’au soir. M. de Bérulle donna à Sœur Catherine de Jésus le chapelet d’Odet de Saint-Gilles, il confia ses restes mortels aux Carmélites, qui l’ensevelirent dans leur chapelle de Saint-Denys, et la Congrégation oublia sa douleur pour se réjouir d’avoir envoyé au ciel, en sa personne, le précurseur, les prémices et l’ange tutélaire de tous ceux qui après lui auraient le bonheur de mourir au sein de l’Oratoire .
Tant de vertus n’étaient pas connues de Paris seulement: le bruit s’en répandait au loin et attirait à l’Oratoire des sympathies chaque jour croissantes. Le cardinal de Joyeuse, qui avait déjà confié à la Congrégation la direction d’un séminaire où il entretenait à Paris vingt-cinq ou trente clercs, remit le 14 septembre de cette année trente mille livres entre les mains de M. de Bérulle, à la charge d’envoyer à Dieppe huit personnes «tant ecclésiastiques que frères » servans». Les calvinistes, nombreux dans cette ville, y avaient un temple, un cimetière: ils étaient actifs et remuants. C’est pourquoi M. de Joyeuse voulait établir à Dieppe des prêtres capables de travailler à l’extirpation de l’hérésie et de soutenir les catholiques par l’instruction et par l’exemple . M. de Bérulle, sachant que les Pères Jésuites désiraient cet établissement, avait d’abord songé à décliner les offres du cardinal; mais, devant ses instances et celles du gouverneur de la ville, M. de Villers-Houdan, il dut céder.
Une fondation plus importante, et au foyer même du calvinisme, se préparait à la même époque, grâce à la générosité et à la foi de M. Gastaud, qui en entrant dans la Congrégation lui avait résigné ses bénéfices: ils étaient si considérables que l’Oratoire recevait ainsi la direction de tout le service religieux dans la Rochelle. Le Pape approuva la donation par une bulle du 5 octobre, et dix Oratoriens partirent pour cette maison, où Notre-Seigneur devait être si fidèlement servi .
En même temps, M. de Bérulle traitait d’une autre fondation, qui peut-être souriait davantage encore à sa piété. Un Oratorien de Notre-Dame de Grâce en Provence, le P. André Tod, originaire de Dieppe, se trouvait à Paris dans l’été de 1614. Frappé du spectacle qu’offrait l’hôtel du Petit-Bourbon, il écrivit à son supérieur, le P. Mouton, «qu’ayant souvent visité la Congrégation et compa-
» gnie de l’Oratoire, assisté à leurs offices, vu et reconnu
» la suave odeur de dévotion qu’ils répandent partout par
» leur conversation et vie exemplaire, il prioit ses con-
» frères d’examiner s’il ne seroit pas à propos pour eux de
» faire union avec elle.» La proposition plut au supérieur et à sa communauté. Ils en écrivirent au P. Tod, qui était en route et ne reçut pas la lettre. Mais de retour à Notre-Dame de Grâce, il rendit plus vifs encore leurs désirs, par tout ce qu’il leur rapporta de la ferveur des prêtres de Jésus-Christ. Chargé de pressentir M. de Bérulle, il en reçut, en date du 23 juin 1614, une réponse où le supérieur de l’Oratoire lui disait tenir à bénédiction que la première maison qui se liait avec la sienne fût spécialement dédiée au culte de Marie. Les confrères duP. Tod ayant adressé le 25 septembre à M. de Bérulle leur demande formelle d’union, celui-ci leur envoya, le 15 janvier suivant, ce petit écrit, où l’on sent déborder toute son âme, et qui révèle à chaque ligne le lieu qu’habitait sa pensée:
«Nous, Pierre de Bérulle...., en l’autorité qu’il a plu
» à Dieu nous confier sur cette Congrégation, et par le pou-
» voir qui nous a été donné de Sa Sainteté, en l’honneur
» de l’unité du Fils de Dieu avec le Père et le Saint-Esprit
» et en l’honneur de l’union de ce même Fils unique de
» Dieu avec la nature humaine, source de l’union de
» nature, de grâce et de gloire que Dieu veut avoir avec
» nous en la terre et au Ciel; et encore en l’honneur des
» liaisons ineffables de Jésus-Christ Notre-Seigneur avec
» sa très-sainte Mère; nous faisons union de laditte mai-
» son de Notre-Dame de Grâce à la Congrégation de l’Ora-
» toire de Notre-Seigneur Jésus-Christ, érigée en France,
» et à la maison de l’Oratoire de Jésus, érigée à Paris, et
» à toutes les autres qui s’érigeront cy-après, et voulons
» que laditte maison soit tenue et censée entre nous la
«seconde maison de cette Congrégation, c’est-à-dire la
» première après celle de Paris, et qu’en toutes les assem-
» blées générales ou particulières, où les rangs des maisons
» seront observés, le supérieur d’icelle tienne le second
» lieu après celle de la maison de Paris, avant tous les
» autres supérieurs des maisons particulières, suppliant
» Notre-Seigneur Jésus-Christ et sa très-sainte Mère qu’en
» l’honneur du lien ineffable de la Divinité avec l’huma-
» nité par le mystère de l’Incarnation et des liaisons inef-
» fables du Fils de Dieu avec sa très-sainte Mère, il leur
» plaise de bénir, accroître et confirmer saintement ce lien
» de paix et d’union que nous établissons entre nous par
» les présentes.»
Richer pouvait interdire l’entrée de la Sorbonne aux disciples de M. de Bérulle; mais il n’était pas de force à arrêter l’essor d’une société qui, à la suite de son fondateur, plaçait si haut le type de sa perfection et la règle de sa vie.