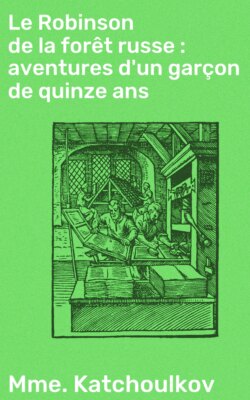Читать книгу Le Robinson de la forêt russe - Mme Katchoulkov - Страница 4
CHAPITRE PREMIER.
ОглавлениеMoi et mes souvenirs. — Mon caractère. — Un entraînement funeste. —Mon auxiliaire. — Une folie qui a eu une foule de conséquences inattendues.
Quand un homme se voit obligé de marcher longtemps par un chemin difficile vers un but lointain, qu’il sent la fatigue s’emparer de lui et l’énergie lui manquer, il regarde souvent en arrière et la vue du chemin parcouru, le souvenir des difficultés surmontées font renaître encore une fois dans son cœur la confiance en ses forces, l’espoir d’atteindre le but; et de nouveau, vaillamment, il se remet en route.
La vie d’un homme est pareillement un long chemin, semé de difficultés et d’obstacles. En jetant un regard sur l’espace déjà franchi, l’homme apprend aussi à connaître bien des choses; il acquiert plus de confiance en ses propres forces, mais il découvre aussi, bien souvent, de grandes erreurs là où, d’abord, il ne voyait qu’une chose raisonnable, bonne et agréable.
Dans ma vie, j’ai commis, certes, plus d’une erreur que je n’ai comprise que beaucoup plus tard; mais l’une eut surtout des conséquences tellement graves, une telle influence sur tout mon avenir, et la réparation de cette erreur m’a coûté tant de peines et d’efforts, que, maintenant que je suis déjà vieux et que j’ai des cheveux blancs, je ne puis m’empêcher de retracer les souvenirs qu’elle m’a laissés. Peut-être, dans le récit véridique de mes rêves et de mes fantaisies si douloureusement froissés par une réalité cruelle, quelque jeune rêveur trouvera-t-il un avertissement salutaire, et le travailleur découragé un exemple frappant de ce fait, qu’il n’y a pas de mauvaise situation dont on ne puisse sortir, grâce à une résolution ferme, à un labeur persévérant et infatigable.
Ne vous imaginez pas que j’aie à vous raconter l’histoire des malheurs et des fautes d’un enfant orphelin et abandonné. Au contraire, mon enfance a été des plus heureuses, entourée de tout ce qui peut contribuer au bonheur le plus absolu. Jugez-en, du reste, vous-même.
Notre famille était nombreuse. Nous résidions toujours dans notre grand domaine patrimonial. Notre père nous aimait tous beaucoup, mais il n’avait pas le temps de s’occuper longuement de nous. Quoique propriétaire foncier, et fixé à la campagne, il était fort supérieur à l’ancien type de ces pomiestchiks , qui mangeaient tranquillement et grassement le pain fabriqué selon des procédés primitifs par les paysans serfs. En son temps, il avait beaucoup lu, beaucoup étudié ; et ayant une fois conçu l’idée que la nature était la matière dont l’homme devait, par tous les moyens, tirer les conditions nécessaires à son bien-être et à son bonheur, il se mit avec fermeté et zèle à la réaliser. De la terre, de l’eau et du bois, — il en avait en quantité ; — et toute sa vie devint une suite ininterrompue de travaux énergiques et utiles. Il ensemençait des prairies, élevait du bétail, fondait une tannerie, une scierie. Avec une telle activité, on comprend qu’il fût souvent absent de la maison, et nous, qui entendions chacun parler de lui et faire son éloge, nous ressentions pour lui une sorte de vénération profonde et enthousiaste.
Ainsi, toute notre vie domestique était dirigée par notre mère. C’était, elle aussi, une femme très instruite, énergique, intelligente, et qui, en même temps, frappait tout le monde par sa tendresse extrême et sa bonté. On conçoit que c’était nous, ses enfants, qui étions l’objet principal de cette tendresse.
Aussi longtemps que sa santé le lui permit, elle ne laissa à personne le soin de s’occuper de notre éducation et de notre instruction. Mon frère aîné, Anatole, qui était déjà étudiant à l’époque où commence mon récit, ma sœur Sacha, qui alors suivait déjà les cours de l’Institut, moi-même et mes deux sœurs cadettes, tous, nous avons été ses élèves. C’est seulement pour nous accompagner dans nos promenades d’été et pour mettre de l’ordre dans nos chambres d’enfants, que demeurait chez nous une vieille bonne allemande, Augusta Ivanovna.
Je me rappelle maintenant avec honte et douleur mes façons d’agir avec ma mère, sa patience et mon invincible paresse, ma dissipation. J’appris de très bonne heure à lire, et la lecture me passionnait. Ce moyen facile d’errer de pays en pays, sans se remuer, de partager les fatigues du héros, ses exploits et ses triomphes, était on ne peut plus selon mon cœur; mais tout ce qui exigeait la moindre assiduité ou la fatigue la plus légère était tout à fait contraire à mon goût. Tout d’abord, mon père avait désiré de me faire préparer à la maison le programme de plusieurs années de l’école réale; mais les notes constamment défavorables de ma mère sur la marche et les progrès de mes études, lui firent changer d’idée. Dans ce temps-là, l’instruction militaire était fort inférieure à l’enseignement civil, et il fut décidé que j’entrerais à l’École militaire.
Cette résolution me causa quelque chagrin, je me sentis un peu humilié ; mais la perspective de consacrer encore plus de temps à la lecture de n’importe quoi m’eut bientôt définitivement consolé. Ma mère était bonne et intelligente, mais ce qui constituait la source première de tous mes défauts lui échappait, pour ainsi dire; et ces défauts grandissaient, s’accentuaient d’année en année. De ma nature, j’étais un grand rêveur, un garçon capable de céder au premier entraînement venu, sans vouloir même écouter les arguments de ma propre raison, laquelle n’était d’ailleurs pas très solide. Quand je lisais, je m’oubliais si bien, que je me considérais sincèrement comme le héros même dont il était question dans le livre; je souffrais de toutes ses peines, je jouissais de tous ses bonheurs: richesse, liberté, situation dans le monde. Par malheur, les volumes qui me tombaient sous la main n’étaient pas des livres d’enfant, mais des romans anciens dont les héros étaient fabuleusement riches, forts et valeureux. C’est pourquoi, quand je refermais le livre et que je me voyais obligé de me métamorphoser, de puissant chevalier ou baron, en un garçon ordinaire et même assez médiocre, souvent tancé pour sa paresse et sa distraction, je ne me donnais jamais la peine d’analyser ma propre personnalité, de recenser mes vrais besoins et mes devoirs, et je commençais tout simplement à m’ennuyer; ma vie me devenait à charge. Il me semblait qu’on n’était pas bien chez nous, qu’on ne me laissait pas assez de liberté, et que mes sœurs étaient des sottes.
J’avais pris le goût de la solitude, et lorsque je ne lisais pas, il m’arrivait souvent de rester étendu des heures entières, immobile, à me forger une foule de plans et d’histoires insensées et ineptes qui toutes, cela va sans dire, tendaient à me soustraire à mon sort «si douloureux, si vulgaire.»
En général, je ressemblais beaucoup au fameux Don Quichotte de la Manche, sans me douter aucunement de cette triste ressemblance et sans penser, à plus forte raison, que le sort, comme s’il voulait me punir, tout d’un coup et par ma propre faute, m’arracherait irrévocablement à ma vie de rêveur et me mettrait face à face avec une réalité aussi cruelle, contre laquelle j’aurais à mesurer mes vraies forces et à me convaincre amèrement de leur impuissance. En un mot, il est clair que je ne croyais pas du tout avoir à supporter les fatigues, les peines et les désillusions du célèbre héros de Cervantès.
Par bonheur ou par malheur, je découvris, sur un des rayons de notre bibliothèque, la relation complète des voyages de Dumont d’Urville. Ce furent d’abord les dessins qui éveillèrent mon intérêt, puis les descriptions elles-mêmes.
L’idée que tout ce qu’on décrivait ainsi était la «vraie vérité » ne contribuait sans doute pas peu à mon plaisir. Je m’abandonnai à la lecture des voyages avec ce même entraînement excessif, ce même penchant aux illusions dont j’étais coutumier. Maintenant, au lieu d’un Monte-Cristo, je m’imaginais être un grand explorateur, civilisateur et bienfaiteur de pays immenses, en oubliant sincèrement que ce civilisateur lui-même, qui se disposait à répandre ses bienfaits sur le genre humain, n’était pas en état d’indiquer les différentes contrées sur la carte, ni d’expliquer pourquoi elles jouissaient d’un climat maritime ou continental, et quelle différence existait entre ces deux sortes de climats.
Dès lors, je continuais, comme par le passé, à m’isoler de la société de mes sœurs et des membres adultes de ma famille, à faire le paresseux; mais ce n’était plus en restant étendu que je m’abandonnais à mes rêves, c’était en façonnant, avec mon couteau, toutes sortes d’armes de sauvages. Cette nouvelle fantaisie fut cause que je me liai d’amitié avec le vieux menuisier Mikhaïlo et le fils du valet de chambre de mon frère, Wassia.
Ce Wassia était élevé avec nous, et il a joué par la suite dans ma vie un rôle grand et important: c’est pourquoi je parlerai de lui avec un peu plus de détail. Son père avait été, dans le temps, le serf du mien, et dans sa jeunesse l’avait servi comme valet de chambre; mais même après l’affranchissement des serfs ils conservèrent, pendant toute leur vie, leurs relations de maître à serviteur, et en même temps d’amis complètement dévoués l’un à l’autre. La mère de Wassia mourut quand il n’avait que cinq ans. Aussitôt, mon père donna l’ordre de le prendre dans «les appartements ». On lui faisait porter nos vieux habits, on le nourrissait des restes de notre table et il fut admis aux jeux des «enfants du maître». Dans l’opinion des grandes personnes, c’était là une grande faveur et un grand honneur pour le fils d’un ancien serf. Mais nous autres, enfants, nous ne percevions, par bonheur, ni l’étendue de cette «faveur», ni la différence qui aurait existé entre nous et Wassia. Pour nous, il était tout simplement un camarade de jeux et quelquefois même un sujet d’envie, parce qu’il jouissait d’une plus grande liberté que nous, tout en n’en usant que pour nous complaire.
Si nous soufflions des bulles de savon pendant les longues soirées d’hiver et qu’un brin de paille vînt à nous manquer, nous n’osions même pas sortir dans l’antichambre pour en demander, tandis que Wassia, coiffé d’une simple casquette, courait hardiment à l’aire et revenait en traînant après lui toute une gerbe. Nous restions craintivement dans la salle d’étude, tandis que Wassia criait jusqu’ à l’enrouement dans les magasins à blé pour faire entrer les oiseaux dans les filets qu’il tressait et qu’il tendait sur les toits avec une grande habileté. Nous pêchions à la ligne le menu poisson, nous tenant timidement sur le radeau, tandis que Wassia allait et venait bravement sur le lac dans un canot, se glissait dans les roseaux et rapportait de grandes brèmes avec des gardons. Comment, à la vue d’une aussi heureuse liberté, l’envie ne se fût-elle pas glissée dans une petite cervelle d’enfant?
Wassia criait pour faire entrer les oiseaux dans les filets qu’il tressait...
Je ne sais pas pourquoi on ne faisait pas étudier Wassia ensemble avec nous. Peut-être son père, qui éprouvait pour ma mère une sorte de vénération, ne l’avait-il pas voulu: qu’elle-même «daignât se donner de la peine pour son gamin, » — il eût vu là presque un sacrilège. C’était un homme qui professait des opinions antiques quelque peu bizarres, mais qui s’y tenait avec une fermeté inflexible, et que pour cela chacun respectait grandement.
J’appris quelque peu à manier les outils.
Entre nous, surtout entre moi et Wassia, la différence était énorme. Ce qui chez moi n’était que rêve timide ou fantaisie indécise passait chez lui immédiatement à l’état d’acte. Il excellait dans la façon de toutes sortes de petits objets. Si quelque part dans le village apparaissait une cage à sansonnet ingénieuse, ou un épouvantail avec une crécelle à vent dans un potager, ou bien un moulin à eau sur le ruisseau, — on n’avait même pas à demander qui en était l’auteur.
Mon idée de fabriquer des armes à l’instar des sauvages avait, bien entendu, rencontré auprès de lui une chaude sympathie et un concours zélé. Le vieux Mikhaïlo s’intéressait aussi à ces inventions plus ou moins ingénieuses, surtout quand je les assaisonnais de curieux récits «sur les gens qui vivent par-delà les mers.» Je contractai l’habitude de passer de longues heures dans l’atelier de menuiserie et j’appris quelque peu à manier les outils.
En attendant, mes études allaient leur train désespérément médiocre d’autrefois. Lorsque mon père revint d’un de ses voyages, ma mère, de nouveau, se plaignit de moi et raconta ma nouvelle fantaisie de passer mon temps à l’atelier et d’y travailler.
— Eh bien, qu’il y reste et qu’il y travaille, répondit-il sèchement; cela vaut toujours mieux que de se rouler sur les canapés et de ne faire absolument rien. Seulement, voilà ce que j’ai à te dire, Nadia: — J’avais d’abord l’intention de le garder à la maison jusqu’à l’âge de quinze ans à peu près, jusqu’à ce qu’il se fût formé et fortifié, mais je m’aperçois maintenant que cela est tout simplement impossible. Lui, il ne fait que perdre inutilement son temps, et toi, il t’a harassée de fatigue. En automne, je le conduirai à l’École militaire.
Cette perspective ne fut pas complètement de mon goût. La crainte me vint, et avec elle un peu de réflexion. L’intelligence ne me manquait pas. Je me mis à travailler avec beaucoup de zèle, et bientôt ma pauvre mère fut non seulement consolée, mais même ravie.
Dans ces agréables dispositions nous arrivâmes jusqu’à Pâques. C’est en général la meilleure fête de l’année, fût-ce par cette seule raison qu’elle tombe au printemps. Mais, dans notre famille, à cette date se rattachait encore une autre circonstance qui en faisait la source d’une joie universelle.
Ma mère avait un cousin, jeune encore, intelligent, riche et insouciant. L’hiver, il le passait à Saint-Pétersbourg; mais dès le retour du printemps et précisément toujours avant Pâques, il quittait cette ville pour s’en venir dans sa propriété, voisine de la nôtre. Il n’y vivait pas d’ailleurs beaucoup, et nous consacrait presque tous ses instants, étant très lié avec mes parents.
Cet oncle célibataire et riche arrivait toujours avec des chariots entiers de cadeaux de toutes sortes. Il se montrait surtout prodigue envers nous, les enfants.
J’étais déjà dans ma treizième année, et l’oncle avait voulu cette fois me faire les présents les plus appropriés à mon âge. Quelques jours après son arrivée, il me gratifia d’un magnifique fusil anglais avec tout un attirail de chasse, d’une trousse complète d’outils, non point des jouets, mais de vrais outils de charpentier et de menuisier, et de plusieurs beaux livres luxueusement reliés.
Toute la soirée se passa dans l’examen de ces objets, les extases, les remerciements. Nous autres enfants, nous nous en couchâmes même un peu plus tard qu’à l’ordinaire.
Cependant mes sœurs furent bientôt emmenées par Augusta Ivanovna. Je restai seul dans la salle à manger, achevant paresseusement mon thé.
La chambre contiguë était le boudoir de ma mère. Tout de suite après le thé, mon père s’en alla dans son cabinet, à ses comptes et à ses papiers, et ma mère fit entrer l’oncle chez elle. Une conversation d’abord simplement gaie s’engagea entre eux, puis ils passèrent aux affaires de famille.
Ils m’avaient probablement oublié, et ce fut ainsi qu’involontairement je surpris leur conversation, qui par la suite eut une influence considérable sur ma vie.
— Et Serge, qu’est-ce qu’il devient? interrogea tout d’un coup l’oncle; vous m’écriviez que ces derniers temps il a fait de nouvelles extravagances. Qu’y a-t-il donc?
— Oui, ce garçon me donne beaucoup de soucis, fit tristement ma mère; ce n’est même pas un homme, c’est pour ainsi dire, un entraînement ambulant. Tout, absolument tout, il ne le fait que comme par élan. Et cela ne présage rien de bon! Naguère il paressait et restait couché des journées entières, en rêvant à je ne sais quoi; puis il se mit à faire de la menuiserie. Maintenant, le voilà encore sous le coup d’un nouvel accès: depuis quelque temps il étudie avec tant d’acharnement que nous en sommes stupéfaits, son père et moi. Il est très bien doué, mais je crains que cet utile engouement ne dure pas longtemps. Oui, il me coûte bien des larmes, des chagrins et des inquiétudes.
Je me sentis mal à mon aise; j’avais honte de moi... pitié de ma mère. Mais je restais là et je continuais d’écouter.
— Et tenez maintenant, reprit-elle, en s’efforçant évidemment de donner à sa voix les plus douces inflexions, je vous suis sans doute bien reconnaissante de votre attention à l’égard de mon fils, mais je dois vous avouer que les cadeaux que vous lui avez faits me causent bien du souci! Avez-vous remarqué, combien fut grande sa joie de posséder un fusil? Maintenant il va y penser des journées entières et ne s’occupera que de cela, de sorte que les études seront de nouveau négligées. Et Dieu veuille encore qu’avec sa distraction, le maniement des armes à feu ne se termine par quelque catastrophe.
— Voyons, cousine, répliqua chaleureusement mon oncle, comment ne vous êtes-vous pas aperçue jusqu’à présent que cet enfant est doué d’aptitudes extraordinaires, qu’il ne tient pa dans les cadres où se meut la généralité des enfants. Vous avez l’air de vous chagriner de ce qu’il ne deviendra pas un officier de la garde bien astiqué ou un fonctionnaire zélé ; mais quel mal voyez-vous donc à ce qu’il devienne un grand explorateur ou un inventeur remarquable? Un caractère aussi exceptionnel promet certainement quelque chose d’extraordinaire dans l’avenir. Quant au fusil et aux outils, puisque c’est un garçon, qu’il acquière aussi des qualités viriles! Vous dites qu’il est fougueux et se laisse aisément entraîner: eh bien, savez-vous que rien peut-être ne nous apprend aussi bien le sangfroid et la possession de soi-même, que le maniement d’un fusil! Et pour les études, nous ne lui permettrons pas de les négliger. Je lui apprendrai moi-même à tirer, mais je lui poserai d’abord quelques conditions; et dans un mois, Anatole sera de retour et vous déchargera des fatigues que vous cause ce garçon-là.
En ce moment revint dans la salle à manger Augusta Ivanovna, qui envoya le futur grand explorateur au lit.
Mon bon oncle! Il parlait ainsi, pour consoler ma pauvre mère! Mais il ne savait pas quel insensé l’écoutait et quelles amères conséquences entraîneraient ses paroles, même pour celle qu’il voulait consoler ainsi!
De longtemps je ne pus m’endormir cette nuit-là ; je songeais à ce que pouvait bien signifier le mot «cadres» prononcé par l’oncle et pourquoi j’étais meilleur que les autres enfants, surtout que mes «stupides» sœurs. Je m’assoupis finalement, très satisfait de ma propre personne.
Toutefois, on ne me permit pas de m’adonner de nouveau à la paresse. L’oncle allait lui-même tirer avec moi, d’abord à la cible, que nous avions installée dans l’aire, ensuite même sur les oiseaux; il étrenna aussi avec moi tous les outils dans l’atelier, mais il veillait également à ce que j’apprisse bien mes leçons. Puis les vacances ramenèrent Anatole et Sacha, et alors il me devint complètement impossible de me plonger dans mes rêveries, ou même tout simplement de flâner si peu que ce fût, parce que j’étais le point de mire d’une sollicitude générale dans la famille, un sujet qu’il fallait soustraire aux suites funestes de la paresse.
Moi-même je sentis du reste bien vite l’intérêt immédiat que j’avais à m’appliquer. Tout le monde devint plus affable envers moi, y compris mon père. Sa bonté alla même jusqu’à m’emmener deux ou trois fois avec lui dans ses voyages d’affaires, et à causer longuement et sérieusement avec moi. J’étais très content, mais je ne comprenais pas que cette façon d’agir n’était qu’encouragement et indulgence témoignés à un enfant qui commençait à se corriger. Je songeais toujours aux «cadres» de mon oncle, et je me disais que mes parents avaient reconnu enfin que j’étais un futur grand homme.
L’été avait été très favorable aux entreprises économiques de mon père. Les foins réussirent on ne peut mieux, les premières rentrées en grains présageaient une récolte magnifique, le bétail avait engraissé et s’était accru considérablement. Mon père se trouvait de très bonne humeur.
Mon bon vivant d’oncle l’engageait à célébrer un automne aussi heureux par une partie de plaisir, et enfin il lui proposa de «faire revivre le bon vieux temps des pomieschiks», d’organiser une chasse avec battue. Sur sa prière, il fut décidé qu’on m’emmènerait aussi.
On choisit, pour rendez-vous de chasse, des bois situés à une vingtaine de verstes à peu près de notre village, et vifs en lièvres et en toutes sortes de gibier. En quelques jours la nouvelle de notre projet et nos invitations se répandirent dans tous les environs. Dès l’avant-veille de la fête, les voisins éloignés commencèrent à arriver chez nous avec leurs fusils et leurs chiens. Notre maison, toujours si tranquille et si calme, avait pris comme une vie nouvelle. Tout y devint bruyant et animé ; partout on entendait des récits et des anecdotes de chasse, des éclats de rire, des commandements brefs, auxquels les chiens bien dressés faisaient toute sorte de tours surprenants. Mon père s’acquittait consciencieusement de son rôle d’hôte plein de cordialité, l’oncle s’amusait sincèrement; quant à ma mère, elle supportait tout ce chaos de bruits inaccoutumés et tout le poids des soucis du ménage avec un sourire de bonhomie indulgente.
A moi, on m’accorda une semaine entière de vacances. Il était du reste peu probable que j’eusse appris quelque chose ces jours-là. Je nageais dans une sorte d’ivresse. Le grand nombre des chevaux dans la cour, des fusils de systèmes différents, les chiens dressés, les discussions des chasseurs, — tout cela me subjuguait entièrement pendant le jour, et la nuit.... je rêvais, comme d’habitude. Même je maigris et pâlis pendant cette période, ce qui fâcha beaucoup ma bonne vieille niania , le meilleur et le plus grognon des êtres.
Enfin, un beau jour, je fus réveillé à l’aube par Wassia qui m’eut promptement habillé. Tous les chasseurs se restauraient et prenaient le thé dans la salle à manger.
Ma mère s’y trouvait également. Elle me servit elle-même à manger et à boire, et au moment de prendre congé, me donna sa bénédiction avec, dans le regard, cette inquiétude secrète que j’y remarquais souvent, quand quelqu’un, dans la maison, se trouvait sérieusement malade. Mais alors, je ne sus pas apprécier cette inquiète sollicitude.
Je dus presque m’arracher de ses bras et je courus dans ma chambre, où je mis mon élégante gibecière neuve, la poire à poudre, le sac à dragées, le couteau, enfin mon armure complète de chasse. Tout cela n’était qu’un fardeau inutile pour moi et mon cheval, et l’un des chariots aurait aussi bien pu le transporter au rendez-vous de chasse. Je comprends maintenant que j’étais ridicule à faire pitié, mais alors je ne songeais qu’aux trappeurs de l’Arkansas et aux héros si terriblement courageux et si heureux de Mayne-Reid.
Sur le lieu de la chasse nous attendaient déjà les chariots avec des rets et des troupes entières de petits paysans traqueurs. Plusieurs moujiks restèrent là pour faire des huttes; les cuisiniers se mirent en devoir de préparer le dîner et nous commençâmes la chasse en tendant tout d’abord les rets.
On appelle ainsi un filet de deux mètres de largeur sur plusieurs dizaines de longueur. On l’étend en demi-cercle sur la lisière d’un bois ou d’une forêt, en l’attachant à des arbres et à des pieux, de façon à ce qu’il se tienne droit comme une muraille. Surtout on veille à ce que le bord inférieur de ce filet soit bien exactement appliqué contre la terre.
Après l’avoir tendu, les traqueurs s’en éloignent d’une verste ou d’une verste et demie, se placent aussi en demi-cercle, et tous criant et faisant tourner des crécelles se dirigent à toutes jambes vers le filet. Tous les lièvres et renards qui se trouvent dans ce cercle se sauvent devant le bruit et tombent dans les rets. Les chasseurs n’ont plus qu’à les tuer.
Mais mon oncle et mon père se lassèrent bientôt de cette chasse, qui ressemblait plutôt à une tuerie. On roula les filets et on les envoya aux huttes. Nous nous mîmes à chasser, en tirant chacun de notre côté. Nous parcourûmes ainsi des espaces considérables, ne mangeant que ce qui se trouvait dans nos gibecières, et ce fut seulement vers le soir, à la tombée de la nuit, que nous débouchâmes sur la clairière où se dressait notre camp.
Jamais de la vie je n’oublierai le transport dont je fus saisi à cette vue. Dans le crépuscule du soir flambaient plusieurs bûchers. Deux énormes huttes projetaient au loin leurs ombres colossales; près de là se dessinaient les silhouettes noires des chevaux, attachés aux tiélégas en guise de râtelier. Au milieu de tout cela on apercevait de temps en temps des formes humaines, qui passaient et remuaient, tantôt vivement éclairées par les flammes des bûchers, tantôt noyées dans les ténèbres qui les environnaient. A mesure que les chasseurs arrivaient, le tableau s’animait de plus en plus. Toutes ces physionomies étaient gaies, excitées par le mouvement. Cela ressemblait tellement à un campement d’émigrants en quête de quelque pays encore inhabité !
Je soupai à la hâte, et malgré mon enthousiasme, je me réfugiai bien vite dans la hutte. J’avais chaud, mon lit était moelleux, je n’avais peur de rien et ma fantaisie, comme de juste, se donna libre carrière!
«Quelle vie adorable, pensais-je, et pourquoi mon père ne vivrait-il pas toujours ainsi? Quel plaisir trouve-t-il, tantôt à voyager par des routes détestables, tantôt à passer les nuits sur des comptes, des plans et d’ennuyeux livres de chimie! Et moi aussi, on me tourmente inutilement. Qu’ai-je besoin de savoir cette table de multiplication, la géométrie, la physique? Il y a pourtant assez de gens ici qui vivent et qui sont heureux sans connaître toutes ces sciences. Et quant à la nécessité où ils se trouvent de labourer, de bêcher la terre, d’abattre les arbres, de scier le bois, cela est agréable, cela n’est pas du tout ennuyeux comme de rester enfermé, et d’apprendre ses leçons.»
Je m’endormis, bercé par ces idées radieuses.
La seconde journée de chasse se passa de même que la première. Mais, la troisième, survint un incident qui acheva de tourner ma pauvre tête.
Pendant la chasse, mon oncle me gardait toujours auprès de lui, m’apprenait quand il fallait tirer, m’exhortait à ne pas perdre mon sang-froid, à attendre avec patience le bon moment pour ne jamais faire feu qu’à coup sûr.
Après avoir fait le tour de tous les petits bois pendant les deux premiers jours, nous avions, le troisième, transporté notre camp sur la lisière d’une grande forêt. Mon oncle me prévint d’avance que, cette fois, la chose était bien plus sérieuse et que, dans la forêt, on pouvait même rencontrer un ours.
La chasse allait son train. Les traqueurs et les chiens firent la chaîne autour d’un côté de «l’île» ; nous, les chasseurs, nous nous plaçâmes de l’autre. La sombre et calme forêt s’anima, et tout à coup retentirent des centaines de voix enfantines, les aboiements des chiens, et le bruit strident des crécelles.
Selon mon habitude, je me tenais à côté de mon oncle, l’arme prête à partir, le cœur agréablement serré par l’attente. Mon oncle se pencha vers moi et acheva de me donner ses dernières instructions.
Soudain, dans l’épaisseur de la forêt, éclatèrent des bruits de crécelles et des pas lourds de sabots qui se dirigeaient rapidement vers nous.
— Fais attention, Serge, ce n’est pas un lièvre — mur mura l’oncle d’une voix quelque peu inquiète, et surtout ne t’avise pas de fuir.
Toute la charge du gros plomb entra dans l’épaule droite de l’élan.
A dire vrai, je me préparais précisément à jouer des jambes, en dépit de mes rêves et du courage que je ressentais et manifestais alors que, étendu sur le canapé, je lisais Mayne-Reid. Mais les paroles de l’oncle excitèrent mon amour-propre et me rendirent mon sang-froid.
En ce moment, de l’épais taillis des boulaies, des aunaies et des sorbiers, surgit, juste en face de moi, la tête cornue d’un élan. Étourdi par les cris et le fracas des crécelles qui le talonnaient, il fuyait, tête baissée; en nous apercevant, il crut sans doute choisir, entre deux dangers, le moindre, car il ne s’arrêta pas, bondit hors du taillis et continua à courir dans ma direction. Tout cela se passa si vite, que j’eus à peine le temps de le mettre en joue et de tirer, au moment même où il m’atteignait. Toute la charge du gros plomb lui entra dans l’épaule droite. L’élan fit encore quelques bonds désespérés en avant, puis il se mit à boiter fortement et enfin tomba par terre de tout le poids de son grand corps. Évidemment, le gros plomb, en faisant balle, lui avait cassé le tendon. Mon oncle tira à son tour et l’atteignit au même endroit. Autour de nous, se réunit bientôt la foule des chasseurs. La mort de l’élan sauva la vie à bien des lièvres et des renards. On l’acheva immédiatement. Des discussions s’engagèrent, des conjectures se firent jour. Il était probable que la malheureuse bête se dirigeait vers un champ d’avoine voisin, quand il était tombé dans notre «île».
Je devins ce que l’on appelle le héros du jour. Les chasseurs, mis en train, me prodiguaient des louanges comme si tout cela était dû, non pas au hasard seul, mais à un acte quelconque de vaillance de ma part. Mon père lui-même m’adressa, sous forme de plaisanterie, des félicitations et des éloges.
Je nageais dans un océan de béatitude, et je m’imaginais de plus en plus que j’étais un jeune homme extraordinaire.
Le soir de cette même journée, nous revînmes à la maison. Ma mère fut très contente de me revoir, mais elle n’eut pas l’air de partager la joie générale causée par ma victoire.
Bientôt notre vie rentra dans son ornière habituelle, si odieuse pour moi. Anatole, Sacha et mon oncle repartirent; mon père reprit ses occupations, et moi je me remis au travail sous la direction de ma mère. Mais à présent il n’y avait plus personne pour me stimuler, et je m’abandonnai de nouveau à la paresse.
Je me trouvais maintenant sous le charme d’un nouvel entraînement. Parmi les livres donnés par mon oncle, j’en découvris un qui me tourna la tête, comme aucun autre encore ne me l’avait tournée. C’était une édition magnifique de Robinson Crusoé. Après la chasse, ce à quoi je rêvais le plus, c’était une existence libre et fantastique dans les bois: et voilà que je rencontrais un récit vraisemblable de la vie qu’un homme solitaire avait menée pendant plusieurs années dans la forêt. Je me mis de nouveau à me forger des rêves. Ma distraction atteignait des proportions incroyables. Ma mère me menaçait souvent de l’École militaire et me racontait les mesures de rigueur qu’on y appliquait, la rude discipline qui y régnait, et comme l’existence y était dure et difficile. Mais j’avais une foi si profonde en sa tendresse, que j’étais convaincu qu’elle ne me soumettrait pas à «un supplice» pareil; de sorte que ses menaces ne me touchaient guère, et que je ne changeais rien à ma conduite.
Enfin, elle s’en plaignit à mon père. Il était cette fois d’une humeur particulièrement exécrable, si bien qu’il ne me demanda même pas d’explications et se borna à dire à ma mère:
— L’année dernière, j’ai cédé à tes sollicitations, j’ai cru aussi qu’il se corrigerait. Je vois maintenant que je me suis trompé et que je n’ai réussi qu’à te fatiguer inutilement. En août, je le conduirai à l’École militaire; peut-être, là-bas, fera-t-on un homme de lui... Mais des bergers ignorants, j’en ai assez sans lui.
L’expression de sa figure et le ton de sa voix me démontrèrent que sa résolution était ferme et irrévocable. Mon sort était décidé.
Cette circonstance me tourmenta beaucoup et m’inspira une grande crainte. Je passai plusieurs nuits sans sommeil, ma distraction augmenta et je cherchai un moyen d’éviter ce qui était maintenant inévitable, d’autant plus que j’atteignais déjà la fin de ma treizième année.
Finalement une nuit, après une soirée passée dans la lecture de Robinson, je trouvai une issue! Mon cœur se mit à battre violemment de joie.
«Ils ne réussiront pas à faire de moi un officier de la garde tiré à quatre épingles, pensai-je avec une méchante expression de triomphe, en oubliant complètement que ce mot «ils» sous-entendait ma mère si pleine de tendresse, et mon père qui toute sa vie avait travaillé pour nous. J’attendrai l’été et je m’enfuirai... Fuir dans une ville ou dans un village, c’est s’exposer à se faire prendre et à être ramené. Je m’en irai donc dans une forêt. Robinson y a bien vécu; j’y vivrai également. Je tire même beaucoup mieux que lui. Je me construirai une hutte..... Et Vendredi? me dis-je soudain; à deux on est tout de même bien mieux. Eh! si je trouvais un camarade!.. Wassia! fus-je presque sur le point de m’écrier.
Je m’endormis tout à fait heureux. Mon avenir de Robinson me paraissait décidé et assuré, et l’École militaire serait privée de l’honneur de posséder dans son sein «l’enfant extraordinaire» et le futur grand homme.
Le matin, lorsque Wassia vint m’apporter de l’eau pour ma toilette, je lui fis part, adroitement et avec circonspection, de mon projet. Mais il agita bras et jambes et s’arma contre moi de tous les arguments que pouvait lui inspirer son esprit simple et droit.
J’en fus quelque peu affligé, mais je ne perdis pas courage. J’étais sûr que Wassia ne livrerait pas mon secret, et pour le convaincre, j’avais devant moi un temps suffisant. Chaque matin et chaque soir, nos conversations roulaient sur ce plan de fuite, et peu à peu je détruisais tous les arguments de Wassia, ce qui m’était particulièrement facile, grâce à Robinson et à quelques livres de voyage. C’est vraiment surprenant à quel point la raison humaine, quand elle est pervertie, peut tourner à son détriment, même les choses les plus utiles.
Une circonstance inattendue m’aida à convaincre Wassia bien plus que tous mes arguments scientifiques. Le bruit de mon départ à l’École militaire arriva bientôt jusqu’à l’office.
Un soir, Wassia vint me déshabiller, les yeux gonflés de larmes.
— Qu’as-tu? lui demandai-je.
— Nous avons, à ce qu’il paraît, le même sort, Serge Alexandrovitch! fit-il avec amertume. — En même temps que vous, mon père veut me conduire aussi à Saint-Pétersbourg pour me mettre en apprentissage chez un graveur. Mais Mathieu m’en a assez conté sur la façon dont on instruit là-bas les ouvriers. — Rien que des coups à recevoir, c’est à en mourir.
Cela m’arrangeait parfaitement. En effet, Wassia consentit bientôt à s’enfuir dans ma compagnie, et avec l’énergie qui lui était propre, il commença ses préparatifs pour notre existence future dans la forêt. Il se mit à faire provision de cordes, clous, vieux couteaux de cuisine et de table, et ainsi de suite. La grosse difficulté était pour nous de faire parvenir tout cela sur le lieu de notre futur domicile. Mais là aussi nous sûmes nous tirer d’embarras. Pour obtenir quelques faveurs, je me mis à étudier avec plus d’application. Pour un cerveau occupé de tout autre chose c’était bien difficile, mais cette fois je résolus de me donner même quelque peine, pourvu que le plan que j’avais conçu pût réussir. Ma mère fut contente de moi, et consentit même assez volontiers à me voir remplacer ma promenade de midi par des visites à l’atelier, pour y construire une brouette avec l’aide de Mathieu.
Le pauvre vieillard n’en revenait pas de l’idée que j’avais eue d’inventer un tel «Esope», ainsi qu’il s’exprimait. Mais moi, j’obéissais à un calcul secret. Je savais que plus la roue serait grande, plus il serait facile au cheval de traîner la voiture, et ce cheval c’est moi-même qui devais l’être. Je voulais aussi emporter avec moi une quantité aussi grande qu’il se pourrait des choses les plus nécessaires. C’est pourquoi j’insistais afin que les roues de ma brouette fussent aussi hautes que possible et la caisse étroite (afin de ne pas accrocher les arbres) et très profonde. Mathieu avait beau me dissuader, j’obtins qu’il fît ce que je désirais. Les essieux, les bandes de fer, la cheville ouvrière et toutes les autres pièces en fer, furent exécutées dans la forge qui se trouvait près de notre tannerie; la brouette fut peinte par un ouvrier qui avait appris lui-même la peinture, et tout en offrant un aspect assez bizarre, elle répondait parfaitement à mes intentions.
Cependant nous ne négligions pas non plus les autres préparatifs pour la fuite. Tous les deux nous entassi ons des allumettes, des clous, et nous nous occupions surtout de nous procurer de la poudre, du plomb et des balles. Mon oncle m’en avait donné une quantité considé rable pour un garçon de mon âge, mais elle n’était guère suf fisante pour un futur habitant des forêts. J’avais une ti relire dans laquelle j’avais peu à peu amassé une som me assez rondelette. Je l’ouvris et donnai tout l’arge nt à Wassia, qui, à l’aide de je ne sais quelle ruse, réussit à nous faire acheter par un de nos ouvriers une bonne provision de poudre, de plomb et de balles.
Enfin arriva le printemps. La neige avait fondu; çà et là des bourgeons apparurent aux arbres. Comme d’habitude, tout dans notre maison s’anima. Ma mère aimait passionnément à s’occuper des fleurs et des légumes, et en dépit de son élégance, travaillait souvent elle-même dans les jardins, comme la plus zélée des journalières campagnardes. Ces jours-là, nous autres enfants, nous étions exemptés des leçons, mais à condition de travailler aussi dans les jardins. On y employait également les femmes et les valets de chambre, les blanchisseuses, les récureuses de vaisselle, et comme tout ce monde était respectueusement attaché à ma mère, ses jardins et ses potagers constituaient une merveille qu’on citait dans tous les environs.
Moi et Wassia, nous prenions part à ces travaux, mais sans ressentir l’enthousiasme dont tous les autres étaient animés. Nous avions autre chose en tête.
Enfin, à la mi-juin, quand tout fut bien épanoui, les journées chaudes et les nuits tièdes, nous résolûmes de fuir, et nous fixâmes au 12 juin l’exécution de notre plan. Trois jours avant cette date, une agitation fébrile s’empara déjà de moi. Je ne pouvais ni manger ni dormir. Wassia, de son côté, était sombre et pâle.
Mon air étrange inspira de l’inquiétude à ma mère. Elle me crut malade. Le soir même du 11, elle vint dans ma chambre, comme j’étais déjà couché, et s’assit au chevet de mon lit.
— Qu’est-ce que tu as donc, mon chéri? fit-elle avec une tendresse indicible dont, je crois, elle seule était capable,
— as-tu mal quelque part?
«Qu’est-ce que tu as donc, mon chéri?.....»
A ces paroles d’amour et d’indulgente bonté, mon cœur se serra, et je devins tout rouge. Alors seulement je m’aperçus, avec une parfaite évidence, que c’était peut-être pour toujours que j’allais me séparer de ma mère. J’avais envie de pleurer. J’étais prêt à avouer tout, à rejeter loin de moi notre plan insensé, mais au même instant se présenta à mon esprit l’image de mon Wassia, si résolu; je songeai que c’était moi qui l’avais engagé à fuir, et quelle honte j’aurais à revenir sur ma décision.
Je me tus donc et, entourant ma mère de mes bras, je l’embrassai longuement, de toutes mes forces. Elle me regarda avec inquiétude et tristesse, écarta les cheveux de mon front, m’embrassa et me dit:
— Que tu es devenu nerveux! Du reste, c’est peut-être la croissance. Tu grandis tellement — c’est à croire que tu deviendras un géant. Allons, couche-toi; laisse que je te couvre. J’ai, moi-même, grande envie de dormir aujourd’ hui, probablement parce que je me suis trop fatiguée dans le jardin.
Elle me couvrit soigneusement, et sortit sans se hâter. Je ne pus qu’embrasser encore une fois sa main dans un élan de folle tendresse.
Resté seul, je pleurai amèrement. Maintenant je comprenais parfaitement que cette fuite était un acte insensé et méchant; mais mon sot amour-propre ne me permettait pas de m’arrêter à temps et de déclarer franchement à Wassia ma décision. J’étais, comme tous les gens peu réfléchis, l’esclave du respect humain, et j’agissais en esclave.
Cependant tous les bruits qui indiquaient la vie s’apaisèrent peu à peu dans la maison. Les domestiques, fatigués par leur travail dans le jardin, se couchèrent de bonne heure et ne tardèrent pas à s’endormir. Je restais au lit, prêtant l’oreille et roulant de douloureuses pensées dans mon esprit.
Tout à coup, sous la fenêtre de ma chambre, se fit entendre un bruit, suivi de trois coups convenus dans la vitre. C’était Wassia. Pour vaincre définitivement ma faiblesse et raffermir ma résolution par sa présence, je sautai du lit, puis je courus vers la fenêtre, je l’ouvris sans bruit et j’aidai Wassia à monter dans ma chambre. La brouette était là dans le jardin.
— Tout le monde dort, murmura-t-il, habillez-vous bien vite.
Les mains tremblantes et le cœur serré, je commençai à mettre mes chaussures et mes vêtements. Wassia tira doucement de dessous mon lit tous les petits sacs, caisses et paquets dont nous avions fait provision. Après avoir placé tout cela sur l’appui de la fenêtre, il descendit de nouveau dans le jardin. J’étais déjà habillé ; je m’approchai donc de la fenêtre et je lui passai les objets, qu’il arrangeait dans la brouette. La lourde caisse qui contenait les outils nous coûta assez d’efforts. Enfin, tout était emballé. Je jetai un coup d’œil dans la chambre. Sur le bureau se trouvaient mes deux canifs; je les pris et les glissai dans ma poche. La commode à linge avait un de ses tiroirs entrebâillé. J’en retirai tout ce qui me tomba sous la main et le passai à Wassia. Il secoua la tête en signe d’approbation. A côté du poêle était placé un assez grand coffre en tille. Il appartenait à ma vieille niania. Je ne savais pas ce qu’il contenait, mais, supposant qu’il devait renfermer des aiguilles, du fil et des chiffons, je le pris et le remis à Wassia.
— A quoi bon? demanda-t-il très surpris.
— Là-bas tout aura son utilité !
— Si vous voulez; seulement, cela suffit, nous ne pourrions plus le traîner.
Je revins pourtant encore une fois et je lui jetai deux couvertures.
Ainsi procédait le futur grand explorateur et civilisateur de pays immenses, s’en allant vivre pour longtemps dans une forêt, sans plan, sans système, sans songer à distinguer l’utile du superflu, saisissant tout simplement et sans aucun discernement tout ce qui lui tombait sous la main.
Sur la table à côté du lit se trouvait un petit bougeoir. Je soufflai la bougie, je la retirai du bougeoir et je fourrai l’un et l’autre dans ma poche. Enfin, je mis ma casquette et je descendis de la fenêtre sur le soubassement. De là je pus atteindre les volets que je fermai, afin que le matin on crût que je dormais un peu plus longtemps, et qu’on ne remarquât pas aussitôt notre fuite. Après quoi, je descendis par terre avec précaution. Wassia avait déjà tout empaqueté et attachait adroitement les objets sur la brouette. Je l’aidai, et finalement, nous nous mîmes en marche. En ce moment je n’avais nullement la conscience que je quittais pour toujours peut-être la maison paternelle, et que bientôt je désirerais avec des larmes, avec une douleur poignante, de la revoir au moins de loin.
La brouette roulait en effet très aisément. Je m’aperçus que mon Wassia, prévoyant et pratique, avait enduit les roues de graisse, ce qui facilite beaucoup la marche de tout véhicule.
De notre pas le plus léger, nous tournâmes dans l’allée tout au bout du jardin et nous arrivâmes près de la porte de sortie. Wassia l’ouvrit en me disant doucement:
— Traînez seul en attendant; je vous rejoins aussitôt.
La brouette roulait très aisément.
A l’écart, dans un angle du jardin, au milieu d’un épais taillis de merisiers à grappes et de lilas, s’élevait le pavillon des bains, construit, comme un kiosque, dans le style chinois. Wassia s’y rendit en courant et au bout d’une dizaine de minutes, il m’avait rejoint. A son épaule était accroché un fusil, à sa ceinture pendait une hache. D’une main il tenait sous son aisselle un petit châssis, de l’autre il traînait deux pioches en fer.
Je m’arrêtai. Nous attachâmes à la hâte ces objets sur la brouette. Le châssis fut enveloppé dans l’une des couvertures.
— Où as-tu pris le fusil, Wassia? demandai-je.
— Chez mon père. Il est trop vieux pour aller à la chasse, fit-il d’un ton bref, et comme pour s’excuser; puis il se détourna et tira fortement sur les brancards.
Il avait honte. Je le compris et je me tus.
Après deux heures environ de marche rapide et parfois même de course, nous nous trouvions déjà loin.