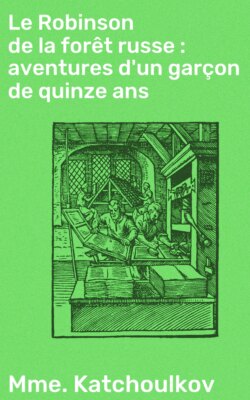Читать книгу Le Robinson de la forêt russe - Mme Katchoulkov - Страница 6
CHAPITRE III.
ОглавлениеEgarés! — Plus de retour possible! — Les tourments de la soif. — Découverte du lac. — Nous prenons la résolution de nous arrêter.
Le lendemain, je me réveillai, à une heure matinale ou tardive, je ne saurais le dire moi-même. Tout mon corps me faisait mal, surtout la tête et les jambes. Je crois que si j’étais resté couché, fût-ce même dans une chambre confortable, je serais tombé malade et d’épuisement et de froid. Mais la nécessité de me donner du mouvement et de faire des efforts me sauva.
Le jour était brumeux. Une pluie fine ne cessait de tomber. Toute la forêt affectait comme une coloration grisâtre qui respirait la tristesse. Mais maintenant cela nous était indifférent, car nous nous disions que dans quelques heures nous nous retrouverions chez nous, à l’abri du froid et entourés de soins. Nous mangeâmes à la hâte et nous nous mîmes à faire nos préparatifs. Nos mains, couvertes d’ampoules à la suite du travail de la veille, nous faisaient tellement mal à tous les deux, qu’il nous devenait absolument impossible de traîner la brouette par les brancards. Nous coupâmes donc un bout de corde et nous en fîmes une sorte de sangle. Chacun de nous, à tour de rôle, la passait à son cou et sous ses aisselles, et les deux extrémités en étaient attachées aux essieux des roues. Avec nos mains, nous n’avions plus qu’à soutenir légèrement les brancards, afin qu’ils ne traînassent pas par terre. L’autre poussait la brouette par derrière.
Nulle part l’homme ne s’égare si facilement que dans les bois. Dans un endroit découvert, même dans un steppe ou un désert, il peut se guider sur le soleil, sur un point quelconque de l’horizon et enfin, la nuit, sur les étoiles. Dans une forêt, tout cela est impossible. L’horizon est invisible; à travers le hallier, il est impossible de distinguer la position des étoiles; on peut se tromper même en se guidant sur le soleil. Quant à la forêt elle-même, elle est si infiniment variée dans ses détails et en même temps si uniformément monotone dans son ensemble, qu’on ne peut s’y orienter sur quelques indices particuliers, à moins que ce ne soit sur un espace tout à fait insignifiant. Nous réfléchîmes à tout cela, et après avoir tenu conseil, nous prîmes la résolution de retrouver nos traces et de les suivre.
En quittant la clairière qui nous avait abrités pour la nuit, je jetais sur elle un regard presque de haine. Pourquoi, je ne saurais le dire moi-même. N’était-ce pas ma propre folie qui m’avait amené là ?
Nous ne nous rappelions plus du tout la direction d’où nous étions venus, et nous eûmes assez de peine à retrouver l’endroit où nos traces s’arrêtaient; mais nous ne pûmes même les suivre pendant longtemps. La route que nous avions parcourue la veille était, à cause de la brouette, excessivement sinueuse. En outre, les mousses et les herbes, piétinées par nous, qui se trouvaient encore en pleine croissance, s’étaient redressées sous l’influence de la pluie avec une nouvelle vigueur. Pendant longtemps nous nous démenâmes, nous embrouillant, errant de tous les côtés, et nous finîmes par marcher à l’aventure.
Le temps restait obstinément brumeux et pluvieux. Nous n’avions même pas, pour nous guider, la ressource du soleil. En déjeunant le matin, nous bûmes les dernières gouttes de kvass, et pourtant notre soif était grande après le jambon et le pain sec. Quant à l’eau, il n’en pouvait même pas être question! Il est notoire que les souffrances de la soif sont bien plus douloureuses que celles de la faim? On peut donc s’imaginer l’état dans lequel se trouvaient deux enfants qui avaient passé deux jours dans un surmenage excessif, tout en sueur et sans boire.
Tout d’abord, nous fîmes preuve, à l’égard des premières atteintes de la soif, d’une certaine endurance. Wassia avoua le premier qu’il mourait d’envie de boire, mais il se hâta tout de suite d’ajouter qu’on pouvait bien patienter un peu. Je ne voulus pas lui céder en fermeté de caractère. Pourtant, après une demi-heure de marche, il s’arrêta, se débarrassa de la sangle, et s’approchant d’un jeune bouleau, se mit à lécher ses feuilles mouillées de pluie. D’abord je me mis à rire de cette fantaisie, puis je m’empressai de l’imiter. Mais est-ce qu’on peut apaiser la soif d’un homme à bout de forces avec des gouttes de pluie? Cela ne fait qu’accroître les souffrances.
Je jetai un regard désespéré autour de moi et tout à coup je me rappelai que la mousse était très hygrométrique, que grâce à elle coulent sur la terre des rivières entières d’une belle eau pure. Cette idée de rivières me fit sentir encore plus douloureusement ma soif. Je me baissai, j’arrachai une touffe de mousse et j’essayai de la sucer. Elle contenait certes, un peu d’humidité, mais aussi de la poussière, de petits insectes, et c’était un vrai dégoût.
En ce moment, Wassia courba doucement une des hautes branches du bouleau; mais le petit rameau, qu’il avait saisi à cet effet, se trouva être insuffisamment solide et se cassa. La grande branche se redressa brusquement et fit tomber sur nous toute une pluie de grosses gouttes.
— Attendez, j’ai trouvé une idée superbe! s’écria Wassia tout à coup.
Il courut vers la brouette qu’il déballa, et en sortit un drap propre, que j’avais emporté avec les autres effets, tirés pêle-mêle de la commode. Nous le pliâmes en quatre pour en faire un grand carré, que Vassia tenait étendu sur deux bâtons, tandis que je secouais au-dessus les branches mouillées. Quand le drap fut bien trempé, nous nous mîmes à en exprimer l’eau qui se trouvait en assez grande quantité, mais où la recueillir? Dans une bouteille? Mais le goulot en était trop étroit, et la majeure partie du précieux liquide coula par terre et fut perdue pour nous.
— Il faut sacrifier une bouteille, fis-je.
Je pris la bouteille, je l’entourai d’un mouchoir de poche et frappai le goulot contre un tronc d’arbre.
La bouteille se brisa, mais si heureusement, que nous obtînmes un verre grand et profond, quoique à bords coupants et inégaux.
Nous trempâmes de nouveau le drap et nous nous mîmes cette fois à deux pour l’exprimer au-dessus de ce verre improvisé, jusqu’à ce qu’il se fût rempli d’eau. Alors nous bûmes tour à tour, puis nous recommençâmes le même procédé.
Maintenant je ne puis me rappeler cet incident sans un sourire, mais je dois reconnaître néanmoins que cette invention si simple nous sauva la vie à tous les deux.
Nous exprimions le drap au-dessus de ce verre improvise.
Nous consacrâmes ainsi beaucoup de temps à nous procurer de l’eau. Le jour, par cette brume, tombait rapidement, et nous nous voyions encore bien loin d’atteindre la sortie de la forêt.
Encore une nuit longue et douloureuse sous la pluie, à monter la garde auprès du bûcher. Au matin recommença le même labeur pénible et désolant que nécessitait notre marche lente et sans issue à travers bois.
Oui, la réparation d’une sottise une fois faite demande parfois des années de tourments et de fatigues.
Trois jours et trois nuits errâmes-nous ainsi dans la forêt, comme les Israélites dans le désert, ne prenant pour toute nourriture que de petites bouchées de pain (car, pour avoir moins soif, nous ne mangions pas de jambon,) et nous procurant de l’eau à l’aide d’un drap mouillé. C’était encore un bonheur pour nous que le temps demeurât constamment pluvieux, autrement nous aurions succombé à la plus douloureuse des morts.
En général, ce qui me surprend, c’est que nous n’ayons pas alors perdu la tête, abandonné la brouette si dure à traîner et désormais inutile par suite de notre résolution de revenir chez nous, et commis enfin une foule d’imprudences fatales. Peut-être était-ce justement parce que la peur et la souffrance avaient anéanti en nous toute faculté de réfléchir; car, dans notre terrible situation, il était vraiment difficile de déterminer ce qui, en réalité, était raisonnable ou utile, ou bien insensé et funeste.
Enfin, le cinquième jour de notre malheureuse course errante, la forêt changea sensiblement de physionomie. Les rangs des conifères s’éclaircissaient, et l’on rencontrait plus souvent des arbres à feuilles.
Nous étions entourés d’une mer immense de cimes d’un vert fonce.
— Si Dieu le veut, nous en sortirons bientôt, fit Wassia. Je vais grimper sur un arbre pour voir si on n’en aperçoit pas la fin, ou bien un village quelconque!
Il grimpa sur le plus haut des pins qui nous entouraient. Je restai en bas, à l’attendre avec impatience.
— Eh bien? m’écriai-je, quand il fut au sommet.
— Rien, bârine , répondit-il. De tous côtés, on ne voit que des arbres; mais voilà qui est bien: à une petite distance d’ici j’aperçois le lac.
— Il n’y a pas à dire que c’est bien, répliquais-je; tu as pourtant entendu raconter que ce lac se trouve au beau milieu de la forêt, dans l’endroit le plus désert et le plus impraticable! Mais attends, je vais moi-même grimper auprès de toi.
Pour ce faire, j’étais tout aussi habile que Wassia, et je me mis à monter rapidement vers lui.
— C’est vrai pourtant, continuait Wassia; voilà aussi la montagne derrière le lac. C’est l’ «enceinte du Diable». Sans doute, quelqu’un au moins de nos aïeux y est allé et en est revenu; donc, nous aussi, nous en reviendrons un jour.
J’atteignis la branche où il se trouvait; je me perchai même un peu plus haut, et jetai un coup d’œil sur tous les environs.
En effet, si loin qu’allaient nos regards, nous étions entourés d’une mer immense de cimes d’un vert foncé. En un seul endroit, cette couleur devenait sensiblement plus claire. C’étaient les arbres à feuilles qui encadraient les bords en pente du lac, étendu comme un blanc miroir dans son long et profond vallon.
Je regardai longtemps, découragé, ce tableau simple, mais significatif, puis silencieusement je me mis à redescendre; Wassia me suivit.
Ainsi, ces quatre jours d’efforts désespérés pour sortir de la forêt demeuraient inutiles!
— Eh bien, que faire, à ton avis? demandai-je d’un air sombre.
Nous nous assîmes pour tenir conseil et nous prîmes la résolution suivante: nous tourmenter de la sorte pendant la journée et passer des nuits aussi terribles, en un mot vivre ainsi que nous avions vécu jusque-là, c’était absolument impossible. Pourtant, aucun de nous ne voulait non plus renoncer à l’espoir de retourner à la maison. C’est pourquoi nous devions profiter du voisinage de l’eau, gagner le lac, nous orienter un peu et construire au moins une habitation temporaire, après quoi seulement nous ferions des explorations quotidiennes, en tâchant dé suivre toujours la même direction, en creusant des incisions sur les arbres et en pénétrant plus loin de jour en jour. De cette façon, nous espérions atteindre, lentement mais sûrement, une des extrémités de la forêt.
Notre plan paraissait être très bien conçu et fort raisonnable. Mais il devait nous fournir la confirmation du dicton par lequel les conteurs russes ont l’habitude de modérer la rapidité de leur récit: «C’est aisé à dire, c’est malaisé à faire».