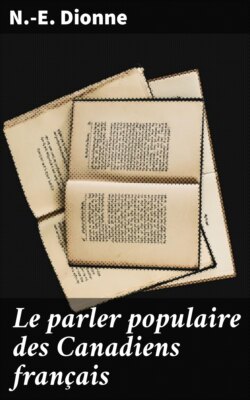Читать книгу Le parler populaire des Canadiens français - N.-E. Dionne - Страница 10
ОглавлениеBois (aller au), loc.
Aller chercher du bois dans la forêt. Ex. Mon père est parti ce matin pour aller au bois, il reviendra rien qu'à soir.
Bois barré, n. m.—Erable jaspé, appelé aussi bois noir.
Bois blanc, n. m.
Tilleul d'Amérique. Le bois blanc désigne d'une manière générale tous les bois à fibre blanche, comme le tremble, le peuplier, etc.
Bois-Brûlé, n. m.
Métis de sauvage et de blanc, habitant le Nord-Ouest du Canada.
Bois debout, n. m.
Terre boisée. Ex. Je viens d'acheter une terre en bois debout.
Bois de calumet, n. m.
Cornouiller à feuilles arrondies. Les sauvages se servent de la tige pour faire des tuyaux de calumet, après en avoir enlevé la moelle.
Bois de Calvaire, n. m.
Bois précieux. Ex. Cet individu n'est certainement pas du bois de Calvaire, c'est-à-dire qu'il est loin d'être un homme de valeur.
Bois de corde, n. m.
Bois de chauffage. Ex. J'ai acheté tout mon bois de corde, j'en ai pour l'hiver. Autrefois, en France, pour mesurer le bois, on plantait quatre pieux en formant un carré de huit pieds de côté; et comme les dimensions de cette mesure se prenaient avec une corde, on appela corde la quantité de bois qu'elle pouvait contenir, bois de corde, le bois de chauffage qui se débitait à la dite mesure. Telle est l'origine de l'expression bois de corde.
Bois de fer, n. m.
Bois très dur dont on se sert pour faire des essieux, des outils. On le rencontre au Cap Tourmente, près de Québec.
Bois de lune, n. m.
—Arbustes coupés la nuit, dans les bois autour de Québec, par des maraudeurs.
—Se chauffer avec du bois de lune, avec du bois volé durant la nuit.
Bois de Mai, n. m.
Aubépine commune, utilisée pour les haies. On l'appelle encore Epine blanche.
Bois de Malte, n. m.
Aulne blanche.
Bois de plomb, n. m.
Appelé aussi bois-cuir. Arbrisseau commun dans Nicolet.
Bois des Iles, n. m.
Bois de Campêche, employé pour teindre en rouge.
Bois d'orignal, n. m.—Viorne.
Bois de poêle, n. m.—Bois de chauffage.
Bois franc, n. m.
—Bois dur, y compris l'érable, l'orme, le merisier, le noyer, etc.
—Bois des arbres à feuilles caduques.
Bois francs, n. m. pl.
—Forêts de bois durs.
—Région appelée aussi Cantons de l'Est, où le bois franc est en abondance.
Bois mou, n. m.
—Bois blanc, tendre, léger, comme l'épinette, le sapin, etc.
—Bois des arbres à feuilles persistantes.
Boisage, n. m.—Boiserie.
Boisées, n. f. pl.
Arborescences qui se forment sur les vitres congelées à l'intérieur des habitations.
Boisson, n. f.
—Liqueur forte. Ex. C'est un ivrogne, il prend de la boisson à cœur de jour.
—Etre en boisson, être pris de boisson.
Boisson forte, n. f.
Boisson enivrante, qui n'est pas le vin, ni la bière, ni même les élixirs.
Boisure, n. f.—Boiserie.
Boitasser, v. n.—Boiter légèrement.
Boîte, n. f.
—Bouche. Ex. Veux-tu fermer ta boîte?
—Banc des jurés. Ex. Les douze petits jurés étaient dans leur boîte.
—Banc des accusés.
—Banc des témoins.
—Etui. Ex. Boîte de pipe.
—Chenil. Ex. Boîte à chiens.
—Avertisseur. Ex. Boîte d'alarme.
—Panier. Ex. Boîte à ouvrage.
—Case. Ex. Boîte postale.
—Caisse. Ex. Boîte d'horloge.
Boiter tout bas, loc.—Boiter beaucoup.
Boiteux d'ermite, n. m.
Boiteux. Ex. «Où vas-tu, boiteux d'ermite?» Souvenir de Giroflé Girofla.
Boitte, n. f.—V. Bouette.
Boitter, v. a.
Amorcer. Ex. Nous allons boitter nos hameçons.
Boiture, n. f.
—Boiterie, claudication d'un animal.
—Boitement, action de boiter.
Bol, n. f.
—Bol, n. m. Ex. Une bol à lait.
—Bol à thé, tasse à thé.
—Bol à lait, écuelle.
—Cuvette.
Bolée, n. f.—Contenu d'un bol.
* Bôlt, bôlte, (m. a.)—Boulon, course.
* Bôlter, v. a. (Angl.)
—Abandonner son poste. Ex. Mon député a bôlté sur la question Riel.
—Se hâter, courir, travailler vite.
* Bôlteur, adj. (Angl.)
Député qui lâche ses amis politiques sur une question vitale. Ex. Ne me parlez pas de Sam MaClure, c'est un bôlteur.
Bolus, n. f.
Pilule. E. Un docteur à bolus.
Bombarde, n. f.—Guimbarde.
Bombarder, v. a.
Faire une réputation. Ex. On l'a bombardé grand homme sans trop de raison.
Bombe, n. f.
—Bouilloire. Le corps de la bouilloire ressemble assez à une bombe, et le bec à celui d'un canard. Il est naturel qu'à Québec, ville militaire—que les bombes n'ont pas épargnée—on ait été frappé de la première ressemblance. Dans la région de Montréal, on dit canard pour bouilloire.
—Bonde d'un tonneau.
Bombée, n. f.
Le contenu d'une bombe. Ex. Une bombée d'eau bouillante.
* Bôme, n. m. (Angl.)
Estacade flottante.
Bommer, v. n. (Angl.)
—Flâner. Ex. Cesse donc de bommer, tu perds ton temps.
—Faire la vie. Ex. Si tu continues à bommer, tu vas ruiner ta santé.
—Faire un usage immodéré de liqueurs fortes.
* Bommeur, n. m. (Angl.)
—Flâneur.
—Viveur.
—Buveur de spiritueux.
Bon, adj. et n. m.
—Fort, robuste, vigoureux. Ex. C'est un bon homme.
—Avantages, réduction de prix. Ex. Si tu acceptes mon marché, je te ferai du bon.
Bon pour, loc.
Solvable. Ex. Jean me doit deux cents piastres, mais il est bon pour.
Bon (plus), adj.—Meilleur.
Bondance.—Interjection pour exprimer l'étonnement.
Bon=Dieu, n. m.
—Dieu, l'Etre Suprême.
—Papillon de nuit.
—La Brebis du Bon-Dieu, personne douce et patiente.
—Manger le Bon-Dieu, être très dévôt.
—Rendu devant le Bon-Dieu, disparu. Ex. Dis-moi ce que tu as fait de ta belle canne à pommeau d'or.—Ne m'en parle pas, elle est rendue devant le Bon-Dieu.
Bonguienne.—Interjection pour exprimer la surprise.
Bonheurement, adv.—Par bonheur, heureusement.
Bonhomme, n. m.
—Vieillard, père de famille affligé de vieillesse. Ex. Voilà le bonhomme Latulippe qui passe, c'est un bon bonhomme.
—Bouillon-blanc.
—Petit bonhomme vit encore. Jeu de société. En prononçant ces mots, on se passe un petit morceau de papier enflammé, ou une allumette, et celui ou celle dans la main de qui le feu s'éteint, doit donner un gage. Ce même jeu a commencé par s'appeler souffler le charbon.
Bonhomme de chemin, n. m.
Tranquillement. Ex. Aller son petit bonhomme de chemin.
Bonjour, int. et n. m.
—Exclamation. Ex. Bonjour! qu'il fait beau!
—Individu quelconque. Ex. Ces bonjours-là m'embêtent.
—Simple comme bonjour, de facile compréhension.
Bon sang.—Vraiment, en vérité. Ex. Bon sang de la vie.
Bon sens (sans), loc. adv.
Beaucoup. Ex. Il y a du poisson sans bon sens dans les trois petits lacs, nous en avons pris une cochonnerie.
Bonne, n. et adj.
—Employé elliptiquement pour bon, dans le but d'exprimer sa satisfaction. Ex. Comme de bonne.
—Petit bateau à fond plat.
—Bon. Ex. Cette fleur sent bonne.
Bonnefemme, n. f.
Vieille femme. Exprime l'idée de chef de famille plutôt sur l'âge.
* Boomerang, n. m., (m. a.)
Sorte de fronde dont se servent les enfants pour tuer les oiseaux.
Bonnement, adv.
Au juste, précisément. Ex. Je ne sais pas bonnement si je t'ai informé de cela.
Bonnes (être dans ses), loc.
De bonne humeur. Rabelais a dit:
«Notre maistre est en ses bonnes,Nous ferons tantôt une bonne chière,Tout ira par escuelles.»
Bonnet, n. m.
—Avoir la tête pris du bonnet, être prompt à se mettre en colère.
—Triste comme un bonnet de nuit, bien triste.
—Jeter son bonnet par-dessus les moulins, ne plus garder de retenue.
—Bonnet blanc, blanc bonnet, la même chose.
Bonnet carré, n. m.—Barrette, bonnet de prêtre.
Bonneter, v. a.
Flatter. Ex. A quoi sert d'aller le bonneter, tu n'obtiendras rien de plus.
Bonnette, n. m.—Bonnet.
Bonté, n. f.
—Exclamation. Ex. Bonté, que voilà du bon thé!
—Bonté divine, même sens.
Bonté divine!J'ai cassé ma terrine.Divine bonté!Ma terrine est cassée.
Bonus, n. m.
Gratification offerte à des employés en sus de leur salaire. Ex. Penses-tu que nous aurons un bonus au jour de l'an.
* Booby, boubé (m. a.)
Booby-price, prix accordé au jeu de euchre à celui qui arrive bon dernier. Booby veut dire nigaud.
Bord, n. m.
—Côté. Ex. Je vais me promener sur la rue, viens-tu de mon bord?
—Bas-côté d'une maison.
—De part en part. Ex. J'ai traversé la rivière de bord en bord.
—Dans. Ex. Embarquons à bord du train.
—Ouvriers de bord, débardeurs.
Bord et babord, loc.
De tous côtés. Ex. Jean court de bord et babord.
Bordage, n. m.
Bord d'une rivière en hiver, quand la glace forme comme une bordure.
Bordas, n. m.—V. Berdas.
Bordasser, v. n.—V. Berdasser.
Bordasserie, n. f.—V. Berdasserie.
Bordasseux, n. et adj.—V. Berdasseux.
Bordassier, n. et adj.—V. Berdassier.
Bordée, n. f.
—Chute. Ex. Nous allons avoir une grosse bordée de neige.
—Série. Ex. J'ai reçu une bordée de coups de canne.
Border, v. a.—Ourler.
Bordi=bordas, n. m.—V. Berdi-berdas.
Bordouiller, v. a.—Bredouiller.
Bordure, n. f.
Passementerie qui sert à border un vêtement.
Borgnesse, adj.—Femme borgne.
* Borneur, n. m. (Angl).
Bec-de-lampe.
Boss, n. m.
Maître, bourgeois, patron, chef d'usine, directeur, propriétaire.
Bosse, n. f.
—Enivrement. Ex. Il s'est flanqué une bosse numéro un.
—Coup. Ex. Je lui ai flanqué des bosses à tout casser.
—Porte-feuille.
Bosser, v. a.
—Bossuer. Ex. J'ai bossé mon castor en entrant dans le bateau.
—Conduire, diriger des travaux. (Angl).
Bosser, (se), v. pron.
Se bosseler. Ex. Mon chapeau s'est bossé en tombant.
Bossuse, n. f. et adj.
Bossue. Ex. Cette femme est bossuse. Se dit surtout dans la région de Montréal.
Botte, n. f.
Tomber en botte, arriver à la ruine, se briser, s'ébarouir. Ex. Tout tombe en botte chez nous depuis que j'en suis parti. La tinette de beurre menace de tomber en botte.
Botter, v. n.
—Accumuler de la neige ou de la boue aux pieds du cheval. Ex. Le cheval botte.
—Rogner des pièces de bois. (Angl.)
—Adhérer, coller à la chaussure. Ex. La neige botte.
Botteur, n. m. (Angl.):—Celui qui rogne des pièces de bois.
Bottes malouines, n. f. pl.
Bottes à l'écuyère. Souvenir de Saint-Malo.
Bottes sauvages, n. f. pl.—Bottes molles, sans semelles.
Boucan, n. m.
—Petite cabane où l'on fait boucaner la viande.
—Mauvais lieu.
—Morceau de bois placé en arrière du chaudron à sucre pour protéger le feu contre le vent.
Boucane, n. f.
—Fumée. Ex. La maison est remplie de boucane, c'est le tuyau qui a besoin d'être vidé.
—Vapeur d'eau. Ex. Vois-tu la boucane là-bas, c'est un bateau qui arrive d'Angleterre.
Boucane (être à la), loc.
Etre suspendu sous l'impulsion d'une personne assise à l'extrémité d'une balançoire spéciale tenue en équilibre sur un pivot et qui s'abaisse alternativement d'un côté en s'élevant de l'autre.
Boucaner, v. n.
Fumer. Ex. La cheminée boucane.
Boucanerie, n. f.
Etablissement où l'on expose des viandes ou des poissons pour les faire fumer.
Boucaneux, adj.—Brumeux.
Boucanière, n. f.—Boucan.
Boucaud, adj.—Bouscaud.
Boucharde, n. f.
—Outil d'acier à l'usage des tailleurs de pierre.
—Marteau dentelé et brételé, à l'usage des mêmes.
Bouché (être), loc.
Etre imbécile. Ex. Cet individu est bouché par les deux bouts.
Bouchefroutte, n. m.
Diable. Ex. As-tu rencontré Bouchefroutte? Expression dont on se sert lorsqu'on s'adresse à une personne de mauvaise humeur.
Boucher, v. a.
—Réduire à quia par des paroles dures. Ex. Il a voulu m'insulter, mais je te l'ai bouché proprement.
—Faire taire, fermer la bouche. Ex. Si tu ne te tais pas, je vais te boucher.
Boucher un trou, loc.
Donner un acompte sur une dette.
Boucherie (faire), loc.
Tuer un bœuf ou un porc, l'épiler, l'ouvrir, le dépecer. Ex. Maintenant que les froids sont commencés, nous allons faire boucherie.
Bouche=trou, n. m.
Qui remplit une lacune. Ex. C'est un gas qui n'est bon qu'à servir de bouche-trou.
Bouchon (mettre un), loc.
Faire taire. Ex. Si tu ne te fermes pas le bec, je vais te mettre un bouchon.
Bouchonner, v. a.
Faire son ouvrage à moitié. Ex. Cet individu bouchonne tout ce qu'il fait.
Bouchure, n. f.
Clôture. Mot usité sur l'île du Prince Edouard.
Boucle, n. f.
Nœud. Ex. Fais donc une boucle à ma cravate.
Boucler, v. n.
—Se dit de la mer montante lorsqu'elle entoure des rochers ou des îlots qu'on peut atteindre à pied sec, à marée basse. Ex. Voilà l'heure où la mer boucle.
—Conclure. Ex. Notre affaire n'est pas encore bouclée.
Boucoup, adv.
Beaucoup. Ex. J'ai boucoup à faire pour arriver à la fin de mon dictionnaire.
Bouctouches, n. f. pl.
Huîtres récoltées à Bouctouche, dans le Nouveau-Brunswick.
Boudin (faire du), loc.
Bouder. Ex. Mon petit, cesse donc de faire du boudin.
Boudinerie, n. f.—Viande hachée, boudin.
* Boudlage, n. m. (Angl.)
Commission ou revenu extraordinaire que l'on obtient par des procédés illicites.
Boudle, n. m. (Angl.)
Pot-de-vin accordé à un personnage influent dans le but de faire réussir une affaire, d'obtenir un contrat.
* Boudler, v. n. (Angl.)—Faire du boudlage.
* Boudleur, n. m. (Angl.)
Entremetteur qui fait accorder un contrat moyennant un pot-de-vin fixé d'avance et qui ne doit pas apparaître au contrat.
Boudrier, n. m.—Baudrier.
Bouer (se), v. pr.—Se crotter.
Bouette, n. f.
—Mélange de son et d'eau donné en pâture aux animaux de la ferme. Dans le Perche, cette expression ne s'applique qu'à la mangeaille des pourceaux. Le vrai sens de bouette est appât pour la pêche de la morue.
—Boue. Ex. Marcher dans la bouette.
—Neige fondante.
—Neige accumulée en masses molles à la surface des rivières.
Bouetter, v. a.
Donner un repas de bouette aux gros animaux.
Bouffée, n. f.—Accès. Ex. Pierre travaille par bouffées.
Bouffer de rire, loc.
Pouffer. Cependant, on dit bien bouffer de colère.
Bouffie, n. f.
—Bulle. Ex. Une bouffie de savon.
—Boursouflure. Ex. Il s'est brûlé, il a de grosses bouffies.
Bouffre, n. m. et interj.
Bougre. Ex. Quel bouffre d'enfant! Si je te poigne, mon petit bouffre, tu te feras arranger.
Bouffrèse, n. f. Bougresse. Ex. Oh! la bouffrèse de femme, elle devient de plus en plus insupportable.
Boufiole, n. f.
—Ampoule, cloche, boursouflure.
—Bulle d'air ou de vapeur, sur les liquides en ébullition ou en fermentation. (B. P. F.)
Bouger (ne pas), loc.
Se détromper. Ex. Bougez pas, l'ami, vous êtes à côté de la coche.
Bougon, n. m.
—Bout d'homme.
—Pipe dont le tuyau est très court.
Bougonner, v. n.
Gronder entre ses dents. Mot français vieilli, qui, en patois normand, signifie travailler mal, chiffonner.
Bougonneux, n. et adj.—Qui bougonne à tout propos.
Bougrant, adj.
Ennuyeux, fâcheux. Ex. C'est-y pas bougrant que de se voir pris dans cette sale affaire!
Bougre=à=bougre (être), loc.—A couteaux-tirés. (B. P. F.)
Bougrement, adv.
Beaucoup, très. Ex. C'est bougrement ennuyeux que ce temps de pluie.
Bougrer, v. a.
—Jeter. Ex. Bougre-moi ça à l'eau.
—Donner. Ex. Je vais te bougrer une tape. Bougre-moi la paix. Bougre-moi patience.
Bougrer (se), v. pron.
Se moquer. Ex. Je me bougre pas mal de toi.
Bougrèse, n. f.
—Bougresse.
—Grand, fort, sérieux. Ex. J'ai une bougrèse d'envie de te flanquer une gnole.
Bougrine, n. f.
Vêtement de dessus sans forme particulière. Ex. Qu'est-ce que tu as de l'air, avec cette vieille bougrine sur le dos!
Bouille, 3e pers. s. ind. prés.
Bout. Ex. L'eau bouille à gros bouillons dans la bombe.
Bouillie, n. f.
—Bouillie pour les chats, travail inutile, peine sans profit.
—Bouillie sans sel, mets mal apprêté.
—Ramener la peau par-dessus la bouillie, donner des arguments qui ont été plusieurs fois répétés.
Bouillir, v. n.
Etre affecté par l'impatience. Ex. Pendant qu'il parlait, je bouillais.
Bouilloire, n. f.—Chaudière à vapeur.
Bouillon blanc, n. m.
Molène commune dont les fleurs teignent en jaune.
Boujour, n. m.—Bonjour.
Boulâcrer, v. a.
Bousculer. Ex. Je n'ai pas envie de me faire boulâcrer plus longtemps.
—Exécuter un ouvrage sans soin.
—Bousiller.
Boulâcreux (euse), n. et adj.
Celui ou celle qui boulâcre.
Boulanger, v. a.
Presser avec la main ou avec les coudes. Ex. Se faire boulanger le dos, la poitrine au milieu d'une foule de personnes.
Boulant, adj.
Enneigé. Ex. Les chemins sont boulants, aujourd'hui.
Boule, n. f.
—Tête. Ex. Perds-tu la boule?
—Position de fortune. Ex. Il a une belle boule en mains.
Boule=de=cire, n. f.—Symphorine à grappes.
Boule=de=neige, n. f.
—Viorne stérile.
—Faire boule-de-neige, profiter, s'accroître. Ex. Le peu d'argent que j'ai finira par faire boule-de-neige.
Bouleau blanc, n. m.—Bouleau à papier.
Bouleau rouge, n. m.—Bouleau à feuilles de peuplier.
Bouler, v. a.
—Rouler en boule. Vient du mot débouler.
—Maltraiter.
* Boulezaille, n. f. (Angl.)
Bonbon en forme d'œil de bœuf. De l'anglais bull's eye.
Boulettes, n. f. pl.
Sottises. Ex. Cet écolier n'est bon qu'à faire des boulettes.
Boulin, n. m.—Tronçon d'arbre employé pour le clôturage.
Boulinant, adj.
Synonyme de boulant, enneigé. Ex. Les chemins sont boulinants, la neige est très légère et très molle.
Boulotte, n. f.
Doigt de gant ou linge que l'on met à un doigt malade, appelé par les enfants catiche. Les Acadiens emploient encore le mot doyon pour signifier la même chose.—Voir ce mot.
* Boume, n. m.
Valeur factice et exagérée. Ex. Nous allons être témoins d'un boume dans les chemins de fer, dans les banques. (Américanisme).
* Boumer, v. n.
Donner une valeur factice et exagérée à des actions de compagnies industrielles et autres. (Amér.)
Bouque, n. f.—Boucle.
Bouquer, v. n.—Montrer de l'humeur.
Bouquet, n. m.
—Fleur, plante cultivée pour sa fleur. Ex. Je vais semer beaucoup de bouquets ce printemps.
—Tête d'arbre, de sapin ou d'épinette plantée au faîte d'une maison dont la charpente vient d'être posée.
Bouquette (avoir, tenir le), loc.
L'emporter sur les autres par son adresse, sa beauté ou toute autre qualité. Ex. Ces trois sœurs sont très jolies filles, mais l'aînée tient le bouquette. Elles ont bien chanté toutes trois, hier soir, mais c'est mademoiselle Domisol qui a eu le bouquette.
Bouquineux, adj.—Bouquineur.
Boura, n. m.—Borax.
Bouragan, n. m.—Bouracan.
Bourbassière, n. f.—Bourbier.
Bourdaine, n. f.
—Alise. Baie du bourdainier. Viorne nue.
—Courir la bourdaine, aller en bande, garçons et filles, cueillir des fruits.
Bourdainier, n. m.—Alisier.
Bourdalou, n. m.—Vase de nuit.
Bourdé, adj.
Gravé. Ex. Mes bottines sont en cuir bourdé, c'est-à-dire à grains plus ou moins soulevés. Dans le vieux français, bourdé voulait dire embourbé.
Bourdignons, n. m. pl.—V. Bourguignons.
Bourgeois, n. m.
—Caractères d'imprimerie de neuf points.
—Homme riche, censé vivre de ses rentes. Ex. Le voilà devenu un gros bourgeois, il est bien chanceux.
Bourgeoiserie, n. f.
Bourgeoisie.
Bourgeronner, v. n.
Bourgeonner, pousser des bourgeons. Ex. Un nez tout bourgeonné.
Bourgot, n. m.
—Porte-voix à coquille. On appelle burgau une grosse coquille dont on tire une nacre grossière.
—Trompette droite, qui sert à donner des signaux.—Autrefois lorsque le service de la poste se faisait par des postillons qui parcouraient nos campagnes, ils étaient munis de bourgots de fer-blanc.
Bourgotter, v. n.
—Parler ou crier dans un porte-voix.
—Sonner de la trompette.
Bourguignons, n. m. pl.
—Mottes de terre durcies par la gelée.
—Morceaux de glace pris d'un pain.
Bourlette, n. f.—Ciboulette.
Bournichon, n. m.—Petit homme.
Bourrasse, n. f.—Bourrasque.
Bourrasser, v. a.
—Bousculer, brusquer. Ex. Cesse donc de bourrasser tes petites sœurs.
—Faire des reproches.
Bourrasseux, adj.
Homme d'une humeur difficile qui brusque tout le monde.
Bourreau, n. m.
—Diable. Ex. Que le bourreau t'emporte! J'ai eu une peur du bourreau.
—Payer en bourreau, payer d'avance. Bon moyen, paraît-il, pour être mal servi.
Bourreau d'ouvrage, n. m.—Homme qui travaille beaucoup.
Bourreau des arbres, n. m.
Célastre du Canada. Plante grimpante qui s'enroule si étroitement autour des arbres qu'elle les fait périr.
Bourrée, n. f.
—Travail forcé et rapide. Ex. Il va falloir donner une dure bourrée, si nous voulons finir d'entrer notre avoine!
—Réprimande, mercuriale. Ex. Je lui ai donné une bourrée dont il ne perdra pas le souvenir.
—Beaucoup, grande quantité. Ex. Une bourrée de coups, de monde.
—Accès. Ex. Pierre travaille bien, mais toujours par bourrée.
Bourrelet de gomme, n. m.
Morceau de gomme durcie que l'on détache des épinettes et que les enfants mâchent avec plaisir.
Bourrer, v. a.
Conter des blagues. Ex. Je l'ai bourré dans les grands prix, il a paru croire tout ce que je lui ai dit.
Bourreur, n. m.
Ouvrier qui rembourre les sofas, les chaises.
Bourrichon, n. m.
Petit bonhomme. Ex. Sauve-toi, mon petit bourrichon. Vient de burrichon, roitelet, dans le patois du Mans et de l'Anjou.
Bourriers, n. m. pl.
Balayures, ordures. Ce mot vient de bourriers, pailles qui se mêlent dans le blé battu; du latin burra, employé par Ausone pour signifier des riens. Par extension, ordures, mot usité en Bretagne.
Bourrique, n. f.
—Ignorant.
—Catholique comme une bourrique, catholique à gros grains.
Bourrolle, n. f.
Espèce de boîte à forme d'amphore sans anse, ouverte aux deux bouts, dont l'un, le petit, débouche dans un coffre où l'anguille va se prendre, et l'autre, le grand, est le récipient de l'anguille qui s'y introduit pour être rejetée dans le coffre par le courant. La bourrolle est fabriquée au moyen de petites harts bien entrelacées et très étroitement serrées les unes contre les autres.
Bourrure, n. f.
—Bourrage. Ex. La bourrure du harnais est finie, il va nous en falloir un autre.
—Rembourrement. Ex. C'est un bon homme pour travailler à la bourrure.
Bourse, n. f.
Crête-de-coq, dont les feuilles teignent en jaune.
Boursiller, v. n.
—Economiser. Ex. Pour arriver à joindre les deux bouts, il vous faudra boursiller plus que de raison.
Boursoufle, n. f.
Boursouflure. Ex. J'ai une grosse boursoufle sur le bras, c'est un bourdon qui m'a piqué.
Bouscailler, v. a.—Bousculer.
Bouscaner, v. a.—Bousculer.
Bouscaud, n. m.
—Lourdaud, homme gros, trapu. Ex. C'est un gros bouscaud.
—Butor, grossier.
Bœuf ou vache sans cornes.
—Courtaud.
Bousculage, n. m.—Action de bousculer.
Bousiat, n. m.—Homme malpropre.
Bousillage, n. m.
Ouvrage mal fait. Ex. Quel bousillage!
Bousiller, v. a. et n.
—Remplir les interstices entre les pièces de bois des pans, avec de la bouse.
—Corriger, arranger, mettre en bon ordre.
—Travailler vite et mal.
Bouskey, n. m.—Whiskey marchand.
Boussole (perdre la), loc.—Devenir fou.
Bout, n. m.
Mot employé dans différentes acceptions, que les dictionnaires ne mentionnent pas toujours.
—Bout-ci bout-là, en désordre, pêle-mêle.
—Un bout de temps, un certain temps.
—Un petit bout de temps, un court espace de temps.
—Prendre quelqu'un par le bon bout, savoir arriver auprès de lui.
—Mettre les deux bouts ensemble, joindre les deux bouts, ne pas s'endetter.
—Tourner un objet bout pour bout, changer sa situation d'une façon opposée.
—Au bout la fin y sera, il faudra bien que cela finisse un jour.
—Au bout le bout, quand ce sera fini, on n'en parlera plus.
—C'est le bout du monde, c'est la fin.
—Cet enfant n'a pas de bout, il est insupportable et incorrigible, d'une façon inexprimable.
—Bête au bout, absolument bête.
—De bout en bout, d'un bout à l'autre.
—Etre rendu au bout, être épuisé.
—Il y a un bout à tout, toute chose a une fin.
Bout=de=canot n. m.
Chacun des deux rameurs qui se placent aux deux bouts d'un canot d'écorce pour le diriger.
Boute=feu, n. m.
Boute-en-train, celui qui met en gaieté tous ceux avec lesquels il se trouve.
Bouteille, n. f.
—Burette. Ex. La bouteille à l'huile, au vinaigre.
—Flacon. Ex. La bouteille d'odeur, de parfum.
—Vin, liqueurs. Ex. Ce garçon caresse un peu trop la bouteille.
Bouteillée, n. f.—Le contenu d'une bouteille.
Bouteiller, v. a.—Mettre en bouteilles.
Bouteillerie, n. f.
Vieux mot français signifiant échansonnerie, ou mieux boutillerie, redevance en grains. Ex. Saint-Denis de la Bouteillerie, paroisse du comté de Kamouraska.
Boutique, n. f.
Maison mal tenue. Ex. Quelle sale boutique!
Bouton, n. m.
—Fruit de l'aigremoine qui s'attache à la laine des moutons en automne et s'enlève très difficilement.
—Petite inflammation commune aux serins à une certaine époque de l'année.
Bouton d'or, n. m.
Renoncule à fleurs jaunes dont nos campagnes regorgent.
Bouton, (dernier).
A bout de ressources. Ex. Pierre est rendu au dernier bouton, il est ruiné.
Boutte, n. m.—Bout.
* Bow=window, n. m., (winn'do), (m. a.)
Fenêtre en saillie, en rotonde.
Boxer, v. a.—Emprisonner.
Boxon, n. m.—Mauvais lieu.
Boyard, boïard, n. m.—Civière à porter le bois, la pierre, etc.
Boyau, n. m.
—Avoir toujours un boyau de vide, avoir toujours faim.
—Les boyaux me crient, avoir des borborygmes.
—Avoir des boyaux de père, éprouver de la tendresse pour ses enfants.
* Bracket, brakète, (m. a.)
Petite console, applique, étagère.
Braguet, breguet, brayet, n. m.—Caleçon de laine.
Braguette, n. f.
Fente de devant d'une culotte. En France, on appelle culottes à braguette celles qui n'ont pas de pont. En Bretagne, bragez a la même signification.
Brai, n. m.—Poix des cordonniers.
Braid, bréde, (m. a.)—Soutache, passementerie.
* Braider, v. a. (Ang.)—Poser du braid.
Brâillade, n. f.—Action générale de brailler.
Brâillage, n. m—-Même sens que brâillade.
Brâillard, e, adj.
—Qui braille, qui pleure. Ex. Un enfant brâillard.
—Qui implore du patronage auprès des gouvernements.
Brâillard de la Madeleine, loc.
Expression appliquée aux enfants qui pleurent à tout propos. Par allusion aux gémissements proférés dans les environs de la rivière Madeleine, suivant une légende populaire rapportée par l'abbé Ferland.
Brâiller, v. n.—Pleurer.
* Brain, braine, (m. a.)
Cerveau. Ex. Celui-là, je l'ai sur le brain, il me fatigue.
* Braker, bréquer. (Angl.)
—Serrer les freins dans un train de chemin de fer.
—Réprimer quelqu'un.
* Brakes, bréques, (m. a.)—Freins.
* Brakesman, bréke's manne (m. a.)—Serre-frein.
Brancard, n. m.
—Morceau de sucre d'érable à forme carrée. Ex. Un brancard de sucre.
—Cartes qui restent sur le tapis après la donne aux joueurs. Ex. Qu'as-tu besoin de regarder dans le brancard?
Branche, n. f.
—Division. Ex. Va au département des terres, branche des arpentages.
—Attaque. Ex. Jean a eu une branche de folie; Joseph a une branche de fièvre.
—Ami. Ex. Bonjour, ma vieille branche.
Branché, adj.
Diplômé, porteur de certificat. Ex. Un pilote branché.
Brancher (se), v. pr.
Brancher. Ex. Les petits oiseaux commencent à se brancher.
Branchu (canard), n. m.
Canard sauvage remarquable par la beauté de son plumage.
Brandiller, v. a.
Brandir. Ex. Ne brandille pas ainsi ce bâton.
Brandy, n. m., branndé.
—Cognac. Vieux mot français qui signifiait allumé, enflammé. «Et le feu soit si brandy. » (D'Argentré, Coutume de Bretagne, p. 1051).
—Danse. Ex. Nous allons danser un brandy.
Branle, n. m.
—Tapage. Ex. Mener un branle terrible.
—Ni foutre ni branle, absolument rien.
Branler, v. a.—Branler dans le manche, hésiter.
Branlette, n. f.
Oscillation de la tête. Ex. Ce vieillard commence à avoir la branlette.
Braque, n. m.—Imbécile. Ex. Il est fou comme braque.
Braquer, v. a.—Abandonner. Ex. Il m'a braqué là.
Braquer,(se), v. pr.
Se fixer. Ex. Il s'est braqué sur une chaise, et il s'y est installé.
Braquette, n. f.
—Broquette.
—Petite console, applique. (Angl.)
Braquetter, v. a.—Poser des broquettes.
Bras, n. m.
—Avoir le bras long, être influent.
—Par dessus bras, bras dessus bras dessous.
—Bras d'escalier, rampe.
—Aimer gros comme le bras, aimer beaucoup.
—Frapper à bout de bras, du bout du bras.
Brasse, n. f.
—Travailler à la brasse, journée de brasse, corvée de bras.
Brasse-corps (à), loc. adv.
A bras le corps. Ex. Se prendre à brasse-corps pour lutter de force et d'agilité.
Brassée, n. f.
Ribambelle d'enfants. Ex. Voilà Victoire qui passe avec sa brassée.
Brasseur, n. m.
Phoque du Groënland qui entre dans le fleuve Saint-Laurent en hiver.
Brâssage, n. m.
Action de secouer, d'agiter quelque chose.
Brâsse, n. f.
Main, au jeu de cartes. Ex. A qui la brâsse?
Brâssée, n. f.
Chaudronnée. Ex. Une brâssée de savon, de sirop, de sucre.
Brâssement, n. m—Remuement, brassage.
Brâsser, v. a.
—Mêler. Ex. Allons, brâsse les cartes.
—Disputer. Ex. Je viens de me faire brâsser de la belle façon. Je me suis fait brâsser le corps.
Brâsseur, adj.—Celui qui, aux cartes, tient la donne.
Braver, v. n.
Faire le brave. Ex. Il fait cela pour braver.
Braverie, n. f.—Bravade.
Braye, n. f.
—Broie ou macque. Instrument pour broyer le lin et le chanvre, composé de deux bois retenus par une de leurs extrémités, et s'enclavant l'une dans l'autre à la manière d'une mortaise.
—Femme qui marchande sans acheter. Ex. Voilà encore une braye qui vient nous ennuyer avec ses marchandages.
Brayer, v. a.
—Broyer. Ex. C'est aujourd'hui que nous allons brayer le lin.
—Aller d'un magasin à l'autre sans faire d'achat.
Brayeur, adj.—Celui qui braye.
* Brécer, v. n. (Angl.)
Poser un bandage de fer sur la coque à l'intérieur d'un vaisseau.
Brèche, n. f.
—Dent perdue. Ex. Cet enfant a plusieurs brèches dans la bouche.
—Brèche-dent. Ex. Cette femme serait plus jolie, si elle n'était brèche.
Bréché, adj.—Ebréché. Ex. Mon couteau est tout bréché.
Bredasser, v. a.—V. Berdasser.
Bredasserie, n. f.—V. Berdasserie.
Bredassier, adj.—V. Berdassier.
Bref, n. m.
Mandat, ordonnance, ordre. Ex. Bref de sommation, bref d'exécution, bref d'arrestation.
Brégade, n. f.—Brigade.
Brelander, v. a.—Raconter les choses à sa façon.
Brelingant, n. m.
Mot cité par Lacurne de Sainte-Pallaye, que nous retrouvons en pleine vigueur dans le comté de Kamouraska. Employé par les mères de famille pour inviter leurs enfants à prendre des positions plus décentes.
Breloque, n. f.—Vieille montre.
Brenante (à la), loc.—A la brune.
* Bréque, n. m. (Angl.)—Frein.
* Bréquer, v. a. (Angl.)—Serrer les freins.
Bretter, v. n.
—Fureter. Ex. Veux-tu me dire ce que tu brettes là?
—Perdre son temps à des bagatelles.
—Faucher. (Expression acadienne). D'après Oudin, bretter signifiait jouer ou faire des armes.
Bretteux, adj.
—Qui furette.
—Qui perd son temps. Ex. Avance donc à quelque chose, espèce de bretteux?
—Faucheur.
Breumasser, v. n.—Brumasser.
Breume, n. f.—Brume.
Breunante, n. f.—Brune.
Breune, n. f.—Brune.
Bréviaire, n. m.—Dire son bréviaire, lire son bréviaire.
* Brevier, brevière, (m. a.)—Petit texte, 8 points (T. d'impr.)
Brick, (m. a.)
—Brave garçon. Ex. Toi, tu es un brick, donne-moi la main.
—Brick bâtard, toute espèce de voiture sans caractère particulier, démodée et vieillie.
Bricoles, n. f. pl.
—Bretelles de pantalons. En France, la bricole est une bande de cuir qui se met aux sabots au-dessus du cou-de-pied.
Brigade, n. f.
Troupe de gens réunis ensemble. Ex. Y avait-il beaucoup de personnes qui marchaient dans la procession?—Oui, il y en avait une brigade.
* Brigade du feu. n. f.—Corps des pompiers. (Angl.)
Brigand, n. m.—Enfant terrible.
Brimbale, n. f.
—Perche en bascule pour tirer l'eau du puits.
—Crémaillère.
Brimbalement, n. m.—Bruit, désordre.
Brin, n. m.
—Peu, petite quantité. Ex. Tu n'en auras pas un brin.
—Grain. Ex. Un brin de pluie.
—Bran. Ex. Du brin de scie.
Brindezingues, n. f. pl.
Pris de boisson. Ex. En voilà encore un qui est dans les brindezingues.
* Brinn'che, n. f.
Bien-aimée, préférée. Ex. Celle-là est ma brinn'che.
Bringue, n. f.
—Fille nonchalante. Ex. C'est une grande bringue.
—Pièces. Ex. Mettre un objet en bringues.
Bringuer.—S'amuser, courir, gambader.
* Briquade, n. f. (Angl.)—Briqueterie.
* Briquaille, n. f. (Angl.)—Briqueterie.
Brique, n. f.
—Morceau taillé en carré. Ex. Une brique de lard, de la brique à couteaux.
—Brique réfractaire, brique à feu. (Angl.)
—Aller à la brique, aller travailler dans les briqueteries. (Angl.)
Briqueler, v. a.—Briqueter.
* Briqueleur, n. m. (Angl.)
Briqueteur, ouvrier et marchand.
* Briquer, v. a. (Angl.)
Briqueter, paver, garnir de briques.
Briquerie, n. f.
Briqueterie. Briquerie se disait autrefois pour exprimer la même chose.
Brisable, adj.—Fragile.
Brise, n. f.
Partir tout d'une brise, partir à la course.
Brise-fer, n. m.
—Qui brise tout ce qu'il touche.
—Qui use beaucoup, usurier. Ex. Cet enfant ne peut rien conserver, c'est un brise-fer.
Brisse, n. f.—Brisque. Ex. Jouer à la brisse.
Broc, n. m.—Fourche en fer à quatre cornes.
Broche, n. f.
—Aiguille. Ex. Apporte-moi mes broches pour que j'achève de tricoter mes bas.
—Bois pour enfiler le poisson que l'on prend à la ligne.
—Fil de fer. Ex. Clôture en broche.
—Epingle. Ex. Broche à cheveux.
—Jeu de broches, cinq aiguilles.
Broche (faire de la), loc.—Faire l'amour.
Broche (travailler à la), loc.—Exécuter à la hâte.
Brocher, v. n.—Faire l'amour.
Brochet, n. m.
Bréchet. Ex. Il n'a pas épais de lard sur le brochet. Le bréchet est la partie saillante en avant du sternum des oiseaux.
Brochetée, n. f.
—Brochette. Ex. J'ai pris une belle brochetée de poissons.
—Fourchée, la quantité de foin ou de paille que l'on enlève avec un broc. Ex. Prends la fourche et envoie-moi une brochetée de foin.
—Grande quantité.
Brodure, n. f.—Broderie.
* Brôker, n. m., brôkeur, (m. a.)—Courtier.
Bronches, n. f. pl.
Bronchite. Ex. Es-tu encore malade, moi j'ai les bronches.
Bronchique, adj.
Atteint de bronchite. Ex. Pierre est malade, je crois qu'il est bronchique.
Bronze, n. m.
Bronche. Ex. Louis a une maladie de bronze.
Broque, n. m.—Tire-fiente, fourche à fumier.
Brosse, n. f.
—Fête. Ex. Notre ami vient de sortir d'une brosse qui s'appelle.
—Prendre une brosse, faire la fête.
Brosser, v. a.
—Fêter. Ex. Cesse donc de brosser.
—Brosser le chien, faire la fête.
—Battre.
Brosser (se), v. pron.
—Se battre.
—Se brosser le ventre, se passer de tout.
Brosseur, n. m.
Celui qui fait souvent des brosses, qui boit à intervalles assez réguliers beaucoup de liqueurs enivrantes, et qui recommence au moment où on le croirait corrigé de sa manie, un dipsomane enfin.
Brou, n. f.
—Ecume, mousse. Ex. P'tit Pierre vient de tomber de son mal, il a la brou à la bouche.
—Bave à la gueule des animaux.
—Savonnure. Ex. Voilà du savon qui fait une belle brou.
Brouasser, v. n.—Bruiner.
Brouch'ter, v. a.—Travailler à la hâte et sans précaution.
Brouch'teux, euse, n. et adj.—Qui brouch'te.
Brouch'te-brouch'te, adv.
Ex. Cet ouvrier travaille brouch'te-brouch'te, c'est-à-dire, il travaille sans soin et hâtivement.
Brouillasser.—Bruiner.
Brouille, n. m.
Brouille, n. f. Ex. Il va y avoir du brouille dans cette discussion.
Brouillon, adj.
Fougueux. Ex. J'ai un cheval qui est pas mal brouillon.
Brousse-poil (à), loc.
A rebrousse-poil. Ex. Ce gas-là n'est pas facile à mener, il faut toujours le prendre à brousse-poil.
Brouscailler, v. a.—Brusquer.
Brûlade, n. f.—Brûlement, action de brûler.
Brûlé, n. m.
Forêt, ou bois ou région rasée par le feu. Ex. La paroisse du Grand-Brûlé.
Brûle-gueule, n. m.—Pipe à tuyau très court.
Brûler, v. a.
—Dépasser. Ex. Il m'a brûlé le long de la route.
—S'approcher d'un objet caché que l'on cherche. Ex. Tu brûles, c'est-à-dire tu t'approches. (Terme de jeu.)
Brûlette, n. f.
Ciboulette, ail civette.
* Brûleur, n. m. (Angl.)—Bec-de-lampe.
Brûlot, n. m.
Espèce de cousin qui brûle la peau en la touchant de son dard. Genre simule.
Brûlure, n. f.
Ex. Ce mets est excellent pour la brûlure, c'est-à-dire qu'il est absolument bon.
Brumasser, v. n.—Bruiner.
Brun, adj. et n. f.
—Bai brun. Ex. Un cheval brun.
—Brune. Ex. Se promener à la brun.
Brunante (à la), loc.
A la brune. Cette expression n'est pas française, mais pourrait l'être sans inconvénient. Faucher de St-Maurice en a fait le titre d'un de ses ouvrages.
Brusquailler, v. a.—Brusquer.
Brusse, adj.—Brusque.
Bubule, n. m.—Feu. (Langage enfantin.)
Bubusse, n. m.
Lait donné aux petits enfants. Ex. Prends ton bubusse, mon petit.
Buc en blanc (de), loc.—De but en blanc.
Bûchage, n. m.
—Débitage du bois en bûches.
—Coupe du bois, abattis.
Bûche, n. f.
Stupide. Ex. C'est une bûche, il ne comprend rien, il a la tête dure.
Bûcher, v. a.
Travailler fort. Ex. L'ouvrage est ardu, mais je vais bûcher assez fort que j'en viendrai bien à bout.
Bûcheux, n. et adj.
—Bûcheur, travailleur.
—Bûcheron.
* Buck=board, n. m., beuke bôrde, (m. a.)—Barouche.
* Buckwheat, n. m., beukouit, (m. a.)—Sarrasin, blé noir.
* Buggy, n. m., beugghé, (m. a.)—Phaéton.
* Bugle, bioug'l, (m. a.)—Cor de chasse.
* Bull's eye, n. f., (m. a.)—V. Boulezaille.
* Bully, boullé, (m. a.)—Fier-â-bras. Ex. Un bully d'élection.
* Bun, n. f., bonne, (m. a.)—Brioche.
Bureau, n. m.
—Commode.
—Etablissement public. Ex. Bureau de santé, bureau d'hygiène.
* Business, biznesse, (m. a.)
Rond en affaires. Ex. J'aime à faire des affaires avec ce marchand, il est business.
* Bus, beuce (m. a.)
Abréviation de omnibus, voiture publique qui transporte les voyageurs hors de la ville, et s'arrête en route au gré de chacun.
* Bustle, n. m. beussl, (m. a.)
Tournure. Ex. Madame a mis son bustle.
* Busy body, bizzé bodé, (m. a.)
Officieux. Ex. Ce n'est qu'un busy body.
Buteux, euse, adj.—Qui bute. Ex. Un cheval buteux.
Butin, n. m.
—Marchandises.
—Mobilier. Ex. Quand je déménagerai, je ne négligerai rien de mon butin.
—Linge et vêtements. Ex. Emporte tout le butin que tu as à te mettre sur le dos.
—Bonne personne. Ex. Cette fille-là, c'est du butin.
Butte (une), n. f.
Beaucoup, en quantité. Ex. Y avait-il beaucoup de monde à l'assemblée? Oui, il y en avait une butte.
* Buttercup, beutteurkeupe (m. a.)—Bouton d'or.
Butteux, euse, adj.
Couvert de buttes. Ex. Le chemin est devenu butteux depuis les dernières gelées.
Button, n. m.
Petite colline. Ex. La paroisse du Button.
Buvable, adj.
Potable. Ex. Cette eau-là n'est pas buvable.
Buvasser, v. n.—Boire sans cesse.
Buvasserie, n. f.—Action de boire outre mesure.
Buvasseux, adj.—Qui est dans l'habitude de boire.
Buveron, n. m.
—Biberon. Ex. Cet enfant de deux ans est encore au buveron.
—Ivrogne. Ex. Çà, c'est un bon buveron.