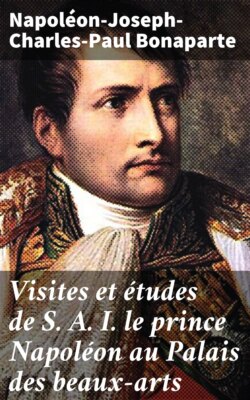Читать книгу Visites et études de S. A. I. le prince Napoléon au Palais des beaux-arts - Napoléon-Joseph-Charles-Paul Bonaparte - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
INTRODUCTION.
ОглавлениеTable des matières
L’Exposition universelle de 1855 est un des grands évènements de notre époque. Conçue au milieu des complications de la question d’Orient, préparée au milieu des préoccupations de la guerre, c’est au bruit du canon que s’est accomplie cette solennité consacrée aux arts, à l’industrie, à la civilisation. On chercherait en vain dans l’histoire des peuples l’exemple d’un pareil concours d’évènements.
Cette grande pensée de la France, qui tend à rapprocher toutes les nations du monde en rapprochant les œuvres de leurs mains, tous les gouvernements l’ont comprise et accueillie avec enthousiasme; tous, dès les premiers jours, se sont préparés avec ardeur à la lutte industrielle et artistique de 1855. En Angleterre, sous l’influence des nombreux comités organisés, l’industrie privée a fait des prodiges d’activité pour rivaliser avec nos produits les plus renommés; les meetings se sont multipliés, et, d’un bout à l’autre de la Grande-Bretagne, l’Exposition de Paris a été le but constant de tous les efforts et de tous les vœux.
En Autriche, en Prusse et dans tous les Etats de l’Allemagne, malgré les agitations de la guerre, et en dehors même de l’action du gouvernement, les industriels et les artistes ont redoublé de zèle pour prendre part à cette lutte pacifique.
Les Expositions de Munich, de Cologne, de Bruxelles, peuvent être considérées comme des essais préparatoires pour la grande Exposition de Paris. En Allemagne, en Espagne, en Italie, les Expositions nationales ont été avancées d’un an. Aucun Etat de l’Europe, enfin, à l’exception de la Russie, n’a fait défaut à la courtoisie de l’appel que leur avait adressé le gouvernement de l’Empereur,
Les produits de tous les pays du monde, depuis l’Angleterre avec ses nombreuses colonies, Malte, l’Ionie, le Cap, l’Afrique de l’Ouest, l’Inde, Maurice, les Antilles, la Guyane, l’Australie, jusqu’aux États lointains de Venezuela, de l’Uruguay, du Chili, de la Bolivie, de la république Dominicaine, jusqu’à la Chine elle-même, sont arrivés en masse dans notre Palais de l’Industrie.
L’Exposition de 1855, ainsi que l’a dit S. A. I. le Prince Napoléon, illustrera la France et l’Europe du XIXe siècle. Elle sera une date fondamentale dans l’histoire de notre époque.
Au point de vue de l’industrie, elle a eu l’avantage de consacrer définitivement l’expérience qui avait eu lieu en Angleterre en 1851, et, en présence de tant de nouveaux produits, elle a permis de juger des progrès faits dans des temps si difficiles par les premières nations du monde.
Au point de vue de l’art, elle a eu une importance non moins grande, car, pour la première fois, une Exposition universelle de l’Industrie s’est trouvée réunie à une Exposition des Beaux-Arts.
L’art, qui, à Londres, se rangeait sous la bannière de l’Industrie, avait à Paris sa bannière à lui. C’est là le côté caractéristique de notre Exposition.
De ces grandes assises de la science, de l’industrie et des arts, de cette grande expérience faite en face du monde entier convié à y prendre part, il doit résulter incessamment de hauts enseignements et des progrès inespérés dans toutes les branches de l’industrie, dans toutes les parties de la science et des arts.
De ces visites de peuple à peuple, de toutes ces facilités de communication, de cet échange d’idées, il doit naître une tendance suprême, irrésistible, qui rendra désormais solidaires les unes des autres les destinées des nations civilisées.
La grande solennité de l’Exposition est une conséquence de nos anciennes Expositions: dans la loi du progrès, de nationales elles sont devenues universelles.
Les Expositions des Beaux-Arts ont précédé de cent trente ans celles de l’Industrie.
C’est au règne de Louis XIV que remontent ces sortes de solennités, appelées à exercer une influence si décisive sur l’avenir des peuples.
Il y eut dix Expositions pendant le long règne de ce souverain. L’Académie, d’après un désir du roi, avait décidé, le 24 décembre 1663, qu’il y aurait tous les ans, le premier samedi de juillet, Exposition dans les salles de ses séances. Telles furent les premières exhibitions publiques qui précédèrent celles des salons du Louvre, La décision de l’Académie ne fut exécutée qu’en 1667, d’après une lettre de Colbert, du 9 janvier 1666, qui régla que ces fêtes de l’art n’auraient lieu que bisannuellement et pendant la semaine-sainte.
Une analyse de ces Expositions, même succincte, mais d’une exactitude rigoureuse, présente un grand intérêt.
EXPOSITIONS DES BEAUX-ARTS.
La première fut ouverte en 1667, sur l’invitation du ministre, et pour célébrer la fondation de l’Académie; elle dura quinze jours, du 9 au 22 avril. Colbert l’honora de sa visite.
La deuxième, tenue du 28 mars au 20 avril 1669, dans la galerie du Palais-Royal et dans la cour du palais Brion ou hôtel Richelieu, fut également visitée par Colbert.
La troisième fut établie aux mêmes lieux, le 20 avril 1671.
La quatrième, du 14 août au 4 septembre 1673, avait été retardée de quelques mois, afin de coïncider avec la fête du roi; elle fut honorée, le 25 août, de la présence du premier ministre.
La cinquième fut inaugurée le 14 août 1675.
Pas d’exposition en 1677 et 1679, à cause des dépenses qu’elles occasionnaient à l’Académie.
La sixième fut ouverte le 14 août 1681; on eut beaucoup de peine à réunir un nombre d’ouvrages suffisant, Lemoyne fut nommé décorateur de l’Exposition.
La septième, retardée par la mort de la Reine, n’eut lieu qu’au mois de septembre 1683.
La huitième, du 20 août au 16 septembre 1699, eut lieu pour la première fois dans la grande galerie du Louvre. — Première mention d’un livret publié par Perrault. Il est cependant certain qu’il en parut un en 1673, ainsi que l’atteste la publication de M. Anatole de Montaiglon; qui a reproduit avec une scrupuleuse exactitude, et d’après le seul exemplaire que l’on connût avant que deux autres fussent retrouvés dans les portefeuilles de la Bibliothèque impériale, la brochure ayant pour titre: Le Livret de l’Exposition faite en 1673, dans la cour du Palais-Royal.
La neuvième, du 12 septembre au 8 novembre 1704, dans la grande galerie du Louvre.
La dixième eut lieu le 25 août 1706, à l’occasion de la fête du roi, pour offrir aux regards du public les morceaux de réception et les objets d’art appartenant à l’Académie; elle ne dura qu’un jour.
Le règne de Louis XV est marqué par vingt-six expositions, de 1725 à 1773.
La onzième, du 25 août au 2 septembre 1725, dans le salon carré, entre la galerie d’Apollon et la grande galerie du Louvre.
La douzième, dans la galerie d’Apollon, du 30 mai au 30 juin 1727, produit du concours ouvert entre les principaux officiers de l’Académie. Le duc d’Antin demande l’avis motivé des académiciens non-exposants sur le mérite des compositions exposées.
La treizième, ouverte le 18 août 1737, dans 16 salon carré du Louvre. Stiémart décorateur: 286 sujets; 69 exposants: 49 peintres, 10 sculpteurs, 8 graveurs en taille-douce, 2 graveurs en médailles. Il y eut un livret,
La quatorzième, le 18 août 1738, toujours dans le salon carré, fut peu nombreuse.
La quinzième, du 6 au 30 septembre 1739, dans le salon carré. Stiémart décorateur; Reydelet chargé du livret. 40 exposants; 119 ouvrages: 82 peintures, 14 sculptures, 12 gravures, 5 miniatures, 6 paysages, La seizième se tient du 18 août au 1er septembre 1740.
La dix-septième, du 1er au 10 septembre 1741. Portail remplace comme décorateur Stiémart, décédé le 19 août de la même année.
La dix-huitième, du 1er au 31 août 1742. Livret par Reydelet; Portail décorateur. 75 exposants; 186 sujets: 123 peintures, 19 sculptures, 40 gravures en taille-douce, 4 paysages.
La dix-neuvième reste ouverte du 5 au 26 août 1743.
La vingtième, tenue du 20 août au 23 septembre 1745. 53 exposants; 214 ouvrages: 140 peintures, 19 sculptures, 40 gravures, 15 paysages. Portail décorateur; livret par Reydelet.
La vingt et unième, ouverte le 25 août, jour de la Saint-Louis, fête du roi, finit le 25 septembre 1746. Origine du Jury. Commission prise dans le sein de l’Académie pour examiner les ouvrages.
La vingt-deuxième, ouverte le 25 août 1748. Reydelet et Portail chargés du livret et des décorations. 60 exposants; 146 sujets: 121 tableaux, 8 sculptures, 14 gravures. A cette exposition se remarquaient 11 tableaux exécutés sous les ordres du roi, qui en commanda dix autres après la clôture.
La vingt-troisième, ouverte le 25 août 1748, dans le salon carré du Louvre et une partie de la galerie d’Apollon. Portail décorateur; livret par Reydelet. 48 exposants dans le grand salon; 158 sujets exposés: 110 peintures, 17 sculptures, 31 gravures; 7 tableaux du peintre Troy figuraient dans la galerie d’Apollon. Pigalle avait exposé dans son atelier, cour du vieux Louvre, trois statues en marbre.
La vingt-quatrième, dans le salon carré du Louvre, du 25 août au 25 septembre 1750. Portail décorateur.
La vingt-cinquième, le 25 août 1751. Portail décorateur; Reydelet rédige le livret. 47 exposants, 158 compositions: 130 tableaux, 14 sculptures, 14 gravures.
La vingt-sixième, ouverte le 25 août 1753.
La vingt-septième, le 25 août 1755..
La vingt-huitième commence le 25 août 1757. 57 exposants; 225 sujets: 148 tableaux, 23 sculptures, 41 gravures. Reydelet rédacteur du livret; Portail décorateur.
La vingt-neuvième, le 25 août 1759. Portail, étant mort le 4 novembre de la même année, a pour successeur Chardin.
La trentième, 25 août 1761. Reydelet. chargé du livret; Chardin décorateur. 53 exposants: 33 peintres, 9 sculpteurs, 11 graveurs; 228 ouvrages: 167 peintures, 40 sculptures, 28 gravures.
La trente et unième, le 15 août 1763. 57 exposants: 38 peintres, 9 sculpteurs, 9 graveurs, 1 tapissier; 300 ouvrages: 250 peintures, 30 sculptures, 19 gravures, et une tapisserie des Gobelins représentant le portrait du roi, d’après Louis-Michel Vanloo.
La trente-deuxième, le 25 août 1765. Un livret. 70 exposants: 42 peintres, 15 graveurs, 11 sculpteurs, 2 tapissiers; 432 sujets: 316 tableaux, 46 sculptures, 68 gravures, 2 tapisseries.
La trente-troisième, le 25 août 1767. Livret. 64 exposants: 45 peintres, 8 sculpteurs, 11 graveurs; 485 compositions: 347 peintures, 40 sculptures, 38 gravures.
La trente quatrième, le 25 août 1769, 68 exposants: 44 peintres, 10 sculpteurs, 12 graveurs, 2 tapissiers; 425 sujets: 293 peintures, 40 sculptures, 73 gravures, 2 tapisseries. Livret.
La trente-cinquième, 25 août 1771. Livret. 70 exposants: 43 peintres, 12 sculpteurs, 12 graveurs; 532 ouvrages: 359 peintures, 79 sculptures, 14 gravures. Hors du Louvre: 10 tableaux de bataille avaient été exposés à Versailles, dans les salons du ministère de la guerre.
La trente-sixième, le 25 août 1773. Livret. 60 exposants: 38 peintres, 12 sculpteurs, 10 graveurs; 479 sujets: 331 peintures, 65 sculptures, 80 gravures, 3 tapisseries.
Durant le règne de Louis XVI se succèdent sans interruption, de 1775 à 1791, neuf expositions bisannuelles.
La trente septième a lieu, suivant l’usage consacré par les deux précédents règnes, le jour de la Saint-Louis, et s’ouvre, en conséquence, le 25 août 1775 pour n’être close que le 25 septembre suivant. Vien avait consenti à se charger de l’arrangement du local, sans qu’aucun honoraire fût attribué à cette tâche. Il parut un livret.
La trente-huitième, le 25 août 1777. Invitation est faite à la Commission d’examen d’apporter toute la sévérité nécessaire dans l’admission des œuvres. Lagrénée aîné pourvoit avec Renou, secrétaire de l’Académie, à la décoration de l’Exposition.
La trente-neuvième, du 25 août au 3 octobre 1779. 71 exposants: 47 peintres, 12 sculpteurs, 12 graveurs; 428 ouvrages: 290 tableaux, 80 sculptures, 58 gravures. Renou se charge de la rédaction du livret.
La quarantième, le 25 août 1781. 71 exposants: 49 peintres, 12 sculpteurs, 11 graveurs; 534 compositions: 348 peintures, 66 sculptures, 122 gravures; Livret par Renou.
La quarante et unième, le 25 août 1783. 63 exposants: 38 peintres, 12 sculpteurs, 12 graveurs et 3 tapissiers; 436 ouvrages: 304 peintures, 64 sculptures, 68 gravures et 3 tapisseries. Renou reçoit 600 livres pour la rédaction du livret. La décoration du salon est confiée à Amédée Vanloo.
L’année suivante; 1784, exposition spéciale du concours ouvert pour les sculpteurs, à l’occasion de la découverte du système aérostatique.
La quarante-deuxième, le 25 août 1785. 72 exposants: 44 peintres, 18 sculpteurs, 10 graveurs; 504 sujets: 292 tableaux, 98 sculptures, 114 gravures. Au milieu de la période affectée à l’Exposition, on songe pour la première fois à changer de place les principaux tableaux, afin de mettre dans le meilleur jour celles de ces œuvres qui avaient été jusque-là moins bien partagées.
La quarante-troisième, le 25 août 1787. Livret par Renou. 76 exposants: 46 peintres, 18 sculpteurs, 12 graveurs; 402 ouvrages: 291 peintures, 69 sculptures, 42 gravures.
La quarante-quatrième, le 25 août 1789, 89 exposants: 55 peintres, 25 sculpteurs, 9 graveurs; 453 envois: 293 peintures, 116 sculptures, 44 gravures. Livret.
La quarante-cinquième, le 25 août 1791. 71 admis: 44 peintres, 21 sculpteurs, 6 graveurs; 426. sujets: 274 peintures, 113 sculptures, 30 gravures. Commission d’examen pour la réception des ouvrages, formée de six officiers de l’Académie et d’autant d’académiciens tirés au sort. Livret par Renou.
Durandeau décorateur.
Neuf expositions annuelles signalèrent, de 1793 à 1802, le passage de la République, du Directoire et du Consulat.
La quarante-sixième, tenue en 1793.
La quarante-septième, en 1795.
La quarante-huitième, en 1796.
La quarante-neuvième, en 1797.
La cinquantième, en 1798.
La cinquante et unième, en 1799.
La cinquante-deuxième, ouverte en 1800. Les arts commencent à renaître. 54 exposants; 275 ouvrages.
La cinquante-troisième; en 1801, 268 admis; 485 envois. Les privilèges académiques avaient disparu.
La cinquante-quatrième, en 1802. 291 exposants; 557 ouvrages.
Sous le premier Empire, de 1804 à 1814, cinq expositions bisannuelles ont eu lieu.
La cinquante-cinquième, en 1804. L’impulsion était donnée, comme le prouvent les chiffres qui vont suivre: 315 exposants, 701 ouvrages.
La cinquante-sixième, en 1806. 360 admis; 699 envois.
La cinquante-septième, en 1808. 411 exposants, 802 compositions.
La cinquante-huitième, en 1810. Le développement artistique est de plus en plus manifeste. 531 exposants répondent à l’appel, et 1,171 ouvrages sont acceptés.
La cinquante neuvième, en 1812. 557 exposants: 1,239 sujets.
Pendant le règne de Louis XVIII, cinq expositions furent ouvertes de 1814 à 1824.
La soixantième, en 1814. 507 admis; 1,359 ouvrages.
La soixante-unième, en 1817. 458 exposants, 1,064 envois.
La soixante-deuxième, en 1819. 620 exposants; 1,702 compositions.
La soixante-troisième, en 1822. Le mouvement se maintient: 585 admis; 1,802 envois,
La soixante-quatrième, en 1824, 779 exposants; 2,371 sujets.
Charles X ne vit s’accomplir sous son règne qu’une seule exposition.
La soixante-cinquième, en 1827, 732 exposants; 1,834 ouvrages.
Toutes les années du règne de Louis-Philippe, moins 1832, époque de l’invasion du premier choléra en France, ont été marquées par une exposition des Beaux-Arts.
La soixante-sixième, en 1831. Cette exposition dépasse de beaucoup toutes les précédentes sous le rapport du nombre des artistes et de la quantité de leurs productions, car elle ne compte pas moins de 1,180 admis, avec 3,211 ouvrages.
La soixante-septième, en 1833. 1,190 exposants; 3,318 envois.
La soixante-huitième, en 1834. 1,079 exposants; 2,314 ouvrages.
La soixante-neuvième, en 1835. 1,231 admis;2,536 compositions.
La soixante et dixième, en 1836. 1,078 exposants; 2,122 envois.
La soixante et onzième, en 1837. 1,065 exposants; 2,130 ouvrages.
La soixante-douzième, en 1838.1,023 admis; 2,310 sujets.
La soixante treizième, en 1839. 1,249 exposants; 2,465 productions.
La soixanie-quatorzième, en 1840. 1,010 exposants; 1,849 ouvrages.
Là soixante-quinzième, en 1841.1,211 admis; 2,280 compositions.
La soixante-seizième, en 1842. 1,158 exposants; 2,121 ouvrages.
La soixante-dix-septième, en 1843. 999 exposants; 1,597 compositions.
La soixante-dix-huitième, en 1844.1,327 exposants; 2,423 œuvres.
La soixante-dix-neuvième, en 1845. 1,272 admis; 2,332 sujets.
La quatre-vingtième, en 1846, offre le curieux incident de 1,251 artistes reçus, sur 4,357 qui se présentaient; 2,412 ouvrages furent exposés.
Ainsi, de la dernière année du XVIIIe siècle à 1846, c’est-à-dire dans un intervalle de quarante-sept ans, 29 expositions ont été ouvertes à Paris, et on y a vu figurer 49,205 ouvrages appartenant aux diverses branches des beaux-arts. Durant ce même intervalle, dix années ont été privées de solennités de ce genre: parmi ces années figurent celles de la double invasion de la France en 1815, de là révolution de Juillet en 1830, et du choléra en 1832.
La République de 1848 a eu quatre expositions.
La quatre-vingt et unième, en 1848, au Louvre comme les précédentes. Suppression absolue du jury; liberté illimitée de l’art et de ses produits; admission de tous les ouvrages présentés, au nombre de 5,180, dont: 4,598 peintures, 335 sculptures, 38 projets d’architecture, 136 gravures, 73 lithographies.
La quatre-vingt-deuxième, en 1849, au palais des Tuileries. 2,586 ouvrages, dont: 2,093 peintures; 254 sculptures, 108 projets d’architecture, 64 gravures, 47 lithographies.
La quatre-vingt-troisième, des derniers jours de 1850 aux premiers mois de 1851, dans les appartements et la cour du Palais-Royal. 3,923 compositions: 3,150 peintures, 466 sculptures, 100 projets d’architecture, 128 gravures, 79 lithographies.
La quatre-vingt-quatrième, du 1er avril au 1er juillet 1852, au même lieu que la précédente. 1,087 exposants; 1,757 ouvrages reçus: 1,280 peintures, 270 sculptures, 88 gravures, 52 lithographies, 67 projets d’architecture. Les travaux de la statuaire mêlés à ceux de la peinture.
Depuis l’avènement du second empire, Paris compte une Exposition des Beaux-Arts.
La quatre-vingt-cinquième, en 1853, dans les bâtiments et dépendances de l’ancien hôtel des Menus-Plaisirs. 1,708 sujets se classant de la manière suivante: 1,208 peintures, 321 sculptures, 102 gravures, 60 lithographies, 75 projets d’architecture, 2 plans en relief, l’un du Louvre achevé, l’autre des Halles centrales.
La distribution des récompenses, à la suite de cette solennité, eut lieu dans le grand salon carré du Louvre, en présence de S. A. I. le Prince Napoléon.
Le Moniteur en rendit compte en ces termes:
«La distribution des récompenses accordées aux artistes qui se sont distingués à l’Exposition de 1853 a eu lieu aujourd’hui dans le grand salon carré du Louvre. A droite de l’estrade étaient placés MM. les membres du jury; à gauche, MM. les membres de l’Académie des Beaux-Arts. Un nombreux public, composé en grande partie de jeunes artistes et de leurs familles, remplissait le reste du salon.
«A trois heures précises, S. A. I. le Prince Napoléon, accompagné de M. Achille Fould, ministre d’Etat et de la Maison de l’Empereur, et suivi des officiers de sa maison, a été reçu au pied du grand escalier par M. le comte de Nieuwerkerke, directeur général des Musées impériaux, et par MM. les secrétaires généraux du Ministère de la Maison de l’Empereur et du Ministère d’Etat.
«Le Prince a pris place au fauteuil, ayant à sa droite M. le Ministre d’Etat, à sa gauche M. le comte de Nieuwerkerke, et a prononcé l’allocution suivante:
«Messieurs,
«Nulle mission ne pouvait m’être plus agréable que celle qui m’est confiée aujourd’hui par l’Empereur. Je suis fier et heureux de venir en son nom encourager les efforts et récompenser le mérite des artistes qui ont paru avec le plus d’éclat à l’Exposition de cette année.
«Dans notre pays d’égalité, où le partage des fortunes tend à niveler les conditions en Universalisant le bien-être, l’Etat doit se substituer aux particuliers, afin d’accomplir ce qu’ils ne pourraient tenter par eux-mêmes. De là les encouragements nombreux que le Gouvernement accorde et les dépenses qu’il fait pour maintenir l’art en France au degré d’éclat et de grandeur où il est parvenu.
«Aucun des régimes précédents n’y a manqué, rendons-leur cette justice; mais qu’il me soit permis de dire avec le même sentiment d’équité, que jamais un champ plus vaste ne fut ouvert aux arts que par l’Empereur actuel. En faut-il d’autres preuves que l’impulsion générale donnée à tous les travaux d’embellissement de la capitale, et surtout l’achèvement du Louvre?
«C’est une grande et féconde pensée, Messieurs, que d’avoir rattaché l’inauguration du nouveau Louvre qui s’élève, à l’ouverture de l’Exposition décrétée pour 1855, Exposition universelle où viendront s’étaler, auprès des produits de l’industrie du monde, entier, les œuvres d’art de quelques peuples privilégiés, parmi lesquels la France tient le premier rang. Mieux qu’aucun autre, elle a su jusqu’à ce jour, par le goût, qui est une des puissances de l’art, ennoblir le domaine de l’industrie, et nous avons le droit d’espérer, en présence des travaux que nous venons couronner aujourd’hui, qu’en 1855 notre belle et chère patrie se montrera digne d’elle-même.»
«Après ce discours, suivi d’applaudissements chaleureux, M. le Ministre s’est exprimé ainsi
«Messieurs,
«L’Empereur, en me chargeant de vous remettre les récompenses décernées par le jury, m’a confié une mission qui m’est bien douce. Je suis heureux de me trouver entouré de l’élite de nos artistes et de pouvoir lés féliciter de leur légitime succès. Déjà l’affluence extraordinaire attirée par l’Exposition vous a montré combien le pays s’intéresse à vos travaux. En France, la prospérité des arts est un bonheur public; leur décadence semblerait un pas rétrograde dans la marche de la civilisation.
«A de rares intervalles, quelques hommes semblent choisis par la Providence pour présider à ces époques de rénovation où se manifestent à la fois toutes les productions du génie. Dans les arts on citera toujours les siècles de Périclès et de Léon X; dans les lettres, le siècle d’Auguste et celui de Louis XIV. L’honneur d’attacher son nom à ces époques signalées par les plus beaux développements de l’intelligence est sans doute le plus grand que puisse ambitionner un souverain. Si, pour l’obtenir, il suffisait d’assurer aux études libérales le calme sans lequel elles ne peuvent subister, de faire régner fa paix au-dedans par de sages institutions, au dehors par une politique habile et ferme, j’oserais prédire de quel nom notre époque s’appellera dans l’histoire. Mais, Messieurs, vous le savez, ni la protection éclairée d’un prince, ni sa munificence ne peuvent créer des chefs-d’œuvre. Pour les produire, il faut l’amour de l’art, une foi vive, des convictions fermes, l’étude constante du beau, l’inspiration, enfin, qui suit les méditations profondes.
«Le succès de l’Exposition de 1853 m’autoriserait à ne vous adresser que des éloges; je vous estime trop, j’ai trop confiance en vous pour ne pas mêler quelques conseils aux louanges qui vous sont dues.
«Je crois être l’interprète des critiques les plus judicieux en remarquant que les productions de cette année dénotent des progrès sensibles dans la partie technique de l’art, dans l’imitation matérielle. Tout en applaudissant à ce résultat, tout en rendant justice à des œuvres remarquables, on peut regretter de ne pas voir nos jeunes artistes poursuivre le beau idéal avec la même ardeur qu’ils apportent à l’étude de la réalité. On souhaiterait qu’à l’exemple des anciens maîtres, ils cherchassent à concilier l’idéal et la réalité, en unissant la contemplation du type éternel du beau à l’étude intelligente des formes et des scènes que le spectacle de la nature offre à nos yeux.
«Les œuvres des maîtres, Messieurs, vous prouvent qu’il n’y a point de but si élevé où leur génie n’ait atteint. Imitez leur généreuse audace. Vous avez, vous aussi, le droit d’être ambitieux; et croyez que le talent grandit toujours dans une noble lutte, quelle qu’en soit l’issue, tandis qu’il s’énerve et s’épuise bientôt à cher. cher de faciles triomphes.
«Aujourd’hui, dans un siècle comme le nôtre, sous un Prince qui s’applique à écouter l’opinion, cette voix du peuple et de Dieu, le talent n’a pas à craindre de demeurer méconnu. Ma constante sollicitude sera de le rechercher, en m’entourant, de toutes les lumières pour le découvrir; car, ce que je regarde comme la plus noble de mes attributions, c’est de lui offrir l’occasion de nouveaux succès en lui demandant de nouveaux efforts. Mais, en même temps, un devoir sérieux m’est imposé, et je saurai le remplir.
«Dans les temps malheureux que nous venons de traverser, mes prédécesseurs ont dû employer toutes les. ressources mises à leur disposition pour ne pas interrompre des travaux qui reçoivent d’ordinaire leur encouragement des fortunes privées. Dans la détresse publique, le Gouvernement devait se préoccuper vivement du sort des artistes: la prospérité revenue; il n’y a plus à songer qu’aux intérêts de l’art. Désormais, l’administration ne disséminera plus ses encouragements: elle assurera aux talents qui se révèlent les moyens de se perfectionner; elle offrira de grands travaux aux talents mûris par l’expérience. De tous côtés, sur l’ordre de l’Empereur, s’élèvent d’immenses constructions; des édifices longtemps négligés vont reprendre leur splendeur première; tous nos monuments demandent à la peinture, à la sculpture leur plus noble, décoration. L’intention du Gouvernement est que ces travaux se distinguent par l’unité de pensée et d’exécution, qui, trop souvent, a fait défaut dans des entreprises semblables. C’est vous dire, Messieurs, qu’il n’en confiera la direction qu’à des hommes éprouvés par le succès et désignés par l’opinion. Mais à côté des chefs d’école, plus d’une place honorable est réservée au talent modeste qui sait attendre, sous la conduite d’un guide sûr, le moment de s’élancer au premier rang. «Maniez la rame avant le gouvernail,» c’est un précepte qui, aujourd’hui plus que jamais peut-être, mérite d’être remis en honneur.
«L’Exposition de 1853 est terminée. Elle laisse d’honorables souvenirs, elle fait concevoir de grandes espérances. Dans deux ans, vous vous représenterez à une épreuve encore plus solennelle. En 1855, les productions des artistes de toute l’Europe, du monde entier, seront exposées avec les vôtres. Les étrangers, dont plusieurs vont aujourd’hui partager vos couronnes, connaissent l’impartialité de leurs juges, la loyauté et la courtoisie de leurs rivaux; ils répondront, je l’espère, à notre appel. En France, le mérite, de quelque part qu’il vienne, a toujours sa place à nos fêtes nationales. Pour vous, Messieurs, vous vous souviendrez que vous avez la gloire du pays à soutenir, et je suis sûr que la grandeur et l’élévation du but, en stimulant votre ardeur, assureront votre succès.» (Applaudissements unanimes).
M. le Directeur des Musées impériaux a pris ensuite la parole en ces termes:
«Après les paroles que viennent de prononcer S. A. 1. le Prince Napoléon et Son Exc. le Ministre d’État et de la Maison de l’Empereur, il m’est réservé l’honneur de vous faire connaitre les noms de ceux d’entre vous qui ont mérité des récompenses à différents degrés.
«Quant à la liste des ouvrages distingués par le jury, elle contient heureusement les noms d’un si grand nombre d’artistes, que le Moniteur seul la fera connaître au public.
«Vous avez en cela, Messieurs, la preuve qu’au Salon de 1853, la moyenne des œuvres exposées est supérieure à celles des années précédentes.»
Les récompenses obtenues à la suite du Concours de 1854 se divisent ainsi: Peinture, 3 médailles de 1re classe, 6 médailles de 2e classe, 12 de 3e classe.
Sculpture: 2 médailles de 1re classe, 4 de 2e, 6 de 3e.
Architecture: 3 médailles de 2e classe et 3 de 3e (Il n’y a pas de 1re classe).
Gravure et Lithographie: une médaille d’honneur, une médaille de 1re classe, 2 de 2e, 4 de 3e.
En outre, deux nominations d’officier et dix de chevalier eurent lieu dans l’ordre impérial de la Légion-d’ Honneur.
L’idée des Expositions de l’Industrie est également née en France. La première a eu lieu en 1798, pendant que le général Bonaparte dirigeait l’expédition d’Égypte. De 1798 à 1855, tous les gouvernements qui se sont succédé ont plus ou moins favorisé cette institution nationale, qui doit exercer une influence si décisive sur les relations industrielles et politiques de toutes les nations.
Plus que tous les autres gouvernements, celui de l’empereur Napoléon Ier devait comprendre et féconder cette idée nationale. Après la paix de Lunéville, en 1801, un décret du Premier Consul portait qu’une Exposition des produits de l’industrie française aurait lieu au Louvre, dans le palais des rois. De 1801 à 1806, quatre expositions successives eurent lieu, et le chiffre des exposants, qui en 1798 était à peine de 110, s’élevait en 1806 à 1,122, chiffre énorme pour une époque où les grands appareils mécaniques étaient à peu près inconnus en France. Cette Exposition de 1806 avait tellement satisfait l’Empereur, qu’il fit dresser par le ministre de l’intérieur une statistique des forces industrielles de la France.
On sait avec quelle constante sollicitude l’Empereur, au milieu de ses grandes expéditions européennes, se préoccupait des progrès de l’industrie en France. Un fait significatif, entre tous, est celui-ci: lors de la création de l’ordre de la Légion-d’Honneur, l’Empereur accorda la première décoration, non pas à un général victorieux, ni à un ministre plénipotentiaire, ni à un grand fonctionnaire de l’État, mais à un savant laborieux et modeste, à Lacépède, continuateur de Buffon. Aussi l’Empire avait-il pénétré profondément dans les entrailles de la France. Le premier de tous les souverains, Napoléon, avait établi la véritable égalité devant la loi, devant le travail, devant le courage, devant la gloire; le premier, il avait dit au monde qu’on arrivait à tous les emplois, à toutes les charges, à toutes les dignités, par tous les services; que la charrue du laboureur, le fusil du grenadier, la méditation du magistrat, le compas du savant, le pinceau de l’artiste, la plume de l’écrivain, étaient, à ses yeux, des instruments propres à acquérir la considération et la supériorité sociale. A l’appui de cette maxime, il avait le premier, sur le vêtement du travail, attaché l’insigne de la Légion-d’Honneur: du fils de l’artisan et du fils du laboureur il avait fait des généraux, des maréchaux, et même des princes.
Sous la Restauration, trois Expositions eurent lieu; seulement le chiffre des exposants resta à peu près stationnaire, entre 1,600 et 1,700. De 1830 à 1848, trois expositions eurent également lieu, et à la dernière, celle de 1844, le nombre des exposants s’élevait à 3,960. L’Exposition de 1849 fut beaucoup plus importante: 4,500 exposants y prirent part, et ses produits furent très-remarquables; c’était un grand progrès au sortir d’une révolution.
EXPOSITIONS DE L’INDUSTRIE.
Première Exposition, tenue au Champ-de-Mars, sous le Directoire, à partir du 1er vendémiaire an VII (22 septembre 1798).
Deuxième, au Louvre, sous le Consulat, à la fin de septembre 1801, pendant les jours complémentaires de l’an IX.
Troisième, en 1802, sur l’esplanade des Invalides, fin de l’an x, également sous le Consulat.
Quatrième, en 1806, au même endroit que la précédente, fut la seule de l’Empire. Des annexes durent être établies dans une longue suite de constructions provisoires en bois, dans les bâtiments de l’administration des ponts-et-chaussées, au Petit-Bourbon et dans la cour du Louvre.
Cinquième, en 1819, sous Louis XVIII, dans les salles et galeries du premier étage du Louvre, ainsi que dans la cour du Palais.
Sixième, encore sous le règne de Louis XVIII, en 1823, et dans les mêmes lieux que l’Exposition de 1819.
Septième, sous le règne de Charles X, en 1827; on retourne à l’esplanade des Invalides.
Huitième, en 1834, sous Louis-Philippe, place Louis XV.
Neuvième, en 1839, au carré Marigny, dans les Champs-Élysées.
Dixième, en 1844, sur le même emplacement que la précédente.
Onzième, en 1849, sous la Présidence, et toujours au carré Marigny.
Le décret du 8 mars 1853, qui a institué l’Exposition universelle de Paris, fera époque dans nos annales. C’est l’application sur une grande échelle de l’idée éclose au commencement de ce siècle, c’est la glorification du principe qui domine notre temps: l’association de l’intelligence et du travail.