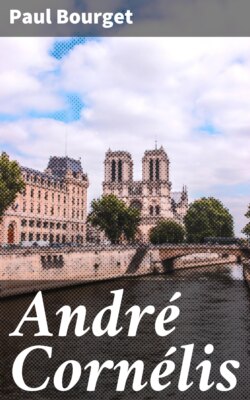Читать книгу André Cornélis - Paul Bourget - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V
ОглавлениеTable des matières
neffaçables? Oui, ces deux dates le sont demeurées, et elles seules... Lorsque je reviens en arrière, toujours et toujours je me heurte à elles. Mon père assassiné, ma mère remariée, ces deux idées ont si longtemps pesé sur mon cœur. Les autres enfants ont des âmes mobiles, souples et qui se prêtent à toutes les sensations. Ils se donnent en entier à la minute présente. Ils vont, ils viennent d'une gaieté à une peine, oubliant, chaque soir, ce qu'ils ont éprouvé le matin, nouveaux à tous les aspects du sentier tournant de leur vie... Et moi, non!... Mes deux souvenirs réapparaissaient sans cesse devant ma pensée. Une hallucination continue me montrait le profil du mort sur l'oreiller du lit au pied duquel pleurait ma mère,—ou bien j'entendais la voix de ma tante, m'annonçant l'autre nouvelle. Je revoyais son visage triste, ses yeux bruns, les rubans noirs de son bonnet qui tremblaient au vent de l'après-midi de septembre. Puis j'éprouvais, comme alors, l'impression de déchirure intime que j'avais ressentie par deux fois, combien cruelle, combien inguérissable! Aujourd'hui encore que je m'essaye à retrouver l'histoire de mon âme, de l'André Cornélis véritable et solitaire, je ne rencontre pas un souvenir qui ne disparaisse devant ces deux-là, pas une phase de ma jeunesse que ces deux faits premiers ne dominent, qu'ils n'expliquent, qu'ils ne contiennent en eux, comme le nuage contient la foudre, et l'incendie, et la ruine des maisons frappées de cette foudre. Par delà toutes les images qui assiègent ma mémoire me représentant celui que je fus, durant mes longues années d'enfance et de jeunesse, ce sont toujours ces deux journées de malheur que j'aperçois en arrière. Fond sinistre du tableau de ma vie, morne horizon d'un plus morne pays...
Quelles images?... Une grande cour plantée d'arbres anciens, des enfants qui jouent, par une fin de jour en automne, et d'autres enfants qui ne jouent pas, mais qui regardent, s'appuient au tronc des arbres jaunis, ou se promènent avec des airs de petites créatures abandonnées... C'est le préau du lycée de Versailles. Les écoliers joueurs sont les anciens; les autres, les timides, les exilés, sont les nouveaux, et je suis l'un d'eux. Voici quatre petites semaines que ma tante me disait le mariage de ma mère, et déjà ma vie est toute changée. À mon retour des vacances, il a été décidé que j'entrerais comme interne au collège. Ma mère et mon beau-père entreprennent un voyage en Italie qui durera jusqu'à l'été. M'emmener? Il n'en a pas été question une seconde. Me laisser externe à Bonaparte sous la surveillance de ma tante qui viendrait s'établir à Paris? Ma mère a proposé ce moyen, que mon beau-père a repoussé tout de suite avec des arguments trop raisonnables. Pourquoi imposer un tel sacrifice d'habitudes à une vieille fille? Pourquoi redouter cette rudesse de l'internat qui façonne les caractères?
—Et il a besoin de cette école, a-t-il ajouté en me regardant avec des yeux froids, comme au moment où il m'a serré le bras si fort. Bref, on a résolu que je serais pensionnaire, mais pas dans un collège de Paris.
—L'air y est trop mauvais..., a dit mon beau-père.
Pourquoi ne lui sais-je aucun gré du souci qu'il semble prendre de ma santé? Je ne prévois pourtant guère ce qu'il prévoit déjà, lui, l'homme qui veut m'écarter à jamais de ma mère, qu'il sera plus aisé de me laisser interne dans un collège situé hors de la ville, quand ils reviendront. Quel besoin a-t-il de ces calculs? Est-ce qu'il ne lui suffit pas d'énoncer une volonté pour que Mme Termonde lui obéisse? Comme je souffre lorsque j'entends sa voix, à elle, lui dire «tu», de même qu'à mon père! Et je pense à mes rentrées d'autrefois lorsque je commençais mes classes à Bonaparte, et que ce pauvre père m'aidait à mes devoirs. C'est mon beau-père qui m'a conduit au lycée, hier dans l'après-midi. C'est lui qui m'a présenté au proviseur, un maigre et long bonhomme à tête chauve qui m'a tapé sur la joue en me disant:
—Ah! il vient de Bonaparte... le collège des muscadins...
J'ai eu, le soir même, la curiosité de chercher ce mot dans le dictionnaire, et j'ai trouvé cette définition: «Jeune homme qui a de la recherche dans sa parure...» Et c'est vrai qu'avec mes vêtements coquets où s'est complue la fantaisie de ma mère, mon grand col blanc, mes bottines anglaises, ma veste joliment coupée, je ne ressemble point aux garnements en tunique parmi lesquels je vais vivre. Ils ont leurs képis déformés. Presque tous leurs boutons sont arrachés. Leurs gros bas bleus tombent sur leurs souliers éculés. Ils achèvent d'user à l'intérieur des costumes de l'an passé. Plusieurs m'ont regardé avec curiosité dès les premières récréations de ce premier jour. Un d'entre eux m'a même demandé: «Que fait ton père?» Je n'ai pas répondu. Ce que j'appréhende avec une angoisse insoutenable, c'est qu'on me parle de cela. Hier, tandis que le train nous amenait à Versailles, mon beau-père et moi, dans ce vagon où nous n'avons pas échangé une parole, comme j'aurais voulu dire cette épouvante, le conjurer de ne pas me jeter au milieu d'autres enfants, ainsi abandonné à leurs indiscrètes férocités, lui promettre, si je demeurais à la maison, de travailler plus et mieux qu'autrefois! Mais le regard de ses yeux bleus est si aigu quand il se pose sur moi; j'ai besoin de tant d'efforts pour prononcer, en m'adressant à lui, ces enfantines syllabes, ce mot de «papa» que je dis toujours en pensée à l'autre, à l'endormi sans réveil possible qui est là-bas dans le cimetière de Compiègne! Et je n'ai pas supplié M. Termonde, et je me suis laissé enfermer au lycée sans une phrase de regret. J'aime encore mieux, plutôt que de m'être plaint à lui, errer comme je le fais parmi les étrangers. Maman doit venir demain, veille de son départ, et cette entrevue toute prochaine m'empêche de trop sentir l'inévitable séparation. Pourvu qu'elle vienne sans mon beau-père?...
Elle est venue,—et avec lui. Dans ce parloir, décoré de mauvais portraits des élèves qui ont obtenu le prix d'honneur au concours général, elle s'est assise. Mes camarades causaient aussi avec leurs mères, mais laquelle était digne d'être aimée comme la mienne? Avec la sveltesse de sa taille, la grâce de son cou un peu long, ses yeux profonds, son fin sourire, encore une fois elle m'est apparue si belle! Et je n'ai rien pu lui dire parce que mon beau-père, «Jack», comme elle l'appelle avec la mutinerie d'une prononciation anglaise, était là aussi, entre nous. Ah! cette antipathie qui paralyse toutes les puissances affectueuses du cœur, l'ai-je assez connue alors, et depuis? J'ai cru voir que ma mère était étonnée, presque attristée de ma froideur à cette minute de nos adieux. Mais n'aurait-elle pas dû comprendre que je ne lui montrerais jamais ma tendresse, à elle, devant lui? Et elle est partie, elle voyage, et moi je suis resté...
D'autres images surgissent qui me montrent notre salle d'étude pendant les soirs de ce premier hiver de mon emprisonnement. Le poêle de fonte rougeoie au milieu de cette salle éclairée au gaz. Un bol rempli d'eau est posé sur le couvercle de peur que la chaleur ne nous entête. Tout le long des murs court la ligne de nos pupitres, et derrière chacun de nous se trouve un petit placard où nous rangeons nos livres et nos papiers. Un grand silence pèse sur la vaste pièce, rendu comme plus perceptible par le bruissement des feuillets tournés, le grincement des plumes, et une toux étouffée de moment à autre. Le maître se tient là-bas, sur une estrade haute de deux marches. Il s'appelle Rodolphe Sorbelle, et il est poète. L'autre jour, il a laissé tomber de sa poche un papier chargé de ratures sur lequel nous avons déchiffré les vers suivants:
Je voudrais être oiseau des champs,
Avoir un bec,
Chanter avec;
Je voudrais être oiseau des champs,
Avoir des ailes,
Voler sur elles.
Mais je ne puis en faire autant,
Car j'ai le bec
Beaucoup trop sec,
Et je suis pion,
Cré nom de nom!...
Cette prodigieuse poésie a fait notre joie, à nous autres petits collégiens féroces. Nous la chantons continuellement, au dortoir, en promenade, en cour, fredonnant les dernières paroles sur l'air classique des «lampions». Mais le vieux chien de cour a la dent mauvaise, il se défend à coups de retenues et on ne le brave guère en face. La lampe suspendue au-dessus de sa tête éclaire ses cheveux d'un gris verdâtre, son front rouge, et son paletot jadis bleu, aujourd'hui blanchâtre à force d'usure. Il rime sans doute, car il écrit, il efface, et, par instants, il relève ce front où les veines se gonflent, ses gros yeux bleus, qui expriment une si réelle bonté lorsque nous ne le tourmentons pas de nos taquineries, fouillent la salle et font le tour des trente-cinq pupitres. Moi aussi je regarde ces compagnons de mon esclavage actuel. Ils ont des visages que je commence à si bien connaître: Rocquain, tout petit, avec un nez trop grand, rouge dans une face longue et blême;—Parizelle, immense, avec sa mâchoire en avant. Il est blond, il a des yeux verts, des taches de rousseur, et par gageure, l'autre été, il a mangé un hanneton. Il y a aussi Gervais, un brun tout frisé, qui écrit son testament chaque semaine. Il m'a communiqué le dernier de ces opuscules où se trouve cette clause: «Je lègue à Leyreloup un bon conseil enfermé dans ma lettre à Cornélis». Leyreloup est son ancien ami qui lui a joué le tour de le rouler, l'automne dernier, dans un tas de feuilles sèches, entraîné à cette malice par le grand Parizelle, que le rancuneux Gervais considère depuis lors comme un scélérat, et le conseil enfermé dans la lettre posthume est un avis de défiance à l'égard du géant... Tout ce petit monde est la proie de mille intérêts puérils et qui, dès cette époque, m'apparaissent tels, quand je les compare aux souvenirs que je porte en moi. Et eux aussi, mes camarades, semblent comprendre qu'il y a dans ma vie quelque chose qui n'est pas dans la leur; ils ne m'ont infligé aucune des misères qui sont l'épreuve accoutumée des nouveaux, mais je ne suis l'ami d'aucun d'eux, excepté de ce même Gervais qui va en rangs avec moi lorsque nous sortons. C'est un garçon imaginatif et qui dévore chez lui une collection de numéros du Journal pour tous. Il a découvert là une suite de romans qui s'appellent: l'Homme aux figures de cire, le Roi des Gabiers, le Chat du bord, et, de jeudi en jeudi, les jours de promenade, il me les raconte. Le fond tragique de mes rêveries me fait trouver un étrange plaisir à ces récits où le crime joue le rôle principal. J'ai eu le malheur de dire cette malsaine distraction à ma bonne tante, et le proviseur a séparé le feuilletoniste improvisé de son public. On nous défend, à Gervais et à moi, d'aller ensemble à la promenade. Ma tante Louise a cru ainsi calmer les frénésies d'une sensibilité qui l'effraye. Pauvre femme! Ni la sollicitude de sa tendresse, ni les soins pieux de sa prévoyance,—elle vient de Compiègne à Versailles chaque dimanche pour me faire sortir,—ni mon travail,—car je redouble d'efforts pour que mon beau-père ne puisse pas triompher de mes mauvaises notes,—ni ma religion exaltée,—car je suis devenu le plus fervent de nous tous à la chapelle,—non, rien n'apaise l'espèce de démon intérieur qui me ravage l'âme. Durant les études du soir, et dans mes repos entre deux séances de travail, je relis une lettre dont l'enveloppe porte un timbre à l'effigie du roi Victor-Emmanuel. C'est ma pâture de la semaine que ces pages qui me viennent de maman. Elles me disent sur son voyage beaucoup de détails que je ne comprends guère. Ce que je comprends, c'est qu'elle est heureuse, sans moi, hors de moi;—c'est que la pensée de mon père et de sa mort mystérieuse ne la hante pas?—c'est surtout qu'elle aime son nouveau mari, et je suis jaloux, misérablement, vilainement jaloux. Mon imagination, qui a ses lacunes étranges, a ses minuties singulières... Je vois ma mère dans une chambre d'hôtel, et, disposées sur une table, les pièces de son nécessaire de voyage qui sont en vermeil avec son chiffre en relief, son prénom tout entier et la première lettre de son nom de femme entrelacée aux lettres de ce prénom: Marie C...—Ah! n'était-ce pas son droit de refaire loyalement son existence? Pourquoi renierait-elle son passé? Pourquoi ce mélange de ce passé à son présent me fait-il si mal,—si mal que tout à l'heure, au dortoir, étendu sur mon étroit lit de fer, je ne pourrai pas fermer les yeux?
Qu'elles me semblaient longues, ces nuits, lorsque je me couchais sur cette impression-là, et comme je luttais en vain pour obtenir l'anéantissement de mon esprit dans le doux abîme du sommeil! Je demandais ce sommeil à Dieu, de toutes les forces de ma piété d'enfant. Je disais mentalement douze fois douze Pater et douze Ave,—et je ne dormais pas. J'essayais alors de me forger une chimère. J'appelais ainsi un bizarre pouvoir dont je me savais doué. Tout petit garçon, et une fois que je souffrais d'une rage de dents, j'avais fermé les yeux, ramené mon âme sur elle-même et forcé mon esprit à se représenter une scène heureuse dont je fusse le héros. J'avais pu ainsi aliéner ma sensation présente au point de ne plus me douter de mon mal. Maintenant, chaque fois que je souffre, je fais de même, et ce procédé me réussit presque toujours.—Je l'emploie en vain lorsqu'il s'agit de maman. Au lieu du tableau de félicité que j'évoque, l'autre tableau se présente, celui de l'intimité de l'être que j'aime le plus au monde avec l'homme que je hais le plus. Car je le hais, animalement, et sans que j'en puisse donner d'autre motif, sinon qu'il a pris la première place dans ce cœur qui fut tout à moi. Allons, j'entendrai les heures sonner, une fois au clocher d'une église voisine, et une fois à l'horloge de notre collège,—un tintement grave, puis un tintement grêle. J'entendrai le vieux Sorbelle marcher le long du dortoir, tristement éclairé de quelques quinquets, puis rentrer dans la chambre qu'il occupe à une des extrémités. Que les deux rangées de nos petits lits sont lugubres à regarder, avec leurs boules de cuivre qui brillent dans l'ombre, et le ronflement des dormeurs odieux à entendre! D'intervalle à intervalle, un veilleur passe, un ancien soldat à la face large, à la grosse moustache noire. Il est engoncé dans un caban de drap brun et porte une lanterne sourde. Est-ce qu'il n'a pas peur la nuit, tout seul, le long des escaliers de pierre du lycée où le vent s'engouffre avec un bruit sinistre? Que je n'aimerais pas à en descendre les marches, dans ce frisson des ténèbres, de crainte d'y rencontrer un revenant! Je chasse cette nouvelle idée, mais vainement encore, et puis je songe... Où est celui qui a tué mon père? Est-ce d'épouvante, est-ce d'horreur que je frémis à cette question? Et je songe toujours... Sait-il que je suis ici? Et la panique m'affole, et je me demande si l'assassin ne serait pas capable de se déguiser en garçon de collège pour venir me frapper à mon tour? Je recommande mon âme à Dieu, et c'est sur ces affreuses pensées que je m'endors enfin, très tard, pour être réveillé en sursaut à cinq heures et demie du matin, la tête lassée, les nerfs tendus, ma pauvre âme malade, d'une maladie qui ne peut pas guérir.