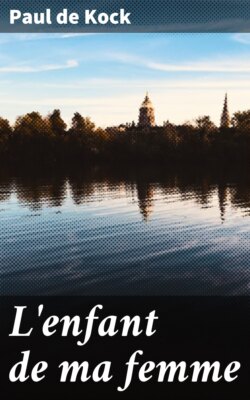Читать книгу L'enfant de ma femme - Paul de Kock - Страница 3
CHAPITRE II.
LES COMTES DE FRAMBERG.
ОглавлениеAvant de tirer Mullern de la surprise que lui a causée sa nouvelle rencontre, il est nécessaire d'apprendre au lecteur quel était le colonel Framberg, et de lui faire connaître le motif de son voyage.
Le comte Hermann de Framberg, père du colonel, descendait d'une ancienne famille d'Allemagne; de père en fils, les Framberg avaient passé leur jeunesse à servir leur patrie, et le comte Hermann, après avoir recueilli au champ d'honneur les lauriers de la gloire, s'était retiré dans le domaine de ses aïeux; et là, auprès d'une épouse chérie, il attendait avec impatience que la naissance de l'enfant qu'elle portait dans son sein vînt mettre le comble à sa félicité.
Ce moment arriva; mais ce jour d'allégresse se changea en un jour de deuil et d'affliction: la comtesse perdit la vie en mettant au monde un fils.
Le comte ne se consola jamais entièrement de cette perte; mais, comme le temps adoucit les peines les plus cuisantes, il se rappela qu'il avait un fils, et se livra avec ardeur aux soins de son éducation.
Elle ressembla à celle de ses aïeux. Le jeune Framberg apprit de bonne heure les exercices militaires; son père vit avec joie ses heureuses dispositions, et, à l'âge de quinze ans, le jeune homme lui demanda la permission de partir pour l'armée.
Le comte, quoique regrettant de se séparer de son fils, consentit à sa demande; le jeune Framberg quitta le château de ses pères pour se rendre au champ d'honneur, où, en très-peu de temps, ses belles actions lui valurent le grade de colonel.
Le comte Hermann était fier d'un tel fils; et lorsque le colonel Framberg venait passer ses quartiers d'hiver au château de son père, il y était reçu avec tous les honneurs militaires, embellis encore par la tendresse paternelle.
Ce fut sur le champ de bataille que le colonel fit connaissance avec Mullern. Ce brave hussard se faisait remarquer par son courage, et de plus par la singularité de son humeur. Il avait toute la franchise et la rudesse d'un bon soldat. Toujours prêt à exposer sa vie pour la personne qu'il aimait, il aurait aussi fait le tour du monde pour punir celui dont il aurait reçu un affront. Il révérait son colonel comme son supérieur, et l'aimait comme le plus brave de l'armée. A chaque bataille, Mullern se trouvait à côté du colonel, combattait devant lui, lui faisait souvent un rempart de son corps, et jamais il n'aurait pardonné à celui qui lui aurait enlevé le plaisir de mourir pour le sauver.
Le colonel, de son côté, s'attachait de plus en plus à Mullern; bientôt ils devinrent inséparables; car le colonel, élevé au milieu des camps, ne connaissait nullement les distances que le rang et la fortune établissent dans le monde. Celui qu'il aimait, fût-il sans titre, sans richesse, n'en était pas moins estimable à ses yeux, s'il possédait les qualités qui lui faisaient rechercher son amitié; en un mot, le colonel était au-dessus de tous les préjugés, et même, par sa conduite, il blessait souvent les convenances sociales. La suite de cette histoire en donnera des exemples fréquents.
Le comte Hermann, devenant vieux, désirait ardemment voir son fils lui donner un héritier de son nom; et à chaque visite que le colonel faisait au château (où depuis longtemps Mullern l'accompagnait), le vieux comte lui renouvelait ses instances pour se marier. Pendant longtemps, le feu de la gloire occupant seul l'esprit du colonel, il refusa à son père cette satisfaction; mais lorsqu'il eut atteint sa trentième année, cette humeur guerrière s'étant un peu refroidie, il consentit à se rendre à ses désirs.
A une demi-lieue du château du comte Hermann, se trouvaient les domaines du baron de Frobourg. Le baron, étant veuf, vivait retiré dans son château, occupé de l'éducation de sa fille unique: la petite Clémentine était l'idole de son père et l'objet de ses plus chères espérances.
Le comte et le baron, se trouvant voisins, ne tardèrent pas à se lier intimement; ils étaient alternativement l'un chez l'autre une partie du temps; passant les soirées d'hiver, l'un, à s'entretenir des hauts faits et de la gloire dont son fils embellissait ses vieux jours; l'autre à détailler les grâces enfantines de sa fille, son amour filial, sa sensibilité pour les malheureux, et l'espoir qu'il avait qu'en ayant un jour la beauté de sa mère, elle en aurait aussi les vertus.
Cependant le temps s'écoulait; le comte faisait part au baron du désir qu'il avait de voir son fils marié; le baron lui confiait les craintes qui l'agitaient, lorsqu'il songeait que, s'il venait à mourir, il laisserait sa fille seule au monde, sans un ami pour la protéger, sans un époux pour la chérir.
Il s'ensuivit de ces confidences ce qui devait nécessairement arriver; le comte et le baron formèrent le projet d'unir leurs enfants; par ce moyen, ils resserraient l'amitié qui les unissait, et mettaient fin aux inquiétudes qui troublaient sans cesse leur vieillesse.
Ce fut à cette époque que le colonel se rendit aux désirs de son père: alors celui-ci le conduisit au château du baron, afin de lui faire voir la femme qu'il lui destinait.
Le colonel, dans ses fréquents voyages au château, y avait déjà vu Clémentine; mais quelle différence! elle était enfant alors, et le temps n'avait pas encore développé toutes ses grâces.
Lorsque le comte la présenta à son fils comme sa future épouse, Clémentine venait d'avoir dix-huit ans; elle était jolie sans être belle, mais chacun de ses mouvements respirait la volupté; ses grands yeux noirs exprimaient la plus tendre langueur, et sa bouche ne s'ouvrait que pour laisser entendre des accents enchanteurs qui portaient le trouble et l'émotion dans le cœur de ceux qui l'écoutaient.
Le caractère de Clémentine ne démentait pas la douceur de ses regards: elle était douée de toutes les qualités; mais elle portait la sensibilité jusqu'à l'excès. Cette passion, quand elle est outrée chez les femmes, est souvent la cause de leur malheur, et les entraîne quelquefois plus loin qu'elles ne voudraient.
Le colonel éprouva, à la vue de Clémentine, ce charme secret que fait naître la présence d'une femme charmante, et il souhaita ardemment la nommer bientôt son épouse, non qu'il éprouvât pour elle cette passion violente, capable de tout sacrifier pour la possession de l'objet aimé; le colonel Framberg, élevé dans les camps, ne connaissait nullement l'amour, et sa brusque franchise était plus propre à faire de lui un ami qu'un amant; mais il était fier du choix de son père, et satisfait de pouvoir concilier en même temps ses désirs et son devoir.
Quant à Clémentine, lorsque le vieux baron lui apprit qu'elle devait considérer le colonel Framberg comme son futur époux, elle pâlit, se troubla, et se jeta aux genoux de son père, en le suppliant de ne point la forcer à le quitter. Le baron lui représenta qu'elle ne le quitterait pas; qu'il habiterait toujours avec elle; que d'ailleurs il lui fallait un protecteur, un second père pour le remplacer lorsqu'il descendrait au tombeau, et qu'il ne pouvait trouver un homme plus digne de remplir tous ces devoirs que le fils du comte Hermann; enfin le baron fit entendre à sa fille qu'il avait mis dans ce mariage sa plus chère espérance, et qu'elle attristerait ses vieux jours en refusant de lui obéir.
Clémentine se tut, essaya de cacher ses larmes, et promit à son père de se rendre à ses vœux.
Cependant elle obtint du baron un délai, afin, dit-elle, d'avoir le temps de connaître son futur époux, et il fut décidé qu'on les marierait au bout de trois mois.
D'où pouvait provenir la peine de Clémentine en apprenant son prochain mariage? Si le colonel n'avait pas le ton doux et tendre que l'on désire dans un amant, au moins possédait-il d'excellentes qualités; et d'ailleurs le plaisir d'obéir à son père aurait dû engager Clémentine à contracter sans chagrin l'hymen qu'il lui proposait. Il fallait donc que quelque motif secret troublât la tranquillité de son âme.
C'est ce que nous allons apprendre sans doute dans le chapitre suivant.