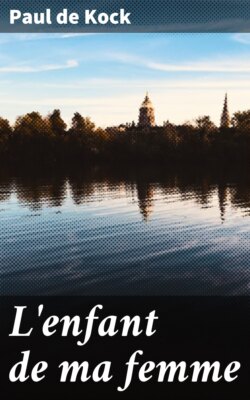Читать книгу L'enfant de ma femme - Paul de Kock - Страница 8
CHAPITRE VII.
RÉCEPTION DU COLONEL.
ОглавлениеPendant près de six mois qui s'écoulèrent après l'aventure de Henri, il se rendit tous les jours à la maison de sa belle, malgré les représentations de Mullern, et la fatigue que lui occasionnaient ces courses réitérées.
Un jour, pourtant, Mullern fut très-étonné, en se levant, de trouver encore Henri au château. «Eh quoi! vous n'êtes pas parti?—Non, Mullern, et je reste.—Bah! votre Dulcinée vous aurait-elle déjà joué quelques tours de sa façon?—Ma Pauline est incapable de changer!...—Elle vous a donc dit qu'elle vous aime?—Penses-tu que, depuis près de six mois que je la vois, nos cœurs ne se soient pas entendus, et que nos yeux n'ont pas exprimé notre amour?...—Oh! je vois bien que c'est une demoiselle qui connaît le service!—Si je n'y suis pas allé ce matin, c'est que la bonne dame Reinstard (c'est le nom de celle qui lui sert de mère) m'a averti que le père de ma Pauline devait arriver d'un moment à l'autre, et qu'il pourrait se formaliser de mes visites avant d'être instruit du commencement de notre connaissance.—Ainsi vous voilà séparé de votre belle pour longtemps.—Pour longtemps!... oh! j'espère bien d'ici à quelques jours me présenter à son père; il me verra, il m'aimera, et...—Et si c'est un homme raisonnable, il vous mettra à la porte de chez lui.—En vérité, Mullern, tu me désespères avec tes réflexions.—Ah! c'est que moi je ne suis pas amoureux, je dis ce que je pense.»
Au bout de quinze jours, Henri, ne pouvant plus tenir à son impatience, résolut d'aller à la demeure de son amante; mais cette fois Mullern voulut accompagner son élève, car il était bien aise de voir le père de la demoiselle, et de connaître aussi l'objet de ses affections. Henri aurait préféré aller seul; mais Mullern lui objecta qu'il était plus convenable qu'il l'accompagnât, et que si le père de Pauline était un brave militaire, la vue d'un ancien maréchal des logis lui inspirerait plus de confiance que celle d'un jeune étourdi. Ils partirent donc tous deux. Henri, pressé par le désir de voir sa belle, faisait aller son cheval ventre à terre; Mullern avait beau lui crier qu'il ne pouvait pas le suivre, c'était une raison de plus pour que notre jeune homme ne s'arrêtât pas.
Enfin, ils aperçoivent cette maison tant désirée. Henri est bientôt en bas de son cheval; Mullern examine l'habitation, qui a peu d'apparence, et branle la tête d'un air mécontent. Henri frappe. Au bout de quelques minutes une vieille femme vient ouvrir la porte; mais Henri ne reconnaît plus la domestique qu'il a coutume de voir; il demande, en tremblant: «M. Christiern?—Il n'habite plus ici depuis huit jours, monsieur.—Grand Dieu! et sa fille? et madame Reinstard?—Sa fille a suivi son père, et madame Reinstard les a accompagnés.» Henri reste comme frappé par la foudre; Mullern rit aux éclats.
«Ah! ah! ah! mille bombes! je suis bien aise que vous soyez débarrassé de votre belle inconnue...—Non, fût-elle au bout de l'univers, je l'y découvrirai!» s'écrie Henri; et il commence par interroger la bonne femme sur le départ de M. Christiern; mais il ne peut rien en apprendre, sinon que les trois personnes qui habitaient la maison sont parties sans faire connaître le motif ni le but de leur voyage, et que la personne qui y demeure maintenant ne connaît nullement ses prédécesseurs. En disant ces mots, la vieille ferme la porte, et laisse nos voyageurs sur le grand chemin.
Henri, désespéré, veut aller à Offembourg, parcourir les environs, se mettre en quatre pour retrouver sa belle; mais Mullern n'entend pas raison, et il le force à reprendre avec lui le chemin du château.
Ils y étaient depuis quelques jours, Henri ne rêvant que voyage et enlèvements, et Mullern se félicitant du dénoûment de cette intrigue, lorsqu'ils apprirent que le colonel Framberg serait sous peu de retour au château.
Mullern ne se sent pas de joie. Il va revoir son colonel, son bienfaiteur! Il met tout sens dessus dessous pour que le comte soit reçu dans ses domaines avec les honneurs qui lui sont dus.
Tous ses vassaux prennent les armes; Mullern les exerce depuis le matin jusqu'au soir, ordonne des combats, des évolutions. M. Bettemann lui-même, qui, depuis quelque temps, n'était plus propre qu'à s'enivrer, M. Bettemann est forcé de porter le mousquet, de prendre part aux exercices, et de monter deux fois par jour la garde sur les remparts du château, ce qui ne laisse pas de lui déplaire fort; mais Mullern pense que c'est le meilleur moyen de le former.
Henri oublie un moment celle qui lui fait tourner la tête, et l'arrivée de son père, qu'il n'a pas vu depuis longtemps, occupe tout à fait ses esprits; il partage l'activité de Mullern, et attend avec impatience le moment de presser son père dans ses bras. Il arrive enfin ce moment si désiré. M. Bettemann, qui était en sentinelle ce jour-là, aperçoit de loin la voiture du colonel. Suivant les ordres de Mullern, il tire son coup de fusil pour annoncer son arrivée, et tombe par terre à la détente de l'arme à feu.
Tout est bientôt en mouvement dans le château; Mullern court relever la sentinelle; il fait baisser le pont-levis, tous les paysans se rangent sur deux lignes. Mullern leur recommande de tirer tous ensemble dès que la voiture entrera dans le château, et M. Bettemann se sauve à la cave pour ne pas entendre ce bruit épouvantable; mais Mullern, qui ne le perd pas de vue, court après lui, et le force à rentrer dans les rangs, en lui donnant un vieux fusil, qui, lui assure-t-il, fera bien moins d'effet que l'autre.
Enfin le bruit des chevaux se fait entendre, la voiture passe le pont-levis, Mullern donne le signal: tous les paysans tirent à la fois. M. Bettemann, effrayé ou électrisé par cette décharge soudaine, essaye de faire comme les autres; mais le fusil, qui n'avait pas servi depuis longtemps, se crève et éclate dans le nez de M. Bettemann, qui se roule en hurlant sous les pieds des chevaux: ceux-ci, que les cris du précepteur effarouchent, se mettent à galoper dans la cour à tort et à travers, faisant fuir devant eux les vassaux du colonel; Mullern crie à tue-tête pour rallier sa troupe; Henri court après les chevaux, qui, stimulés par le vacarme, galopent de plus belle, et ne s'arrêtent que devant une mare, dans laquelle ils font rouler la voiture, qui écrase, en tombant, une demi-douzaine de canards.
Enfin les chevaux sont arrêtés, et Henri court relever son père qui a roulé dans la mare, mais qui, heureusement, en est quitte pour son grand uniforme couvert de fange, et pour avoir au derrière une oie qui avait cherché son refuge près de lui, et qui s'était attachée à sa culotte.
Pendant que l'on s'occupe à ôter l'animal, qui ne voulait pas lâcher prise, Mullern s'avance d'un air consterné. «Ah! mon colonel!... daignerez-vous excuser... si la réception que je vous avais préparée a manqué son effet!...—Ce n'est rien, mon cher Mullern, ton intention était bonne et cela me suffit.—C'est la faute de ce b..... de Bettemann; mon colonel!...—J'en serai quitte pour changer d'habit.—Et lui pour un œil, mon colonel.—Mais où est mon fils!... Mon Henri, viens donc dans mes bras!...» Le jeune homme se précipite dans les bras du colonel, qui le regarde avec attendrissement, en s'écriant: «C'est elle!... c'est ma Clémentine!...» Et il le serre tendrement contre son cœur. Henri, de son côté, sentit naître dans son âme le sentiment profond de respect et de reconnaissance qu'il devait à celui qu'il regardait comme son père.
Après quelques instants donnés à la sensibilité, le colonel pensa qu'il ne ferait pas mal d'aller se déshabiller; il engagea Henri à aller voir si tout était rentré dans l'ordre au château, et il fit signe à Mullern de le suivre dans son appartement.
«Eh bien! mon cher Mullern, dit le colonel lorsqu'ils furent seuls, c'est à toi que j'ai confié mon cher Henri, il y a près de douze ans. Pendant que j'ai employé ce temps à parcourir le monde, à battre les ennemis, à me distraire enfin du souvenir déchirant de la perte d'une femme qui méritait si bien mes larmes et mes regrets, comment l'as-tu passé, toi, que j'ai chargé spécialement de former le cœur de mon fils? Tu n'as pu encore me rendre compte de tes peines, de tes soins, et de la manière dont tu t'y es pris pour faire de Henri un homme dont je n'aie jamais à rougir; dis-moi, y as-tu réussi?—Oui, mon colonel, et fièrement réussi, je m'en vante. Allez, le jeune homme est un gaillard qui fera des siennes!...—Comment!...—C'est-à-dire, mon colonel, qu'il fera parler de lui: d'abord, il est brave, j'en réponds!... et il se bat! ah! j'espère que vous le verrez vous-même, et que vous m'en ferez compliment!...—Ensuite?—Ensuite, il est humain, généreux, sensible! Oh ça, pour sensible!...—Je vois qu'il aura toutes les vertus de sa mère.—Oh! oui, mon colonel, je crains seulement que cette sensibilité-là ne le mène trop loin!...—Que veux-tu dire?—Oh! c'est que le jeune homme aura diablement de goût pour le sexe!...—Tu crois?—Parbleu, si je le crois...» (Ici, Mullern s'arrêta, se rappelant qu'il avait promis à Henri de cacher au colonel son aventure avec sa belle.)
«Ainsi, Mullern, tu es donc entièrement satisfait de mon fils?—Oui, mon colonel, très-satisfait; c'est un élève qui me fera honneur un jour, j'en suis certain. Ce n'est pas qu'il n'ait bien aussi quelques petits défauts... D'abord, il est violent, impatient, emporté...—Oh! oh! tu ne m'avais pas dit cela!—Mais, soyez tranquille, mon colonel, ces défauts se corrigent avec l'âge, et, lorsque le cœur est bon, il y a toujours du remède, et le sien l'est! oh! j'en réponds, autant que le vôtre, mon colonel!... il était digne d'être votre fils...—Que dis-tu, Mullern?» s'écria vivement le colonel. Mullern se troubla, se gratta l'oreille, et s'aperçut qu'il avait dit une bêtise; cependant il prit son parti, et répondit: «Ma foi, mon colonel, puisque le mot est lâché, je ne chercherai pas à me rétracter; d'ailleurs, tenez, je ne sais pas dissimuler, et j'avoue que cela me coûtait d'avoir quelque chose à vous cacher, mon colonel.—Eh bien! Mullern, puisque tu sais le secret de la naissance de Henri, je ne veux plus feindre avec toi; d'ailleurs, le hasard!... les événements me forceront peut-être un jour à tout lui dire; et si je venais à perdre la vie avant de lui avoir révélé ce secret, je ne serais pas fâché qu'un autre que moi en fût dépositaire. Mais, songe bien, Mullern, à ne jamais divulguer à personne ce que je vais t'apprendre, sans y être forcé par les circonstances les plus impérieuses, ou sans un ordre de ma part!...—Soyez sans inquiétude, mon colonel, je vous en donne ma parole; vous me connaissez, et vous savez que Mullern est incapable de violer son serment.» Le colonel Framberg apprit alors à Mullern tout ce qui concernait la naissance de Henri, ainsi que le véritable nom de son père, que Clémentine lui avait dit.