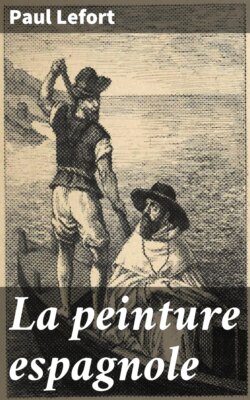Читать книгу La peinture espagnole - Paul Lefort - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PRÉFACE
ОглавлениеTable des matières
Nous n’avons pas adopté, dans ce précis d’histoire de la «Peinture espagnole», la division en écoles locales, provinciales ou régionales habituellement employée par les anciens auteurs et appliquée par eux à un groupe, ou à une suite d’artistes, nés ou établis en un même centre ou en une commune région.
A notre avis, cette division est absolument arbitraire et ne doit être entendue que comme simple expression géographique. Pris en son sens esthétique, le mot «école» impliquerait, en effet, l’existence plus ou moins prolongée, et plus ou moins active, d’un groupe ou d’une suite d’artistes possédant, sinon une unité absolue d’enseignement, du moins une communauté de tendances, de traditions, de sentiment, voire même, dans l’exécution, une certaine fraternité de méthodes. Or, ces conditions essentielles à l’existence d’une école, nous ne les rencontrons nulle part réunies, du moins jusqu’à un certain moment, pas plus en Catalogne et en Aragon qu’à Valence, Tolède, Madrid ou Séville. Ce n’est seulement que dans le dernier tiers du XVIe siècle, et plus pleinement au commencement du siècle suivant, que les diverses manifestations locales ou provinciales, jusque-là divergentes, viennent se fondre en une seule et même école, homogène en ses tendances, unie en un même principe, le naturalisme, vraiment indigène et nationale enfin, et bien espagnole.
Avant cette éclosion définitive, lentement préparée par des artistes de transition, parfois inconscients du but à atteindre, aucun des groupes provinciaux, qualifiés trop pompeusement et improprement du titre d’écoles, n’offre donc, dans la succession de ses peintres, une unité, un ensemble véritable de traditions et de doctrines. Tour à tour, et selon l’enseignement reçu, ces artistes ont, à l’origine, imité les primitifs italiens ou flamands; puis, lorsque la Renaissance a pénétré chez eux, ils ont couru étudier leur art à Florence, à Rome, à Venise. Qu’à cette diversité d’études et d’initiation, puisées hors de leur patrie, l’on joigne encore la variété des exemples pratiqués par les maîtres étrangers, italiens ou flamands, établis en Espagne, et l’on se rendra compte de l’extrême diffusion de styles et de méthodes dont chaque province, chaque ville même, a été le théâtre.
Aucun des centres artistiques, qu’il s’agisse de Séville, de Valence, de Tolède ou de Madrid, comme de l’Aragon ou de la Catalogne, n’a donc échappé à cette mêlée, à cette lutte d’influences extérieures.
A son aurore, la peinture espagnole est byzantine comme l’avait été l’enluminure; elle est, au XVe siècle, simultanément flamande et italienne, selon que le peintre a été enseigné dans l’une ou l’autre école; brusquement, au XVIe siècle, elle s’affranchit des timidités gothiques et passe à l’imitation des grandes œuvres vénitiennes, florentines ou romaines.
Parmi les nouveaux initiés, les plus marquants ne sont, à quelques exceptions près, que des «italianisants » de seconde main, mais qui laissent cependant entrevoir de bonne heure, à travers leurs imitations et leurs emprunts, quelque chose de particulier à leur race et à leur terroir. Alors, en effet, que les successeurs de Michel-Ange et de Raphaël ne sont déjà plus que des décadents, des demi-païens, pratiquant surtout le culte des élégances et des sensualités de la forme, les Espagnols, leurs élèves, continuent de conserver intacte leur foi simple et sincère qu’ils traduisent, d’ailleurs, avec quelque éloquence, dans leurs ouvrages.
Une tendresse leur est commune, qu’ils n’ont pas apprise des Italiens. Ils aiment les petits, les humbles, les pauvres et jusqu’à leurs haillons pittoresques. Aussi, par quelque endroit, trouvent-ils toujours prétexte à les introduire en leurs compositions et celles-ci en prennent on ne sait quoi d’intime, de familier et de touchant. Et ces tendances naturalistes, allant parfois jusqu’à la trivialité, que l’on voit d’abord poindre chez les artistes appartenant aux deux premiers tiers du XVIe siècle et simultanément en Andalousie, à Valence et en Castille, grandissent et vont s’affirmant de plus en plus jusqu’à devenir enfin, au XVIIe siècle, avec le goût inné des colorations sobres, saines et puissantes, les caractères les plus éminents et les plus typiques de la peinture espagnole.
P. L.