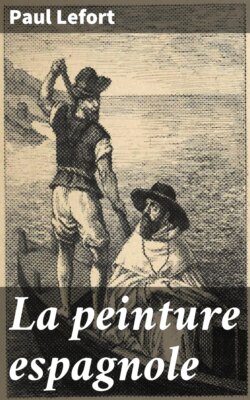Читать книгу La peinture espagnole - Paul Lefort - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE PREMIER
ОглавлениеTable des matières
LA DÉCORATION DES MANUSCRITS.
L’art de l’enluminure a de beaucoup précédé en Espagne, comme du reste chez les autres nations occidentales, l’art de la peinture proprement dite. C’est donc aux illustrations des manuscrits qu’il convient de recourir pour retrouver les origines ainsi que les plus anciens monuments de l’art indigène.
Au temps des rois goths, les peintures sur vélin ne consistent, le plus souvent, qu’en lettrines très simples, tracées au minium et relevées de quelques mouchetures d’or. Cependant, la figure du Christ en croix se rencontre dans un missel dont la date, selon Eguren, remonterait au vue siècle. Le manuscrit Cornes, qui fait partie de la collection de l’Académie de l’Histoire, à Madrid, fut commencé, en 744, par l’abbé du monastère de San Emiliano. Le dessin des figures et des formes y apparaît on ne peut plus rudimentaire et barbare. Sous ce rapport il offre certaines analogies avec la manière du dessinateur des figures des évangélistes, dans le code de Saint-Gall, que l’on croit être l’œuvre d’un moine irlandais. La première page du Cornes est ornée d’une croix, formée de rubans entrelacés, d’où pendent les lettres alpha et oméga; cette croix est surmontée de deux anges, dont les pieds sont trop petits et d’un modelé tout à fait insuffisant. Le nom de ce manuscrit lui vient de l’inscription tracée au bas de la représentation d’un guerrier, armé d’une lance et portant un écu de forme ronde, marqué d’une croix. En une écriture postérieure à celle du titre, on lit ces mots: Tellus cornes Ruconum sub era 756. date qui parait être celle de l’achèvement du manuscrit. Passavant, dans son étude sur l’Art chrétien en Espagne signale, dans la bibliothèque de Saint-Gall, un autre manuscrit, appartenant à la même époque, qui paraît également avoir été exécuté en Espagne, par quelque moine irlandais ou anglo-saxon. Au-dessous d’une figure d’homme, placée sous un arc mauresque et offrant les mêmes caractères de dessin que l’on remarque dans le Cornes. on lit la signature: Vandalcarius fecit.
L’Académie de l’Histoire, à Madrid, possède une Apocalypse du Xe siècle, œuvre de Beatus. Le titre en est orné d’une représentation de l’Agneau, placé dans un médaillon et au centre d’une croix dont les extrémités sont formées par les animaux symboliques, attributs des évangélistes; les couleurs employées par l’enlumineur sont le pourpre, le jaune et le vert. Les feuillets suivants sont ornés de diverses miniatures, parmi lesquelles on remarque saint Jean écrivant, avec un ange soutenant son livre, et la Vierge, représentée debout. Ces figures sont d’un dessin encore bien rudimentaire, et leurs pieds, rapprochés et posés comme dans les peintures égyptiennes, sont présentés de profil. Sous des arceaux voltigent des anges. L’un de ces arceaux est de forme arabe. Quant à l’ornementation des marges et des lettrines, elle ne diffère pas sensiblement de celle des manuscrits, français ou allemands, de l’époque carlovingienne. Notre Bibliothèque nationale a acquis trois autres manuscrits du même Beatus, renfermant des Commentaires de l’Apocalypse et enrichis de figures d’un dessin hardi, parmi lesquelles on voit les dix rois alliés de la Bête, vêtus en jongleurs ou en fous, se précipitant dans l’abîme sous les yeux de l’Agneau triomphateur. L’un des exemplaires, quelque peu postérieur au Xe siècle, offre un symptôme naturaliste curieux à relever: c’est une initiale, un grand M, dont les jambages sont formés par deux musiciens dansant. L’un d’eux tient un archet et en racle les cordes d’un instrument qui ressemble beaucoup à une guitare. M. L. Delisle a décrit, dans ses Mélanges de paléographie, le troisième manuscrit de Beatus, ne contenant pas moins de soixante miniatures, d’une exécution assez grossière du reste. Le savant paléographe a rapproché cet exemplaire de plusieurs autres du même ouvrage exécutés dans les monastères d’Espagne, à la Cogolla, à Saint-Isidore-de-Léon, à Silos et ailleurs et, de son examen, est sortie, entre autres, cette observation: que les enlumineurs d’alors n’aimaient pas le bleu, mais le remplaçaient presque constamment par le pourpre ou le violet. Il note que cette dernière nuance alterne avec le rouge dans la plupart de leurs initiales et que leur coloris est le plus souvent avivé par une gomme à reflets argentins.
Fig. 1. — Miniature tirée dit Codice vigilano.
(Manuscrit du Xe siècle, appartenant à la Bibliothèque nationale de Madrid.)
On doit au moine Vigila, du couvent de San-Martin-de-Abelda, un manuscrit, daté de 976, relatif à divers conciles généraux, dont l’un tenu à Tolède, et qui appartient à la Bibliothèque nationale de Madrid. Entre autres miniatures, ce Codice vigilano renferme les portraits des rois don Sancho el Craso et don Ramiro, de la reine doña Urraca et même celui de l’enlumineur qui, d’après sa propre attestation, se fit aider, dans ce travail, par les moines Saracino et Garcia. Un autre manuscrit, conservé à l’Escurial, relatif également à l’histoire des conciles- et paraissant dater de la même époque que le précédent, nous montre, sur sa première page, l’artiste enlumineur assis sous un portique d’architecture mauresque. Plus loin, il a représenté Adam et Ève sous l’arbre de la science du bien et du mal; puis vient l’image du Sauveur, bénissant à la manière grecque. Le dessin de ces miniatures, byzantines d’inspiration, mais où les personnages n’ont que des apparences de pieds, alors que leurs mains sont de dimensions disproportionnées, est excessivement brutal et archaïque; il ne présente point de progrès sur les enluminures datant du VIIIe siècle et reste inférieur, comme art, aux miniatures allemandes, mais byzantines d’inspiration, du Codice aureo, don de l’empereur Conrad II, en 1020, que possède également l’Escurial.
Fig. 2. — Miniature tirée des Évangiles ou Codice aureo.
(Manuscrit du XIe siècle, exécuté en Allemagne et appartenant à la bibliothèque de l’Escurial.)
De nombreux manuscrits, remontant au XIIe et au XIIIe siècle, où se rencontrent des miniatures intéressantes pour les détails de costumes, d’armures, et dont le dessin commence à se rapprocher de celui des artistes flamands, français ou allemands contemporains, sont conservés dans le Trésor de la cathédrale de Tolède, à la Colombienne de Séville et dans la Bibliothèque de l’Académie espagnole de l’Histoire. Une Bible, écrite pour le roi Alphonse le Savant, par le peintre Pedro de Pamplona et appartenant à la Colombienne, est particulièrement remarquable pour les nombreuses représentations de sujets sacrés dont se compose son illustration, ou apparaissent fréquemment des détails d’architecture mauresque. Un très grand intérêt d’art s’attache également au manuscrit de l’Escurial, exécuté à Séville pour le même roi Alphonse et intitulé : Juegos diversos de Axedrez, de dados y tablas; il abonde en curieuses enluminures aquarellées, représentant des seigneurs et des personnages appartenant aux différentes classes de la société du temps, jouant à ces divers jeux, et le roi Alphonse lui-même, assis sous un portique et enseignant les échecs à un page; ailleurs, c’est un prince maure s’entretenant avec un professeur d’échecs; dans une très belle peinture à l’eau, placée au commencement du manuscrit, l’artiste a représenté le roi dictant à un scribe les règles de divers jeux, ayant à sa gauche un groupe de personnages; tous sont assis sous des arceaux de style gothique.
Fig. 3. — Miniature extraite du Libro de las Tablas.
(Manuscrit espagnol du XIIIe siècle. — Bibliothèque de l’Escurial.)
Le Pontifical de la cathédrale de Séville, commencé en 1390 et terminé seulement en 1473, renferme de nombreuses compositions enluminées, d’exécution très diverse, mais rappelant, pour la plupart, le style de l’école franco-flamande contemporaine. Quelques-unes sont d’un grand intérêt, tant par l’importance des sujets représentés que par leurs dimensions extraordinaires et surtout par l’extrême habileté que l’artiste a déployée. Encadrées dans des ornements formés d’ingénieux caprices et de détails exquis, elles se détachent sur des fonds d’or, rouges et bleus, disposés en petits carrés, variés de couleur, sur lesquels sont peints en rehaut des ornements d’or.
Le missel du cardinal Mendoza, qui appartient à la même cathédrale, est aussi enrichi de superbes miniatures, d’un format moindre que les précédentes, mais d’un caractère d’art qui permet d’en rattacher quelques-unes à l’école des Van Eyck. Certains détails typiques d’architecture, de costumes, de physionomies et un coloris plus brun dans l’exécution des carnations et, en général, plus chaud que dans les miniatures flamandes, prouvent que l’artiste qui en est l’auteur était Espagnol ou, du moins, qu’il habitait l’Espagne. Un autre superbe missel, décoré dans le style des écoles du Nord et qui fut achevé, pour la reine Isabelle, en 1496, par Francisco Florès, est conservé à Grenade dans le Trésor de la chapelle sépulcrale des rois catholiques.
L’art italien a aussi sa large part d’influence dans l’exécution de quelques manuscrits du même temps. Cean Bermudez cite, entre autres monuments de cet ordre, des Décrétales, œuvre de Garcia Martinez, qui travaillait à Avignon vers 1343, ainsi que les miniatures qui ornent le missel du cardinal Ximenez de Cisneros; ces ouvrages font partie de la bibliothèque de la cathédrale de Séville. Le dernier, outre diverses petites compositions d’un caractère italien évident, en renferme une d’un plus grand format où l’artiste, un indigène assurément, car ses types de figures sont bien espagnols, a représenté le Crucifiement.
Fig. 4. — Miniature tirée du Devocionario de la reine Isabelle la Catholique.
(Manuscrit du XVe siècle. — Bibliothèque de l’Escurial.)
Avec les règnes de Jeanne la Folle et de Charles-Quint, nous voyons reparaître l’influence flamande, d’abord dans un Office de la Vierge, de la bibliothèque de l’Escurial, puis dans un Devocionario qui a appartenu à Charles-Quint. L’intéressant Libro de Monteria, ou-recueil consacré aux divers genres de chasse, que possède la bibliothèque royale de Madrid, est une œuvre du XVIe siècle, empreinte du naturalisme des écoles du Nord, mais dont l’exécution n’égale cependant pas la précision, la finesse de dessin ni la délicatesse de coloris des grands enlumineurs bourguignons ou flamands contemporains. Comme l’avait fait Charles-Quint pour le célèbre enlumineur Antonio de Holanda, Philippe II protégea son fils, Francisco de Holanda, Portugais d’origine et fort habile miniaturiste dans la manière de Julio Clovio. Ayant à faire exécuter les livres de chœur de l’Escurial, Philippe II n’appela à concourir à ce travail que des artistes, soit italiens d’origine, soit espagnols, mais formés à l’école romaine ou florentine. Parmi ces derniers, on note, comme ayant fait preuve d’une particulière habileté, fray Andrès de Léon, Nicolas de la Torre, Jusepe Rodriguez, Francisco Hernandez, Simon de Santiago, fray Martin de Palencia, Juan Salazaret fray Julian de la Fuente del Saz.
Fig. 5. — Miniature tirée du «Virgile» (Manuscrit flodrentin du XVe siècle. — Bibliothèque de l’Escurial.)
Fig. 6. — Miniature tirée du Devocionario de Philippe II.
(Manuscrit du XVIe siècle. — Bibliothèque de l’Escurial.)
Quelques-uns de ces illuminadores collaborèrent également avec Francisco de Villadiego et Diego de Arroyo, qui avait étudié son art en Italie, à la décoration de divers livres de chœur pour la cathédrale de Tolède. Il convient de citer encore, comme auteurs des splendides miniatures du missel, en six volumes, offert à cette même cathédrale par le cardinal Cisneros, missel qui fut terminé en 1518, les noms de Bernardino Canderroa, d’Alonso Vazquez et de fray Felipe. Avec le XVIIe siècle commence le déclin de la miniature; elle fut cependant pratiquée longtemps encore au cours de sa décadence, et nous rencontrons des noms d’enlumineurs jusque vers la fin du XVIIIe siècle. Mais l’étude de leurs ouvrages n’offrirait plus aucun intérêt d’art.
De l’examen chronologique des quelques manuscrits dont nous venons de parler, il ressort clairement que, tantôt l’art des écoles du Nord, tantôt l’art italien a inspiré les enlumineurs espagnols et qu’ils obéissent à l’une ou à l’autre influence, non selon l’époque et le milieu où vit l’artiste, — puisque nous voyons ces deux influences s’exercer simultanément en un même centre et au même moment, — mais plutôt comme conséquence et comme résultat de l’enseignement que cet artiste aura reçu et qu’il continue, d’ailleurs, en y mêlant quelque chose de sa personnalité et des tendances naturalistes de sa race.