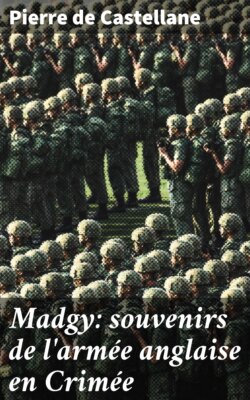Читать книгу Madgy: souvenirs de l'armée anglaise en Crimée - Pierre de Castellane - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II LE PLATEAU DE CHERSONÈSE
ОглавлениеTable des matières
La direction du grand parc d’artillerie avait été prévenue de l’arrivée de l’Euphrates par le télégraphe électrique établi entre Balaclava et le quartier général anglais. Le colonel Otway trouva sur le quai, en débarquant, un chariot pour transporter ses bagages au camp et le poney trapu d’une intelligence et d’une adresse remarquables qu’il avait coutume de monter dans ses courses. Le poney se mit à frapper du pied, comme s’il eût reconnu son’ maître et quand la main du colonel passa, en la caressant, dans sa crinière, Bob releva fièrement la tête et hennit joyeusement. Otway avait un ami fidèle qui saluait son retour. Montant aussitôt à cheval, il prit la route qui, longeant le cimetière à moitié submergé, passait au pied des contreforts, près de l’endroit où, tournant brusquement à gauche, ces hauteurs se dirigeaient vers le plateau de Chersonèse. Le chemin de fer était alors terminé jusqu’à un petit village nommé Kadikoï, dont les maisons basses servaient de magasins, et les robustes ouvriers terrassiers, ces athlètes que l’Angleterre avait envoyés en Crimée, travaillaient avec ardeur dans leur costume pittoresque. Auprès d’eux passaient et repassaient, au milieu des fondrières, les fourgons de l’artillerie, les mules, les transports, les lourdes pièces de siège que vingt chevaux traînaient péniblement, des cavaliers, des piétons isolés, tous les types et tous les uniformes, des vêtements qu’un règlement militaire n’avait jamais prévus, des barbes qu’il n’avait jamais permises, des tenues inventées par la guerre, la peine, la fatigue, le froid et la misère de chaque jour, mille races et mille figures, une foule enfin, qui semblait accourue de tous les points de l’univers. Après avoir dépassé le village que les marchands avaient élevé au delà de Kadikoï, singulier assemblage de maisons de tôle, de baraques de bois et de tentes, et plus loin, sur la gauche, le vallon de Karani où bivouaquaient un régiment de cavalerie anglaise et une batterie d’artillerie, le colonel atteignit rapidement le col conduisant au grand plateau occupé par les armées alliées. Il s’arrêta à cet endroit, rendit les rênes au poney, et, le laissant prendre haleine, se retourna vers le paysage immense qui se déroulait, devant lui.
Presqu’île dans la presqu’île de Crimée, le plateau de Chersonèse est défendu du côté opposé à la mer par des pentes abruptes qui partent des montagnes de Balaclava, décrivent une courbe à Karani pour courir depuis ce village, vers l’est, jusqu’à la rivière de la Tchernaïa et tourner brusquement à gauche, en formant le contre-fort de la vallée qui porte, à partir de ce point jusqu’à son débouché dans la rade, le nom de vallée d’Inkermann. Entre le col et la rivière de la Tchernaïa, coulant du sud-est au nord-ouest, et le rideau de montagnes perpendiculaire à la mer fermant l’horizon, on découvrait la plaine à jamais célèbre par la charge de l’héroïque cavalerie anglaise et la fermeté impassible de sir Colin Campbell et de ses highlanders. Au delà des petits mamelons bordant la Tchernaïa, cette plaine s’étendait sur la rive opposée, jusqu’au pied des escarpements où bivouaquait l’armée russe de soutien, puis venait, resserrée entre les deux plateaux, aboutir aux marais qui précédaient la rade. La sécurité féconde de la paix avait disparu de ces terres: le silence lugubre de ces pays déserts, abandonnés des hommes et livrés aux armées, planait sur ces espaces. De grands oiseaux de proie, seuls hôtes de ces solitudes, volaient lourdement au-dessus de la Tchernaïa, dont les eaux boueuses, gonflées par la pluie, coulaient à pleins bords. Le vent d’ouest avait chassé le soleil du matin, les nuages couvraient le ciel et répandaient une teinte grise sur ces plaines, ces collines, ces escarpements, ces plateaux et ces montagnes, qui se renvoyaient, comme les rafales d’une tempête, les grondements du canon venus de la ville.
Le colonel Otway regardait toujours. Il voyait deux plateaux se dressant l’un devant l’autre comme des forteresses, et à leur pied un sol prêt pour la bataille, un champ clos digne d’une guerre qui n’empruntait rien aux enseignements laissés par l’expérience, et il arrivait à se demander s’il n’eût pas mieux valu prendre le jour et l’heure, se donner rendez-vous un matin, comme les Horaces et les Curiaces, plutôt que de rendre les camps inexpugnables,pendant que l’on s’acharnait à attaquer par d’étroites issues, derrière des travaux de défense hérissés de canons, une armée toujours en communication avec ses réserves. Il ne doutait pas du succès. Le taureau qui attaque de front l’emporte aussi bien que le lion par des assauts rapides; mais il aurait voulu que le sang épargné rendît l’effort moins pénible. Il resta ainsi longtemps à contempler ce paysage triste et magnifique, quand le poney, impatienté de la halte, partit dans la direction du bivouac.
–Allons, Bob, lui dit le colonel en reprenant les rênes, tu seras donc toujours le même, capricieux, et entêté! Tu as tort, mon ami! si je mourais, ton nouveau maître serait sans doute moins indulgent.
L’heure où l’on avait coutume de lui donner sa nourriture était passée, et Bob, en véritable philosophe qui ne se préoccupe point inutilement de l’avenir, avait hâte de retrouver sa provende. Il allongeait donc le trot sans s’inquiéter de la remontrance à laquelle il était du reste habitué, car Otway aimait à lui parler dans ses longues courses et à le dirige avec la voix sans employerer la bride; mais cette fois monsieur Bob, comme l’appelaient les canonniers, dut modérer son ardeur. Le chemin passait au milieu du bivouac du contin gent Égyptien, .et le colonel remarquait avec plaisir la belle tenue des soldats de service, le soin donné aux armes bien rangées en faisceaux, la propreté des tentes soigneusement ouvertes pour renouveler l’air, la souplesse et la force des hommes réunis en petits groupes, fumant leur petite pipe de terre rouge, au tuyau de cerisier, et chantant leurs mélodies traînantes, lorsqu’à un détour du chemin il fut croisé par un officier anglais qui se retourna aussitôt.
–Bonjour, Otway, dit l’officier en lui serrant cordialement la main, je suis content de vous voir enfin rétabli!
–Et moi aussi, Morris; votre vue me fait du bien!
–Nous voulions tous aller à Balaclava, mais on a enterré ce matin Mac-Henry, et j’ai pu seul venir vous souhaiter en leur nom le bon retour.
–Pauvre garçon!. C’était un brave soldat, qui avait déjà passé par bien des dangers! répondit Otway. Les épreuves ne sont pas finies, je le crains, mon ami, ajouta-t-il après un instant de silence.
Et, pendant que leurs chevaux marchaient au pas, le major Morris, raconta au colonel Otway le long détail des souffrances de l’hiver, la difficulté du travail, les ravages du scorbut, les changements survenus dans les attaques, dont une partie à la droite avait été confiée à l’armée française, le retour de l’espérance avec l’approche du beau temps et l’arrivée des renforts, la tenacité des Russes poussant sans cesse de nouvelles embuscades et tirant un merveilleux parti des armes de précision, les préparatifs enfin du bombardement qui s’achevaient rapidement, sans que rien, au reste, pût faire supposer le plan des généraux en chef.
–Otway ne put réprimer un geste d’impatience.–Nous serons donc toujours immobiles dans notre routine’! s’écria-t-il; quand je montrais qu’avec les nouvelles carabines on avait maintenant une artillerie à bras mille fois plus redoutable que nos grosses pièces, de la mitraille humaine qui passe partout, se divise ou se concentre au gré du chef, je n’ai pas été cru, et il faut que ce soient des Russes qui donnent l’exemple! Ainsi donc, à la fin du mois de mars, après avoir perdu durant l’hiver la moitié de nos soldats par la misère, nous sommes si peu avancés que les Russes, prenant l’offensive, d’assiégés sont devenus assiégeants; cela est triste. Tenez, Morris, il faudra bien que notre constance l’emporte; mais la boucherie sera terrible.
Les deux officiers avaient suivi, tout en causant, le chemin qui rejoignait la route de Woronzof: du point où ils étaient arrivés, on découvrait, à un quart de lieue en ligne droite du col de la route de Balaclava, la ferme où demeurait lord Raglan, et plus loin, séparant le plateau des attaques du siège, les collines couvertes par les bivouacs anglais, qui dominaient les campements du deuxième corps de l’armée française. Les tentes coniques des divisions anglaises faisaient facilement reconnaître l’em placement qu’elles occupaient. A la gauche, on apercevait la troisième division, puis, en remontant vers Inkerman, la quatrième et la seconde, celle-ci séparée de la division légère par la route Woronzof. Les quartiers du général Bosquet étaient placés à mille mètres en arrière de la deuxième division anglaise. Près de la division légère, un ancien moulin à vent, devenu un magasin à poudre, servait de point de repère pour retrouver le parc du génie et tout à côté le grand parc de l’artillerie anglaise, établis, au milieu même des troupes françaises, dans cette agglomération de régiments et de tentes qui faisaient ressembler cette partie du terrain à un champ de gigantesques pavots blancs.
Les devoirs du service attendaient déjà Otway à son arrivée au parc de siège. Il trouva en descendant de cheval une lettre du colonel Steel secrétaire militaire de lord Raglan, qui l’inyitait à se rendre sans retard au quartier général, et prenant à peine le temps de serrer la main à ses vieux compagnons réunis pour saluer son retour, il se mit aussitôt en route pour la ferme où demeurait le commandant en chef de l’armée anglaise.
Établi dans une maison de campagne qui avait appartenu avant la guerre à un entrepreneur de transports, le quartier général anglais se composait d’une grande cour ouverte dans la direction de l’est, au fond de laquelle s’élevait une maison à un seul étage. On y entrait par un petit escalier en pierre de six marches, et un perron garni de deux arbres, placés de chaque côté de la porté. A gauche de cet édifice, et le reliant avec les écuries, il y avait deux autres petites maisons occupées par l’état-major. De l’autre côté, un large passage donnait accès dans un jardin planté, de vignes et d’arbres fruitiers, entouré d’une muraille en pierres sèches de quatre pieds de haut. A chaque instant, dans cette cour gardée par un poste d’honneur, entraient des cavaliers d’ordonnance. Les messages s’échangeaient, les officiers s’éloignaient, les lettres, les ordres arrivaient et partaient; on sentait au mouvement qui né s’arrêtait jamais, qu’en ce lieu se trouvait l’âme de l’armée anglaise, le maître de toutes les volontés, le général en’ chef. Les chevaux de main tenus par des soldats de cavalerie française, le groupe d’officiers anglais et français fumant ensemble sur le perron, le fanion tricolore porté par un spahi en burnous rouge annonçaient, lorsqu’Otway arriva, la présence du général Canrobert. Le colonel Steel le pria d’attendre la fin de la conférence des deux généraux en chef: lord Raglan voulait lui parler, bien qu’il fût en ce moment très-occupé. La responsabilité qui pesait sur lui exigeait un travail immense, car depuis quelques semaines seulement l’organisation de l’armée anglaise venait de recevoir les nouveaux rouages sans lesquels le chef suprême ne peut assurer la marche régulière de toutes les branches du service. Levé chaque jour à six heures, lord Raglan écrivait jusqu’au déjeuner, à huit heures. En ce moment commençait le rapport; le quartier-maître-général, l’adjudant-général, le général en chef du génie, l’officier commandant l’artillerie royale, et trois ou quatre fois par semaine, suivant les circonstances, le commissaire-général et l’inspecteur général des hôpitaux ou le médecin en chef venaient conférer avec lui. La durée de ces conférences n’était pas limitée. Le général reprenait ensuite sa correspondance, recevait dans le milieu de la journée les officiers de tout grade qui avaient à lui parler, montait souvent à cheval, sans escorte, pour visiter les brigades ou les hôpitaux, et au retour il écrivait encore jusqu’au dîner, qui avait lieu vers huit heures, et où il invitait habituellement quelques officiers. En sortant de table, il traitait diverses affaires avec des personnes de son état-major, et ne se levait souvent de son bureau qu’aprè s minuit. Le nombre de lettres, de mémorandum, de notes, de rapports, qu’exige la coutume anglaise ne saurait se compter, et tel était, quand aucune circonstance extraordinaire ne venait pas nécessiter un surcroît d’efforts, l’ordre habituel des journées de lord Raglan, que l’on accusait parfois alors en Europe de négligence.
Si le général en chef avait ses heures prises, le secrétaire militaire, sur qui reposait le soin de tous les détails, l’expédition d’une multitude d’ordres et d’une correspondance plus nombreuse encore, était bien rarement libre, et comme l’on entrait à chaque instant dans son cabinet pour lui demander une explication ou un renseignement, Otway, qui n’avait pas besoin de l’entretenir, lui dit adieu. Il s’en allait sur le perron rejoindre les officiers, quand un bras se posa sur le sien, et, se retournant, il reconnut Harry Melton, un capitaine des ingénieurs royaux pour lequel il avait beaucoup d’amitié.
–Laissons les Français, lui dit Harry on l’emmenant dans la cour, s’appeler mon colonel et mon commandant, gesticuler, rire de ce qu’ils disent, mesurer leurs paroles et leurs manières aux grades de ceux qui les écoutent. Venez avec moi, je vous appellerai mon cher, et nous resterons gentlemen, quitte à retrouver la différence de grade dans la tranchée.
–Tant que vous voudrez, mon cher ami, dit le colonel, qui ne put s’empêcher de sourire de cette boutade d’autant plus juste que, le service une fois terminé, on ne connaît dans l’armée anglaise aucune distinction hiérarchique. Il n’y a plus que des gens de bonne compagnie, entre lesquels une même situation sociale crée une parfaite égalité de rapports.–Vous vivez, Melton, ajouta-t-il, vous êtes sur vos jambes, vous paraissez de belle humeur. Je m’en réjouis, car, en revenant ici, on ne sait jamais dans quel état l’on va retrouver ceux que l’on aime.
–Ma jambe a supporté à merveille, répondit Melton, l’égratignure qu’il a plu aux Russes de lui envoyer.
–Tant mieux, il nous faut de bons officiers, Harry, et les rangs se sont bien éclaircis pendant mon absence. Presque tous nos chefs sont morts, blessés ou malades. Le duc de Cambridge, le comte de Cardigan, sir George Cathcart, sir de Lacy Evans, sir George Brown, lord de Ross, ne sont plus parmi nous.
–Sir George Brown est remis de ses blessures; on l’attend chaque jour.
–J’en suis heureux. Sir George Brown est un noble cœur et un brave soldat. Vous ne sauriez croire, Melton, la tristesse dont j’ai été pris ce matin en voyant ces jeunes figures qui ont remplacé nos vieux compagnons. Parmi tous ces officiers que j’ai rencontrés depuis Balaclava, je n’ai pas trouvé un seul visage auquel il m’eût été possible de donner un nom. Nos pertes ont été bien cruelles.
Les officiers qui se trouvaient sur le perron s’écartèrent en ce moment avec respect et firent place au général Canrobert et à lord Raglan. qui le reconduisait. Le général français paraissait soucieux, mais malgré les fatigues dont sa physionomie portait l’empreinte, il conservait toujours cet air de bonté et de loyauté martiale qui le rendait si sympathique. Atteint au coude par une balle à Inkermann, son bras était presque paralysé, et il ne parvint qu’avec peine à se mettre en selle en se faisant aider par le spahi qui lui amenait son cheval. Lord Raglan resta sur le perron jusqu’à ce que le général Canrobert se fut éloigné; puis, se tournant vers le colonel Otway, il lui fit signe d’approcher. Le général en chef de l’armée anglaise avait en toute sa personne une dignité polie qui ne manquait point de grandeur. On voyait parfois un sourire calme passer sur ses lèvres, d’où ne sortait jamais une parole de colère. La façon pourtant dont il portait la tête indiquait un homme qui savait regarder froidement le péril, et le bras qu’il avait perdu à Waterloo, en rappelant le courageux sang-froid qu’il avait déployé dans ces luttes héroïques, ajoutait encore à l’aspect énergique de ce vaillant soldat. Son teint était mat, son nez aquilin, ses traits accentués, mais sans maigreur, ses manières pleines d’aisance. Esprit positif et ferme, lord Raglan manquait de ces élans qui devinent, de ces ardeurs qui entraînent. Il avait la constance, dans les grandes comme dans les petites choses, cédait bien rarement, et son caractère, comme il arrive parfois, gardant l’empreinte des longues années durant lesquelles il avait été le second du duc de Wellington, avait peut-être perdu son initiative, en sorte qu’avec les plus nobles qualités on pouvait se demander si ce parfait gentilhomme et ce valeureux soldat savait oser et vouloir, comme il convient à un général en chef.
–Bonjour, Otway, dit le vieux lord, qui paraissait content de le revoir; votre blessure est complétement guérie?
–Oui, mylord, répondit le colonel; mon corps est prêt, et ma tête vous appartient depuis longtemps, vous le savez.
–Nos Turcs envieraient vos paroles, mon cher Otway. Venez avec moi, a jouta-t-il en donnant à sa voix une expression sérieuse.
Lord Raglan, après avoir traversé un étroit couloir, ouvrit la porte d’une grande pièce servant de salle du conseil. Les vitres des deux fenêtres sans rideaux qui l’éclairaient laissaient voir des champs de vigne, des arbres fruitiers, sur la hauteur opposée un bivoua d’artillerie et de cavalerie anglaises, et vers la droite, à quinze pas de la petite muraille de clôture, le cimetière qui contenait déjà plusieurs tombes. La terre était boueuse, jaune, et à certaines places elle avait des reflets rougeâtres. Ce paysage triste et morne augmentait encore l’impression pénible que l’on éprouvait en entrant dans cette chambre, dont l’enduit de chaux, en s’écaillant, semblait avoir taché la muraille. Il s’y trouvait une cheminée grossière, et pour tout ameublement une seule table couverte d’un tapis de laine, une chaise et quelques escabeaux de bois.
Appuyé contre la fenêtre, lord Raglan se tenait debout et paraissait réfléchir. Il gardait le silence et suivait les nuages chassés par un rude vent d’ouest.
–Voilà notre plus grand ennemi! dit-il en montrant le ciel; la rigueur du temps nous a fait cruellement souffrir. Vous m’avez apporté, n’est-ce pas, les informations que je vous ai fait demander?
–Oui, mylord.
–C’est bien, j’attends de votre dévouement un nouveau service. Il était de mon devoir de m’entourer de tous les renseignements qui peuvent satisfaire le désir que nos alliés expriment de tenir la campagne au printemps; mais cette guerre ne ressemble à aucune autre, et bon gré, mal gré, il faudra continuer l’attaque de front contre la ville. Seulement il faut y entrer, puisque l’imagination du monde donne un prix exagéré à ces murailles. L’artillerie est appelée, je le pense, à jouer dans cette lutte le premier rôle. C’est un duel à coups de canon dont l’importance grandira chaque jour. Le soin de nos batteries et de notre matériel de siège vous revient. Je mets l’honneur de nos armes en vos mains. Toutefois, je vous demanderaiai d’être prudent et de ne pas vous exposer. Je vous l’ordonne, entendez-le bien. Ne cherchez pas le danger. Trop de braves officiers sont déjà morts ici.– Et la voix du vieux chef avait un accent plein d’émotion. J’ai votre promesse, n’est-ce pas?
–Votre désir, mylord. est un ordre, répondit simplement Otway.
–Demainin donc, reprit lord Raglan, vous passerez une inspection minutieuse de toutes les batteries. Examinez avec attention les travaux de la place. Les Russes ont un ingénieur d’une habileté rare. Les ordres sont déjà donnés pour le transport des munitions aux batteries; il importe qu’elles soient assez largement approvisionnées pour que nous ne soyons pas les premiers à diminuer notre tir. Et maintenant, ajouta-t-il en lui tendant la main, que Dieu vous garde!
En quittant lord Raglan, Otway trouva dans la cour lord Dover, le vaillant colonel du38e, qui restait à cheval tout en causant avec Harry Melton.
–On vient de m’apprendre votre arrivée, dit Dover à Otway en lui serrant la main, et bien que lady Dover m’attendeje n’ai point voulu partir sans vous féliciter de votre bon retour. Tous nos camarades, mon ami, s’en réjouiront avec moi, et lady Dover partagera leur contentement. Ce matin même, elle me demandait, si nous allions bientôt vous voir.– Et comme Otway le remerciait du bon souvenir et le priait de présenter ses respectueux devoirs à lady Dover:–Je ne me charge point du message, répondit-il. Vous êtes condamné à venir prendre le thé demain soir à son cottage de Karani. Melton, prévenez Morris et le docteur, si vous les rencontrez avant moi.
Puis, rendantt les rêneà son cheval, il partit au galop.
–Point d’excuses, dit-il encore, en se retournant sur sa selle, je n’écoute rien, lady Dover ne me le pardonnerait pas.
–Comment a-t-elle pu s’habituer à cette vie, mon cher Melton? demanda Otway en regardant lord Dover s’éloigner.
–Avec un courage et une bonne humeur sans pareils. Sur ce triste plateau, elle avait une aimable parole pour chacun de nous, et lorsqu’elle passait, un bon regard pour les soldats. Pour ces hommes que le danger ennoblit, sa présence est devenue un gage de victoire. Vous riez de mon enthousiasme, et peut-être avez-vous raison, mais je ne suis pas seul à le partager. Interrogez les soldats, surtout ceux de Dover, vous verrez s’ils ne vous parlent pas de leur belle lady comme les anciens parlaient de la bonne déesse. Est-ce parce que nous sommes près de ces terres qui inspirèrent la mélancolie d’Ovide? Je ne sais, mais en vérité tous sont convaincus, en la voyant s’avancer sur son cheval favori, un cheval turcoman noir, à tout crin, qui semble en belle humeur de la porter, qu’elle s’en va dans nos rangs semant la bonne chance, et, si elle nous quittait, l’armée croirait avoir perdu son talisman.
–Et comment a-t-on pu parvenir à la loger?
–Une vieille maison que les matelots du yacht de lord Dover ont réparée lui sert de demeure. Elle vous dira demain qu’elle s’y trouve mieux que dans son palais de Piccadilly, et qu’elle ne songe guère à la saison de Londres qui va commencer.
–A coup sûr, elle doit être fière de son mari.
–C’est un héros de l’antiquité. Croiriez-vous qu’il continue à rester au bivouac, sous la tente, avec son régiment?
–Il n’a pas tort.
–Peut-être, mais je n’en ferais pas autant.
–J’en suis convaincu, mon ami. A demain donc, mon cher Melton. Nous dînerons ensemble; je serai bien aise de causer avec vous après avoir terminé l’inspection de nos batteries, et vous me montrerez ensuite la route, car vous devez être un excellent guide, et ne jamais vous égarer en allant à Karani.