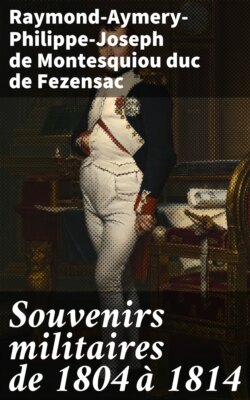Читать книгу Souvenirs militaires de 1804 à 1814 - Raymond-Aymery-Philippe-Joseph de Montesquiou duc de Fezensac - Страница 8
MARCHE EN ALLEMAGNE.—COMBAT DE GUNTZBOURG.—PRISE D'ULM.
ОглавлениеLa troisième division partit du camp de Montreuil le 1er septembre[4]. Les deux premières nous avaient précédés à un jour de distance. Ces deux jours furent précieux au moment d'un départ si précipité. Nous marchions par division, la gauche en tête; ainsi les 59e régiment, 50e, 27e et 23e léger. Rien ne fatigue plus les troupes que la marche par division. Il faut de la place pour loger huit mille hommes, et, après une longue route, les compagnies se trouvaient souvent obligées d'aller chercher par des chemins de traverse et à d'assez grandes distances le village qu'on leur assignait.
Le 59e étant tête de colonne, M. le chef de bataillon Silbermann commandait l'avant-garde, dont je faisais partie le jour du départ avec un autre sous-lieutenant. J'étais en retard, et mon camarade m'avait imité. L'avant-garde se trouvait bien loin quand nous allâmes présenter nos excuses au commandant, qui nous répondit avec son sang-froid alsacien: Messieurs, je ne me fais jamais attendre et je n'attends jamais personne; vous garderez les arrêts. Rien ne me contraria plus que cette punition au début d'une campagne. Elle me parut un triste souvenir du passé, un sinistre présage pour l'avenir.
En vingt-six jours, la division atteignit les bords du Rhin à Seltz, au-dessous de Strasbourg, en passant par Arras, La Fère, Reims, Châlons, Vitry, Saint-Dizier, Nancy et Saverne. Nous marchions dans le plus grand ordre par le flanc, sur trois rangs, les officiers constamment avec leurs compagnies. Un jour que j'étais resté en arrière un quart d'heure pour achever de déjeuner à la halte, mon capitaine me dit que lui-même ne se serait pas permis ce que je venais de faire. Quand les officiers donnent un pareil exemple, on peut être sûr que tout va bien. Aussi le passage d'une armée aussi nombreuse ne donna lieu à aucune plainte. Il y avait dans nos régiments beaucoup de conscrits qui supportèrent admirablement cette longue marche; il y eut peu de malades, point de traînards, et les hommes à qui l'on accorda des congés pour aller voir un instant leur famille, rentrèrent tous avant le passage du Rhin.
J'avais espéré moi-même une permission pour revoir mes parents après un an d'absence et au moment d'entrer en campagne. Mon colonel l'avait promis à ma mère, et je le vis avec surprise, le second jour de route, partir pour Luxembourg, dépôt du régiment, sans me parler de rien. Il nous rejoignit, le 15, à Saint-Dizier, et j'appris la cause de cette rigueur. Le second jour de marche j'étais de service à l'arrière-garde, corvée fort ennuyeuse, car on doit faire filer devant soi tous les bagages. Je causais avec une cantinière à la fin d'une longue étape, et comme elle me dit qu'elle se sentait fatiguée et un peu souffrante, je lui offris mon bras sans y penser et comme à une dame de Paris. Le général Malher nous vit et félicita mon colonel sur la galanterie des officiers qui donnaient le bras aux cantinières. Il n'en fallait pas tant pour exciter sa colère. Après m'avoir vivement reproché mon étourderie, il me dit que cette sottise l'avait empêché de me donner plus tôt une permission, mais que mes parents ne pouvaient pas être punis pour ma faute; que j'allais partir pour Paris, à la condition d'être de retour pour le passage du Rhin, le 26. Ainsi, en douze jours, il fallait faire deux cents lieues en poste, car je ne pouvais pas perdre un des instants consacrés à ma famille. N'ayant point de voiture, je prenais à chaque poste un cabriolet, une carriole, une petite charrette, où l'on attelait un cheval; le postillon assis à côté de moi, courant ainsi jour et nuit sans arrêter, prenant à peine le temps de manger. Mon arrivée à Paris fut un jour de fête pour ma famille et pour moi.
Il faudrait avoir passé un an au camp pour comprendre ce que j'éprouvai à Paris. Ce séjour me parut enchanté, je croyais rêver; et pourtant, en me retrouvant dans le lieu où j'avais passé mon enfance, je me demandais quelquefois si le camp de Montreuil n'était pas plutôt un mauvais rêve. Quelqu'un disait qu'en lisant Homère, les hommes lui paraissaient avoir six pieds de haut. On peut dire aussi que les gens bien élevés semblent des êtres d'une autre nature, des espèces de génies supérieurs aux hommes. La toilette des femmes, la conversation, le ton, les manières me transportaient dans un nouveau monde. On avait fort approuvé le parti que j'avais pris, et qui était déjà couronné de succès, puisque j'étais officier. D'ailleurs, M. Lacuée étant l'ami de la maison, le numéro du régiment augmentait encore l'affection qu'inspirait le jeune sous-lieutenant. Ces moments de bonheur durèrent peu. Arrivé à Paris le 17 septembre, j'en devais partir de manière à arriver sur le Rhin le 26.
Mon voyage eut lieu, comme je l'ai dit, en charrette de poste, jour et nuit; il fallait mon âge et ma santé pour supporter de pareilles épreuves. On attendait l'Empereur, et c'est à peine si je pouvais obtenir le seul cheval dont j'avais besoin. Quelquefois un voyageur demandait la permission de monter avec moi; j'y consentais, pourvu qu'il donnât quelque chose au postillon et que la rapidité de la course ne fût point ralentie.
J'arrivai à Seltz le 26, veille du passage du Rhin; mais dans quel équipage! J'avais acheté à Paris tout ce dont j'avais besoin; on le mit à la diligence. La, rapidité de notre marche et notre changement de direction m'empêchèrent de le recevoir. Je passai le Rhin avec une épaulette et une épée d'emprunt. C'est ainsi que j'ai toujours manqué de tout dans le cours de ma carrière. J'ai été sergent-major sans argent pour payer le prêt, voyageur en poste sans voiture, officier sans épaulette ni épée, aide de camp sans chevaux. Je suis venu à bout de toutes ces difficultés, en les bravant hardiment, en ne doutant jamais ni de moi ni de la Providence. La division passa le Rhin le 27 sur un pont de bateaux, entre Seltz et Lauterbourg. Ce passage fut une véritable fête. Les soldats portaient de petites branches d'arbres à leurs habits, en guise de lauriers. Nous défilâmes de l'autre côté du Rhin, devant les généraux, au cri de: Vive l'Empereur!
Le 30, le corps d'armée se réunit à Stuttgard, en passant par Carlsruhe et Prorsheim. Nous y séjournâmes jusqu'au 3 octobre.
Il faut maintenant raconter la position de l'ennemi, expliquer les projets de Napoléon. On verra ensuite quelle part fut réservée au sixième corps, dans leur exécution, quel rôle joua le 59e dans les opérations du corps d'armée, enfin la part très-minime que j'ai prise aux exploits de ce régiment.
La coalition formée par les Anglais, les Autrichiens, les Russes, les Suédois et les Napolitains, espérait attirer les Bavarois, tout le reste de l'Allemagne et la Prusse elle-même. Plusieurs attaques se préparaient par la Poméranie, la Lombardie et le midi de l'Italie. La seule dont j'aie à m'occuper devait suivre la vallée du Danube; elle était confiée aux Autrichiens et aux Russes, mais les Russes étaient en arrière. Si l'armée autrichienne se fût portée à leur rencontre, elle eût découvert l'Allemagne, que Napoléon aurait envahie et forcée de se joindre à lui. Le général Mack, qui commandait l'armée autrichienne, résolut de le prévenir; il traversa la Bavière et vint prendre position, la droite à Ulm, la gauche à Memmingen, couvert par l'Iller. Il supposait que Napoléon l'attaquerait de front par les défilés de la forêt Noire, entre Strasbourg et Schaffouse; il comptait pouvoir se défendre avantageusement dans la forte position qu'il avait prise; et, en supposant même qu'il fût vaincu, il opérerait sa retraite en se rapprochant des Russes. Il avait détaché le général Kienmeyer à Ingolstadt pour observer les Bavarois et se lier avec les Russes qu'on attendait par la route de Munich.
Mais Napoléon forma un tout autre plan. Il ne se proposait pas de battre les Autrichiens, mais de les envelopper et de les détruire, pour marcher lui-même au-devant des Russes. Il organisa son armée en sept corps, et lui donna pour la première fois le nom de Grande Armée, ce nom devenu si célèbre. Chaque corps d'armée se composait de deux ou trois divisions d'infanterie, d'une brigade de cavalerie et d'un peu d'artillerie. Le maréchal Bernadotte commandait le premier, Marmont le deuxième, Davout le troisième, Soult le quatrième, Lannes le cinquième, Ney le sixième, Augereau le septième. La grosse cavalerie, composée de carabiniers, de cuirassiers et de dragons, était réunie en un seul corps, que commandait habituellement le prince Murat; la garde impériale formait la réserve. La Grande Armée présentait une masse de cent quatre-vingt-six mille combattants, à laquelle allaient bientôt se joindre vingt-cinq mille Bavarois, huit mille Badois et Wurtembergeois, car l'électeur de Bavière, après beaucoup de perplexité, avait fini par s'unir franchement à la France.
Voici les dispositions que prit Napoléon pour exécuter son plan:
Le 23 septembre, Murat avec une partie de la cavalerie et quelques bataillons du cinquième corps, paraissant faire l'avant-garde de l'armée, passa le Rhin à Strasbourg et se présenta aux défilés de la forêt Noire, pour faire croire au général Mack qu'il allait être attaqué de ce côté; les fausses nouvelles, les achats de vivres, rien n'avait été négligé pour confirmer son erreur. Pendant ce temps, les corps de la Grande Armée franchissaient le Rhin de la droite à la gauche: le sixième à Lauterbourg; le quatrième à Spire; le troisième à Manheim; les premier et deuxième arrivèrent de la Hollande et du Hanovre à Wurtzbourg. Tous ces corps se dirigeaient sur le bas Danube, pour le passer à Donauwerth, s'emparer du pays situé entre le Lech et l'Iller, forcer le passage de cette rivière, afin d'investir Ulm par la rive droite; le maréchal Ney, avec le sixième corps, devait rester sur la gauche et s'approcher d'Ulm le plus possible.
Ainsi, nous partîmes de Stuttgard le 3 octobre pour suivre la grande route d'Ulm. La troisième division logea pendant deux jours dans de mauvais villages. Le 5, au soir, avant d'arriver à Geislinigen, elle tourna à gauche pour suivre le mouvement des autres corps, sur le bas Danube. Nous marchâmes la nuit et la journée suivante avec quelques moments de repos, et sans manger. L'Empereur avait ordonné de faire porter aux soldats du pain pour quatre jours, et d'avoir pour quatre jours de biscuit dans les fourgons. Je ne sais ce qui avait lieu dans les autres corps, mais, quant à nous, nous n'avions rien; et comme le 59e marchait le dernier par son ordre de numéro, il n'arriva qu'à l'entrée de la nuit au bivouac près de Giengen, ville où logeait le général Malher. Le colonel lui dit que son régiment arrivait après une marche de trente-six heures, et lui demanda la permission de faire une réquisition de vivres. Le général refusa, parce qu'il avait promis de ménager la ville, mais c'était autoriser tous les désordres: aussi les villages environnants furent saccagés; et le premier jour de bivouac devint le premier jour de pillage. Le colonel, qui mourait de faim lui-même, trouva les grenadiers faisant rôtir un cochon. Sa présence causa d'abord de l'embarras; au bout d'un instant, un grenadier plus hardi lui offrit de partager leur repas, ce qu'il fit de grand cœur, et le pillage se trouva autorisé.
Le lendemain 7 nous bivouaquâmes près d'Hochstedt. Ce même jour, le maréchal Soult passait le Danube à Donauwerth. Le maréchal Ney reçut l'ordre de revenir sur ses pas pour se rapprocher d'Ulm, et de s'emparer des ponts de Guntzbourg et de Leipheim, afin de resserrer la place et de faciliter la communication entre les deux rives.
La troisième division fut chargée de cette opération. Il fut impossible d'aborder le pont de Leipheim, à cause des marais impraticables qui l'entouraient. Le général Marner, avec la brigade Marcognet, entreprit l'attaque du grand pont de Guntzbourg en face de la ville. Le lit du Danube, en cet endroit, est coupé par différentes îles; elles furent toutes enlevées avec résolution. Mais il fut impossible de franchir le grand bras du Danube, qui touche à la ville. Une travée du pont avait été détruite, et les travailleurs, exposés aux coups des Autrichiens placés de l'autre côté du fleuve, ne purent réussir à rétablir le pont. Il fallut se retirer dans les îles boisées et renoncer à cette opération, qui avait déjà coûté près de trois cents hommes.
Le général Labassée, avec le 59e, reçut l'ordre d'enlever un autre pont situé au-dessous de Guntzbourg[5]. Le régiment arriva, le 8, fort tard à la petite ville de Gundelfingen. La journée fut pénible; plusieurs soldats, fatigués par les marches précédentes, restèrent en arrière. Le colonel assembla les sergents-majors et leur parla vivement sur le devoir pour des militaires de supporter sans se plaindre la fatigue, le manque de nourriture et tous les genres de souffrances. Il ne suffit pas d'être braves, ajouta-t-il, nous le sommes tous, et moi-même, je puis être tué demain; paroles, hélas! bien tristement prophétiques. Le lendemain 9, le deuxième bataillon marchait en tête; le soir, pour la première fois, nos conscrits parurent devant l'ennemi; les tirailleurs chassèrent les Autrichiens des bois qui sont en avant du pont; ce pont lui-même fut enlevé au pas de charge. Le colonel plaça en réserve à l'entrée du pont les trois dernières compagnies du premier bataillon: c'étaient les sixième, septième et huitième[6]; la mienne était la septième. Nous gardâmes longtemps cette position, fort impatientés de ne pouvoir partager la gloire et les dangers de nos camarades. Lefèvre, adjudant du bataillon, nous tenait compagnie. Vous me voyez à mon poste, me dit-il, au demi-bataillon de gauche. C'est en effet la place de l'adjudant; mais je ne pus m'empêcher de penser que lorsqu'il y avait en avant un bon château, l'adjudant ne gardait pas si scrupuleusement son poste[7]. Là, nous vîmes quelques blessés et un assez bon nombre de prisonniers, que la huitième compagnie fut chargée de conduire à Gundelfingen. À l'entrée de la nuit, nous eûmes enfin l'ordre de rejoindre le régiment. Le pont étant à moitié coupé, on ne pouvait passer qu'homme par homme. Quand vint notre tour de suivre la sixième compagnie, mon capitaine passa et se mit à courir sans regarder derrière lui; le premier sergent, les soldats le suivirent comme ils purent. Pour moi, j'oubliai en cette occasion que le premier soin d'un jeune officier qui débute devant l'ennemi doit être d'établir sa réputation; je ne pensai qu'au succès de l'affaire, et au lieu d'agir en sous-lieutenant, je me mis à faire le général. Je crus qu'il fallait, avant tout, faire passer les soldats, et comme la nuit venait, que la compagnie se trouvait la dernière, beaucoup d'hommes pouvaient rester en arrière; je les fis donc tous passer devant moi, et je passai ainsi moi-même le dernier du régiment. Aussi, quand je rejoignis mon capitaine sur le terrain, il se mit à rire, et ce rire voulait dire: Vous voilà, j'y comptais; mais il commençait à être temps. Je n'ai compris cela que longtemps après.
Nous trouvâmes le régiment assez en désordre. Il avait résisté aux charges de cavalerie, comme au feu de l'infanterie, et cette journée lui fit beaucoup d'honneur. Pour dire la vérité, je ne crois pas que les attaques de l'ennemi aient été bien vives. Je trouvai les officiers agités et inquiets, s'occupant d'encourager les soldats et de tâcher de remettre de l'ordre, les compagnies se trouvant mêlées; car, comme je l'ai dit, il avait fallu passer le pont un à un, et en arrivant dans la plaine recevoir les coups de l'ennemi avant d'avoir le temps de se mettre en défense. Je suis persuadé qu'il y eut un moment où une attaque à la baïonnette et une charge de cavalerie sur nos flancs nous eussent ramenés et précipités dans le Danube. Dans cette situation, nos deux compagnies de réserve auraient pu être d'un grand secours. Mais les capitaines, pressés de se rendre sur le champ de bataille, n'avaient point voulu se donner le temps de les former après le passage du pont, et le régiment les eût entraînées dans sa déroute. Heureusement, il faisait nuit, les Autrichiens ignoraient notre petit nombre, et je crois même qu'ils ne combattirent que pour assurer leur retraite. Le feu cessa bientôt; le 50e vint nous rejoindre, et il est à regretter qu'il ne soit pas venu plus tôt. Nous passâmes la nuit sous les armes, sans allumer de feu. J'ai appris alors que le colonel avait reçu une blessure grave; il mourut quand on le transportait de l'autre côté du pont. Son dernier mot fut d'ordonner à l'officier qui le conduisait de le laisser mourir et de retourner au combat. Au point du jour, nous entrâmes dans Guntzbourg, que l'ennemi avait évacué; nous y prîmes quelques heures de sommeil.
La perte du colonel Lacuée fut vivement sentie dans l'armée et particulièrement dans son régiment. Ceux qui l'aimaient le moins, ceux que lui-même traitait le plus sévèrement, rendaient justice à ses belles et nobles qualités. Il fut enterré le jour même dans le cimetière de Guntzbourg: les régiments qui se réunissaient dans cette ville y assistèrent; mon capitaine prononça un petit discours que je regrette de n'avoir pas conservé. Le colonel Colbert, ami particulier de Lacuée, voulut avoir sa dragonne, et par un souvenir tout militaire de son affection il se promit bien de donner avec elle un bon coup de sabre, et il a bien tenu parole. Pour moi, je n'ai pas besoin de dire que j'en éprouvai une vive douleur. Il m'avait témoigné la tendresse d'un père; je lui devais ma nomination d'officier, et la lettre que j'écrivis ce jour-là même à ma mère fut souvent interrompue par mes larmes.
Dans cette première affaire, chacun donna des preuves de son caractère, de sa bravoure et quelquefois de sa faiblesse. Le capitaine Villars ne manqua pas l'occasion de faire une gasconnade; nous le retrouvâmes blessé dans une maison de Guntzbourg. Il nous raconta qu'il avait été renversé par terre et qu'on lui donnait des coups de sabre et de baïonnette. Je riais en moi-même, ajoutait-il, et je me disais: Ils sont bien attrapés; ils croient que je vais me rendre, et je ne me rendrai pas. On le fit prisonnier cependant, mais comme le général Cambronne à Waterloo, lorsqu'il ne fut plus en état de se défendre. Le sergent Décours, mon ancien camarade, alors sergent-major, se conduisit de la manière la plus brillante. Il reçut une légère blessure et fut nommé légionnaire. La première affaire est une épreuve pour les jeunes gens. Un sergent de ma connaissance se cacha, et ne fut pas le seul[8]. Chaque compagnie avait à cet égard une histoire à raconter. Les affaires de nuit sont commodes; on se perd dans les bois, on tombe dans un ruisseau, et j'ai admiré dans le cours de ma carrière militaire le talent de gens qui s'esquivent toujours au moment du danger, et toujours sans se compromettre.
Le régiment eut à l'affaire de Guntzbourg douze hommes tués, en comptant le colonel et deux sous-lieutenants, et une quarantaine de blessés, y compris le capitaine Villars. M. Silbermann, le plus ancien des deux chefs de bataillon, prit le commandement du régiment.
Pendant ce temps les autres corps d'armée passaient le Danube sur plusieurs points, occupaient le pays compris entre l'Iller et le Lech. Un brillant combat eut lieu, le 8, à Westingen; le maréchal Soult entra le même jour à Augsbourg: le maréchal Bernadotte, ayant terminé sa longue marche, s'approchait de Munich. Napoléon, qui était resté plusieurs jours à Donauwerth (les 7, 8 et 9), se rendit à Augsbourg, pour apprendre des nouvelles de l'armée russe et diriger les mouvements de tous les corps d'armée. Il laissa dans les environs d'Ulm le maréchal Ney, le maréchal Lannes et le prince Murat, en donnant le commandement à ce dernier. Cette faveur, que Murat devait à son titre de prince et à l'honneur d'être beau-frère de l'Empereur, déplut beaucoup aux deux maréchaux, qui ne s'entendirent point avec lui. Depuis la prise du pont de Guntzbourg, nous nous trouvions maîtres des deux rives du Danube; le général Dupont occupait seul la rive gauche, en position à Albeck. Le maréchal Ney voulait le soutenir avec les deux autres divisions du 6e corps; et bientôt l'événement lui donna raison. Dupont, qui avait ordre de s'approcher d'Ulm, et qui se croyait appuyé, se trouva avec six mille hommes en face de soixante mille Autrichiens; il eut l'audace de commencer l'attaque, ce qui fit croire aux Autrichiens que sa division formait l'avant-garde de l'armée. Après avoir soutenu toute la journée un combat inégal, il se retira le soir à Albeck, emmenant quatre mille prisonniers. Mais les Autrichiens pouvaient renouveler l'attaque avec toutes leurs forces, écraser la division Dupont et nous échapper en se retirant en Bohême. Si l'Empereur avait ordonné de s'emparer des ponts de Guntzbourg, il n'avait point prescrit au 6e corps de rester sur la rive droite. Cette rive était assez bien gardée par tous les corps d'armée; toutefois le prince Murat s'obstina à nous laisser sur la rive droite, et l'Empereur, arrivant d'Augsbourg le 13 au matin, donna raison au maréchal Ney. Il lui reprocha seulement d'avoir laissé la division Dupont s'engager témérairement sur les hauteurs d'Ulm. Maintenant, pour réparer la faute commise et repasser sur la rive gauche, l'Empereur ordonna au maréchal Ney de s'emparer du pont et des hauteurs d'Elchingen situés au-dessus de Guntzbourg, à environ 7 kilomètres d'Ulm. Cette opération offrait le double avantage de resserrer la place et de frapper le moral des ennemis par un nouveau triomphe. Mais l'entreprise offrait des difficultés. Les travées du pont avaient été enlevées. Il fallait les rétablir sous un feu meurtrier, enlever ensuite le village et le couvent situés sur une hauteur. Le maréchal Ney entreprit cette opération avec la plus grande vigueur. Il était mécontent de quelques reproches de l'Empereur, plus mécontent encore d'un propos du prince Murat, qui, quelques jours auparavant, ennuyé de ses explications, lui avait dit qu'il ne faisait jamais de plans qu'en présence de l'ennemi. Le matin, le maréchal Ney, au moment de l'attaque, lui prit le bras et lui dit en présence de l'Empereur et de tout l'état-major: Prince, venez faire avec moi vos plans en présence de l'ennemi; et il se précipita au milieu du feu. La 1re division, qui n'avait rien fait encore, fut chargée de cette opération et s'en acquitta de la manière la plus brillante. Le pont fut réparé tant bien que mal, et franchi aussitôt; le village et le couvent enlevés, la cavalerie dispersée, les carrés enfoncés. L'ennemi se retira sur les hauteurs du Michelsberg, qui défendent les approches de la place d'Ulm.
Nous marchions en réserve ce jour-là, et nous voyions revenir les blessés, soit à pied, soit sur des charrettes. Ce spectacle est pénible pour un régiment qui compte beaucoup de conscrits, et le dispose mal à entrer en ligne à son tour. Un vieux soldat les amusait en leur disant que nous étions loin encore, puisque les musiciens se trouvaient à notre tête. Au même instant, nous en vîmes revenir deux; ce fut une joie générale.
Le même jour, le général Dupont avait rencontré le corps du général Werneck, sorti d'Ulm pour tâcher de trouver une direction par laquelle l'armée autrichienne pût opérer sa retraite. Le général Dupont le battit et l'empêcha de rentrer dans la place.
Le lendemain 15 vit compléter l'investissement. Le maréchal Ney enleva les hauteurs du Michelsberg, le maréchal Lannes celles du Frauenberg, qui toutes deux dominent la place. On s'avança jusque sur les glacis, et même un bastion fut un instant occupé; mais l'attaque était prématurée, et il fallut se retirer. L'Empereur remit au lendemain la capitulation ou l'assaut.
Qu'aurait donc pu faire le général Mack pour éviter d'être réduit aune pareille situation? Il est certain qu'en s'y prenant à temps, il aurait pu essayer de gagner le Tyrol par la rive droite du Danube, ou mieux encore la Bohême par la rive gauche. L'archiduc Ferdinand, qui commandait une division de l'armée, le voulait. Il obtint du moins la permission de sortir pour son compte; et le 14 au soir, jour de la bataille d'Elchingen, il alla joindre le général Werneck, ce qui privait le général Mack de vingt mille hommes, et le réduisait à trente mille. Murat fut chargé de les poursuivre avec la division Dupont, les grenadiers Oudinot et la réserve de cavalerie. En quatre jours il dépassa Nuremberg, en passant par Meustetten, Heidenheim, Neresheim et Nordlingen; chaque jour fut marqué par un combat, ou plutôt par un triomphe. Le général Werneck fut forcé de capituler; l'archiduc Ferdinand se sauva en Bohême avec deux mille chevaux. Jamais on ne vit une telle rapidité, jamais une suite de succès si éclatants.
Il ne restait plus au malheureux général Mack qu'à capituler avec ses trente mille hommes. Mack ne pouvait obtenir d'autre condition que celle de mettre bas les armes. Les soldats devaient être conduits en France, les officiers rentreraient en Autriche avec parole de ne pas servir. Tout le matériel était livré à l'armée française. Le général Mack conservait jusqu'au dernier moment l'espoir d'être secouru, soit par l'armée russe, soit par l'archiduc Charles, opposé en Italie au maréchal Masséna. Il ne pouvait renoncer à cette pensée, qui l'avait engagé à se tenir enfermé dans Ulm, sans essayer de se faire jour à travers l'armée française, quand il en était temps encore. À peine les assurances les plus positives et la parole donnée par le maréchal Berthier furent-elles suffisantes pour lui prouver que, d'après les positions respectives des armées, tout secours était impossible. Il fut donc convenu que la place serait remise le 25 octobre à l'armée française, si elle n'était pas secourue à cette époque; cela faisait huit jours depuis le 17, époque de l'ouverture des négociations. Mais le 19, Napoléon, ayant appris la capitulation du général Werneck, représenta au général Mack que ce délai était parfaitement inutile et ne faisait que prolonger les souffrances et les privations des deux armées. Il obtint que la place fût rendue le lendemain 20, à condition que les troupes du maréchal Ney ne sortiraient point d'Ulm avant le 25. Ce fut une coupable faiblesse et bien inexcusable, car on ne pouvait, exiger de lui que d'exécuter la capitulation; et avec un adversaire tel que Napoléon, il n'était pas indifférent de gagner quatre jours. Quoi qu'il en soit, cette clause nous a privés de l'honneur d'être à Austerlitz.
Ainsi, le 20 octobre, la garnison d'Ulm, au nombre de vingt-sept mille hommes, dont deux mille de cavalerie, sortit avec les honneurs de la guerre, et défila entre l'infanterie et la cavalerie françaises. Napoléon était en avant de l'infanterie, et assista pendant cinq heures à ce beau triomphe. Il fit appeler successivement tous les généraux autrichiens, conversa avec eux, leur témoigna beaucoup d'égards, mais en s'exprimant durement et avec menaces sur la politique de l'empereur d'Autriche.
J'ai toujours regretté de n'avoir point assisté à cette belle journée. J'avais été envoyé, deux jours auparavant, dans un village pour une réquisition de bestiaux, et c'est à peine si je pus arriver à Ulm le 22.
Tel fut le résultat de cette campagne si courte et si brillante. On croit rêver quand on pense que le 1er septembre nous étions encore au camp de Boulogne, et que, le 20 octobre, soixante mille Autrichiens se trouvaient en notre pouvoir, avec dix-huit généraux, deux cents bouches à feu, cinq mille chevaux et quatre-vingts drapeaux.
Je n'ai pas voulu interrompre ce récit très-succinct des opérations, et j'y ajoute maintenant quelques réflexions.
Cette courte campagne fut pour moi comme l'abrégé de celles qui suivirent. L'excès de la fatigue, le manque de vivres, la rigueur de la saison, les désordres commis par les maraudeurs, rien n'y manqua; et je fis en un mois l'essai de ce que j'étais destiné à éprouver dans tout le cours de ma carrière. Les brigades et même les régiments étant quelquefois dispersés, l'ordre de les réunir sur un point arrivait tard, parce qu'il fallait passer par bien des filières. Il en résultait que le régiment marchait jour et nuit, et j'ai vu pour la première fois dans cette campagne dormir en marchant, ce que je n'aurais pas cru possible; on arrivait ainsi à la position que l'on devait occuper, sans avoir rien mangé et sans y trouver de vivres. Le maréchal Berthier, major général, écrivait: Dans la guerre d'invasion que fait l'Empereur, il n'y a pas de magasins, c'est aux généraux à se pourvoir des moyens de subsistance dans les pays qu'ils parcourent. Mais les généraux n'avaient ni le temps ni les moyens de se procurer régulièrement de quoi nourrir une si nombreuse armée. C'était donc autoriser le pillage, et les pays que nous parcourions l'éprouvèrent cruellement. Nous n'en avons pas moins bien souffert de la faim pendant la durée de cette campagne. À l'époque de nos plus grandes misères, une colonne de prisonniers traversa nos rangs; l'un d'eux portait un pain de munition, un soldat du régiment le prit de force; un autre lui en fit des reproches, et il s'établit une discussion entre eux pour savoir s'il était loyal d'ôter les vivres à un prisonnier; le premier alléguant le droit de la guerre, nos propres misères, le besoin de nous conserver; l'autre le droit de possession et l'humanité. La discussion fut longue et très-vive. Le premier, impatienté, finit par dire à l'autre: Ce qui arrivera de là, c'est que le ne t'en donnerai pas.—Je ne t'en demande pas, répondit celui-ci, je ne mange point de ce pain-là. Pour apprécier la beauté de cette réponse et la noblesse de ce sentiment, il faut penser que celui qui l'exprimait était lui-même accablé de fatigue et mourant de faim.
Un autre jour, un petit soldat de la compagnie, à qui j'avais rendu quelques services, me donna en cachette un morceau de pain de munition et la moitié d'un poulet, qu'il avait enveloppé dans une chemise sale. Je n'ai de ma vie fait un meilleur repas.
Le mauvais temps rendit nos souffrances plus cruelles encore. Il tombait une pluie froide, ou plutôt de la neige à demi fondue, dans laquelle nous enfoncions jusqu'à mi-jambes, et le vent empêchait d'allumer du feu. Le 16 octobre en particulier, jour où M. Philippe de Ségur porta au général Mack la première sommation, le temps fut si affreux que personne ne resta à son poste. On ne trouvait plus ni grand'garde ni factionnaire. L'artillerie même n'était pas gardée: chacun cherchait à s'abriter comme il le pouvait, et, à aucune autre époque, excepté la campagne de Russie, je n'ai autant souffert, ni vu l'armée dans un pareil désordre. J'eus occasion de remarquer alors combien il importe que les officiers d'infanterie soient à pied et s'exposent aux fatigues aussi bien qu'aux dangers. Un jour, un soldat murmurait; son capitaine lui dit: De quoi te plains-tu? tu es fatigué, je le suis aussi. Tu nos pas mangé, ni moi non plus. Tu as les jambes dans la neige, regarde-moi. Avec un pareil langage, il n'est rien qu'on ne puisse exiger des soldats, rien qu'on ne soit en droit d'attendre d'eux. C'est la célèbre réponse de Montézuma: Et moi! suis-je donc sur un lit de roses?
Toutes ces causes développèrent l'insubordination, l'indiscipline et le maraudage. Lorsque par un temps pareil des soldats allaient dans un village chercher des vivres, ils trouvaient tentant d'y rester. Aussi le nombre d'hommes isolés qui parcouraient le pays devint-il considérable. Les habitants en éprouvèrent des vexations de tous genres, et des officiers blessés qui voulaient rétablir l'ordre furent en butte aux menaces des maraudeurs. Tous ces détails sont inconnus de ceux qui lisent l'histoire de nos campagnes. On ne voit qu'une armée valeureuse, des soldats dévoués, rivalisant de gloire avec leurs officiers. On ignore au prix de quelles souffrances s'achètent souvent les plus éclatants succès. On ignore combien, dans une armée, les exemples d'égoïsme ou de lâcheté s'unissent aux traits de générosité et de courage.
La prompte reddition d'Ulm mit bientôt fin à tant de désordres. Les soldats isolés rentrèrent à leurs corps, et quelques-uns reçurent de leurs camarades une punition militaire. J'ai même vu dans l'occasion les capitaines donner quelques coups de canne. Il est certain qu'il y a des hommes dont on ne peut pas venir à bout autrement; mais il faut être sobre de ce moyen de correction, et surtout savoir à qui l'on s'adresse: car il y a tel soldat qui se révolterait à moins; il est vrai que ceux-là n'ont pas besoin de pareilles leçons.
Le 6e corps passa six jours à Ulm en vertu des capitulations. Ce séjour, bien long pour cette époque, nous reposa de nos fatigues, en nous préparant à celles qui devaient suivre.