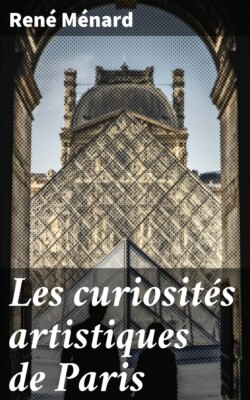Читать книгу Les curiosités artistiques de Paris - René Ménard - Страница 7
MUSÉE DE PEINTURE
ОглавлениеCOLLECTION LACAZE
Quand on entre au Musée par la porte placée à gauche du vestibule, sous le pavillon de l’Horloge, en avant de la cour du Louvre, on trouve un escalier. Arrivé au premier étage, on laisse à main gauche le musée des dessins et on prend à main droite la porte qui ouvre sur la salle Lacaze. Le nom de cette salle vient du généreux amateur qui, après avoir formé cette belle collection, en a fait don au Musée. Le portrait de Louis Lacaze, peint par lui-même, à l’âge de quarante-cinq ans environ, occupe le fond du panneau d’entrée; il tient une palette à la main. Louis Lacaze est né à Paris le 6 mai 1798 et mort dans la même ville, le 28 septembre 1869. Nous ne pouvons faire ici une biographie de cet ami des arts; mais voici un extrait de l’article publié par le Journal des Débats, le 19 octobre 1869:
«On a déjà beaucoup parlé de M. Louis Lacaze depuis sa mort récente; on en parlera plus encore. Il est bien naturel que la reconnaissance publique s’empare du nom du donateur du Musée, de l’Ecole de Médecine et de l’Académie des sciences. Ses fondations prennent place tout à la fois à côté de celles de Luynes et de Montyon; l’art et l’humanité protégeront sa mémoire contre l’oubli.
» Il entrait cependant bien peu dans les goûts de cet homme modeste de se placer sur un piédestal. Comme le sage, il a caché sa vie, et si ses donations perpétuent son nom, on peut dire que c’est malgré lui. Tel il a vécu, tel on le retrouve dans ses dernières dispositions. Il laisse au Musée sa collection; il émet un simple vœu pour que ses tableaux, qu’il aimait tant, ne soient pas disséminés; il lègue en rentes annuelles 15,000 francs à l’Académie des sciences, 5,000 fr. à l’Ecole de médecine; il précise les branches de la science qu’il veut encourager: la physiologie, la physique, la chimie; il désigne les maladies qu’il veut encore combattre après sa mort: la phthisie et la fièvre typhoïde; mais voilà tout. Pour sa mémoire, il ne demande rien. Quoi qu’il en soit, le nom de M. Louis Lacaze nous appartient au même titre que ses donations; il est irrévocablement attaché à la galerie qui contiendra ses tableaux, non moins qu’aux prix qu’il a fondés.»
La collection Lacaze comprend des maîtres de toutes les écoles, mais surtout de l’école française du dix-hutième siècle. Les attributions données par le célèbre amateur ont été respectées par l’administration.
Panneau à gauche. — GREUZE (1725-1805) — 210 — Son portrait. — 208 — Gensonné. — Ces portraits de sont qu’ébauchés.
LE MOYNE (1688-1737) — 225 — Hercule et Omphale. — Peinture intéressante, parce qu’on y voit poindre les blancs nacrés et les roses pâles qui vont devenir la coloration habituelle de l’école française. Le Moyne, qui, dans son plafond du salon d’Hercule, à Versailles, s’est montré vraiment grand peintre, n’apparaît ici que comme un peintre aimable.
DENNER (1685-1747) — 53 — Tète de Vieille femme. On en trouve d’analogues dans presque toutes les grandes collections. Nous signalons celle-ci à titre de curiosité, mais non comme œuvre d’art.
AD. OSTADE (1610-1685) — 87 — Intérieur d’école. — Authenticité douteuse.
RIGAUD (1659-1743) — 241 — le Cardinal de Polignac.
PATER (1696-1736) — 235 — la Toilette. — Pater est un imitateur de Watteau, qu’on avait absolument oublié dans la première partie de ce siècle et que les amateurs ont remis à la mode depuis quelques années. Il est bien loin d’avoir les qualitées de peintre de son maître, mais il ne manque pas d’esprit dans la tournure qu’il donne à ses personnages. Dans la Toilette, il y a une petite figure vue de dos qui est d’une désinvolture charmante: c’est la soubrette, vêtue de rouge, qui fait chauffer un linge devant le feu.
FR. HALS (1584-1666) — 65 — la Bohémienne. — Superbe peinture, d’une touche franche et hardie. C’est une jenne fille au regard vif, au sourire franc, à la physionomie étincelante de vie et de santé, peinte avec brutalité, mais aussi avec ce charme d’improvisation dont le maître d’Haarlem a donné parfois d’admirables exemples.
BOUCHER (1703-1770) — 161 — Vénus chez Vulcain. — On peut voir ici toute l’insuffisance des formes dans le dessin de Boucher.
CHARDIN (1699-1779). — Outre le Bénédicité, répétition originale d’un tableau identique de la galerie française, on trouvera sur ce panneau un assez grand nombre d’études de Chardin, car L. Lacaze était grand amateur de ce maître. Ces études, ustensiles de ménage, pièces de faïences, gobelets d’argent, fruits ou petits gâteaux, groupés d’une manière souvent heureuse, forment des petits tableaux d’un aspect fort agréables pour l’œil. Nous recommanderons particulièrement la Fontaine de cuivre rouge — 176 — le Bocal d’olives — 175 — le Gobelet d’argent — 181 — etc.
Chaque tableau que faisait Chardin arrachait à Diderot des cris d’admiration. Voyez plutôt le compte rendu du Salon de 1763:
. .. C’est celui-ci qui est un peintre; c’est celui-ci qui est un coloriste! Il y au Salon plusieurs petits tableaux de Chardin; ils représentent presque tous des fruits avec les accessoires d’un repas. C’est la nature même; les objets sont hors la toile et d’une vérité à tromper les yeux. Celui qu’on voit en montant l’escalier mérite surtout l’attention. L’artiste a placé sur une table un vase de vieille porcelaine de la Chine, deux biscuits, un bocal rempli d’olives, une corbeille de fruits, deux verres à moitié pleins de vin, une bigarade avec un pâté... C’est que ce vase de porcelaine est de la porcelaine; c’est que ces olives sont réellement séparées de l’œil par l’eau dans laquelle elles nagent; c’est qu’il n’y a qu’à prendre ces biscuits et les manger, cette bigarade et l’ouvrir et la presser, ce verre de vin et le boire, ces fruits et les peler, ce pâté et y mettre le couteau... On n’entend rien à cette magie. Ce sont des couches épaisses de couleur appliquées les unes sur les autres, et dont l’effet transpire de dessous en dessus. D’autres fois, on dirait que c’est une vapeur qu’on a soufflée sur la toile; ailleurs, une écume légère qu’on y a jetée. Rubens, Berghem, Greuze, Loutherbourg vous expliqueraient ce faire bien mieux que moi, tous en feront sentir l’effet à vos yeux. Approchez-vous, tout se brouille, s’aplatit, disparaît; éloignez-vous, tout se recrée et se reproduit. On m’a dit que Greuze, montant au Salon et apercevant le morceau de Chardin que je viens de décrire, le regarda et passa en poussant un profond soupir. Cet éloge est plus court et vaut mieux que le mien. Qui est-ce qui payera les tableaux de Chardin quand cet homme rare ne sera plus? Il faut que vous sachiez encore que cet artiste a le sens droit et parle à merveille de son art... Ah! mon ami, crachez sur le rideau d’Appelles et sur le raisin de Zeuxis. On trompe sans peine un artiste impatient, et les animaux sont mauvais juges en peinture. N’avons-nous pas vu les oiseaux du jardin du roi aller se casser la tête contre la plus mauvaise des perspectives? Mais c’est vous, c’est moi que Chardin trompera quand il voudra.
Chardin, après avoir été fort délaissé pendant toute la première moitié de ce siècle, est redevenu en faveur, et ce n’est que justice. Nous trouvons même que l’engouement à son égard va peut-être un peu trop loin: nous croyons ne rien rabattre de son mérite en déclarant que, malgré tout ce que peuvent dire aujourd’hui les critiques en renom, une terre cuite antique, ou un dessin de l’école florentine ont une tout autre valeur à nos yeux.
LANCRET (1696-1743) — 212 — le Théâtre italien. — Ce tableau, qui a été gravé par Schmidt, est assez important dans l’œuvre de Lancret. Il représente les acteurs de la comédie italienne groupés autour de Gille: Colombine et le docteur sont à droite, Arlequin, Silvie et Scapin, à gauche.
WATTEAU (1684-1721) — 263 — Assemblée dans un parc. — Plusieurs personnages, hommes, femmes, enfants, causent jouent et font de la musique, près d’une pièce d’eau placée dans un parc. Les scènes galantes sont toujours bien à leur place dans ces jardins enchantés, où l’on cause d’amour à l’ombre des bosquets, dont l’écho ne répète que des notes tendres. Nous voyons là tout un petit peuple amoureux, vivant, se remuant et s’amusant, parmi des arbres comme la nature n’en fait pas, mais comme il en pousse dans le monde de la fantaisie. — 264 — L’escamoteur.
D. TÉNIER (1610-1690) — 136 et 137 — l’Été et l’Hiver.
CALLET (1741-1823) — 167 — le Triomphe de Flore.
BOUCHER (1703-1770) — 163 — le Peintre dans son atelier.
REMBRANDT (1607-1669) — 98 — Portrait d’homme.
PATER (1696-1736 — 236 — Conversation dans un parc. — 237 — la Baigneuse. — Ce tableau, qui a été autrefois attribué à Watteau, est en somme d’une facture assez maigre.
REGNAULT (1754-1829) — 240 — Les Trois Grâces. — Cette peinture, placée un peu haut, est d’un aspect singulier qui marque assez bien la transition entre le goût du dix-huitième siècle et celui qui a prévalu au commencement du dix-neuvième Le Pausianas français en parle dans un style qui n’est pas sans analogie avec celui de la peinture elle-même. «Les Trois Grâces, dit-il, son grandes comme nature; à leur pose aimable, à leurs traits, aux tons frais qui les colorent et aux charmes du pinceau qu’elle ont inspiré, il est imposible de les méconnaître.»
FRAGONARD (1731-1806 — 202 — l’Orage. — Tableau de paysage dont M. L. Lacaze faisait le plus grand cas.
REMBRANDT (1607-1699) — 96 (+) La femme au bain. — Ce tableau est la pièce capitale de l’école hollandaise dans la collection Lacaze; ceux qui veulent donner à toutes choses un nom historique pourront baptiser cette figure du nom de Betsabée: pour nous, nous n’y voulons voir que ce que le peintre y a mis, une femme qui se baigne. — Eh bien! franchement, elle en avait besoin! vont s’écrier les personnes qui dans la peinture ne voient que le sujet, et elle aurait même dû accomplit cette petite formalité avant de se présenter ainsi au public. On peut présumer d’ailleurs que cette cérémonie n’avait lieu que dans les grandes occasions, car la bonne dame qui se lave ainsi, et dont une vieille servante est en train d’essuyer les pieds, tient en main une lettre qu’elle vient de lire; dans la pensée du peintre, cette lettre n’est peut-être pas étrangère à cette toilette inaccouumée. Ajoutons que cette femme entièrement nue, est par-dessus le marché d’une laideur rare, et que l’aspect du tableau repousse tout d’abord par sa vulgarité ; néanmoins, la puissance lu modelé est si irrésistible, la chair est si vivante, le relief si saisissant, qu’il faut malgré tout saluer l’œuvre d’un grand naître, mal inpiré cette fois, mais toujours inimitable!
Chose singulière, cette vilaine femme a été peinte plusieurs lois par Rembrandt, dans le même costume et vers la même époque, c’est-à-dire en 1664. Ceux qui ont vu la Femme au bain le la National Gallery, à Londres, ont certainement reconnu, bien que la pose en soit différente, le modèle qui a posé pour le ableau de la galerie Lacaze. La malheuresuse que le peintre a ainsi vouée à l’immortalité n’était assurément pas sa femme, puisque Rembrandt est devenu veuf en 1642; mais l’hypothèse mise à ce sujet par M. Paul Mantz nous paraît assez vraisemblable.
«Le maître, dit-il, avait d’abord cherché des consolions dans le ravail, mais le jour vint où le veuvage lui ayant paru lourd, il se réa des affections nouvelles. On ne sait trop quelle était Hendrickie aghers, on ignore si sa liaison avec Rembrandt fut bien orthodoxe, mais elle fut tellement intime, qu’il naquit bientôt à Amsterdam une petite fille, qui fut baptisée dans la Oude kerke, le 30 octobre 1651. Un document retrouvé par M. Scheltema prouve que l’artiste reconnut enfant de Hendrickie et qu’il la nomma Cornélia. Cette période de la le de Rembrandt est encore fort obscure; toutefois on est tenté de onclure, d’après le rapprochement des dates, que Hendrickie Jaghers dû poser pour les études de femmes que le maître multiplia alors. on corps n’avait pas la pureté grecque, ses énormes mains n’étaient as italiennes; mais s’il est vrai que Rembrandt l’aima et qu’elle ait aidé à faire des chefs-d’œuvre, elle restera désormais de nos mies.»
DAVID TÉNIER (1610-1690) — 125 — Le duo.
WATTEAU (1684-1721) — 261 — L’indifférent. — C’est un jeune danseur, à la mine effrontée, qui porte la jambe en avant comme pour faire une pirouette, et semble ravi de se voir affublé d’un jolie habit bleu de ciel et d’un manteau rose. — 262 — La Finette. — Jeune fille vêtue d’une robe verdâtre, qui est assise dans un paysage complètement chimérique, et joue de la mandoline en regardant le spectateur. Ces deux tableaux, qui ont fait partie de l’ancienne collection du marquis de Ménars, ont été popularisés par la gravure. Ils sont d’une facture exquise, mais malheureusement. un peu fatigués.
FRAGONARD (1732-1805) — 197 198-199 et 200 — Ces tableaux semblent être des portraits et avoir été destinés à se faire pendant. La touche facile et heurtée, habituelle à Fragonard, est à nos yeux une qualité secondaire, mais qui est fort prisée aujourd’hui.
«Fragonard a été plus loin que personne dans cette peinture enlevée qui saisit l’impression des choses et en jette sur la toile comme une image instantanée. On a de lui, dans ce genre, des tours de force, des merveilles, des figures où il se révèle comme un prodigieux Fa Presto. On voit dans la galerie Lacaze quatre portraits de grandeur naturelle à mi-corps. Au dos de l’un je lis ceci écrit, me semble-t-il, de sa main: Portrait de M. de la Bretèche, peint par Fragonard en 1769, en une heure de temps. Une heure! rien de plus. Il lui suffisait d’une heure pour camper, bâcler et trousser si fièrement ces grands portraits où se déploie et s’étale toute cette fantaisie à l’espagnole dont la peinture d’alors habille et ennoblit les contemporains. Une heure pour couvrir toute cette toile! A peine s’il jette ses touches; il dégrossit à grands coups les visages, les indique avec les plans d’un buste commencé, tire les traits comme d’un fond de bile. Son pinceau étend les couleurs en lanières à la façon d’un couteau à palette. Sous sa brosse enfiévrée qui va et vient, les collerettes bouillonnent et se guindent, les plis serpentent, les manteaux se tordent, les vestes se cambrent, les étoffes s’enflent et ronflent en grands plis matamoresques. Le bleu, le vermillon, l’orange coulent sur les collets et les toques; les fonds sous les frottis de bitume, font autour des tètes un encadrement d’écume; et les tètes elles-mêmes jaillissent de la toile, s’élancent de cette balayure furibonde, de ce gâchis de possédé et d’inspiré.»
DE GONCOURT. (L’Art au XVIIIe siècle.)
PH. DE CHAMPAIGNE (1602-1674 — 51 — Portrait de Jean Antoine de Mesme, président à mortier du parlement de Paris.
RIBÉRA (1588-1656) — 32 — Le pied-bot. — C’est un jeune mendiant, à la mine crasseuse et joviale, qui tient son chapeau et sa béquille, en attendant qu’un passant lui fasse l’aumône. La coloration de cette toile, bien que d’un aspect terreux et monotone, est d’une singulière puissance, et il y a une exubérance de vie bien saisissante dans cet infirme couvert de haillons, qui dans l’espoir que vous lui ferez la charité, sourit en montrant deux rangées de dents superbement blanches.
JEAN STEIN (1626-1679) — 122 — Repas de famille.
CH. COYPEL (1694-1752) — 188 — Portrait de l’acteur Jelyotte en costume de femme. — Il est placé tout près de la porte. Charles Coypel était poëte en même temps que peintre. Ces aptitudes multiples lui ont attiré de la part de Voltaire la critique suivante:
On dit que votre ami Coypel
Imite Horace et Raphaël;
A les surpasser il s’efforce,
Et nous n’avons point aujourd’hui
De rimeur peignant de sa force,
Ni peintre rimant comme lui.
Panneau à droite. — Pour suivre ce panneau dans l’ordre indiqué, il faut revenir sur ses pas et repartir du portrait de M. Lacaze, placé à l’entrée de la salle.
FRAGONARD (1731-1806) — 196 — La chemise enlevée, est l’esquisse d’un tableau qui a été gravé sous ce titre et dont le peintre a fait plusieurs répétitions.
D. TÉNIERS (1610-1690) — 134 — Les joueurs de boule.
GREUZE (1725-1805) — 206 — Tête de jeune fille.
LARGILLIÈRE (1655-1746) — 221 — Le président de Laage.
LE NAIN (trav. vers 1640) — 227 — Repas de paysans.
Cette toile, qui est datée de 1642, est une œuvre d’une impression triste, d’une coloration terne, mais qui n’est pas dépourvue de saveur. Cependant, il faut bien le reconnaître, ce tableau n’ajoute pas beaucoup à la gloire des Le Nain, ces peintres mystérieux sur lesquels on sait en somme si peu de chose.
PH. DE CHAMPAIGNE (1602-1674) — 50 — Le prévôt des marchands et les échevins de la ville de Paris. — C’est un des bons tableaux du maître; un article de M. Paul Mantz, nous fournit sur cette toile de précieux renseignements:
«M. Lacaze acheta cette peinture en 1851, à la vente Sébastiani, et il la paya 1,550 fr. Personne absolument n’en voulait. M. Lacaze couvrit la dernière enchère, non-seulement parce qu’il trouvait le tableau honorable, mais aussi par une sorte de pitié pour cette pauvre toile qui, tombant entre des mains barbares, aurait été probablement dépecée. Ce tableau importe d’ailleurs à l’histoire de la magistrature parisienne, et nous approuvons fort M. Lacaze de l’avoir sauvé. Philippe de Champaigne y a représenté huit figures agenouillées au pied d’un crucifix posé sur un socle, dans lequel est encastrée sous forme de bas-relief une image de sainte Geneviève. Ces dignes personnages sont le prévôt des marchands, le procureur du roi, quatre échevins, le greffier et le receveur de la ville. Le tableau n’est point daté. Guillet de Saint-Georges, qui a écrit une notice sur Philippe de Champaigne, insérée dans les Mémoires sur la vie des académiciens, nous fournit une vague indication: «Dans les années 1649, 1652 et 1656, il fit pour la maison de ville de Paris trois tableaux où sont les portraits des différents magistrats de la ville, élus sous trois diverses prévôtés: le premier sous la prévôté de M. Le Féron, le second sous celle de M. Le Febure, et le troisième sous celle de M. de Sève.» Des armoiries placées au bas des portraits des deux principaux personnages permettront sans doute de les reconnaître, et par suite de dater le tableau. Quoi qu’il en soit, il y faut voir une des meilleures toiles de Champaigne. Les tètes sont sincèrement étudiées, et avec cette préoccupation de marquer finement l’individualité du modèle. L’animation du regard, les lèvres qui vont-parler, la gravité de l’attitude, donnent une haute valeur à cette collection de figures qui, sévères, demeurent intimes. Ici l’art et l’histoire vont de compagnie. Vraiment, lorsqu’on voit quel savant portraitiste était Philippe de Champaigne, on se prend à regretter que la fatalité des circonstances, le caprice d’une ambition imprudente l’aient conduit à composer de grands tableaux prétentieux et vides; autant il est glacé dans ses machines d’apparat, autant il a le sentiment de la vie lorsqu’il se trouve face à face avec une personnalité qui parle à son esprit ou à son cœur. Champaigne, dont on a voulu faire un Français, est toujours resté Brabançon; il est l’homme et le peintre des choses vues, et non des choses imaginées.»
ÉCOLE FRANÇAISE (dix-huitième siècle) — 271 (+) Portrait de femme. — Cet admirable portrait représente une dame inconnue, quoiqu’on l’ait autrefois désigné comme étant madame Lenoir. Il a été exécuté par un peintre auquel on a voulu donner toutes sortes de noms célèbres, Chardin ou Tocqué, mais qui, malgré toutes les recherches, est resté anonyme. Ce chef-d’œuvre mystérieux est peut-être la perle de la collection, et l’inconnu qui en est l’auteur était un véritable maître.
WATTEAU (1684-1721) — 260 (+) Gilles. — Voici un tableau peut-être unique dans l’œuvre du maître, qui s’est presque toujours complu dans des toiles de très-petite dimension. C’est un portrait en pied, grand comme nature, le portrait d’un comédien debout dans ses habits blancs, et qui fier de sa collerette et de ses chaussures à bouffettes, regarde fixement le spectateur en laissant tomber les bras, d’un air moitié moqueur, moitié ébahi. Ce morceau est de la plus extrême rareté, mais peut-on dire que ce soit une œuvre capitale? Watteau refroidissait sa verve quand il s’attaquait à une toile de cette taille; et malgré tout le talent qu’il a su déployer ici, on sent qu’il est plus à son aise dans les petits sujets intimes, et il en a d’exquis dans la galerie Lacaze.
RIGAUD (1659-1743) — 2-12 — Portrait de J. F. P. de Créqui, duc de Lesdiguières. — Il est extrêmement jeune, mais déjà affublé d’une cuirasse et d’une perruque monumentale. C’est un portrait d’une distinction exquise.
HUBERT ROBERT (1733-1808) — Un portique.
CHARDIN (1699-1779) — 171 — Le Château de cartes.
D. TÉNIERS (1610-1690) — 138 — Le ramoneur.
BRAUWER (1608-1640) — 43 — Homme taillaut sa plume; — 45 — Le fumeur.
LARGILLIÈRE (1656-1746) — 224 — Largilliére, sa femme et sa fille. Le peintre s’est représenté au milieu d’un jardin, en compagnie de sa femme et de sa fille, qui chante un morceau de musique.
LANCRET (1690-1743) — 213 — Le gascon puni.
NATTIER (1685-1766) — 230 — Mademoiselle de Lambese et le comte de Brionne. — La princesse est représentée en Minerve qui arme son jeune frère.
ÉCOLE HOLLANDAISE (dix-huitième siècle) — 155 — Portrait de vieille femme.
VESTIER (trav. en 1786) — 256 — Portrait de jeune femme.
Salle de Henri II. — En sortant de la galerie Lacaze on entre dans la salle de Henri II; c’est une petite salle oblongue, où on a placé quelques tableaux de maîtres français: Bouclier, Van Loo, Prudhon, de la Porte, etc. Nous ne nous arrêterons pas sur ces tableaux, dont aucun ne mérite d’être désigné d’une manière spéciale, et après avoir traversé cette salle, nous arrivons au salon des sept cheminées.
SALLE DES SEPT CHEMINÉES
La salle des sept cheminées, dont le nom bizarre n’est justifié par rien, et comme le salon d’honneur de l’école française moderne. Le plafond est décoré de figures monumentales par Duret et de médaillons représentant les maîtres qui se sont rendus illustres pendant le premier quart de ce siècle.
1er Panneau. — L. DAVID (1748-1825) — 149 (+) Les Sabines. — Ce célèbre tableau occupe toute la largeur du panneau. On sait de quelle gloire colossale Louis David a joui de son vivant, et de quel injuste dédain ses meilleurs ouvrages ont été l’objet de la part des romantiques de 1830. La génération actuelle, plus équitable à son égard, lui a rendu sa véritable place en se tenant à égale distance de ces opinions excessives. Si ses personnages semblent quelquefois figés comme des figures de marbre, si son coloris terne et monotone manque de charme et d’éclat, on ne peut lui contester une mâle énergie, un très-grand savoir et une complète originalité. Le timide Vien peut bien passer historiquement pour être le précurseur de David, mais son robuste élève l’a tellement éclipsé, que Vien serait tout à fait inconnu sans David.
Le tableau des Sabines exprime si bien les idées et les doctrines de David, qu’on pourrait presque le regarder comme un manifeste. La disposition des deux figures principales est d’une symétrie voulue. Romulus va lancer son javelot contre Tatius qui se baisse pour parer le coup. Hersilie, femme de Romulus, sépare les combattants, au milieu desquels une Sabine à genoux vient de déposer trois petits enfants, tandis qu’une autre embrasse la jambe de Tatius en l’implorant. Plus loin une mère présente son enfant aux lances des soldats. Dans le fond on aperçoit la bataille qui se continue et les remparts abruptes de la ville naissante.
On a beaucoup reproché à David d’avoir placé les deux héros sur le même plan, et d’avoir donné aux mouvements de leur corps une pondération calculée. Cette pondération, David l’avait vue sur nombre de bas-reliefs antiques, et convaincu que la peinture devait obéir aux même lois que la sculpture, il en a fait le nœud de sa composition: c’est par une raison analogue qu’il établit ses deux figures dans une sorte de cadence qui donne de la froideur à la scène et n’exprime nullement le tumulte et l’imprévu d’un combat. Mais comme il sait être naïf quand il oublie ses théories, et que faute d’un modèle ancien qu’il se serait cru obligé de reproduire, il est forcé de recourir directement à la nature! Je n’en veux pour exemple que ces charmants petits enfants qui sont à terre, et notamment ce nouveau-né, encore emmailloté, qui se tête le pouce.
C’est dans sa prison du Luxembourg que David a conçu l’idée première de son tableau. Sa femme, dont le père était royaliste, avait quitté son époux quand elle l’avait vu siéger à la Convention parmi les plus ardents montagnards. Mais lorsqu’il fut emprisonné, non-seulement elle revint le voir, mais encore elle lui prodigua les marques de la plus touchante sollicitude. Après être sorti de sa prison, David, voulant montrer que la tendresse des femmes a plus de puissance que toutes les haines politiques, composa son tableau des Sabines.
Lorsque David exécuta ce tableau, sa réputation d’artiste était si grande, que les dames de l’aristocratie, qui à ce moment commençaient à rouvrir leurs salons, onbliaient son rôle politique pour ne voir en lui qu’un génie qu’il fallait honorer. Delécluze, qui a connu intimement David, dont il était l’élève, raconte un incident assez singulier qui survint pendant une visite de madame de Bellegarde à l’atelier du maître et qui est bien caractéristique des mœurs du temps.
La belle figure et les grands cheveux noirs de madame de Bellegarde le frappèrent, et il exprima devant ces trois dames le regret de n’avoir pas eu à sa disposition, pour peindre la tète de la femme à genoux qui montre ses enfants, la figure de madame de Bellegarde. Cette observation flatteuse, faite par un homme dont le talent excitait alors une admiration universelle, et adressée à une jeune femme qui ne manquait pas de vanité, fut très-bien prise par madame de Bellegarde, qui, en effet, laissa retoucher d’après la sienne la tète de la femme à genoux. Ce fait se répandit dans la ville, mais en passant d’abord par tous les ateliers de peinture du Louvre, ce qui lui fit prendre un coloris un peu plus cru, mais absolument faux. Ce qu’il sera peut-être difficile de faire comprendre aujourd’hui, et ce qui est cependant très-vrai, c’est que ces mauvaises plaisanteries d’atelier, loin de blesser les personnes qui en étaient l’objet, flattaient au contraire leur vanité. Madame de Bellegarde en particulier était si loin de s’en plaindre, qu’elle affectait de paraître au théâtre avec ses grands cheveux noirs disposés à peu près comme David les a peints dans son tableau des Sabines. On était si entêté de tout ce qui se rapportait à l’antiquité, que la complaisance des jeunes beautés grecques qui s’étaient présentées à Apelles pour l’aider à peindre sa Vénus paraissait une action louable, par cela seul qu’il s’agissait de l’intérêt des arts.
DELÉCLUZE. (David, son école et son temps.)
On imaginerait difficilement les acclamations enthousiastes avec lesquelles on accueillit le tableau de David lorsqu’il fut terminé. Cette frénésie pour les Sabines, qu’on regardait assez généralement comme le chef-d’œuvre de la peinture, dura quelques années; mais si le public applaudissait très-fort, il n’achetait pas, et David, pour tirer parti de son tableau, résolut d’en faire une exposition publique à son profit. Elle eut lieu dans une salle du Louvre alors inoccupée, et où sont aujourd’hui les pastels. L’exposition, ouverte au mois de nivôse de l’an VIII, dura jusqu’au mois de prairial de l’an XIII, c’est-à-dire plus de cinq ans.
David avait fait sur son tableau une notice explicative, qu’on vendait pendant l’exposition et qui est fort curieuse, parce qu’elle nous fait pénétrer dans l’intimité des idées de cette époque. Comme on n’avait encore fait en France aucune exposition payante pour les œuvres d’art, l’artiste commence par s’autoriser de l’exemple des anciens:
L’antiquité n’a pas cessé d’être la grande école des peintres modernes et la source où ils puisent les beautés de leur art. Nous cherchons à imiter les anciens dans le génie de leurs conceptions, la pureté de leur dessin, l’expression de leurs figures et les grâces de leurs formes. Ne pourrions-nous pas faire un pas de plus et les imiter aussi dans leurs mœurs et les institutions qui s’étaient établies chez eux, pour porter les arts à leur perfection?
L’usage, pour un peintre, d’exposer ses ouvrages aux yeux de ses concitoyens, moyennant une rétribution individuelle n’est point nouveau. Le savant abbé Barthélemy, dans son Voyage du jeune Anacharsis, parlant du fameux Zeuxis, ne perd pas l’occasion d’observer que ce peintre retirait de la vue de ses ouvrages des rétributions qui l’enrichirent à un tel profit qu’il faisait souvent don de ses chefs-d’œuvre à la patrie, disant qu’il n’y avait point de particulier en état de les payer. Il cite à ce sujet les témoignages d’Elien et de Pausanias. Ils nous prouvent que, pour les ouvrages de peinture, l’usage de l’exposition publique était admis chez les Grecs.
De tous les arts que professe le génie, la peinture est incontestablement celui qui exige le plus de sacrifices. Il n’est pas rare de mettre jusqu’à trois ou quatre ans à terminer un tableau d’histoire. Je n’entrerai ici dans aucun détail concernant les dépenses préalables auxquelles un peintre est obligé. L’article seul des costumes et des modèles est très-considérable. Ces difficultés, n’en doutons pas, ont rebuté beaucoup d’artistes; et peut-être avons-nous perdu bien des chefs-d’œuvre que le génie de plusieurs d’entre eux avait conçus et que leur pauvreté les a empêchés d’exécuter. Je vais plus loin: combien de peintres honnêtes et vertueux, qui n’auraient jamais prêté leurs pinceaux qu’à des sujets nobles et moraux, les ont dégradés et avilis par l’effet du besoin! Ils les ont prostitués à l’argent des Phryné et des Laïs: c’est leur indigence seule qui les a rendus coupables; et leur talent, fait pour fortifier le respect des mœurs, a contribué à les corrompre.
Qui empêche donc d’introduire dans la République française un usage dont les Grecs et les nations modernes nous ont donné l’exemple? Nos anciens préjugés ne s’opposent plus à l’exercice de la liberté publique. La nature et le cours de nos idées ont changé depuis la Révolution; et nous ne reviendrons pas, j’espère, aux fausses délicatesses qui ont si longtemps comprimé le génie. Pour moi, je ne connais point d’honneur au-dessus de celui d’avoir le public pour juge. Je ne crains de sa part ni passion ni partialité : ses rétributions sont des dons volontaires qui prouvent son goût pour les arts; ses éloges sont l’expression libre du plaisir qu’il éprouve; et de telles expressions valent bien, sans doute, celles des temps académiques.
Louis DAVID. (Le tableau des Sabines.)
L’artiste entre ensuite dans le récit de l’événement qu’il a voulu représenter, puis il termine en répondant à certaines critiques qui s’étaient produites au sujet de la nudité absolue de son Romulus et de son Tatius. Il rappelle que dans l’antiquité les dieux et les héros se représentaient généralement nus, et après avoir cité une foule d’exemples, il termine ainsi:
Et combien d’autres autorités ne pourrais-je pas citer encore! Celles que je viens de rapporter suffiront sans doute pour que le public ne s’étonne pas que j’aie cherché à imiter ces grands modèles dans mon Romulus, qui lui-même est fils d’un dieu. Mais en voici une que j’ai réservée pour la dernière, parce qu’elle est le complément de toutes les autres: c’est Romulus lui-même, qui est représenté nu sur une médaille, au moment où, après avoir tué Acron, roi des Céninéens, il porte sur ses épaules un trophée formé de ses armes, qu’il déposa ensuite dans le temple de Jupiter Férétrien; et ce furent là les premières dépouilles opimes. Actuellement que je crois avoir répondu d’une manière satisfaisante au reproche que l’on m’a fait ou qu’on pourra me faire sur la nudité de mes héros, qu’il me soit permis d’en appeler aux aux artistes. Ils savent mieux que personne combien il m’eût été plus facile de les habiller: qu’ils disent combien les draperies me fournissaient de moyens plus aisés pour détacher une figure de la toile. Je pense au contraire qu’ils me sauront gré de la tâche difficile que je me suis imposée, pénétrés de cette vérité, que qui fait le plus, peut faire le moins. En un mot, mon intention, en faisant ce tableau, était de peindre les mœurs antiques avec une telle exactitude que les Grecs et les Romains, en voyant mon ouvrage, ne m’eussent pas trouvé étranger à leurs coutumes.
Louis DAVID. (Le tableau des Sabines.)
L. DAVID (1748-1825) — 148 — Léonidas aux Thermopyles. — La composition de ce tableau est conçue dans un esprit analogue à celui du tableau précédent. Léonidas, assis sur un rocher, est entouré des Spartiates qui se préparent à la mort; l’aveugle Euritus, conduit par un ilote, brandit sa lance; des soldats s’embrassent ou élèvent des couronnes en regardant l’un d’entre eux qui, avec son épée, trace ces mots sur le rocher:«Passant, va dire aux Lacédémoniens que nous sommes morts ici en obéissant à leurs ordres.» Le tableau de Léonidas, commencé en 1802, fut ensuite complètement abandonné par son auteur. Mais en 1814, lorsque les alliés envahirent la France, David se hâta de terminer un tableau où il voulait montrer ce que l’héroïsme pouvait contre la multitude. Toutes les qualités du maître se retrouvent dans ce tableau, mais à un degré moindre que dans les Sabines.
Il est certain, comme on peut s’en convaincre en regardant le Léonidas avec attention, que cet ouvrage, considéré sous le rapport de la composition et de l’exécution, a éte achevé sous l’influence de deux manières, de deux systèmes très-distincts. Le jeune homme qui lie sa chaussure, les deux autres qui offrent des couronnes, celui qui trace l’inscription, et le groupe du vieillard et de son fils se tenant embrassés, ont été conçus, tracés et presque entièrement peints à la première époque; tandis que l’aveugle, le personnage assis à la gauche de Léonidas, les doux soldats nus qui vont pendre leurs armes à un arbre, ainsi que les figures du fond, ont été dessinés et entièrement peints lorsque David termina cet ouvrage; en effet, l’œil le plus faiblement exercé ne pourra manquer de saisir l’extrême différence qu’il y a entre les attitudes élégantes et la fermeté du dessin des figures peintes vers 1802 et le laisser-aller de celles que l’artiste n’exécuta que douze années après. Cette disparate est sensible au point d’en devenir parfois choquante.
Quant à Léonidas, l’intention prêtée à ce personnage, son attitude et son expression n’étaient point encore entièrement arrêtées dans l’esprit du peintre. Ce qui fixa ses idées à ce sujet est un camée antique qui représente un héros de la mythologie grecque ayant absolument la même attitude que le Léonidas. Ce plagiat reproché, avec beaucoup d’autres, à David, ne portait aucune atteinte à sa conscience d’artiste,»
DELÉCLUZE. (David, son école et son temps.)
GÉRARD (1779-1837) — 238 — La Victoire et la Renommée — 239 — l’Histoire et la Poésie. — Ces figures ailées, qui supportent et déroulent une tapisserie, devaient servir d’encadrement au tableau de la Bataille d’Austerlitz, aujourd’hui à Versailles.
De belles esquisses par Géricault et Prudhon sont placées sur le même panneau; elles proviennent d’une donation récente et ne sont pas encore inscrites au catalogue.
Deuxième Panneau. — GROS (1771-1835) — 275 (+) Le champ de bataille d’Eylau. — Eugène Delacroix a donné de ce tableau la description suivante:
«Dans la représentation de l’héroïque champ de bataille où les Français, en nombre bien inférieur, épuisés par les marches, aveuglés par la neige et à demi noyés dans la fange et les glaces, avaient terrassé les barbares du Nord, le peintre déroule à perte de vue le morne aspect des plaines de la Pologne. Les rangs entiers des régiments tombés à leur place de bataille sont étendus sous la neige comme des gerbes couchées uniformément dans cette cruelle moisson d’hommes. Le village d’Eylau brûle encore à droite. La garde, les restes de l’armée demeurent rangés et l’arme au bras sur ce champ de carnage. Çà et là des chevaux moribonds, secouant les frimats de la nuit, se dressent par un dernier effort sur leurs jambes affaiblies, et retombent près de leurs maîtres étendus morts. Le Russe, le Français, le Lithuanien, le Cosaque à la barbe hérissée et chargée de glaçons, tombés l’un près de l’autre, ne présentent plus que des tas informes sous leur manteau de neige. Ici, un sabre inutile dans une main qui ne peut plus le saisir; là, le canon sur son affût fracassé et enterré dans la neige avec l’artilleur écrasé lui-même en le défendant, et dont le bras roidi l’entoure encore.
» Ce tableau sinistre, formé de cent tableaux, semble appeler l’œil et l’esprit de tous côtés à la fois; mais ce n’est encore que le cadre de la sublime figure de Napoléon. On le voit au milieu de la toile, arrêté dans sa lugubre promenade et suivi de ses maréchaux. Une de ses mains laisse flotter les rênes de son cheval; l’autre, élevée en l’air, par un geste mélancolique, semble accuser les maux de la guerre. C’est peut-être la plus belle conception de l’artiste et aussi le portrait 1 e plus magnifique et assurément le plus exact qu’on ait fait de Napoléon. Ce grand homme aurait dû, commme Alexandre, interdire à d’autres qu’à son peintre favori le droit de reproduire son image. Gros seul a su le peindre: c’est dans ses ouvrages seulement que nos neveux trouveront le type immortel de ses traits.»
EUGÈNE DELACROIX.
(Revue des Deux-Mondes, 1er septembre 1848.
GIRODET (1714-1824) — 250 — Scène du déluge. — Ce tableau, qui a joui autrefois d’une très-grande célébrité, est placé en haut du panneau. Girodet n’avait pas ce qu’on appelle un tempérament de peintre: ce qu’il a été, il l’a dû surtout à ses fortes éludes. C’était un homme très-lettré et passionné pour les beaux-arts, dont il aimait également les manifestations les plus diverses. Il adorait la musique et il a écrit des poëmes imités de l’abbé Delille et des traductions d’ouvrages grecs. Il a passé une grande partie de sa vie à faire des séries de compositions, fort intéressantes d’ailleurs, tirées de Virgile, Anacréon, etc; mais son bagage comme peintre se réduit à un petit nombre de tableaux, et si on excepte l’Endymion, ils manquent en général de spontanéité ; on y sent trop la peine énorme que l’artiste s’est donné pour les exécuter.
La Scène du déluge montre bien les efforts du peintre et la tournure de son esprit. L’intérêt dramatique est calculé et gradué avec une recherche infinie; c’est une conception d’homme de lettres traduite par un pinceau savant.
Au milieu des eaux qui ont tout envahi, un rocher émerge, couronné d’un arbre; dernière espérance d’une famille qui vient y chercher un refuge contre la tempête. Un homme portant son père sur ses épaules et retenant sa femme qui presse un petit enfant sur son sein, cherche à gravir le rocher: à la longue chevelure de la femme se suspend un jeune garçon, en sorte que toute cette grappe humaine, qui oscille au-dessus de l’abîme, n’a d’autre espoir de salut que le suprême effort tenté par le père. Le malheureux, pour s’aider à gravir le rocher à pic, a saisi de ses doigts désespérément crispés, une branche, qui à ce moment même ploie et se brise sous le poids; toute espérance est irrévocablement perdue. Cette scène de désespoir est vraiment émouvante, bien qu’on y sente un peu l’apprêt et ce qu’on pourrait appeler la ficelle dramatique.
GIRODET (1767-1824) — 251 — Le Sommeil d’Endymion. — Voici un sujet qui nous ramène à des idées plus riantes. Ce tableau est également placé à gauche du spectateur, sur le même panneau, mais il est placé sur la cimaise, et c’est une bonne fortune de pouvoir examiner de près cette charmante toile, qui est assurément le chef-d’œuvre de l’artiste. Retiré dans la grotte du mont Latmos, Endymion est couché sur une peau de tigre, et son beau corps, dont la partie supérieure est seule éclairée, repose mollement dans la pénombre des feuillages. L’Amour, qui voltige dane la verdure avec ses ailes de papillon, écarte en souriant les branches, pour laisser passer le rayon amoureux de la lune, qui vient s’épanouir sur le visage du beau dormeur. C’est une conception ravissante de fraîcheur et de jeunesse, et Girodet n’a pas su retrouver plus tard ces accents de lumière, que font si heureusement valoir les ombres mystérieuses du bocage.
Le sommeil d’Endymion est le premier tableau de Girodet: il l’a exécuté à Rome, quand il était pensionnaire de l’Académie de France. Voici l’extrait d’une lettre que le jeune artiste écrivait de Rome à son bienfaiteur, le docteur Trioson:
«Je suis fort occupé, dans ce moment-ci, de ma figure pour l’Académie ou plutôt de mon tableau. Je vous en dirai le sujet, puisque vous le désirez, mais je serai bien aise que personne ne le sache: je ne l’ai pas dit à M. David, auquel cependant j’écris de temps en temps. Je fais un Endymion dormant; l’amour écarte les branches des arbres auprès desquels il est couché, de manière que les rayons de la lune l’éclairent par cette ouverture, et le reste de la figure est dans l’ombre. Je ne crois pas la pensée mauvaise; quant à l’effet, il est purement idéal, et par conséquent très-difficile à rendre. Le désir de faire quelque chose de neuf, et qui ne sentît pas simplement l’ouvrier, m’a peut-être fait entreprendre au delà de mes forces; mais je veux éviter les plagiats.»
PRUD’HON (1758-1823) — 459 (+) La Justice et la Vengeance divine poursuivant le crime. — Quoique Prud’hon se soit surtout complu dans la représentation des sujets aimables et presque érotiques, il est vraiment tragique dans ce tableau. Dans un paysage éclairé par la lune, est étendu par terre le corps nu d’un jeune homme assassiné. Le meurtrier, tenant dans ses mains une bourse et un poignard, s’enfuit, poursuivi par deux figures allégoriques qui planent dans les airs: la Vengeance, tenant une torche pour éclairer la marche du coupable, qui cherche en vain l’obscurité, et la Justice, personnifiée par les balances et le glaive. Les teintes vagues des buissons, les larges ombres projetées sur le sol, le contraste des lueurs rougeâtres de la torche avec la pâle clarté des rayons lunaires, produisent sur le spectateur un effet saisissant et comme un frisson d’effroi.
Le grand tableau que nous voyons avait eté commandé à Proud’hon pour le Palais de Justice. Voici la lettre dans laquelle l’artiste expose lui-même au préfet de la Seine son idée et ses prétentions:
«Précis du tableau destiné pour la grande salle du tribunal criminel au Palais de Justice:
» La Justice divine poursuit constamment le Crime; il ne lui échappe jamais.
» Couvert des voiles de la nuit, dans un lieu écarté et sauvage, le Crime cupide égorge une victime, s’empare de son or et regarde encore si un reste de vie ne servirait pas à déceler son forfait. L’insensé ! il ne voit pas que Némésis, cette agente terrible de la Justice, comme un vautour fondant sur sa proie, le poursuit, va l’atteindre et le livrer à son inflexible compagne. Tel est le sujet du tableau qui doit être placé dans la salle du tribunal criminel du département de la Seine.
» Ce tableau, de huit pieds de hauteur sur dix de largeur, serait du prix de quinze mille francs.
» Il serait payé par tiers de cinq mille francs, à trois époques différentes: la première, à la présentation de l’esquisse; la seconde, lorsque le tableau serait ébauché, et la troisième, lorsqu’il serait entièrement terminé.
» Je me charge de finir dans l’espace de dix mois, à dater du jour où je recevrai l’arrêté du préfet qui décide irrévocablement de son exécution.
» Tous mes efforts seront employés dans ce tableau à répondre aux intentions du Conseiller d’Etat, préfet de la Seine, et à le rendre, par son énergie, digne du local qu’il doit occuper.
PRUD’HON, peintre.
Musée des artistes, ci-devant Sorbonne.
» Paris, ce 5 messidor an XIII.»
Le tableau de Prud’hon, exposé au Salon de 1808, a produit une sensation assez vive, mais surtout par son étrangeté. La critique du temps ne voyait que par les principes de David, et elle ne comprenait pas qu’un peintre de petits sujets comme Prud’hon eût l’audace d’aborder un grand sujet historique. Le persiflage alla donc son train et la chanson qui accompagne le petit article qu’on va lire, retentit bientôt dans les ateliers: elle est tirée de l’Observateur au Muséum. Paris 1808:
SALON DE 1803
N° 484. — M. PRUD’HON
«La Justice, devancée par la Vengeance divine, poursuit le Crime: bonne couleur, effet de convention, comme tant d’autres auxquels on ne fait pas grande attention. Dessin très-incorrect: le bras de la Justice tenant l’épée n’est nullement heureux; l’action en est forcée et hors absolument de nature.
AIR: Jeunes amants, cueillez des fleurs.
Dessinez mieux, monsieur Prud’hon,
Surtout fuyez l’allégorie;
Car de ces êtres de raison
Le connaisseur même s’ennuie.
Vous colorez avec grand art
Un sujet de simple caprice;
Mais c’est méchant de votre part
D’avoir torturé la Justice.
La postérité, plus équitable, a porté un jugement bien différent sur Prud’hon, et son tableau compte aujourd’hui dans l’opinion parmi les plus grands chefs-d’œuvre de l’école française.
«Enfin parut, en 1808, le tableau de la Justice et la Vengeance divine poursuivant le Crime. C’est l’ouvrage le plus important de Prud’hon. Dans cette composition, le mélange des caractères vigoureux et des beautés touchantes se présentait avec tous les avantages possibles: la franchise de l’effet, la décision des lignes, tout y frappant et attachant. Ce fut un rude coup pour ses adversaires et un objet de surprise pour cette masse inhabile qui, incapable par elle-même de porter un jugegement quelconque, est toujours disposée à s’en rapporter à celui de la haine. Napoléon, supérieur aux cabales et frappé de l’excellence de l’ouvrage, donna au peintre la décoration. Accordée spontanément par l’empereur et à cette époque féconde en miracles, cette distinction était immense; elle tirait à l’instant de la foule des artistes et plaçait au premier rang un homme presque obscur la veille. Ses ennemis, et il comptait dans ce nombre tous les peintres, lui reprochèrent d’avoir peint le crime avec des traits trop repoussants; à leur gré, il eût fallu de la grâce jusque dans la figure du brigand teint de sang, marchant sur l’innocente victime dont il emporte les dépouilles.»
EUG. DELACROIX.
(Revue des Deux-Mondes, 1er novembre 1846.)
PRUD’HON (1758-1823) — 460 — Portrait de madame Jarre. — Ce portrait a figuré au Salon de 1822.
Disons un mot du magnifique Portrait de madame Jarre, qui pourrait tenir sa place parmi les plus beaux de Titien, de Van Dyck et de Velasquez. C’est une brune aux yeux de velours, dans toute la plénitude de sa beauté ; elle est vêtue d’une robe décolletée, la taille sous le sein, selon la mode de l’Empire, en gaze blanche lamée d’or.
La lumière s’étale complaisamment sur une poitrine du plus admirable modelé et qui semble se gonfler au souffle de la vie, et les contours de son séduisant corsage se noient dans des ombres que le Corrége seul eût pu faire aussi suaves. Prud’hon connaissant à fond la pratique matérielle de son art, beaucoup trop négligée par les artistes de son temps, ébauchait en grisaille, revenant sur sa préparation avec des glacis, employant le blanc dans les ombres, au lien de les frotter de bitume et de jaune de Naples; aussi ses tableaux conservent-ils leur fraîcheur, tandis que ceux de ses confrères changent de ton, verdissent dans toutes les parties ombrées et se craquèlent par l’abus des huiles siccatives.
THÉOPHILE GAUTIER. (Paris-Guide.)
Cette dernière remarque n’est pas absolument juste. Les peintures de Prud’hon conservent, il est vrai, leur coloris, mais plusieurs de ses tableaux sont horriblement craquelés.
Louis DAVID (1748-1824) — 157 — Portrait de Pecoul, entrepreneur des bâtiments du roi Louis XV, beau-père de David. — 153 — Portrait de madame Pecoul. — Deux autres portraits, non inscrits au catalogue et sans numéro.
MADAME LE BRUN (1755-1842) — Portrait de Paisiello, compositeur de musique.
GUÉRIN (1774-1833) — 277 — Le retour de Marcus Sextus. — Ce Marcus Sextus est un personnage imaginaire dont l’histoire ne fait mention nulle part; le peintre a supposé un proscrit de Sylla qui, rentrant dans sa maison, trouve sa femme morte et sa fille désespérée. Le tableau fut exposé en 1799, au moment où un grand nombre d’émigrés commençaient à rentrer en France, et on vit une allusion politique dans l’intention du peintre. Il n’en fallut pas davantage pour assurer à Guérin un. prodigieux succès, qui était d’ailleurs appuyé sur un talent réel.
«Non-seulement le tableau fut constamment environné d’une foule immense pendant les trois mois d’exposition, mais le peintre fut l’objet d’une suite d’ovations et de triomphes qui faillirent ruiner le peu de santé qu’il avait. Outre les invitations qui lui furent faites par l’ancienne aristocratie, par les banquiers, par les personnes à la mode, et même par les fonctionnaires de l’Etat, tous les théâtres lui offrirent ses entrées gratuites, et Guérin ne paraissait jamais dans un de ces lieux publics sans être couvert d’applaudissements à son entrée et pendant les entr’actes.»
DELÉCLUZE. (David, son école et son temps.)
GUÉRIN (1774-1833) — 282 — Clytemnestre. — L’artiste a touvé un effet véritablement tragique dans le rideau rouge à travers lequel tremblote la lumière d’une lampe. On aperçoit au fond Agamemnon, qui est endormi dans une posture pleine de noblesse: Balzac, dans sa Physiologie du mariage, se plaint de la façon ridicule dont dorment beaucoup de maris, et il leur propose pour modèle la manière dont Agamemnon sait dormir, dans le tableau de Guérin. Ce talent du roi des rois ne lui a d’ailleurs pas servi à grand’chose, car Clytemnestre tient en main le poignard et s’apprête à frapper son époux. Cependant elle semble hésiter, mais Égysthe, placé derrière elle, l’excite en lui parlant à l’oreille. Cette hésitation de Clytemnestre au dernier moment est une conception dramatique inconnue aux anciens: dans les vases antiques où cette scène est représentée, Clytemnestre tient sa hache à double tranchant et frappe sa victime résolûment.
Troisième panneau. — GÉRICAULT (1791-1824) — 242 (+) Le radeau de la Méduse. — Ce tableau a été le signal d’une rénovation dans la peinture. La relation publiée par Corréard, un des survivants du naufrage, avait causé dans le public une émotion indicible. C’est le passage suivant de cette relation qui a été le point de départ du tableau de Géricault:
«La frégate la Méduse, accompagnée de trois bâtiments, la corvette l’Echo, la flûte la Loire et le brick l’Argus, quitta la France le 18 juin 1816, portant à Saint-Louis (Sénégal) le gouverneur et les principaux employés de cette colonie. Il y avait à bord environ quatre cents hommes, marins ou passagers. Le 2 juillet, la frégate tombait sur le banc d’Arguin, et après cinq jours d’inutiles efforts pour remettre le navire à flot, un radeau fut construit, et cent quarante-neuf victimes y furent entassées, tandis que tout le reste se précipitait dans les canots. Bientôt les canots coupèrent les amarres, le radeau qu’ils devaient traîner à la remorque resta seul au milieu de l’immensité des mers. Alors la faim, la soif, le désespoir armèrent ces hommes les uns contre les autres. Enfin, le douzième jour de ce supplice surhumain, l’Argus recueillit quinze mourants.»
(Extrait du rapport de Corréard, l’un des survivants de la Méduse.)
Géricault, avant d’entamer sa grande toile, a fait plusieurs esquisses très-différentes les unes des autres et dont plusieurs s’éloignent beaucoup de la composition définitive. M. Ch. Clément, auteur d’un livre qui est ce qu’on a publié de plus complet sur Géricault, donne de longs détails sur la manière dont l’artiste a procédé dans la marche de son travail; en voici quelques extraits:
Géricault employa le printemps et l’été de 1818 à compléter ses informations et ses études. Avec ce besoin d’exactitude qui est l’un des traits caractéristiques de notre temps, et qui était plus accusé chez lui que chez personne, il dressa le procès-verbal de cette affaire avec l’apreté, la persistance et la minutie qu’y mettrait un juge d’instruction. Il rassembla un véritable dossier bourré de pièces authentiques, de documents de toute sorte. Il s’était beaucoup lié avec MM. Corréard et Savigny, les principaux survivants parmi les acteurs de ce drame dont il se faisait raconter toutes les navrantes et horribles peripérities. Il fit d’après eux plusieurs études qui lui servirent pour son tableau. Tout l’intéressait; il voulait tout savoir. Il avait retrouvé le charpentier de la Méduse, qui était l’une des quinze personnes échappées au désastre, et il lui avait fait faire un petit modèle du radeau qui reproduisait tous les détails de la charpente avec la plus scrupuleuse exactitude, et sur lequel il avait disposé des maquettes de cire. Il l’avait dessiné à part, et M. Camille Marcille conserve un de ces curieux croquis. Comme son atelier de la rue des Martyrs était trop petit pour qu’il pût songer à y exécuter son tableau, il en avait loué un autre de très-vastes dimensions dans le faubourg du Roule; il était ainsi à deux pas de l’hôpital Beaujon. C’est là qu’il allait suivre avec une ardente curiosité toutes les phases de la souffrance, depuis les premières atteintes jusqu’à l’agonie et les traces qu’elle imprime sur le corps humain. Il y trouvait des modèles qui n’avaient pas besoin de se grimer pour lui montrer toutes les nuances de la douleur physique, de l’angoisse morale: les ravages de la maladie et les terreurs de la mort. Il s’était arrangé avec les internes et les infirmiers, qui lui fournissaient des cadavres et des membres coupés.
«En général, Géricault se servait de modèles de profession. Quelques-unes des figures de la Méduse sont cependant des portraits. M. Corréard a posé pour le personnage qui tend les bras vers l’Argus; M. Savigny pour celui placé immédiatement au pied du mât; M. Jamar pour la figure qui se trouve entre M. Savigny et le nègre, et pour le jeune homme du groupe du premier plan; Eugène Delacroix pour la figure repliée sur elle-même, les bras pendants et la tête appuyée au radeau; M. Dastier, officier d’état-major, pour l’homme vu de dos tout à la droite du radeau; quant au nègre qui fait des signaux, c’est Joseph, un modèle bien connu dans les ateliers, il n’y a pas à s’y tromper; l’une des tètes du second plan a été faite d’après celle du charpentier de la Méduse; enfin, c’est le modèle Gerfard qui a servi pour le personnage étendu tout à la gauche de la composition.»
CHARLES-CLÉMENT. (Géricault.)
La dimension énorme donnée à une scène toute d’actualité, était une protestation contre les théories classiques, et il serait difficile aujourd’hui d’imaginer à quel point un pareil sujet, traité de cette façon, renversait toutes les idées reçues en matière d’art, à l’époque où ce tableau parut au salon de 1819? de plus l’opinion publique voyait là une intention politique.
Le capitaine qui, en 1816, avait si mal conduit son navire, était un ancien émigré, qui n’avait pas vu la mer depuis vingt-cinq ans, et devait son grade, non à son expérience, mais à son dévouement dynastique.
L’opposition avait vivement attaqué le ministre qui avait ainsi confié un équipage à un homme incapable de le diriger, et la représentation poignante du désastre qui en avait été la conséquence ne pouvait manquer de causer une vive émotion.
Géricault signale lui-même dans une lettre l’étrange façon dont son tableau est apprécié dans les journaux:
«Cette année, nos gazetiers sont arrivés au comble du ridicule. Chaque tableau est jugé d’abord selon l’esprit dans lequel il a été composé. Ainsi vons entendez un article libéral vanter dans tel ouvrage un pinceau vraiment patriotique, une touche nationale. Le même ouvrage, jugé par l’ultra, ne sera plus qu’une composition révolutionnaire où règne une teinte générale de sédition. Les tètes des personnages auront toutes une expression de haine pour le gouvernement paternel. Enfin, j’ai été accusé par un certain Drapeau blanc d’avoir calomnié par une tète d’expression tout le ministère de la marine. Les malheureux qui écrivent de semblables sottises n’ont sans doute pas jeûné quatorze jours, car ils sauraient alors que ni la poésie ni la peinture ne sont susceptibles de rendre avec assez d’horreur toutes les angoisses où étaient plongés les gens du radeau.»
L’idée d’entasser sur un radeau battu des vagues, de malheureux affamés dont la nudité affirmait encore la maigreur, fut presque universellement blâmée comme incompatible avec l’idée de beauté que l’art doit avant tout chercher, et un critique célèbre qualifia le tableau de naufrage de la peinture Un petit groupe d’admirateurs passionnés se forma néanmoins autour du jeune maître et commença dans les arts l’évolution d’idée qu’on a appelée le romantisme. Mais dans la masse du public la tentative hardie de Géricault fut complètement désapprouvée, et après la mort du peintre, survenue en 1824, ses héritiers voulaient couper la toile en morceaux dans l’espoir d’en tirer plus de profit: le musée en fit heureusement l’acquisition au prix de 6,000 francs, et il est aujourd’hui classé parmi les chefs-d’œuvre de l’école française.
GÉRICAULT (1791-1824) — 243 (+) Officier de chasseurs à cheval chargeant:
«Il est à peine nécessaire de décrire ce bel ouvrage, l’un des plus connus et des plus populaires de Géricault. Le cheval gris pommelé, vu de trois quarts, par la croupe, et marchant à droite, gravit au galop les escarpements d’un terrain rocheux. Le jeune officier qui le monte, le sabre au poing, la pelisse flottante, se retourne sur la selle, commande du geste et de la voix et enlève l’escadron de chasseurs que l’on voit au second plan, tout à la gauche du tableau. Dans son effort, le cheval se cabre, et, effrayé par l’éclat d’un obus, rejette la tète du côté du spectateur, en faisant un mouvement contrarié de la plus grande énergie; l’une de ses jambes de derrière est repliée presque jusqu’à terre; il tend l’autre dans un écart démesuré, au point de ne plus toucher le roc que par du tranchant du sabot. Les deux figures se détachent en force sur le fond éclairé des lueurs fauves du combat, et la lumière, pittoresquement distribuée, ne tombe en plein que sur la croupe et sur la tète du cheval, sur la cuisse et sur le visage du cavalier.»
CHARLES CLÉMENT. (Géricault.)
Ce tableau qui a figuré au salon de 1812 est le premier que Géricault ait exposé, il avait alors 21 ans. David s’écria en voyant cette peinture: «D’où cela sort-il? je ne reconnais pas cette touche.»
La critique du temps est assez curieuse à relever.
«Il y aurait un mérite à avoir inventé la figure d’un officier de hussard (sic) annoncé sous le n° 445. Cette figure est parfaitement en rapport avec l’ajustement et les habitudes du cavalier militaire. Le mouvement de l’homme et surtout le mouvement du cheval, fort exagérés, ce me semble, ont cependant de l’effet: la couleur, à laquelle on pourralt désirer un peu plus de chaleur, ne manque pas d’harmonie; la touche est facile et spirituelle. Je pense que l’auteur traiterait avec succès le tableau de batailles de moyenne dimension. M. Géricault se montre au Salon pour la première fois.»
Journal de l’Empire, 16 novembre 1812.
GÉRICAULT (1791-1824) — 244 — Cuirassier blessé quittant le feu. — C’est au moment des désastres qui précédèrent l’invasion que ce tableau a été conçu. Il est inférieur au précédent et a figuré au salon de 1814.
«Abattu, harassé, le soldat vaincu descend avec peine une pente glissante en tenant par la bride son cheval, compagnon fidèle de ses infortunes, en s’appuyant de l’autre sur son sabre désormais inutile. Il retourne la tète et regarde une dernière fois la colline où s’est consommée la défaite. La souffrance est empreinte dans ses traits, dans toute son attitude. Tout est bien perdu; le ciel lui-même, d’un aspect funèbre n’est éclairé que par une lueur à l’horizon. Les jours mauvais sont venus. Le souffle le plus puissant inspire cette composition-sublime, et à l’égard du sentiment pathétique, Géricault ne s’est jamais élevé plus haut. C’est une conception gigantesque, homérique, du plus admirable caractère. Mais là doit s’arrêter la louange. L’exécution de cet ouvrage est incomplète et imparfaite; elle ne résiste pas à l’analyse. L’ensemble est peu achevé ; ce n’est guère qu’une ébauche. Le dessin de la figure est vague: elle paraît un peu vide, et le cheval, replié sur lui-même, n’est pas possible. On dirait que le peintre, ayant mal pris ses mesures, l’a fait entrer de force dans sa toile. Lorsque Géricault exécuta ce tableau, il était dans de très-mauvaises dispositions. Il le fit très-vite, en quinze jours ou trois semaines, et sans entrain. Il en était très-mécontent et disait de la. tête du cuirassier: «C’est une tête de veau avec un grand œil bête!» Il y a du vrai dans cette appréciation, et l’artiste savant avait le droit d’être sévère pour lui-même.»
CHARLES-CLÉMENT. (Géricault.)
GÉRICAULT (1791-1824) — 245 — Un carabinier. — Cette figure vue à mi-corps semble peinte en quelques heures. Ce n’est qu’une étude, mais une étude d’une hardiesse et d’une franchise superbe.
DROUAIS (1763-1788) — 189 — Marius à Minturne. — Bon tableau, placé un peu haut et qui est le début d’un jeune homme mort à la fleur de l’âge, laissant des regrets universels. Il était l’élève chéri de David, qui, lorsque Drouais remporta le prix de Rome, le suivit en Italie. David écrivait ensuite:
«Je pris, dit-il, le parti de l’accompagner en Italie, autant par attachement pour mon art que pour sa personne. Je ne pouvais plus me passer de lui; je profitais moi-même en lui donnant des leçons, et les questions qu’il m’adressait seront des leçons pour ma vie. J’ai perdu mon émulation,»
FABRE (1766-1837) — 192. — Néoptolème et Ulysse enlevant à Philocléte les flèches d’Hercule. — Fabre est un des plus anciens élèves de David, qui comptait beaucoup sur son avenir. C’était un artiste instruit, mais dépourvu d’activité, aussi a-t-il peu produit. Il est surtout connu par sa liaison intime avec le poëte Alfieri et la comtesse Albani, qui lui laissa sa fortune. Fabre était un très-grand connaisseur, et a réuni une magnifique collection de tableaux qu’il a laissée à Montpellier, sa ville natale.
REGAULT (1754-1822) — 466 — Éducation d’Achille par le centaure Chiron. — Ce tableau, exposé au salon de 1783, a été le morceau de réception de l’artiste à l’Académie de peinture. Regnault a été considéré quelques temps comme un rival de David, mais il était loin d’avoir la même puissance.
MADAME LE BRUN (1755-1842) — 82. — Portrait de madame Le Brun et de sa fille.
DAVID (1748-1825) — 159 — Portrait du pape Pie VII. — Cet admirable portrait, un des chefs-d’œuvre du maître, a été exécuté en 1805 au palais des Tuileries. — 152 — Bélisaire demandant l’aumône. — Ce tableau est une réduction, retouchée et signée par David, d’un ouvrage plus grand qui avait paru au salon de 1781. David était alors un débutant et il est intéressant de voir comment il est apprécié par Diderot:
«Ce jeune homme, dit-il, montre de la grande manière dans la conduite de son ouvrage; il a de l’âme; ses tètes ont de l’expression sans affectation, ses attitudes sont nobles et naturelles; il dessine, il sait jeter une draperie et faire de beaux plis; sa couleur est belle sans être brillante. Je désirerais qu’il eût moins de roideur dans ses chairs, ses muscles n’ont pas assez de flexibilité en quelques endroits. Rendez par la pensée son architecture plus sourde, et peut-être que cela fera mieux. Si je parlais de l’admiration du soldat, de la femme qui donne l’aumône, de ces bras qui se croisent, je gâterais mon plaisir et j’affligerais l’artiste, mais je ne saurais me dispenser de lui dire: Est-ce que tu ne trouves pas Bélisaire assez humilié de recevoir l’aumône? Fallait-il encore la lui faire demander? Passe ce bras élevé autour de l’enfant, ou lève-le vers le ciel qu’il accusera de sa rigueur. »
Quatrième panneau. — GROS (1771-1835) — 274 (+) La peste de Jaffa. — L’admiration qu’inspira ce tableau au salon de 1804, où il fut exposé, fut si universelle que les artistes et les élèves peintres vinrent y déposer une palme d’honneur. Bien que le temps l’ait fait noircir et craqueler, il est encore aujourd’hui classé parmi les plus grands chefs-d’œuvre de la peinture. Nous emprunterons à Eugène Delacroix la belle description qu’il en a donnée:
«L’école française, accoutumée à la discipline de David et aux sujets puisés dans l’antique, s’étonnait de l’intérêt que cette action comtemporaine empruntait à la seule fidélité de la représentation. A la vérité, l’uniforme français s’y trouvait mêlé aux costumes variés de l’Orient; la figure humaine, dans la peinture des Pestiférés, s’y offrait aussi dans des conditions où le mélange de ces divers éléments n’avait rien de forcé ni d’étrange. Gros avait tiré un parti énorme de ces oppositions, et loin que l’habit européen en paraisse plus mesquin, il est des parties de ce tableau où cet habit, en raison de sa simplicité même, prend un intérêt particulier. Nous citerons pour exemple la figure de ce malade assis de face, à gauche et sur le devant du tableau, qui, le menton appuyé sur ses poings crispés, semble en proie à une fièvre affreuse. Une capote de soldat l’enveloppe, et le simple bonnet de police qui descend jusque sur ses yeux, et dont la pointe déroulée pend le long de son épaule, compose un ajustement aussi neuf que frappant. Un autre exemple, entre une multitude d’autres, peindra mieux eneore l’effet de ces contrastes. Dans le même coin de gauche, on voit un dragon accroupi à terre, le dos appuyé contre la muraille. Par un geste frénétique, il tend les deux bras à la fois pour avoir du pain. Cet homme est entièrement vêtu de son uniforme étriqué et porte autour de la tète un mauvais chiffon entortillé. Ce misérable corps, sous cet habit militaire, paraît plus dénué, plus effrayant que les corps entièrement nus ou vêtus à moitié qui se roulent près de lui dans la poussière. Gros est plein de ces traits que la description ne peut qu’affaiblir et qui saisissent fortement à l’aspect de sa peinture. »
EUGÈNE DELACROIX.
(Revue des Deux-Mondes, septembre 1848.)
Gros, qui était élève de David, avait un tempérament absolument personnel auquel pourtant il n’obéissait qu’à regret, car il tenait pour excellent l’enseignement qu’il avait reçu de son maître et il voulait le transmettre à ses élèves. A la fin de sa vie, le romantisme apparaissait, et de jeunes novateurs, avec un enthousiasme plus exalté que réfléchi, commençaient à attaquer le principe même de l’école. Le jour de l’enterrement de Girodet, comme on vint à parler du déclin des études, Gros s’accusa personnellement d’en être la cause indirecte, par les exemples qu’il avait donnés dans ses ouvrages. C’est alors qu’il conçut ce grand tableau mythologique pour lequel la critique a été si dure à son égard et qui était en effet très-faible. Gros est un singulier exemple du peu de mesure avec lequel les artistes jugent quelquefois leurs propres ouvrages.
GUÉRIN 1774-1833) — 279. — Phèdre et Hippolyte. — Cette scène paraît aujourd’hui bien froide et son aspect théâtral fatigue l’esprit plus qu’il ne le séduit. Guérin sentait la peinture en acteur et ses personnages semblent déclamer des vers plutôt que penser et agir réellement. Par contre, ses tableaux sont d’un grand intérêt pour l’histoire du théâtre, et les gestes que nous voyons ici répondent exactement aux traditions de la Comédie française à cette époque; on sait, en effet, que Guérin était un grand ami de Talma.
Nous comprenons difficilement aujourd’hui l’enthousiasme d’une génération dont les idées étaient aussi différentes des nôtres. Cependant les artistes, qui dans tous les temps se dénigrent assez volontiers les uns les autres, mêlaient leurs applaudissements à ceux du public. On peut juger de leur opinion par une lettre de Girodet, dont voici un extrait.
«Le sujet de Phèdre accusant Hippolyte devant Thésée est un des plus heureux de la peinture; on peut même dire qu’il est éminemment pittoresque, tel que l’a conçu Guérin, qui a su fondre ensemble Euripide et Racine, et qui en s’appropriant, en quelque sorte, le génie de ces deux grands hommes, a montré toutes les ressources du sien.»
A. Couple. (Œuvres de Girodet.)
GUÉRIN (1774-1833) — 280. — Andromaque el Pyrrhus. — Ce tableau présente les mêmes qualités et les mêmes défauts que le précédent.
GIRODET (1767-183) — 252. — Atala au tombeau. — Ce tableau, très-admiré autrefois, semble une vignette grandie et tout le talent du peintre n’empêche pas le manque de proportion entre le sujet, qui est une illustration de roman, et ce tableau qui semble, une grande page d’histoire. La scène est d’ailleurs traitée d’une manière touchante, mais dans un coloris savonneux et une facture creuse qui en atténuent singulièrement le charme.
GÉRARD (1770-1837) — 236. — Psyché reçoit le premier baiser de l’Amour. — Charmante composition: le papillon, symbole de l’âme, voltige sur la tête de la jeune fille, assise sur un tertre de gazon; son air ingénu et un peu étonné s’explique par la présence de l’Amour qui, invisible pour elle, dépose un baiser sur son front. Lamartine, qui était grand admirateur de Gérard, lui a adressé les vers suivants, en même temps qu’un exemplaire de son Jocelyn:
Sous les traits de Psyché, toi qui peignis une âme,
Pour créer comme toi, je fais de vains efforts;
Jette à mes deux amants un éclair de ta flamme,
Et mes âmes auront un corps.
H. GÉRARD. (Correspondance de François Gérard.)
Le tableau de l’Amour et Psyché eut un succès prodigieux au salon de 1798 où il figura: pourtant il souleva aussi quelques critiques. On trouva que l’expression touchait à l’afféterie et que le modelé, à force de simplification, finissait par manquer d’accent. Dans un groupe d’artistes, le sculpteur Giraud, montrant le torse de l’Amour, s’avisa de demander si le torse était peint en long ou en large. Le mot courut tout Paris.
GÉRARD (1770-1837) — 240. — Portrait d’Isabey. — Les commencements de Gérard ont été difficiles, et malgré son talent, il gagnait péniblement sa vie au début de sa carrière, Isabey, déjà célèbre comme peintre en miniature et très-répandu dans le monde, lui proposa de peindre son portrait, étant bien certain qu’il attirerait l’attention. C’est ce beau portrait que M. Eugène Isabey a donné au Louvre et qui fut le premier ouvrage remarqué de Gérard. La petite fille qu’on voit à côté d’Isabey est devenue depuis madame Cicéri.
PRUD’HON (1758-1823) — 458. — L’Assomption de la Vierge. — Ce tableau commandé à Prud’hon en 1816 pour la chapelle des Tuileries, est loin de valoir les autres ouvrages du même maître qui se voient au Louvre.
GRANET (1775-1849) — 256. — Intérieur de la basilique basse de Saint-François d’Assise à Assise. — Ce tableau très-remarquable sous le rapport de la couleur et de l’effet, est malheureusement très-abîmé.
GÉRICAULT (1791-1824). — Course de chevaux.
COCHEREAU (1793-1817) — 127. — Intérieur de l’atelier de David. — Ce petit tableau est assez curieux parce qu’il passe pour être d’une exactitude absolue: tous les personnages sont des portraits, parmi lesquels on regrette de ne pas voir le professeur en train de corriger. Parmi les élèves on reconnaît Schnetz et Pagnest; le modèle qui est sur la table est un nommé Polonais, autrefois très-fameux dans les ateliers: c’est lui, dit-on, qui avait posé pour le Léonidas de David. Cochereau est mort extrêmement jeune et ce tableau est le seul qu’on connaisse de lui.
LE SALON CARRÉ
Quand on est dans le Salon des sept cheminées, il faut prendre la porte qui est à main droite en tournant le dos aux Sabines de David: cette porte ouvre sur la salle des bijoux antiques; un vestibule rond, qui vient ensuite, donne accès, par une belle grille en fer forgé, à la galerie d’Apollon, au bout de laquelle on trouve le Salon carré. Ce salon a été complètement restauré et décoré par l’architecte Duban. Dans les voussures on voit des trophées et des statues allégoriques sur les Beaux-Arts, dues au statuaire Simart. On a placé dans cette belle et grande salle un choix de tableaux pris indistinctement dans toutes les écoles de peinture jusqu’au dix-septième siècle inclusivement. Comme dans la fameuse tribune du Musée de Florence, il n’y a ici que des chefs-d’œuvre, et l’œil ne risque point de s’égarer. Toutes les toiles qui se trouvent dans cette salle doivent être examinées l’une après l’autre et avec le plus grand soin.
Premier panneau. — PAUL VÉRONÈSE (1528-1588) — 93 (+) Les noces de Cana. — Cette admirable peinture, qui est venue à Paris à la suite des guerres de Napoléon, et nous avons eu le bonheur de la conserver, le gouvernement autrichien ayant consenti à prendre en échange un tableau de Ch. Le Brun sur un sujet analogue.
«Paul Véronèse a introduit dans cette immense composition les portraits d’un grand nombre de personnages célèbres. D’après une tradition écrite, conservée dans le couvent de Saint-Georges et communiquée à Zanetti, il parait que l’époux assis à gauche, à l’angle de la table, et à qui un nègre, debout de l’autre coté, présente une coupe, serait don Alphonse d’Avalos, marquis du Guast, et la jeune épouse placée près de lui, Eléonore d’Autriche, reine de France. On remarque un fou derrière elle. François 1er, coiffé d’une façon bizarre, est assis à ses côtés; vient ensuite Marie, reine d’Angleterre, vêtue d’une robe jaune. Soliman Ier, empereur des Turcs, est près d’un prince nègre qui parle à un des serviteurs; plus loin, Victoire Colonna, marquise de Pescaire, tient un cure-dents. A l’angle de la table, l’empereur Charles V, vu de profil, porte la décoration de l’ordre de la Toison d’or. Paul Véronèse s’est représenté lui-même, avec les plus habiles peintres de Venise, ses contemporains, au milieu du groupe de musiciens qui occupe le devant du tableau. Il est en habit blanc et joue de la viole; de l’autre côté, Titien joue de la basse; le vieux Bassan joue de la flûte; derrière lui, le Tintoret l’accompagne avec un instrument semblable; enfin, celui qui est debout, vêtu d’une étoffe brochée, et qui tient une coupe remplie de vin, est Benedetto Cadiari, frère de Paul. — Ce tableau, cité par Vasari comme une merveille, était placé au fond du réfectoire du couvent de Saint-Georges-Majeur, à Venise.
VILLOT. (Notice de l’Ecole italienne )
Les noces de Cana du Louvre sont considérées comme le chef-d’œuvre de Paul Véronèse. Le peintre était là dans son élément: il s’agissait pour lui de déployer, au milieu d’une architecture élégante et grandiose, un splendide festin dont les convives, superbement bariolés dans leurs costumes de velours et de satin, montrent tous des visages radieux, exempts d’inquiétudes et d’une santé florissante. Cette manière singulière de comprendre l’histoire n’est pas sans avoir soulevé des critiques, de la part des gens amoureux de l’exactitude avant tout. Il ne faudrait pas croire cependant que le grand peintre vénitien fût ignorant au point de croire qu’une noce dans un pauvre village de la Judée, pût ressembler aux magnificences qu’il étale dans son tableau; c’est le résultat d’un parti pris. Paul Véronèse est un vrai Vénitien, et peut-être l’incarnation la plus complète de l’école; ces magnifiques ordonnances architecturales où se meut tout un peuple richement vêtu, ces vases précieux, ces brillantes étoffes, ces jardins enchantés qu’on entrevoit au travers des colonnades de marbre, n’est-ce pas là ce que rêvait Venise, la ville des fêtes, des repas somptueux, où la musique, les fleurs, l’amour et les festins étaient l’occupation quotidienne d’une société qui ne connut jamais l’ennui ni la passion? Ce rêve poursuivait Paul Véronèse jusque dans ses scènes religieuses. Comme les anciens Grecs, qui pensaient honorer les dieux par la joie et le rire, l’artiste vénitien se plaignait dans ses lettres de l’aspect lugubre sous lequel les peintres ont coutume de représenter une croyance qui promet tant de bonheur aux élus: ce bonheur, il le plaçait, comme tous les Vénitiens, dans la magnificence et l’éclat radieux de la mise en scène. Derrière des dessins décrits par Ridolfi, on lit des notes de l’artiste comme celle-ci:
«Si jamais j’ai le temps, je veux représenter un repas somptueux dans une superbe galerie, où l’on verra la Vierge, le Sauveur et Joseph. Je les ferai servir par le plus grand cortége d’anges qui se puisse imaginer, occupés à leur offrir, dans des plats d’argent et d’or, des viandes exquises et une abondance de fruits superbes. D’autres s’emploieront à leur présenter, dans des cristaux transparents et des coupes dorées, des liqueurs précieuses, pour montrer le zèle des esprits bienheureux à servir leur Dieu.»
Dans une autre note, Il parle d’un tableau représentant Jésus et sa mère, autour desquels des anges tiennent le soleil, la lune, les étoiles, un pélican, un phénix, etc., et en même temps la terre se couvre de fleurs et de fruits. On voit qu’il n’y a nulle philosophie, nul mysticisme dans cette façon toute orientale de concevoir le bonheur; Paul Véronèse n’est ni un mystique, ni un philosophe, il se contente d’être un admirable peintre.
GIORGIONE. — (1478-1511) — 39 — Concert champêtre. — Ce joli tableau, qui est placé à gauche, en se rapprochant de la porte de la galerie d’Apollon exprime dans toute sa netteté la tendance de l’école vénitienne, c’est-à-dire ce qu’on appellerait aujourd’hui l’art pour l’art. En effet l’idée est complètement absente et la composition n’existe que pour le charme de l’oeil: deux jeunes hommes dans un costume de fantaisie, une femme nue qui joue de la flûte et une autre à demi-vêtue qui verse de l’eau dans un réservoir en pierre, le tout d’une admirable couleur et dans un ravissant paysage, voilà le concert champêtre de Giorgione.
CORRÉGE (1493-1534) — 19 (+) Mariage mystique de sainte Catherine d’Alexandrie. — L’enfant Jésus, sur les genoux de la Vierge, passe son anneau au doigt de sainte Catherine, derrière laquelle on voit saint Sébastien debout et tenant des flèches. Vasari parle de ce chef-d’œuvre dans la vie de Girolamo Carpi:
«Étant arrivé à Modène, il resta émerveillé à la vue des tableaux du Corrége, mais l’un d’eux surtout le frappa de stupéfaction: ce fut ce tableau, ouvrage divin, qui représente la Vierge avec l’Enfant Jésus, épousant Sainte-Catherine, Saint-Sébastien, et d’autres figures avec des airs de tète si admirables qu’elles semblent faites dans le paradis. Il est impossible de voir de plus beaux cheveux, de plus belles mains et un coloris plus charmant, plus naturel.»
VASARI. (Vie des peintres.)
L’opinion émise en passant par Vasari est encore juste aujourd’hui, et le tableau du Corrége est d’une conservation si admirable, qu’on le dirait fraîchement sorti des ateliers du maître.
SIMONE MEMMI — (1284-1341) — 260 — Jésus-Christ marchant au Calvaire. — Simone Memmie est un des chefs de l’ancienne école de Sienne, et un des ancêtres de la Renaissance: l’attribution de ce petit tableau est contestée.
FRANCIA. — (1450-1517) — 306 — La Nativité.
RAPHAEL SANZIO (1483-1520) — 370 (+) Saint Michel terrassant le démon. — Au milieu d’un désert hérissé de rochers, dont les fentes laissent échapper les flammes de l’enfer, l’archange saint Michel, recouvert d’une cuirasse de fer et d’or, vient de s’abattre comme un oiseau de proie sur le démon, qu’il a terrassé, et qu’il va transpercer de sa lance. Les ailes du guerrier céleste sont encore à demi ouvertes et son écharpe vole derrière lui; il vient de s’élancer du haut des cieux et son pied effleure à peine l’épaule de son ennemi, qui se tord dans les efforts d’une rage impuissante. Cette belle et gracieuse figure forme un superbe contraste avec celle du démon terrassé que Raphaël, avec son sentiment exquis des convenances, a dissimulé à l’aide du raccourci, de façon que l’ange domine absolument toute la composition.
«Comment représenter le visage de saint Michel? Quels traits pouvaient convenir au chef invincible et invulnérable des milices célestes, au héros de diamant? La tète de ce héros du ciel est un des chefs-d’œuvre les plus accomplis de Raphaël: elle est si noble, si lumineuse, si imposante, qu’à peine ose-t-on la regarder. On y retrouve toute la fierté de l’Apollon Pythien; elle présente, en même temps, dans chaque trait la sévérité, la vigueur, la finesse dont les plus belles tètes antiques de Minerve offrent seules la réunion. Les sourcils droits et immobiles, les plans simples et fermes du front et des joues, attestent la tranquille supériorité de l’ange qui a vaincu sans efforts et qui triomphe sans orgueil. Un trait à peine sensible, placé entre les sourcils, indique un léger mouvement des muscles; là seulement, et dans la saillie de la lèvre inférieure, se manifestent le sentiment de la victoire et le dédain. L’agitation de la chevelure, les mouvements de la draperie, l’action des bras et des ailes, forment avec la tranquillité du visage une opposition sublime.
ÉMÉRIC DAVID. (Chefs-d’œuvre de la peinture.)
Ce tableau a beaucoup souffert par des restaurations successives. Vasari dit qu’il a été peint pour François Ier, mais il paraît avéré aujourd’hui qu’il aurait été commandé par Laurent de Médicis. Celui-ci voulait en faire présent au roi de France, dont il désirait l’appui dans sa querelle avec le duc d’Urbin. On a prétendu aussi que Raphaël avait choisi ce sujet pour complaire au pape, en faisant sentir au roi de France que le grand maître de l’ordre de Saint-Michel et le fils aîné de l’Église ne pouvait s’empêcher de terrasser le démon de l’hérésie que Luther venait d’évoquer de l’enfer. Mais cette opinion n’est guère soutenable, attendu que le tableau a été fini au mois de mai 1518, et c’est seulement la veille de la Toussaint de l’année 1517 que Luther afficha pour la première fois ses propositions contre les indulgences; le pape y attacha si peu d’importance qu’il crut simplement à une jalousie de moines.
HOLBEIN LE JEUNE (1498-1554) — 211 — Portrait d’Anne de Clèves, reine d’Angleterre, femme de Henri VIII. — Figure admirable de finesse et de modelé, mais d’un aspect assez étrange. Elle est debout, vue de face et les mains jointes.
VAN DYCK (1599-1641) — 142 (+) Charles 1er. — Le roi d’Angleterre est représenté debout, la tête coiffée d’un chapeau à grands bords, la main gauche posée sur la hanche et la droite appuyée sur une canne. Derrière lui, un écuyer, qu’on dit être le marquis d’Hamilton, retient la bride d’un cheval, Ce tableau, si riant dans son aspect, quand on le considère au point de vue de la peinture, a pourtant quelque chose de sinistre par les souvenirs qui s’y rattachent. Dans les jours orageux qui précédèrent la mort de Louis XVI, le roi de France ne cessait de contempler cette radieuse peinture, qui pour les autres était une œuvre d’art et pour lui prenait la valeur d’une sombre prophétie.
LE TINTORET (1512-1594) — 355 — Suzanne au bain. — (En haut).
LE GUERCHIN (1591-1664) — 42 — La résurrection de Lazare — 46 — Les Saints protecteurs de Modène. — Ce dernier tableau est placé de l’autre côté des noces de Cana; c’est là qu’il faut nous mettre actuellement pour continuer notre examen.
LE BASSAN (1510-1592) — 300 — Le Christ descend de la croix.
RUBENS (1577-1640) — 433 — Thomyris, reine de Scythes, fait plonger la tête de Cyrus dans un vase rempli de sang. — La jeune reine est en robe de satin blanc et couverte d’une parure éblouissante; du trône où elle est assise, elle contemple en souriant l’exécution de ses ordres sauvages.
LE SUEUR (1617-1655) — 523 — Apparition de sainte Scholastique à saint Benoît. — Saint Benoît, à genoux et en prière, voit dans le ciel sainte Scholastique, portée par trois anges et accompagnée de jeunes filles couronnées de roses blanches, symbole de virginité. Les apôtres saint Pierre et saint Paul sont près d’elles et montrent à saint Benoît le ciel, nouveau séjour de la sainte. Toute cette scène est d’une délicatesse esquise et d’une distinction ravissante.
ANDRÉ DEL SARTO (1487-1531) — 380 — Sainte Famille. — Tableau célèbre, mais extrêmement abîmé.
La Vierge, assise à terre vers la gauche du tableau, présente l’enfant Jésus à saint Elisabeth. Le jeune saint Jean, retenu par sa mère, est debout et lève sa main vers le ciel. Deux anges, dans une attitude de tendre adoration, se tiennent derrière la Vierge. Le dessin de cette belle composition a toute l’élegance florentine sans aller jusqu’au maniérisme tourmenté des lignes que n’évite pas toujours Michel-Ange lui-même. Les contours, enveloppés dans une pâte riche et chaude, ne se cernent pas et ne s’arrêtent pas durement; et, quoique le groupe présente des recherches d’eurhythmie, il ne se durcit pas en poses sculpturales. Chose singulière, ce peintre si malheureux en réalité, donne à ses figures un air de bonheur candide et de bonté naïve; une sorte de joie innocente retrousse le coin de leurs lèvres, et elles rayonnent, illuminées d’une sérénité douce, dans l’atmosphère tiède et colorée dont l’artiste les entoure. On peint son rêve et non sa vie.»
THÉOPHILE GAUTIER. (Paris-Guide.)
Les madones d’André del Sarto se ressemblent entre elles et on croit y retrouver l’image de cette Lucrezia del Fede qu’il aima si follement et qui eut sur la vie du malheureux artiste une influence si funeste. Ce fut pour la revoir qu’il quitta la France, où il avait été appelé par François Ier et comblé d’honneurs et de présents. Le roi ne le laissa partir qu’en lui faisant jurer sur l’Evangile de revenir sous peu de mois, et lui confia une somme considérable destinée à réunir pour la France une collection d’oeuvres d’art. Mais sa faiblesse pour sa femme l’ayant entraîné à dissiper cet argent, il n’osa plus retourner en France et tomba bientôt dans un état voisin de la misère. La peste l’enleva à quarante-deux ans. Sa femme l’abandonna à ses derniers moments; il mourut seul, privé de soins et de secours.
LÉONARD DE VINCI (1452-1517) — 459 — La Vierge, l’enfant Jésus et sainte Anne. — La composition de ce tableau célèbre semble un peu bizarre au premier abord. La Vierge, presque de profil, est assise sur les genoux de sainte Anne, et se baisse pour prendre l’enfant Jésus, qui caresse un agneau. Le sujet de ce tableau se rapporte à une image miraculeuse qui, dans l’église de San Celso, à Milan, parut un jour resplendissante de lumière devant les fidèles. L’image de San Celso devint l’objet de la dévotion populaire et fut reproduite par différents artistes avec des variantes.
HOLBEIN (1498-1554). — 208. Portrait d’Érasme. — C’est un des chefs-d’œuvre du maître.
ANTONELLO DE MESSINE (1414-1493) — 31 (+) Portrait d’homme. — Cette belle tête est au Louvre depuis quelques années. C’est une condottière à la mine farouche, à la bouche fine et pincée, et dont le regard profond accuse un singulier mélange d’intelligence et de volonté, mais sans la moindre bonhomie. Un pareil type est suffisant pour caractériser toute une époque, mais il n’y a qu’un grand maître qui soit capable d’écrire ainsi l’histoire, avec une physionomie.
MEMLING (fin du quinzième siècle) — 288 — Saint Jean-Baptiste. — 589 — Sainte Marie-Madeleine. — Ces deux fines peintures, qui proviennent de l’ancienne collection du roi de Hollande, servaient autrefois de volets à un tryptique dont la partie centrale n’est pas connue.
Deuxième panneau. — Nous entendons sous ce titre le panneau dans lequel est la porte qui ouvre sur la grande galerie, et au bas duquel se trouve la Belle Jardinière, de Raphaël.
RAPHAEL (1483-1530) — 362 (+) La belle Jardinière. — Ce tableau, peint en 1508, est le dernier que Raphaël ait éxécuté à Florence, au moment où il allait partir pour Rome; il est impossible de pousser plus loin la candeur et l’ingénuité que dans cette scène calme et pure, où la Vierge, dans une prairie émaillée de fleurs, contemple l’Enfant-Dieu qui lève la tête vers elle. Ce n’est pas encore le style grandiose des peintures de la dernière manière du peintre mais la grâce des mouvements, la pureté du dessin et la souplesse des figures annoncent une observation attentive de la nature et un goût exquis dans le choix des formes. Le symétrie hiératique est tout à fait abandonnée et l’impression religieuse résulte de la suavité chaste d’un type que depuis quinze. cents ans l’humanité rêvait sans pouvoir le réaliser.
«Le tableau est désigné sous le nom assez singulier de la Belle-Jardinière, parce que la Vierge est assise sur une pierre dans une prairie richement couverte de plantes et de fleurs. Elle regarde avec lune grâce inexprimable l’enfant Jésus, qui, debout devant elle, pose un bras sur les genoux de sa mère et lève vers elle ses regards remplis d’amour. Le petit saint Jean, agenouillé à droite et s’appuyant sur sa croix, contemple son divin compagnon, avec une tendre admiration. Le fond est un paysage dans lequel serpente une rivière, avec les montagnes et une ville à droite, dans le lointain. Ce tableau est ceintré dans le haut.
Ce magnifique ouvrage, traité avec l’esprit le plus élevé, et dont les têtes surtout sont remplies d’âme et d’expression, présente pourtant quelques parties paraissant non terminées, comme les mains et les pieds, qui ne sont qu’indiqués. Il s’y trouve aussi quelques négligences le dessin; néanmoins cette Madone est une des plus belles que le génie de Raphaël ait créées.»
PASSAVENT. (Raphaël.)
RAPHAEL (1483-1520) — 364 (+) La grande sainte famille de François Ier. — Cette toile célèbre appartient à la troisième matière du maître. La couleur en est un peu briquetée et le premièr aspect n’est pas très-séduisant, mais l’impression grandit le plus en plus à mesure qu’on l’analyse. L’Enfant-Dieu s’élance le son berceau, dans les bras de sa mère, qui se penche vers ai pour le prendre dans ses bras. Sainte Elisabeth est agenouil avec le petit saint Jean, et saint Joseph, dans une attitude ontemplative, est de l’autre côté du tableau. Deux anges, dont un croise les bras en signe d’adoration, tandis que l’autre ipand des fleurs sur. la Vierge et L’Enfant-Dieu, complètent la. composition.
Ce tableau, dont la célébrité est immense, a été ébauché par les Romain, ce qui explique le ton rougeâtre des chairs et la irceur des ombres, défaut assez ordinaire chez cet artiste. On a imaginé une fable par laquelle Raphaël aurait donné ce tableau à François Ier, par reconnaissance pour sa générosité ; il est démontré aujourd’hui qu’il a été commandé par Laurent de Médicis pour être offert par lui au roi de France.
— 368 — Saint Michel. — Ce petit tableau, qu’on appelle le petit saint Michel pour le distinguer de l’autre, est intéressant parce qu’il marque les débuts de Raphaël et sa période Péruginesque; il est plein de réminiscences du Dante. Derrière l’archange, couvert d’une armure d’or, qui terrasse les monstres qui l’entourent; on aperçoit les pécheurs repentants chargés de chapes de plomb, rôdant mystérieusement autour de la ville que détruit le feu du ciel, et les hypocrites et les voleurs tourmentés par des serpents.
— 369 — Le petit saint Georges, qui fait pendant au précédent, a été peint à la même époque et rappelle beaucoup le Pérugin. Le saint chevalier, couvert d’une armure d’acier et monté sur un cheval blanc, s’apprête à frapper le monstre avec son épée. Sa lance brisée est par terre, et dans le paysage on aperçoit une femme qui s’enfuit.
ANDRÉA SOLARI (?-1530) — 394 — La Vierge au coussin vert.
LUINI (? vers 1530) — 332 — Salomé recevant la tête de saint Jean-Baptiste.
CLAUDE LORRAIN (1600-1682). — Deux paysages de forme ovale..
POUSSIN (1594-1665) — 453 (+) Diogéne (paysage). — Le philosophe est représenté au moment où il jette son écuelle; mais tout l’intérêt du tableau est dans l’admirable paysage, où la figure ne joue qu’un rôle accessoire. La belle lumière argentine répandue sur l’ensemble, montre que si Nicolas Poussin est en tout temps un homme de ligne et de style, il sait aussi être coloriste à ses heures.
PH. DE CHAMPAIGNE (1602-1674) — 79 — Le Christ mort couché sur son linceul. — Peinture sur bois qui parait avoir été exécutée pour Port-Royal. — 87 — Le cardinal de Richelieu, superbe portrait en pied.
RIGAUD (1659-1743) — 477 — Portrait en pied de Bossuet.
JOUVENET (1644-1717) — 301 — La descente de croix. — Cette oile monumentale fait ici bonne contenance, bien qu’on ait encore l’œil tout imprégné des colorations de Titien, de Rubens et de Paul Véronèse. C’est en effet le chef-d’œuvre de Jouvenet et une des belles pages dont s’honore notre art national.
VALENTIN (1600-1534) — 586 — Concert.
JORDAENS (1593-1678) — 254 — L’enfance de Jupiter. — C’est une interprétation toute flamande de la mythologie antique. Le loi des dieux est figuré sous les traits d’un enfant rose et joufflu, qui tient un biberon et qu’une satyre amuse avec le tapage de sa musique, tandis qu’une nymphe aux formes exubérantes est occupée à traire la chèvre Amalthée.
Troisième panneau. — Sous ce titre nous désignons le anneau qui fait face aux Noces de Cana.
PAUL VÉRONÈSE (1528-1588) — 96 — Le repas chez Simon le harisien occupe tout le haut de ce panneau. Bien que ce tableau n’ait pas autant d’éclat que les Noces de Cana, qui sont vis-à-vis, c’est une magnifique peinture. Elle représente encore ne table avec de somptueux personnages, qui ressemblent moins aux apôtres de l’Evangile qu’à des praticiens de Venise. Jésus-Christ est assis à l’angle de la table et la Madeleine essuie iieusement ses pieds avec son opulente chevelure. La scène se sasse sous un portique circulaire qui laisse apercevoir divers odifices dans ses entrecolonnements.
MURILLO (1616-1682) — 539 — La Conception immaculée de la ierge. — Au milieu d’une brume lumineuse où volent les chéabins, la Vierge, posant les pieds sur le croissant de la lune et croisant les bras sur sa poitrine, s’élève vers le efel où plongent déjà ses yeux baignés d’extase. Sa tête est couronnée d’étoiles, et un manteau d’azur jeté sur sa robe blanche et ses épaules. Il a ans tout l’ensemble de dévotion et d’afféterie, de myticisme et lecharme mondain, qui est le caractère particulier de Murillo, qu’il n’a jamais peut-être poussé plus loin qu’ici. Ce tableau et acquis, à la vente du maréchal Soult, au prix de 615,000 .ncs.
POUSSIN (1594-1665) — 434 — Saint François-Xavier rappelent à la vie la fille d’un Japonais. — C’est une toile importente dans l’œuvre du Poussin, qui s’est bien rarement attaché à des personnages de grandeur naturelle. Néanmoins les hautes qualités du chef de l’école française nous semblent plus franchement accusées dans quelques-unesdes toiles que nous décrirons en parcourant d’autres salles.
BRONZINO (1502-1572) — 87 — Portrait d’un sculpteur; il est vêtu de noir et tient en main une statuette de femme.
PARIS BORDONE (1500-1570) — 82 — Portrait d’homme.
LÉONARD DE VINCI (1452-1519) — 462 (+) La Joconde, surnom d’une dame appelée Mona Lisa. Cette, peinture est extrêmement célèbre et Vasari en parle avec. admiration.
«Léonard de Vinci, dit-il, entreprit de faire pour Francesco del Giocondo le portrait de Mona Lisa, sa femme, et après quatre ans d’un, travail assidu, il le laissa imparfait. On le voit à présent chez le roi de France, à Fontainebleau. Qui veut savoir jusqu’à quel point l’art peut imiter la nature, peut s’en rendre compte facilement en examinant cette tête, car il a représenté les moindres détails avec une extrême finesse. Les yeux ont ce brillant, cette humidité que l’on observe toujours pendant la vie; ils sont cernés de teintes rougeâtres et plombées d’une vérité parfaite; les cils qui les bordent sont exécutés avec une excessive délicatesse. Les sourcils, leur insertion dans la chair, leur épaisseur plus ou moins prononcée, leur courbure suivant les pores de la peau, ne pouvaient pas être rendus d’une manière plus naturelle. Le nez et ses belles ouvertures d’un rose tendre respirent. La bouche, sa fente, ses extrémités qui se lient par le vermillon des lèvres à l’incarnat du visage, ce n’est plus de la couleur, mais c’est vraiment de la chair. Au creux de la gorge, un observateur attentif surprendrait le battement de l’artère; enfin, il faut avouer que cette figure est d’une exécution à faire trembler et reculer l’artiste le plus habile du monde qui voudrait l’imiter. Mona Lisa était très-belle, et pendant qu’il la peignait, Léonard eut soin de l’entourer de musiciens, de chanteurs, de bouffons, qui l’entretenaient dans une douce gaîté, afin d’éviter cet aspect mélancolique que l’on observe dans la plupart des portraits. Aussi remarque-t-on dans celui de Léonard un sourire si agréable, que cette peinture est plutôt une œuvre divine qu’humaine, et qu’on la tenait pour une chose merveilleuse et vivante à l’égale de la nature elle-même.»
VASARI. (Vie des peintres.)
On pourrait aujourd’hui faire quelques restrictions à ces éloges, du moins sous le rapport du coloris, qui a certainement changé Th. Gautier a donné sur la Joconde une appréciation enthousiaste:
«La Joconde! dit-il, sphinx de beauté qui souris si mystérieusement dans le cadre de Léonard de Vinci, et semble proposer à l’admiration des siècles une énigme qu’ils n’ont pas encore résolue, un attrait invincible ramène toujours vers toi! Oh! en effet, qui n’est resté accoudé de longues heures devant cette tète baignée de demi-teintes crépusculaires, enveloppée de crêpes transparents et dont les traits, mélodieusement noyés dans une vapeur violette, apparaissent comme une création du rêve à travers la gaze noire du sommeil? De quelle planète est tombé, au milieu d’un paysage d’azur, cet être étrange avec son regard qui promet des voluptés inconnues et son expression divinement ironique? Léonard de Vinci imprime à ses figures un tel cachet de supériorité, qu’on se sent troublé en leur présence. Les pénombres de leurs yeux profonds cachent des secrets interdits aux profanes, et les inflexions de leurs lèvres moqueuses conviennent à des dieux qui savent tout et méprisent doucement les vulgarités humaines. Quelle fixité inquiétante et quel sardonisme surhumain dans ces prunelles sombres, dans ces lèvres onduleuses comme l’arc de l’amour après qu’il a décoché le trait! Ne dirait-on pas que la Joconde est l’Isis d’une religion cryptique qui, se croyant seule, entr’ouvre les plis de son voile, dût l’imprudent qui la surprendrait devenir fou et mourir? Jamais l’idéal féminin n’a revêtu de formes plus inéluctablement séduisantes. Croyez que si don Juan avait rencontré la Mona Lisa, il se serait épargné la peine d’écrire sur sa liste trois mille noms de femmes; il n’en aurait tracé qu’un, et les ailes de son désir eussent refusé de le porter plus loin. Elles se seraient fondues et déplumées au soleil noir de ses prunelles.»
INCONNU (seizième siècle) — 523 (+) Portrait d’un jeune homme coiffé d’une toque noire. — Autrefois on l’attribuait à Raphaël; il a été ensuite catalogué sous le nom de Francia, et à présent on le classe parmi les inconnus. C’est un des chefs-d’œuvres les plus étonnants du salon carré.
RAPHAEL (1483-1520) — 363 — La Vierge au voile. — La tête ceinte d’un léger diadème, la Vierge soulève d’une main émue le voile qui recouvre l’enfant Jésus endormi sur un coussin dans la campagne et le fait voir au petit saint Jean, agenouillé près d’elle. Raphaël a rendu son nom inséparable de celui de la Madone, et quand nous disons dans nos prières: «Salut Marie, pleine de grâce», nous pensons au grand peintre en même temps qu’à la reine des cieux.
GHIRLANDAJO (1449-1494) — 202 — La Visitation. — Cette intéressante peinture du maître qui eut l’insigne honneur d’avoir Michel-Ange pour élève, a été rapportée au commencement de ce siècle parmi nos trophées; les commissaires étrangers l’ont laissée au musée en 1815.
«Ghirlandajo a peint une Visitation, que nous possédons au Louvre, et dans laquelle il s’est placé directement et sans l’intermédiaire de ses contemporains, en présence de l’Evangile. La Vierge, enveloppée dans un grand manteau bleu qui tombe jusqu’à terre, se penche vers sainte Elisabeth agenouillée devant elle. Derrière la mère du précurseur une jeune femme est debout, les mains jointes et le corps respectueusement incliné vers la Vierge. Derrière la Vierge est une autre femme, qui se redresse avec dignité. La majesté divine ne pouvant dépouiller Marie de son humilité, le peintre a voulu sans doute montrer dans ce personnage secondaire un reflet de la splendeur du Verbe. Ces deux figures accessoires sont admirables: ce sont deux anges, moins les ailes; la seconde surtout est d’une beauté à côté de laquelle pâlit la beauté des personnages principaux. Ceux-ci, malgré l’émotion religieuse qui les domine, portent encore une empreinte trop individuelle pour exprimer les idées générales: ils appartiennent trop exclusivement au quinzième siècle et sont trop Florentins pour parler la langue universelle de l’Eglise. Ce sont des portraits: les individus qu’ils représentent, quoique vivement et sincèrement émus, sont trop accessibles aux passions accidentelles de la vie.»
GRUYER. (Les Vierges de Raphaël.)
VAN EYCK (1390-1441) — 162 (+) La Vierge au donateur. — Sous un riche portique terminé au fond par des arcades qui donnent sur la campagne, la Vierge, enveloppée d’un ample manteau rouge, tient sur ses genoux l’enfant Jésus, tandis qu’un petit ange, vêtu d’une longue robe bleue, vole derrière elle et s’apprête à lui poser sur la tête une riche couronne d’or, couverte de perles et de pierreries. L’enfant Jésus bénit le donateur, qui est vêtu d’une robe de brocart blanc et or, et s’agenouille enjoignant les mains. A travers les arcades on aperçoit une grande étendue de pays, une rivière traversée par un pont, une ville avec ses tours et ses églises, un jardin où se promènent des paons et d’autres oiseaux, des roses, des glaïeuls, des fleurs diverses, puis des petits personnages, et au fond des montagnes qui terminent l’horizon. Le prodigieux ni de toutes les parties n’est pas moins surprenant que l’étonnante conservation de cette superbe peinture, qui est peinte depuis quatre cents ans et a gardé plus de fraîcheur que bien des tableaux qui n’ont pas plus de vingt ans de date. Mais, malgré son esquise délicatesse, Van Eyck est plus près de la terre que du ciel. Ses madones ont un air de propreté et de toilette qui rappelle la ménagère et non la divine apparition qui n’emprunte à la forme humaine que ce qu’il en faut pour être la mère de Dieu.
VAN DYCK (1699-1641) — 150 — Portrait de Richardot et de son fils, — Cet admirable portrait était autrefois attribué à Rubens. (Ce tableau et le suivant sont maintenant transférés dans la grande galerie.)
RUBENS (1577-1640) — 460 — Portrait d’Hélène Fourment, seconde femme de Rubens, et de deux de ses enfants.
La femme de Rubens, vêtue en blanc, est assise dans un fauteuil et vue presque de profil, tournée à gauche. Elle porte sur la tète un large chapeau de feutre gris orné de plumes, qui projette une ombre légère sur la figure, et tient sur ces genoux un petit garçon coiffé d’une toque noire avec des plumes et des nœuds rouges. A gauche, une petite fille debout, relevant son tablier. Les tètes seules de ce tableau sont assez avancées, mais le reste est à l’état d’ébauche. Dans le fond, indiqué par un léger frottis, on aperçoit entre les deux enfants un arbre, un oiseau qui vole, et à droite, près du fauteuil, deux mains d’un autre enfant.
VILLOT. (Notice du Musée.)
SÉBASTIEN DEL PIOMBO (1485-1547) — 229 — La Visitation — La tête de la Vierge a longtemps passé pour avoir été peinte par Michel-Ange; mais c’est une hypothèse qui ne repose sur aucun fondement.
GÉRARD DOW (1598-1674) — 121 — La Femme hydropique. — Le fameaux tableau de la femme hydropique faisait autrefois partie de la galerie royale de Turin. Il fut donné aug énéral Clause], par le roi Charles-Emmanuel IV, comme témoignage de sa satisfaction. Le général en a fait hommage au musée du Louvre. Quoique fort simple, la composition est une des plus importantes de Gérard Dow. Une femme atteinte d’hydropisie, est assise dans un fauteuil près d’une fenêtre. Sa fille en larmes lui tient la main, tandis qu’une servante offre à la malade une cuillerée de bouillon. Le médecin debout, tient une fiole qu’il considère attentivement.
LE TITIEN (1477-1576) — 452 (+) Alphonse de Ferrare et Laura de Dianti. — Cette superbe peinture est souvent désignée sous le nom de la Maîtresse du Titien. Mais c’est là un titre de fantaisie que rien ne peut justifier: une jeune femme tient d’une main ses cheveux, et de l’autre une fiole de parfums. Un homme placé derrière elle lui présente un miroir. D’après des médailles et des portraits authentiques, on croit y reconnaître Alphonse Ier duc de Ferrare, et Laura de Dianti. Dans une répétition de ce tableau qui se trouve à Ferrare, la femme est représentée-presque nue, ce qui fait supposer que Titien l’a peinte lorsqu’elle était la maîtresse du duc, et que lorsqu’elle fut son épouse, la même composition fut reproduite avec un vêtement.
TERBURG (1608-1681) — 526 (+) Un Militaire offrant des pièces d’or à une jeune femme.
«Le Lansquenet de Terburg, ce gros homme en harnais de guerre, avec sa cuirasse, son pourpoint de buffle, sa grande épée, ses bottes à entonnoir, son feutre posé par terre, sa grosse face enluminée, mal rasée, un peu suante, avec ses cheveux gras, ses petits yeux humides et sa large main, potelée et sensuelle, dans laquelle il offre des pièces d’or et dont le geste nous éclaire assez sur les sentiments du personnage et sur l’objet de sa visite, — cette figure, un des plus beaux morceaux hollandais que nous possédions au Louvre, qu’en savons-nous? On a bien dit qu’elle était peinte au naturel, que l’expression était des plus vraies, et que la peinture en était excellente. Excellente est peu concluant, il faut en convenir, lorsqu’il s’agit de nous apprendre le pourquoi des choses. Pourquoi excellente? Est-ce parce que la nature y est imitée de telle façon qu’on croit la prendre sur le fait? Est-ce parce qu’aucun détail n’est omis? est-ce parce que la peinture en est lisse, simple, propre, limpide, aimable à regarder, facile à saisir, et qu’elle ne pèche en aucun point ni par la minutie, ni par le négligé ? Comment se fait-il que depuis qu’on s’exerce à peindre des figures costumées dans leur acception familière, dans une attitude posée, et certainement posant devant le peintre, on n’ait jamais ni dessiné, ni modelé, ni peint comme cela?
» Le dessin, où l’apercevez-vous, sinon dans le résultat, qui est tout à fait extraordinaire de naturel, de justesse, d’ampleur, de finesse et de réalité sans excès? Saisissez-vous un trait, un contour, un accent, un point de repère, qui sentent le jalon, la mesure prise? Ces épaules fuyantes en leur perspective et dans leur courbe, ce long bras posé sur la cuisse, si parfaitement dans sa manche; ce gros corps rebondi, sanglé haut, si exact dans son épaisseur, si flottant dans ses limites extérieures: ces deux mains souples qui, grandies à l’échelle de la nature, auraient l’étonnante apparence d’un moulage.»
EUGÈNE FROMENTIN. (Les Maîtres d’autrefois.)
REMBRANDT (1608-1669) — 419 (+) Portrait de femme. — Rembrandt, qui a fait tant d’admirables portraits d’hommes, en a rarement exécuté d’après des femmes, mais celui que nous avons dans le salon carré du Louvre est un chef-d’œuvre unique en son genre. C’est une jeune femme (419), avec les traits assez forts, mais réguliers, les lèvres épaisses, les yeux bruns, les cheveux abondants et tirant sur le roux, la physionomie tranquille et souriante: une chemisette plissée que recouvre une épaisse fourrure compose son costume. Il y a dans ce portrait une puissance de relief, une intensité de vie, qui semble affadir toute autre peinture dans le voisinage, même quand cette peinture est du Titien.
METZU (1615-1658) — 293 (+) Un Militaire recevant une jeune dame.
«Le tableau que nous avons sous les yeux est un de ses plus beaux ouvrages. Il représente l’intérieur d’un appartement richement décoré. Un militaire, que l’élégance de son costume et plus encore la noblesse de son maintien font reconnaître pour un homme d’un rang distingué, reçoit la visite d’une jeune dame, et lui fait servir des rafraîchissements. Il est debout, tenant à la main son chapeau orné de plumes de diverses-couleurs, auprès d’une table couverte d’un de ses beaux tapis de l’Orient, qui ont si souvent fait briller l’habileté des peintres flamands et hollandais. Un valet présente un citron sur une soucoupe. On peut supposer que cette jeune dame vient solliciter quelque grâce; la douleur la plus touchante, l’éloquence la plus persuasive animent sa physionomie; un sentiment respectueux et tendre se laisse voir sur celle du cavalier: l’âme de Metzu s’est peinte dans ces deux figures. Tous les détails sont rendus avec un art admirable: la cuirasse, l’or et les broderies des vêtements du militaire, le siège couvert de velours bleu sur lequel est posé un de ses gants, le tapis, le velours violet et le satin blanc, dont se compose l’habillement de la jeune femme, sont des chefs-d’œuvre pour la délicatesse de l’exécution, pour l’harmonie et pour la vivacité du coloris. Ce tableau présente peut-être parmi de grandes beautés quelques légers défauts; mais ils sont si peu importants que nous ne croyons pas devoir les relever. Metzu y a pleinement développé son beau talent.»
EMERIC DAVID. (Chefs-d’œuvre de la peinture.)
Quatrième panneau. Nous désignons sous ce titre le panneau qui est adossée à la galerie d’Apollon.
PAUL VÉRONÈSE (1528-1588) — 160 — Jupiter foudroyant les Crimes.
Ce tableau, qui est un plafond, fut primitivement placé dans la chambre du conseil des Dix, au palais ducal, et l’allégorie qu’il représente s’expliquait d’elle-même. Jupiter, irrité des crimes de la terre, descend des sommets de l’Olympe, son noir sourcil froncé et secouant de sa puissante main une flamboyante poignée de foudres. Rien de plus noble, de plus majestueux, de plus homériquement antique que la figure du dieu. Au-dessous de lui un Génie, planant les ailes ouvertes et tenant un livre où sont écrites les décisions de l’éternelle justice, chasse à coups de fouets les Crimes, qui se précipitent avec un effarement tumultueux. Sa chevelure blonde se déroule en longues boucles soulevées par l’impétuosité de son vol. On dirait la descente de Phébus-Apollon au commencement de l’Iliade. Les Crimes sont la Rébellion, la Trahison, la Luxure et la Concussion, punis par le conseil des Dix, et Paul Véronèse les a caractérisés d’une manière ingénieuse et poétique sans tomber pour cela dans la laideur. En peinture surtout, les monstres «par l’art embellis» doivent plaire aux yeux, et c’est là un précepte qu’un peintre vénitien n’oubliera jamais. Paul Véronèse peignit ce magnifique plafond après un voyage à Rome, où il vit l’antique et Michel-Ange. Un artiste, quelque grand qu’il soit par lui-même, ne peut que hausser son style au contact de ce sublime génie. Raphaël lui-même sortit plus fort de la Sixtine entr’ouverte un moment.»
THÉOPHILE GAUTIER. (Paris-Guide.)
HERRERA (1576-1656) — 536 — Saint Basile dictant sa doctrine. — Cette étrange peinture est l’œuvre d’un maître espagnol, dont l’humeur sombre et farouche est demeurée en quelque sorte légendaire.
La tradition rapporte que, ne pouvant vivre avec personne, il fut abandonné successivement par ses amis et ses élèves, et qu’une vieille servante, le seul être au monde qu’il ait pu supporter, l’aidait à ébaucher ses tableaux. Herrera eut trois enfants: l’aîné mourut à la fleur de l’âge, donnant les plus belles espérances; le second lui vola son argent et s’enfuit à Rome; sa fille se mit au couvent. Poursuivi comme ayant fait de la fausse monnaie, Herrera se réfugia dans le collége des jésuites, où il peignit un tableau qui fut tellement admiré par le roi, que celui-ci lui accorda sa grâce en disant: «Celui qui a un tel talent ne doit pas en faire un mauvais usage.»
Il était nécessaire de dire un mot du personnage pour faire comprendre le bizarre tableau qu’on a sous les yeux et qui représente saint Bazile dictant à des religieux les inspirations qu’il reçoit du Saint-Esprit. A ses côtés on voit Diego, évêque d’Osma, un des premiers inquisiteurs, saint Bernard, abbé de Citeaux, saint Dominique et saint Pierre le Dominicain.
«Herrera le vieux, dit Théophile Gautier, était un maître d’une humeur terrible et farouche. L’aspect de sa peinture confirme sa légende. Le saint Basile présidant un concile a bien la mine la plus rébarbative qui se puisse imaginer, et le Saint-Esprit qu’il place au-dessus de sa mitre ressemble à un faucon se précipitant sur sa proie. Jamais bandits n’eurent des têtes plus sinistrement féroces que les évèques, les moines et les inquisiteurs qui l’entourent. Il y a surtout un moine hâve, maigre, osseux, à demi eoglouti dans sa cagoule, dont le sourire convulsif fait vraiment peur. S’il jetait son froc, on verrait apparaître le pourpoint rouge, le petit manteau et le pied de cheval de Méphistophlès.»
LE CARAVAGE (1569-1609) — 27 — Portrait d’Alof de Wignacourt, grand maître de Malte en 1609. — C’est un admirable portrait d’homme en pied, recouvert d’une riche armure, et portant en main le bâton du commandement. Le personnage ici représenté est un grand maître de Malte, et l’auteur du portrait est le Caravage, le père du réalisme en peinture. C’était un artiste d’une singulière énergie, mais il était fils d’un maçon et n’avait reçu aucune éducation dans sa jeunesse. D’un caractère violent et querelleur, il fut obligé de s’enfuir de Rome pour se soustraire aux conséquences d’un homicide. Il avait précédemment voulu se battre avec son rival, le Josepin, dont il avait été le domestique, mais le Josepin, qui était noble, refusa de se commettre avec un roturier. Caravage étant allé à Malte, fut créé chevalier par le grand maître de l’ordre dont nous voyons ici le portrait, et dès qu’il se vit anobli, il songea à provoquer de nouveau son vieil ennemi, le Josépin, qui cette fois ne devait plus avoir de prétexte pour lui refuser satisfaction. Au moment de quitter Malte, il eut une dispute avec un chevalier qu’il blessa grièvement, il fut jeté en prison pour ce fait. Il parvint à s’échapper; mais arrivé à Naples, il se querella avec des soldats dans un cabaret, fut blessé, obligé de s’enfuir et se cacha dans une felouque, qui mit aussitôt à la voile et le déposa sur les frontières de la Toscane, où il mourut misérablement dans un bouge. — 26 — Le Concert. — Neuf musiciens vus à mi-corps jouent de divers instruments.
LIONELLE SPADA (1576-1622) — 402 — Le Concert. — Trois jeunes gens et un enfant réunis autour d’une table se préparent à exécuter un concert.
LE GUIDE (1575-1642) — 325 — L’Enlèvement de Déjanire.
PÉRUGIN (1446-1524) — 426 (+) La Vierge et l’Enfant. — Cet admirable tableau, qui vient de l’ancienne collection du roi des Pays-Bas, montre la madone adorée par deux anges et deux saintes. L’illustre maître qui a eu Raphaël pour disciple n’est représenté dans aucun musée d’Italie par une page plus digne de lui.
BELLINI (?-1507) — 59 — Portraits d’hommes. Ces deux têtes à chevelures bouffantes sont coiffées d’une toque noire: on a cru longtemps qu’elles offraient l’image de Jean et Gentile Bellini. Cet opinion est abandonnée aujourd’hui. Ces deux visages au reste, sont loin d’être beaux, mais leur laideur est expressive, et la physionomie est d’une personnalité saisissante.
LE POUSSIN (1594-1665) — 447 (+) Portrait du Poussin. — Le portrait du Poussin, par lui-même, est vraiment magistral et c’est un ouvrage d’autant plus précieux qu’il ressort complètement des habitudes du peintre. C’est en effet une œuvre unique en son genre, et il a fallu que M. de Chantelou, le bienfaiteur du Poussin, l’exigeât en quelque sorte pour décider le peintre à reproduire lui-même ses traits. Poussin lui écrivait: «Je confesse ingénument que je suis paresseux à faire cet ouvrage, auquel je prends peu de plaisir et j’ai fort peu d’habitude, car il y a vingt-huit ans que je n’ai fait aucun portrait.» Le chef de l’école française s’est représenté enveloppé d’un large manteau, avec la tête presque de face.
LE TITIEN (1477-1576) — 446 (+) La Mise au tombeau. — Le corps du Christ, porté par Joseph d’Arimathie et deux autres disciples, est déposé dans le sépulcre; la Vierge, accablée de douleur, est sur le point de s’évanouir. Le Titien est le peintre de la santé, de la richesse et du sourire, mais il sait aussi à ses heures demeurer grave et austère.
LE CORRÉGE (1494-1534) — 20 (+) L’Antiope. — Tandis que Jupiter a pris pour la regarder la forme d’un satyre, Antiope, mollement couchée sur une draperie bleue, arrondit son bras au-dessus de sa tête. A ses pieds l’Amour, qui a posé son carquois, s’endort ou plutôt fait semblant de dormir innocemment sur une peau de lion. Ces figures d’un ton admirable se détachent avec un relief puissant sur un bois dont la teinte sombre et veloutée se marie avec la lumière qui les dore et se concentre sur la poitrine d’Antiope. Tout ici semble baigné dans une atmosphère tiède et harmonieuse, qui dissimule les contours et accuse mollement les saillies par d’insensibles transitions. Ce magnifique tableau est considéré comme un des plus précieux du Musée.
REMBRANDT (1608-1669) — 410 (+) Le Ménage du menuisier. — Cet admirable petit tableau, dans lequel on a voulu voir une sainte Famille, est un intérieur éclairé par un rayon de soleil. Jamais on n’a poussé plus loin l’effet saisissant d’un effet de lumière entrant subitement par une lucarne et venant se résumer au centre du tableau avec une franchise et un éclat éblouissant. C’est assurément un des chefs-d’œuvre de Rembrandt.
ADRIEN VAN OSTADE (1610-1685) — 379 (+) Le Maître d’école. — Assis à une table, le maître d’école menace de sa férule un enfant qui pleure en tenant son chapeau. Divers groupes d’enfants sont occupés à jouer ou à étudier leur leçon.
CLOUET (1500-1572) — Portrait d’Élisabeth d’Autriche, reine de France, femme de Charles IX. — C’est un petit chef-d’œuvre d’élégance et de distinction.
LA SALLE DES FRESQUES. — Tout à côté de ce portrait une porte donne accès à un petit salon auquel on arrive aussi par un escalier qui part du Musée des antiques. Ce petit salon a reçu le nom de salle des fresques. Jusqu’à présent on n’avait guère vu de fresques dans le musées, par la raison que ce genre de pointure est inhérent à la muraille sur laquelle elle est inhérente. On a pourtant trouvé moyen d’en apporter, et la salle où nous sommes en renferme plusieurs qui sont bien intéressantes, car ce sont des fresques de Bernardino Lecini. Ce sont d’abord celles qu’il avait exécutées dans la villa Pelucea à Monza: elles représentent un Bacchus enfant jouant sous une treille. La Nativité, l’Adoration des mages et le Christ ont été acquises à Milan en 1867. Quand on quitte la petite salle des fresques on se retrouve dans le salon carré.