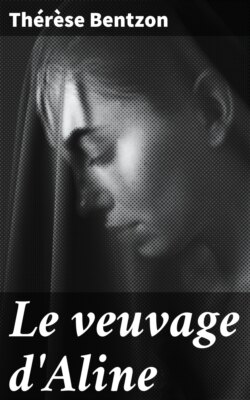Читать книгу Le veuvage d'Aline - Therese Bentzon - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II
ОглавлениеL’ironie de la baronne Olga touchait juste. Marc.était un de ces êtres faibles et enthousiastes, généreux et irrésolus, dont les aspirations naturellement nobles sont trahies souvent par une volonté défaillante. Cependant s’il eût voulu se justifier au lieu de laisser tomber l’accusation avec une sorte de dédaigneuse insouciance dont il avait depuis longtemps pris l’habitude, ce jeune homme eût réussi à prouver peut-être que ses qualités lui appartenaient bien en propre et qu’il-avait eu même quelque mérite à les défendre contre des influences hostiles, tandis que ce qu’il pouvait avoir de défauts était surtout le résultat de la guerre acharnée livrée sans trêve ni merci à tous les instincts de son cœur. Cette lutte datait de sa première enfance. Il était né très frêle, et on avait pu prévoir tout d’abord qu’il n’aurait jamais rien de commun avec les ancêtres aux armures de fer, géants barbus et basanés dont les portraits garnissaient la longue galerie du château de Sénonnes dans la Nièvre.
Son père, qui le destinait à l’état militaire comme au seul état possible pour un homme de haute lignée, en avait été consterné au point de garder quelque temps rancune à sa femme, belle et robuste personne cependant, qui semblait faite pour perpétuer dans toute sa vigueur une race de colosses. L’embonpoint bien nourri qui seyait du reste à la taille élevée, au type louis-quatorzien de madame de Sénonnes, avait apparemment étouffé chez elle une certaine finesse de discernement que la plupart des femmes et surtout des mères poussent jusqu’à la divination, car elle ne sut jamais aider son mari à comprendre que l’énergie physique des aïeux s’était transformée en ardeur intellectuelle chez ce dernier rejeton, fleur tardive éclose sur le vieil arbre par un suprême effort de sève; elle ne sut rien lire dans le regard pensif de cet enfant, dont l’organisation déliée indiquait moins une santé chétive que des délicatesses de plus d’une sorte qui du corps s’étendaient jusqu’à l’âme.
En effet, le ressort ne manquait pas à ces membres fluets d’une singulière élégance. Marc était agile et actif autant que son superbe cousin Albéric, plus âgé de quelques années, et auquel on le comparait toujours d’une façon désavantageuse. Celui-là serait un brillant officier et un homme du monde, disaient en soupirant M. et madame de Sénonnes.– Et ils se désolaient à l’envi de ce qui eût simplement excité l’attention et l’intérêt de parents plus vigilants et plus éclairés, par exemple de la vive curiosité sans but ni méthode qui poussait l’intelligence de leur fils dans tous les sentiers à la fois, de la sensibilité presque féminine du jeune Marc, de sa timidité poussée jusqu’à la sauvagerie, de la muette contemplation où le jetaient mille choses dont lui seul comprenait la beauté. Il suffisait des effluves d’une matinée de printemps, de la splendeur d’un coucher de soleil, de quelque rayon égaré dans la voûte des bois, pour lui faire perdre la tête et le détourner de tout travail suivi, disait, en se plaignant de lui. l’abbé chargé de l’instruire. Il fallait absolument l’aguerrir, l’endurcir, faire un homme de cette petite fille prompte aux caresses et aux larmes. Pour cela ses parents s’appliquèrent à refouler toutes les facultés aimantes du pauvret, sans réfléchir qu’une âme tendre, froissée au premier battement d’ailes, se replie sur elle-même, et devient d’autant plus impressionnable qu’elle s’étudie mieux à tout cacher.
Un jour l’abbé apporta, fort alarmé, à madame de Sénonnes, une page de méchants vers saisie dans le pupitre de son élève. Les guides maladroits du poète en herbe se consultèrent et finirent par décider entre eux que la solitude était pour Marc une mauvaise conseillère; son précepteur renonçait à l’empêcher de bayer aux mouches: peut-être l’émulation du collège ferait-elle justice de cette tendance déplorable en même temps que le contact d autres garçons de son âge le rendrait bon gré mal gré semblable à tout le monde; mais il était écrit que Marc prendrait toujours le contre-pied de ce que l’on souhaitait pour lui. Cee collège, choisi avec soin pourtant, parmi ceux où dominaient de bons principes, recélait, comme tous les grands foyers d’éducation publique. une effervescence d’idées libérales que le comte de Sénonnes eût appelées des idées subversives, et Marc, après avoir surmonté l’espèce de mélancolie morbide que lui inspiraient les murailles grises dérobant la vue du ciel et des bois, se consola peu à peu à l’aide de ce poison.
–Vous faites de mon fils un révolutionnaire, dit un jour avec indignation M. de Sénonnes au directeur du collège, bien étonné.
Si encore l’écolier malencontreux eût tiré parti de la facilité à tout comprendre dont on le savait doué, pour remporter quelques-uns de ces succès qui flattent la vanité des parents!. mais non. il ne se distingua que très tard dans les classes supérieures; alors le goût des lettres fit explosion chez lui avec une telle force que ses professeurs conçurent, à son sujet, de brillantes espérances. M. et madame de Sénonnes, loin de s’en réjouir, s’inquiétèrent de plus en plus: ces goûts-là ne le conduiraient pas vers l’École militaire, où Albéric avait réussi à entrer, pour quitter bientôt le service, il est vrai, comme font beaucoup d’autres, en se mariant; n’importe, il avait suivi la route frayée, tandis que son cousin allait continuer sans doute à battre les buissons. Quand Marc, ses études achevées, entra dans le monde avec des convictions politiques qui n’étaient pas précisément celles de sa caste, des sympathies qui l’entraînaient vers toutes les supériorités, sauf celles du rang et de la fortune, quelques amitiés de collège que son père lui reprochait comme basses, vulgaires, indignes de lui. et une vocation littéraire très prononcée dont il n’osait rien dire, la fâcheuse position où il se trouva pouvait rappeler celle du cygne couvé par mégarde au milieu des poussins.
«Tu nous appartiens, tu es tenu de nous ressembler», lui disaient tous ces gens, qui ne le connaissaient pas plus qu’il ne les comprenait lui-même. M. et madame de Sénonnes déclaraient de bonne foi que Marc était un être fantasque, réfractaire. un peu fou. CComment expliquer autrement qu’ il n’n’aimât ni la carrière où s’étaient distingues tous ceux de sa race ni les chevaux qui avaient été l’unique passion de son père. ni le monde, ou sa mère n’avait pas cessé de se plaire? Il eût voulu voyager, élargir ainsi l’horizon de ses connaissances et de ses idées, mais cette nouvelle lubie rencontra une formidable résistance qu’il n’essaya même pas de combattre. Une fois de plus, il se retrancha silencieusement dans cette vie contemplative et tout intérieure où aucune tyrannie ne peut nous atteindre. Certain volume de poésies, qui parut sous le pseudonyme de Marc Séverin, les deux noms de baptême du jeune vicomte, acheva d’exaspérer le courroux de ceux qui prétendaient lui vouloir du bien. Le père tança vertement son fils; la mère, ayant lu le malheureux livre par curiosité, le qualifia de galimatias.
–Il ne sait ce qu’il désire, ni ce qu’il dit, faisait observer madame de Sénonnes à son beau neveu de Vesvre, mais je crois qu’il s’ennuie. Qu’en penses-tu, Albéric? Il faudrait le distraire.
Et Albéric s’efforça consciencieusement de distraire cet étrange cousin, pour lequel, au fond, il avait de l’amitié sans trop savoir pourquoi. L’inexplicable mélancolie de Marc intriguait ce joyeux viveur:–Les plaisirs de Paris en auront raison, décida-t-il.
En effet, Marc, poussé par lui, se jeta dans ce courant sauveur, au dire de son cousin, avec une impétuosité qui put faire croire qu’il avait laissé sur la rive, une fois pour toutes, les chimères dont on lui faisait un crime. Mais bientôt on s’aperçut qu’il en avait gardé avec lui une forte dose pour la mêler à ses nouveaux égarements de la façon la plus aggravante: il marchait dans une atmosphère d’illusions dont il enveloppait comme d’une auréole les objets de ses fantaisies aussi violentes qu’éphémères. Un second volume de vers, moins innocents que leurs devanciers, faillit refléter ces hallucinations, ces ivresses; mais il brûla tout à coup ce témoignage des folies désespérées où il s’était efforcé un instant de trouver l’oubli de lui-même. Le second volume n’en parut pas moins peu après, tout autre seulement qu’il ne l’avait préparé d’abord. Un souffle purifiant venait de passer sur l’œuvre de Marc et sur sa vie. La muse chaste et tendre des premiers essais avait reparu, mais avec une puissance toute nouvelle pour sentir et pour aimer. Ce miracle coïncida, il faut le dire, avec l’instant où les yeux noirs de madame d’Herblay se posèrent bienveillants et doux sur Marc de Sénonnes. Ce fut madame d’Herblay qui inspira une suite de poèmes tout palpitants de jeunesse, remarquables par la sincérité des impressions évidemment subies, notées au jour le jour.
Les amis de Marc lui avaient prédit un succès. Ces amis-là n’étaient autres qu’un petit groupe d’anciens camarades de collège, qui, pour leur part, se livraient sans contrainte, en luttant vaillamment et même gaîment contre mille difficultés, à des travaux littéraires desquels chacun d’eux attendait avec le temps sa place au soleil. Marc, pour ne pas les perdre de vue, les rejoignait le lundi de chaque semaine dans un café du quartier latin où les gens de son monde eussent été bien scandalisés de lui voir mettre le pied, et là, réunis autour d’un dîner frugal, on parlait de l’avenir. Les plus chaleureux éloges étaient donc venus réjouir Marc lorsqu’il avait communiqué au petit cénacle les principales pièces de son dernier recueil, mais ce fut là tout le succès promis. Le public proprement dit, fort indifférent aujourd’hui à la poésie, à moins qu’un nom déjà glorieux ne lui impose l’admiration, laissa passer, sans même s’apercevoir de leur eclosion, ces vers printaniers, qu’il confondit avec le torrent de fadeurs qui s’écoule journellement sous la même forme; des critiques oiseuses et un blâme général furent tout ce que l’auteur recueillit parmi ses proches, mais peu lui importait alors; il était amoureux, et l’objet de cet amour lui disait, de façon à le consoler d’injustices plus cruelles encore:
–Je suis fière de vous, à mes yeux vous êtes grand…
N’était-ce pas assez? Quels suffrages eussent valu ceux de cette bouche fraiche comme une fleur, qui lui versait, entre deux baisers, le miel des flatteries sincères? Les plus délicates sympathies de l’âme et la compassion que leur inspiraient l’un pour l’ autre des tristesses qui leur étaient communes, devaient presque inévitablement rapprocher madame d’Herblay et Marc de Sénonnes. Quand ce dernier avait rencontré ou plutôt retrouvé, après l’avoir longtemps perdue de vue. madame d’Herblay chez sa mère, il avait tressailli comme sous l’influence d’un inexplicable magnétisme, et il lui avait semblé qu’une flamme vive, étouffée aussitôt entre les longs cils de cette charmante femme, révélait une émotion semblable à la sienne. Tous les deux en effet sentirent ensemble, et à première vue, qu’un intérêt suffisant pour tout remplir s’élevait soudain dans le vide de leur double existence.
La vie de madame d’Herblay était plus désemparée encore que celle de Marc. Mal mariée, elle n’avait pas d’enfants, rien qui pût la dédommager des amertumes et des dégoûts de chaque jour, et elle ne trouvait pas en elle-même la solidité de principes qui l’eût sauvée du désespoir. Après avoir grandi, jusqu’à l’âge de quinze ans, auprès d’une grand’mère idolâtre qui la gâtait sous prétexte de l’élever, elle était tombée de cette atmosphère de tendresse sans règle et sans mesure, entre les mains de parents éloignés qui, ne sachant que faire d’elle, l’avaient mise au couvent. C’était pour en finir avec le couvent qu’Antoinette avait accepté d’épouser M. d’Herblay. Très timide, elle pliait sous le joug à la façon d’une esclave, passivement soumise à toutes les incessantes tracasseries qui peuvent résulter de l’avarice poussée jusqu’à la manie et de l’égoïsme allié à une obstination stupide, à une humeur sans cesse agressive, à une méfiance incurable. Chaque année ajoutait quelques aspérités de plus au caractère de M. d’Herblay, déjà vieux. Les médecins mettaient sur le compte d’une gastrite chronique les symptômes de l’hypocondrie qui se manifestaient chez lui par une variété de menues tortures dont sa jeune femme était victime, mais celle-ci trouvait, non sans raison peut-être, que la science moderne rend trop volontiers le corps responsable des pires infirmités de l’âme; elle eût été disposée plutôt pour sa part à le considérer comme un malade imaginaire qui se dédommageait méchamment, en faisant peser sur elle une autorité despotique, de n’avoir jamais pu lui inspirer que des sentiments de crainte et d’obéissance attristée.
Marc sut lire bien des secrets douloureux sur ce visage pâli. dont toutes les lignes finement arrêtées révélaient une organisation de sensitive; il crut voir dans ces grands yeux de velours certaine expression vague d’attente et de désir qui l’enivra. La morbidesse des attitudes. l’accent mélancolique auquel les moindres paroles de madame d’Herblay empruntaient une douceur touchante, mille révélations involontaires lui en apprirent bien long avant les confidences sur cette destinée, sœur de la sienne, où tout manquait, liberté, confiance en soi et en autrui, épanouissement de jeunesse, mais l’amour pouvait pour elle comme pour lui remplacer les autres biens absents… Ils s’aimèrent donc furtivement et passionnément. Marc eut enfin la joie de se croire compris, et Antoinette échappa, elle aussi, à ce supplice de l’isolement moral dont elle avait souffert plus que de tout le reste.
Ils étaient du même âge, peut-être était-elle l’ainée de quelques mois, ce qui lui permettait d’affecter une sorte de protection quasi maternelle qui formait un contraste piquant avec le besoin qu’elle avait en réalité de s’abandonner au contraire de se laisser conduire, de céder toujours, pourvu qu’on l’adorât. Jamais créature humaine ne fut plus absolument femme par la grâce, la douceur, la mobilité des impressions. C’était là surtout ce qui la rendait attachante et ce qui faisait d’elle par excellence la maîtresse d’un poète, d’un cœur généreux jusqu’à la déraison. Marc l’aimait comme une jolie plante fragile qu’il avait relevée, réchauffée, rendue au bonheur de vivre, alors qu’alanguie et brisée à demi, elle se mourait faute de soleil; il l’aimait avec attendrissement, il reportait sur Antoinette toutes ses sensibilités refoulées, il s’ouvrait à elle avec un abandon absolu dont il avait jusque-là ignoré le charme. Sans cesse il lui parlait de ce qu’il se sentait capable de faire, tout en ne faisant rien; car madame d’Herblay n’était pas de celles qui poussent à l’accomplissement de choses héroïques, son influence singulièrement absorbante avait plutôt pour effet de plonger l’âme qui la subissait dans une heureuse paresse. Du reste, sans avoir l’esprit étendu ni cultivé, elle savait s’intéresser aux nombreux projets de Marc, qui lui inspiraient, quels qu’ils fussent, une admiration naïve. C’est là toute l’intelligence qu’un artiste et un homme en général désire et recherche chez la femme de son choix.
Quatre années passèrent ainsi rapides comme autant de jours. M. d’Herblay s’absentait assez souvent pour aller dans ses terres tracasser ses fermiers quand il était las de tourmenter sa femme; d’ailleurs, après avoir été à plusieurs reprises jaloux sans motif, il semblait favorisé de l’espèce d’aveuglement qui peut être parfois le privilège des sots,–on le vit en cette circonstance,–comme il est si souvent celui des gens d’esprit. Le monde, beaucoup plus perspicace, s’était demandé très vite pourquoi madame d’Herblay n’avait plus l’air abattu et pourquoi Marc avait renoncé simultanément à ce qu’on appelait par ironie ses allures de beau ténébreux, mais le monde garde toujours avec indulgence le secret des amants qui ménagent son opinion; il attend pour lancer ses foudres une maladresse, un scandale, et il n’est pas seul à agir ainsi. Personne, par exemple, ne savait mieux à quoi s’en tenir que madame de Sénonnes, qui avait tacitement encouragé la liaison de son fils et de sa jeune amie, grâce à un de ces accommodements dont certaines mères ne se font point scrupule: Antoinette arrachait son fils aux coquines qui s’étaient un instant emparées de lui et qu’il avait eu le tort de ne pas voir telles qu’elles sont, ce qui les rendait fort dangereuses, tandis qu’une femme du monde comme celle-ci n’était pas à craindre, pauvre petite! Madame de Sénonnes la jugeait assez apathique, presque nulle, incapable de dominer longtemps un homme d’esprit. Quand il serait blasé sur son profil de camée et sur sa langueur, quelles ressources aurait-elle pour le retenir? Il n’y avait pas là de quoi forger une chaîne.
La chaîne était légère en effet. Antoinette, incapable de tout calcul, ne cherchait à prendre aucun ascendant sur celui qu’elle considérait comme trop supérieur à elle. Et puis, si jeune qu’elle fût, elle connaissait le train du monde et l’évolution fatale de la vie dans ces régions où règne une routine invariable, où des espèces de bornes milliaires plantées de distance en distance marquent chaque étape et tel chemin à prendre, sans qu’il soit permis de regimber. De dix-huit à vingt-neuf ans, un jeune homme est libre en effet de gaspiller impunément son cœur, mais avant que la trentaine ait sonné, le devoir social lui enjoint d’offrir ce qui peut en rester à une jeune fille prudemment choisie pour lui apporter un cœur tout neuf en échange. Madame d’Herblay avait été initiée de bonne heure à ces lois inflexibles, elle était capable en outre d’une certaine fierté qui l’empêchait de se plaindre; d’ailleurs quelques insinuations d’amies l’avaient avertie récemment que le monde soupçonnait la nature de son intimité avec Marc; peut-être même ces insinuations avaient-elles effleuré l’oreille de son mari, car il la surveillait de plus près et il semblait trouver un plaisir nouveau à l’humilier, à contrarier ses moindres mouvements. N’avait-il pas parlé de la retenir toute l’année en Sologne, sous prétexte qu’il s’y portait mieux qu’à Paris?–Quoi qu’il en fût, lorsque la grave question du mariage de Marc fut agitée, madame d’Herblay témoigna plus de douleur que de surprise; elle parut même s’armer peu à peu de résignation. Loin de stimuler la résistance à laquelle il était disposé, elle lui dit, avec une exaltation de dévouement qui séchait ses larmes prêtes à couler, qu’elle ne voulait pas compliquer pour lui les difficultés d’une situation déjà pénible, qu’elle ne serait jamais une entrave, qu’elle saurait s’effacer. Cet ensevelissement à la campagne, elle l’accepterait comme un sacrifice à celui qui, même absent, resterait toujours le maître de. son âme, et comme une pénitence devant Dieu. Marc était, quant à lui, assez étranger à ce mysticisme qui se mêlait parfois aux ardeurs profanes d’Antoinette; il comprit cependant que la jeune femme trouverait une volupté amère dans l’effort qu’elle s’imposait, qu’elle reporterait sans trop de peine vers le ciel l’encens brûlé d’abord aux pieds d’une idole terrestre, et que les défauts mêmes de son mari lui sembleraient moins odieux qu’auparavant, puisqu’elle se sentait désormais digne d’être châtiée.
Cette pensée calma un peu ses regrets. La délaissée, au lieu de lui rien reprocher, ne répétait-elle pas que le souvenir de sa faute serait encore une dernière consolation, comme le parfum qui survit à la rose effeuillée en rappelant ce qu’elle fut? Maintenant des réalités inévitables mettaient fin pour tous les deux à un trop doux rêve: elle allait subir, dans la solitude, une expiation volontairement acceptée, disait-elle; il allait renoncer, de son côté, aux ambitions d’indépendance et de gloire dont il s’était bercé naguère, ambitions chimériques peut-être. Marc était tenté de le croire en songeant aux quatre années d’oisiveté complète qui avaient suivi la publication de deux petits volumes imprimés à ses propres frais et tombés sans bruit: telle une pâle étoile file sur le ciel où elle devait briller d’un feu fixe et durable. Oui, c’en était fait, il valait mieux prendre son parti une fois pour toutes de n’être rien que ce que la naissance et la fortune l’avaient fait, il valait mieux céder sans plus de combats à l’ascendant qu’exerçait sur sa faiblesse l’opiniâtreté de son père, cet entêtement des gens volontaires et bornés qui est une force inerte, aveugle, brutale comme la fatalité même. C’en était fait, il donnerait raison au penseur pessimiste qui a dit que vers trente ans l’homme est réduit, bon gré mal gré, pour pouvoir vivre tranquille, à étrangler son idéal. Les emportements, les exhortations. les prières, les pleurs maternels, cesseraient autour de lui, ce serait quelque chose.
Cette résolution désespérée fut prise entre Marc et Antoinette dans les derniers instants pleins d’orageuses délices qui précédèrent leurs adieux. Ils croyaient alors sincèrement se séparer pour toujours, et néanmoins il leur semblait ne s’être jamais mieux aimés. Ce fut dans ces dispositions que le vicomte de Sénonnes souscrivit au mariage dont nous l’avons entendu parler à sa cousine.