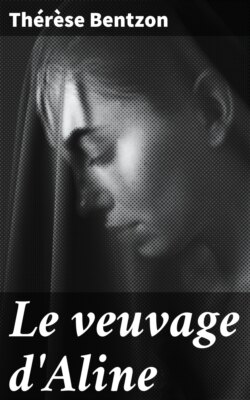Читать книгу Le veuvage d'Aline - Therese Bentzon - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV
ОглавлениеLa cérémonie nuptiale fut fixée au mois de juin: cette date était encore assez éloignée, mais il semblait douteux que les fiancés, tout en se voyant presque chaque jour, arrivassent à se connaître comme l’eût désiré mademoiselle Béraud. Il y avait toujours tant de monde autour d’eux! Aucun moyen, quand on l’aurait voulu, de former entre soi des projets d’avenir. On eût dit que tout se bornât à l’acquisition du trousseau et de la corbeille, au choix des voitures, à la recherche d’un petit hôtel dans les Champs-Élysées; c’étaient ces préoccupations-là qui dévoraient les heures et les journées. Madame de Sénonnes prenait des rendez-vous quotidiens avec sa future belle-fille pour aller commander ceci, essayer cela, puis il fallait consulter le goût, réputé infaillible, de la baronne Olga, discuter la grave question du mobilier, celle des diamants.
Marc donnait son avis au besoin, il accompagnait partout ces dames avec une courtoisie attentive, il envoyait les plus belles fleurs de Paris à mademoiselle Aline. Celle-ci n’ayant pas de mère, le cérémonial ordinaire de la cour se trouvait modifié. M. Béraud n’était que fort peu chez lui, et miss Ruth, malgré sa mine rébarbative, ne suffisait pas apparemment au rôle de chaperon; les entrevues avaient donc lieu de préférence chez madame de Sénonnes, dont le salon ne désemplissait guère. Comment Marc aurait-il, dans de pareilles conditions, trouvé moyen de glisser à l’oreille de sa fiancée le: Je vous aime qu’elle avait entendu en rêve? Aussi ne prononça-t-il jamais ces trois mots magiques. Malgré elle, Aline les attendait:
—Il m’aime pourtant, pensait-elle, puisqu’il m’épouse; mais qu’appelle-t-on dans les romans une déclaration?
En fait de romans, elle n’avait lu que des romans anglais irréprochables, puisqu’ils étaient choisis par son austère gouvernante. Dans ces romans-la toutefois les jeunes gens se voyaient librement, longuement, à la campagne, en voyage; l’amoureux ne voulait tenir la jeune fille que d’elle-même; c’était charmant, et cela lui paraissait naturel, beaucoup plus naturel que l’espèce de surveillance tacite qui empêche toute intimité de croître ou même de naître avant le sacrement.
–Ce qui ne nuit pas au bon accord après, tu peux m’en croire, dit M. Béraud un jour qu’elle lui exprimait son étonnement de voir le monde réel si peu semblable à celui des livres. Nous ne sommes point en Angleterre: dis cela une bonne fois à miss Ruth et à ses héroïnes, Tant mieux pour toi, du reste! la Française est encore la plus heureuse des femmes: maîtresse chez elle, reine dans le monde.
–Mon oncle, croyez-vous vraiment que cela suffise à son bonheur si elle n’est pas aimée?
–Mais pourquoi ne serait-elle pas aimée? Est-ce parce que l’usage ne lui permet point de recevoir, jeune fille, des sérénades et de se promener en tête-à-tête avec son fiancé au clair de la lune?
–Vous savez bien, mon oncle, que je ne suis pas absurde à ce point, dit Aline en rougissant: il ne s’agit ni de sérénades ni de clair de lune; je voudrais seulement, avant de me donner pour toujours, car c’est pour toujours, pour cette vie et pour l’autre, reprit-elle avec une gravité émue,–je voudrais m’assurer…
–Si vous vous convenez? Parbleu! vous n’en êtes plus à ces précautions, à ces calculs. Tu l’aimes, n’est-ce pas?
Aline rougit de plus belle.
–Tu l’aimes, puisque tu es si souvent muette et embarrassée auprès de lui.
–La bonne raison! Comprenez donc, mon oncle, quel ennui, quelle contrainte c’est pour moi d’être perpétuellement en butte, devant M. de Sénonnes, à l’examen curieux de tant d’importuns qui ne cessent de me mettre sur la sellette!
–Bah! ces prétendus importuns ne sont pas ce qui t’intimide; ils te viennent en aide, au contraire. Ton trouble a une autre cause, celle que je t’ai dite. Oui, les gens qui nous plaisent infiniment nous ôtent, par le seul pouvoir qu’ils exercent sur nous, tous nos moyens d’être aimables. J’ai éprouvé cela, moi qui te parle, quand j’étais amoureux; malgré mon aplomb et ma grande habitude du monde, j’étais stupide, entends-tu, absolument stupide.
–Et vous trouvez que je le suis aussi, mon oncle? s’écria la pauvre Aline effrayée. Que doit-il penser de moi?
–Non, tu n’en es pas là, chérie, et il ne pense de toi que du bien, d’abord parce qu’il a de l’esprit et puis parce que c’est autour de lui un concert de louanges à ton sujet. Toutes ces dames raffolent de mon Aline. Cela se comprend, avec elles tu oses mieux te montrer telle que tu es. La baronne Olga disait l’autre jour en ma présence à son cousin:–Elle est trop bien, mille fois! Vous êtes plus heureux que vous ne le méritez,
–Quelle folie! je suis sûre que M. de S. Sénonnes mérite tout le bonheur qu’une femme peut donner.
–Hum! quant à mériter, les hommes ne méritent rien que les étrivières, déclara l’oncle Fabien en toute humilité. C’est une triste espèce, va! Mais la charité consiste à donner sans demander si celui que l’on comble en .est digne, et toutes les femmes sont charitables, heureusement pour nous autres.
–Oh! mon oncle, ne vous calomniez pas, ni vous, ni mon pauvre papa, ni M. de Sénonnes: je vous abandonne le reste de l’espèce, comme vous dites, qui ne m’intéresse guère; mais pourquoi prétendez-vous qu’elle ne vaut rien à propos de Marc justement? Moi qui vais devenir sa femme, je devrais être renseignée sur ses défauts, et on ne me parle jamais que de ses belles qualités; c’est ce qui m’effraie tant, je crois. Je me sens auprès de lui si imparfaite.
–Mon Dieu! tu sais, Marc a causé beaucoup de chagrin à ses parents en donnant dans les hasards de la carrière littéraire pour laquelle n’est pas fait un homme de son rang; du reste, son mariage l’en détournera, cela va sans dire.
–N’y comptez pas! riposta vivement Aline. Je ne me ferai point complice de cette mauvaise action. Puisqu’il a du talent, qu’il s’en serve! Je serai si contente d’avoir pour mari un homme supérieur! Je saurai si bien respecter ses heures d’étude, m’intéresser à tout ce qu’il entreprendra! Oh! que je voudrais pouvoir le lui dire! Mais c’est impossible, il ne m’a jamais confié seulement qu’il écrivît.
–Il te révélera sans doute cette infirmité après le mariage, et alors tu agiras à ta guise; je m’en lave les mains. S’il te convient d’avoir un mari qui travaille… Après tout, tu n’as peut-être pas tort, c’était le désir de ton père. Libre à toi. Tu sais que madame de Sénonnes vient te prendre à trois heures pour aller chez le tapissier.
–Encore! mon Dieu! je connaîtrai le tapissier, la lingère, le gantier, tous les grands faiseurs de Paris beaucoup mieux que mon mari, s’écria-t-elle avec une naïve consternation. Vous avez beau dire, les choses ne devraient point se passer ainsi, n’est-ce pas, miss Ruth? poursuivit Aline, interpellant son institutrice qui entrait.
Miss Ruth leva au ciel les yeux bleu faïence qui, avec de longues dents d’une effrayante blancheur, éclairaient son visage uniformément revêtu d’un ton rosâtre.
–Ne me parlez pas de vos mariages français, répondit-elle,–l’énergique intensité de prononciation qu’un séjour de quinze années à Paris n’avait pas réussi à lui faire perdre, redoublant sous l’influence d’une indignation contenue,–je ne les comprends pas mieux que je ne ferais de mariages chinois.
–Vous entendez miss Ruth, mon oncle.
–Miss Ruth n’est pas compétente sur ces questions, interrompit M. Béraud avec impatience.
Le teint déjà coloré de la chaste Anglaise devint du plus beau violet.
–C’est vrai, ni dans mon pays ni ailleurs je ne me suis souciée du mariage, dit-elle d’un air de pudeur un peu dédaigneuse qui formait un contraste si comique avec sa figure, qu’Aline, quoiqu’elle l’aimât au point de ne pas la trouver trop laide, s’enfuit pour ne pas céder à l’envie de rire.
–Je vous en prie, chère miss, dit alors M. Béraud, ne mettez pas d’idées romanesques dans la tête de cette enfant et laissez-la se marier comme se marient toutes nos jeunes Françaises, en se fiant au choix de leurs parents.
–Les parents prennent là une grosse responsabilité, répondit miss Ruth, regardant fixement son interlocuteur, et je suis fâchée que, dans une circonstance de laquelle dépend le bonheur de la vie, vous m’interdisiez de rappeler à mon élève que je lui ai enseigné avant tout à faire un digne usage de sa raison et de sa liberté. N’importe, vous pouvez être tranquille, Monsieur. Quand, il y a une douzaine d’années, je suis entrée protestante dans votre maison catholique, j’ai promis de ne jamais toucher dans le cours de mes leçons aux questions de foi, même d’une manière indirecte. Vous savez que j’ai tenu parole.
–Scrupuleusement, miss Ruth. Oui, vous êtes la loyauté même. Autant que mon frère, j’ai toujours senti ce que nous vous devions. Mais aujourd’hui…
–Aujourd’hui, j’agirai pour ce mariage comme j’ai agi autrefois quand des points de controverse religieuse étaient en jeu. Je me tairai; mais c’est plus difficile, beaucoup plus difficile.
Les paroles se brisèrent avec un bruit de sanglots dans la gorge de miss Ruth, ordinairement si maîtresse d’elle-même.
–Qu’est-ce qui vous prend? s’écria M. Béraud inquiet. Auriez-vous vraiment quelque motif pour blâmer?…
–Oh! je ne blâme personne, je ne critique rien. M. de Sénonnes est un gentleman fort aimable et les dames de sa famille sont very engaging indeed; mais songez donc que le sort le meilleur qu’une femme puisse avoir dans la vie est à peine digne de cette chère enfant. Nul ne la connaît comme moi… Vous-même, monsieur Béraud, vous ne soupçonnez pas ce qu’il y a dans son âme de fierté, de tendresse, de grandeur, d’exigences aussi; elle peut tout donner, mais il faudra qu’on lui rende tout en échange, autrement elle souffrira. Comme elle souffrira, hélas! Pensez à cela, pensez-y sérieusement. Si quelque chose pouvait gâter Aline,–mais la gâter est impossible,–ce serait le courant frivole où chacun s’efforce de l’entraîner à la veille d’un acte si grave, si décisif.
–Allons, miss Ruth, dit affectueusement M. Béraud, vous exagérez. Je ne verrais aucun mal à ce qu’Aline mêlât aux mérites que nous lui connaissons un grain de coquetterie, qui les rehausserait au lieu de les diminuer. Il lui a manqué jusqu’ici une qualité, ou plutôt .un défaut, comment dirais-je? ce je ne sais quoi sans lequel une femme n’est pas complète. Bref, elle se ressent d’avoir été élevée par des hommes, la chère petite.
–Par des hommes! s’écria miss Ruth avec un geste de surprise et toutes ses grandes dents dehors. N’ai-je donc été pour rien dans son éducation?
–Si fait, répondit M. Béraud, en riant à la pensée que cette digne Anglaise était presque aussi virile que lui-même, sauf la barbe. Le ciel me préserve d’être ingrat au point de l’oublier! Votre élève n’est que trop parfaite. Il faudra, bon gré mal gré, qu’elle descende au niveau de celui qui doit être le compagnon de sa vie, ou qu’elle fasse au moins semblant d’y descendre. Les anges nous effraient, nous autres simples mortels, quand ils ne savent pas porter leurs ailes avec grâce et se coiffer coquettement de leur auréole. Eh bien! c’est en somme l’art précieux d’être mondaine à la surface, quitte à garder au fond son caractère intact, un caractère formé par miss Ruth, c’est là uniquement ce que les personnes bien intentionnées, dont l’allure un peu frivole vous scandalise, s’efforcent d’inculquer à notre Aline pour achever son éducation et lui donner ce vernis qui ne fait pas grand tort, quoi que vous puissiez croire, à la solidité.
Mais il avait beau entasser les arguments spécieux, miss Ruth secouait la tête,
–La surface, répétait-elle en s’obstinant, doit ressembler au fond; je n’aime pas que, sous prétexte de préparer une fille à ses devoirs de femme, on change du jour au lendemain sa manière de vivre qui était sage, réglée…
–Un peu triste et monotone, interrompit M. Béraud.
–Croyez-vous? nous étions heureuses ensemble!
–Et nous allons être tous plus heureux que jamais. Vous verrez, farouche puritaine! En somme, vous ne nous quittez pas. puisque je dois continuer à vivre sous le même toit qu’Aline. Vous n’allez donc faire que changer d’élève: c’est l’oncle, à défaut de la nièce. qui sera désormais sous votre tutelle. J’ai gardé pour moi cette perle modestement cachée dans sa coquille, notre chère miss Ruth. Elle tiendra ma maison, elle me morigénera d’importance. un vieux célibataire français à la merci d’une spinster anglaise! Quelle gloire pour Albion! s’écria M. Béraud, certain de désarmer, comme toujours, par des plaisanteries, le rigide bon sens de miss Ruth, qui le traitait volontiers de mauvais sujet, un peu trop galant, mais irrésistible.–Laissez-moi baiser le joug et faisons la paix, ajouta-t-il en tendant une main où la vieille fille plaça le bout d’un doigt osseux en murmurant:
–Shocking indeed!
Malgré les silences désapprobateurs derrière lesquels se retrancha désormais le mécontentement de ce mentor en jupons, le tourbillon préliminaire aurait continué pendant deux mois encore, si un accident inopiné n’eût brusqué la célébration du mariage. M. Béraud fut frappé d’un coup de sang. Replet et sanguin, il s’y savait prédisposé depuis longtemps et, bien qu’il dût en rester quitte cette fois pour un léger embarras de la langue, l’idée fixe l’obséda aussitôt que c’était un avertissement, qu’il n’avait plus devant lui que quelques jours de grâce. Une anxiété fiévreuse s’ensuivit, l’impatience de remettre Aline aux mains de sa nouvelle famille. Pour le tranquilliser, la jeune fille permit donc que l’on avançât l’époque de la cérémonie, qui, vu l’inquiétude causée par la santé de M. Béraud, devait avoir lieu sans bruit, du moins sans aucun bruit de fêtes.