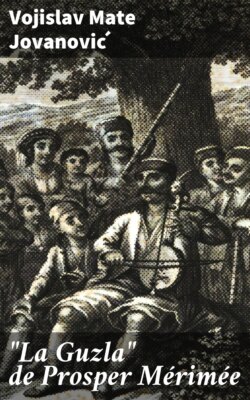Читать книгу "La Guzla" de Prosper Mérimée - Vojislav Mate Jovanović - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
BIBLIOGRAPHIE INDEX AVANT-PROPOS
ОглавлениеTable des matières
Dans les derniers jours du mois de juillet 1827 parut à Paris, chez
F.-G. Levrault, un volume de XII-257 pages in-12, intitulé La Guzla ou choix de poésies illyriques recueillies dans la Dalmatie, la Bosnie, la Croatie et l'Herzégowine. Sorti des presses de F.-G. Levrault, à Strasbourg, cet ouvrage contenait:
1º Une préface de six pages, dans laquelle son auteur, anonyme, Italien d'origine, Français par son éducation, Dalmate de naissance, expliquait ou plutôt justifiait cette publication. «Quand je m'occupais à former le recueil dont on va lire aujourd'hui la traduction, disait-il, je m'imaginais être à peu près le seul Français (car je l'étais alors) qui pût trouver quelque intérêt dans ces poèmes sans art, production d'un peuple sauvage; aussi les publier était loin de ma pensée. Depuis, remarquant le goût qui se répand tous les jours pour les ouvrages étrangers et surtout pour ceux qui, par leurs formes mêmes, s'éloignent des chefs-d'œuvre que nous sommes habitués à admirer, je songeai à mon recueil de chansons illyriques. J'en fis quelques traductions pour mes amis, et c'est d'après leur avis que je me hasarde à faire un choix dans ma collection et à le soumettre au jugement du public.» Dans la suite de sa préface, «s'imaginant que les provinces illyriques, qui ont été longtemps sous le gouvernement français, sont assez bien connues pour qu'il soit inutile de faire précéder le recueil d'une description géographique, politique, etc.», l'auteur, en quelques mots à peine, nous dit ce qu'est la guzla: «espèce de guitare qui n'a qu'une seule corde faite de crin», et nous parle des bardes slaves, joueurs de guzla, qui parcourent les villes et les villages en chantant des romances; puis vient:
2° Une notice sur Hyacinthe Maglanovich, joueur de guzla, le poète des «ballades illyriques» dont on ne fait qu'offrir au public la traduction littérale. Le portrait lithographié de Maglanovich, signé A. Br., ornait le volume; enfin:
3° Vingt-huit ballades, traduites en prose française, accompagnées de longues notes et deux dissertations folkloriques.
Cette collection de ballades eut peu de succès en France. On l'eût rapidement oubliée si elle n'avait eu pour auteur un jeune homme qui se révéla bientôt écrivain de grand talent, si, enfin, on ne lui avait fait à l'étranger un accueil plus favorable. En effet, peu de mois après sa publication, cet ouvrage eut les honneurs d'une traduction en vers allemands. Goethe lui consacra une notice dans sa revue Art et Antiquité. Le vieux poète le loua fort, mais se donna le malin plaisir de dévoiler à cette occasion une petite supercherie littéraire: l'auteur des ballades n'était autre que le jeune et brillant écrivain qui, deux ans auparavant, avait publié le Théâtre de Clara Gazul, œuvre d'une fictive comédienne espagnole. Le titre même du livre (la Guzla) était-il autre chose que l'anagramme de Gazul?
Cette aimable découverte—inutile, disait le démasqué—ne tarda pas à provoquer une certaine curiosité, sinon pour le livre mis en cause, du moins pour son spirituel et original auteur, que ses autres ouvrages commençaient déjà à rendre célèbre.
Prosper Mérimée, qui avait vingt-quatre ans alors, était, en effet, le véritable auteur de ces ballades prétendues illyriques. Dans une lettre restée inconnue des mériméistes français, lettre adressée à Sobolevsky, ami de Pouchkine, le 18 janvier 1835, et, dans une préface écrite en 1840 pour la seconde édition de la Guzla, édition parue en 1842, il a raconté lui-même l'histoire de cette mystification littéraire.
«Vers l'an de grâce 1827, dit-il dans cette préface, j'étais romantique. Nous disions aux classiques: «Vos Grecs ne sont point des Grecs, vos Romains ne sont point des Romains; vous ne savez pas donner à vos compositions la couleur locale. Point de salut sans la «couleur locale.» Nous entendions par couleur locale ce qu'au XVIIe siècle on appelait les mœurs; mais nous étions très fiers de notre mot, et nous pensions avoir imaginé le mot et la chose. En fait de poésies, nous n'admirions que les poésies étrangères et les plus anciennes: les ballades de la frontière écossaise, les romances du Cid nous paraissaient des chefs-d'œuvre incomparables, toujours à cause de la couleur locale».
«Je mourais d'envie d'aller l'observer là où elle existait encore, car elle ne se trouve pas en tous lieux. Hélas! pour voyager il ne me manquait qu'une chose, de l'argent; mais, comme il n'en coûte rien pour faire des projets de voyage, j'en faisais beaucoup avec mes amis.»
«Ce n'étaient pas les pays visités par tous les touristes que nous voulions voir. J.J. Ampère et moi, nous voulions nous écarter des routes suivies par les Anglais; aussi, après avoir passé rapidement à Florence, Rome et Naples, nous devions nous embarquer à Venise pour Trieste, et de là longer lentement la mer Adriatique jusqu'à Raguse. C'était bien le plan le plus original, le plus beau, le plus neuf, sauf la question d'argent!… En avisant au moyen de la résoudre, l'idée nous vint d'écrire d'avance notre voyage, de le vendre avantageusement, et d'employer nos bénéfices à reconnaître si nous nous étions trompés dans nos descriptions. Alors l'idée était neuve, mais malheureusement nous l'abandonnâmes.»
«Dans ce projet qui nous amusa quelque temps, Ampère, qui sait toutes les langues de l'Europe, m'avait chargé, je ne sais pourquoi, moi ignorantissime, de recueillir les poésies originales des Illyriens. Pour me préparer, je lus le Voyage en Dalmatie de l'abbé Fortis et une assez bonne statistique des anciennes provinces illyriennes, rédigée, je crois, par un chef de bureau du Ministère des Affaires étrangères. J'appris cinq à six mots de slave, et j'écrivis en une quinzaine de jours le livre que voici!»
Mérimée, qui ne s'épargnait pas lui-même dans cette préface, raconta ensuite «le succès immense» de la Guzla. «Il est vrai qu'il ne s'en vendit guère qu'une douzaine d'exemplaires, dit-il, mais si les Français ne me lurent point, les étrangers et des juges compétents me rendirent bien justice.»
«Deux mois après la publication de la Guzla, M. Bowring, auteur d'une anthologie slave, m'écrivit pour me demander les vers originaux que j'avais si bien traduits.»
«Puis M. Gerhart, conseiller et docteur quelque part en Allemagne, m'envoya deux gros volumes de poésies slaves traduites en allemand, et la Guzla traduite aussi, et en vers, ce qui lui avait été facile, disait-il dans sa préface, car sous ma prose il avait découvert le mètre des vers illyriques. Les Allemands découvrent bien des choses, on le sait, et celui-là me demandait encore des ballades pour faire un troisième volume.»
«Enfin, M. Pouchkine a traduit en russe quelques-unes de mes historiettes, et cela peut se comparer à Gil Blas traduit en espagnol, et aux Lettres d'une religieuse portugaise traduites en portugais.»
«Un si brillant succès ne me fit point tourner la tête. Fort du témoignage de MM. Bowring, Gerhart et Pouchkine, je pouvais me vanter d'avoir fait de la couleur locale; mais le procédé était si simple, si facile, que j'en vins à douter du mérite de la couleur locale elle-même et que je pardonnai à Racine d'avoir policé les sauvages héros de Sophocle et d'Euripide.»
Ce récit fut, pendant longtemps, l'unique source de renseignements sur le sujet, tant pour les biographes de Mérimée que pour les historiens de l'époque romantique.
L'ironie de ce passage a éveillé une méfiance générale. M. Augustin Filon, le distingué biographe de Mérimée, sachant bien que ce railleur impitoyable, qui nous a donné la Vénus d'Ille et la Chambre bleue, avait trop de goût et trop d'esprit pour faire de pareilles confessions, M. Filon, disons-nous, alla, non sans raisons, jusqu'à qualifier ces deux pages de «nouvelle mystification greffée sur celle de 1827[1]».
Cependant, à l'exception de P. V. Annenkoff, qui a publié, en 1855, ses Matériaux pour servir à la biographie de Pouchkine (en tête de la grande édition du poète russe que Mérimée a dû posséder!), et de M. Jean Skerlitch, qui a donné, en 1901 et 1904, plusieurs articles sur la fortune de la poésie serbe en France—articles malheureusement écrits en serbe et pour des Serbes—personne n'entreprit de vérifier le récit de notre auteur[2]. Une étude complète sur la Guzla était encore à faire.
Un tel travail ne serait pas sans intérêt ni sans utilité pour qui veut mieux connaître le curieux épisode d'histoire romantique qu'est cette œuvre de jeunesse du parfait écrivain à qui les lettres françaises doivent la Chronique de Charles IX et Colomba. Mais—et nous tenons à le dire avant d'aborder la matière—ce n'est pas exclusivement au critique français que s'adresserait une monographie sur la Guzla. Et tout d'abord, un «choix de poésies illyriques», alors même que les origines en seraient douteuses, intéresse l'historien littéraire serbo-croate. La poésie populaire a joué un grand rôle dans la destinée de cette nation dont elle constitue encore aujourd'hui le plus important monument littéraire; aussi les érudits serbo-croates doivent-ils chercher à savoir quelle fut son influence à l'étranger. La Guzla, d'autre part, appartient à un genre international par excellence: son caractère dépasse les frontières du pays où elle a vu le jour et du pays qui l'a inspirée; son histoire intéresse tous ceux qui s'occupent de l'influence de la ballade populaire sur la littérature en général, sur le romantisme européen en particulier.—Enfin, à propos de ce recueil, Mérimée est entré en relations avec Goethe et Pouchkine. Connaître l'histoire de la Guzla est donc chose importante pour les biographes et les commentateurs de ces deux grands poètes. Il est nécessaire en effet, et nous le montrerons, d'apporter certaines rectifications aux travaux qu'on leur doit, encore que ces mêmes travaux aient fourni un sérieux appoint à notre étude.
Pour ces raisons, nous avons voulu faire œuvre utile à la fois pour les mériméistes, pour les slavicisants, pour ceux qui se sont adonnés à l'étude du romantisme, pour ceux enfin qui font de Goethe leur poète favori.
Il est vraiment difficile d'être parfait alors qu'on s'adresse à des érudits qui ont des préoccupations si différentes, quand on s'expose à la fois à la critique française et aux critiques étrangères. Les méprises sont possibles en effet; de plus, on risque toujours, s'adressant à des publics si divers, d'être ici trop prolixe, ici trop incomplet. En ce qui concerne le premier de ces écueils, nous croyons que le meilleur moyen sinon d'éviter toute méprise, du moins de les faire ressortir d'elles-mêmes, est de donner en notes tout ce qui peut permettre de contrôler et de rectifier le travail. Quant au second, nous avouerons que, pour notre part, nous préférons le superflu à l'insuffisant.
Il est certain que le lecteur versé dans quelques-unes des questions que nous avons à traiter (Poésie populaire dans la littérature européenne; Mérimée avant 1827; etc.) trouvera dans notre livre bien des choses qu'il jugera trop connues pour figurer dans un travail d'érudition. Mais, pour parler sans fausse modestie, il n'est pas moins certain qu'elles lui apparaîtront sous un jour nouveau, dans l'ensemble qu'elles forment avec d'autres faits jusqu'alors ignorés.
Nous nous proposons, en ce qui concerne le plan de notre ouvrage, d'exposer l'histoire de la Guzla dans l'ordre qui nous paraît le plus logique: 1° retrouver les causes littéraires et autres qui ont contribué à la produire (les Origines); 2° étudier les procédés de composition dont l'auteur s'est servi (les Sources); 3° raconter l'histoire du livre une fois paru (sa Fortune). Nous voulons vérifier, rectifier et compléter les faits connus[3], en apporter de nouveaux, les ordonner, les grouper, sans craindre de nous engager dans des digressions et des discussions lorsqu'elles nous paraîtront nécessaires, car notre matière est, après tout, de celles qui sont nettement circonscrites: on peut aisément l'épuiser.
Nous avons adopté les règles suivantes pour la transcription des noms et des mots slaves:
1° Pour les Slaves qui se servent de l'alphabet romain, nous avons conservé l'orthographe originale;
2° Pour ceux dont l'écriture est cyrillique, nous avons composé des transcriptions phonétiques françaises qui se rapprochent le plus possible de la prononciation du peuple auquel ces mots appartiennent; sauf dans le cas où il s'agit, soit de noms déjà orthographiés par ceux qui les portent, soit, surtout, de noms et de mots cités dans la Guzla, pour lesquels nous avons cru devoir respecter la forme originale.
Depuis un certain temps, les philologues slaves les plus estimés s'efforcent de faire accepter à l'étranger une méthode beaucoup moins compliquée, mais qui a aussi de graves inconvénients. Ils ont proposé d'adopter le plus simple parmi les alphabets slaves romains, c'est-à-dire l'alphabet croate, avec quelques additions indispensables. Ils ont eu beaucoup de succès en Allemagne et un peu en Angleterre. Pour des raisons dont l'énumération serait trop longue ici, nous ne croyons pas qu'il en sera de même en France, et que l'on n'y écrira jamais Puškin au lieu de Pouchkine, Turgenjev au lieu de Tourguéneff, Tolstoj, etc.