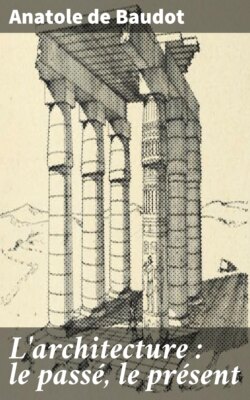Читать книгу L'architecture : le passé, le présent - Anatole de Baudot - Страница 8
ОглавлениеL’ARCHITECTURE EN ÉGYPTE, EN CHALDÉE ET EN PERSE
Afin de saisir comment l’art s’est introduit dans le domaine de la construction, c’est vers les premières civilisations de l’Égypte et de l’Asie qu’il faut diriger nos vues.
Fig. I. — Plan d’un temple égyptien.
Les Egyptiens avaient à leur disposition la pierre et l’argile: les calcaires et le granit pour les temples et les tombeaux, la matière argileuse réservée aux habitations. Ces dernières offrent assurément un intérêt de curiosité, mais c’est dans la réalisation des temples qu’il faut chercher la méthode de composition qui a guidé ces premiers constructeurs, dont le sentiment artistique a atteint une si haute et si impressionnante puissance.
Résumons tout d’abord (voir fig. I) la composition générale des temples, dont l’étendue et certains caractères de détails ont varié suivant les dynasties, mais qui ont tous obéi à un même programme. Ces édifices se composent de trois parties: une première cour entourée de portiques, destinée à la foule et dans laquelle on pénètre par une seule porte, flanquée de deux pylones; à la suite une grande salle réservée aux initiés; enfin le sanctuaire, où séjourne l’Idole et où nul ne peut pénétrer. L’ensemble est fermé par un mur continu qui n’est percé d’aucune ouverture. Ces trois parties distinctes sont closes, dans leur partie supérieure, par des plafonds formés de dalles de granit que soutiennent des points d’appui verticaux, grâce à l’intermédiaire de plates-bandes ou architraves dont la disposition correspond aux dimensions des dalles qui sont parfois très étendues (voir fig. 2). L’éclairage et l’aération de l’intérieur des temples sont obtenus par des ouvertures établies sur certains points, grâce à la surélévation du plafond. Les points d’appui correspondants devenant plus hauts sont logiquement augmentés dans leur section horizontale. Rien de plus simple qu’un tel système de construction et cependant rien de plus caractéristique de plus monumental qu’une telle combinaison dont l’effet est dû, avant tout, à la franchise des moyens employés et à la répétition des ordonnances. Ici, tout point d’appui a son utilité ; il en est de même de chaque élément horizontal. Aussi quand par la pensée on se reporte à tant d’édifices beaucoup moins anciens et qu’on y constate une profusion de colonnes et de pilastres inutiles qui ne sont là que pour l’aspect, on est pris d’un certain découragement à observer combien, dans une société affinée, les artistes deviennent étrangers, dans leurs ambitions, à tout esprit de bon sens et de logique.
Fig. 2. — Perspective d’une galerie de temple égyptien.
On objectera peut-être, pour justifier l’incohérence et l’inconséquence des édifices modernes, que la façon de procéder dans les premiers temps de l’architecture résultait de la simplicité des programmes, et qu’elle n’est pas applicable à des problèmes plus étendus. Ce serait une erreur que rectifient amplement certaines époques intermédiaires qui, dans les solutions les plus complexes, ont su servir et appliquer les principes les plus rigoureux, comme nous le verrons par la suite. Ce qui a pu faciliter la simplicité et en même temps la beauté expressive de l’œuvre égyptienne, c’est l’unité de structure suivant laquelle tout y est exécuté. Pour des raisons diverses qu’il convient d’envisager et qui s’expliquent plus ou moins, des matières de nature différente ont été introduites dans les édifices modernes; mais il est toujours temps d’abandonner ces pratiques et de revenir au principe d’unité qui peut être adopté si utilement à l’époque présente, sinon avec la pierre, du moins avec les nouveaux matériaux dont l’emploi s’impose d’ailleurs désormais, qu’on le veuille ou non.
Mais revenons à la méthode de composition des Egyptiens; elle correspond à deux opérations qui sont pratiquées simultanément, dont l’une est architectonique, l’autre architecturale. La première détermine les dispositions constitutives de la structure, ses ordonnances verticales et horizontales, ainsi que la force des éléments de construction; l’autre fixe les formes en raison de la nature de la matière et des ressources que celle-ci offre à l’ouvrier qui sait la travailler. C’est ainsi que s’établit la concordance entre la structure et la forme et qu’est satisfait ce principe capital de sincérité, sans lequel l’œuvre perd son véritable caractère d’architecture, pour ne plus être fatalement qu’une œuvre décorative, susceptible de charmer les yeux, mais incapable de procurer l’émotion et d’éviter le double emploi de matériaux. Au sujet de cette méthode à laquelle il conviendrait tant de revenir, se pose une question d’une singulière importance; c’est celle des proportions. A cet égard, d’observations et de constatations nombreuses, il résulte que l’Égyptien avait recours, soit aux rapports arithmétiques des nombres, soit à des combinaisons géométriques de triangles pour proportionner les ensembles. Procédait-il de même pour arrêter les formes de détails? Ce point n’est pas élucidé, en tout cas il ne semble pas que l’Égyptien ait obéi à un système modulaire analogue à celui que nous trouverons chez le Grec. Quoi qu’il en soit, il n’apparaît pas que cette question particulière soit d’un intérêt absolu pour l’architecte moderne, car dans les problèmes complexes qu’il a à résoudre, les moyens employés dans des édifices aussi simples que les temples ne pourraient être de grande utilité. Lorsque la nature des matériaux et les dimensions générales des édifices se modifient, il paraît en effet impossible d’appliquer un système de proportions adopté pour des conditions entièrement différentes.
L’enseignement que nous pouvons demander à l’architecture égyptienne est donc limité à l’observation attentive de la méthode de composition, mais sous ce rapport il est d’importance capitale. Ce qui éloigne surtout à notre époque les esprits de cette primitive et cependant si instructive période, c’est le caractère hiératique auquel elle a obéi et qui est en contradiction absolue avec le sentiment d’individualité qui domine chez nous, où chacun prétend créer en toute liberté l’œuvre d’art. La volonté supérieure qui s’imposait sous une forme hiératique à l’artiste égyptien, durant une longue période de siècles, n’a aucun rapport cependant avec la méthode de composition indiquée ci-dessus; cette méthode devrait toujours guider le chercheur dans toute œuvre d’architecture, quel que soit d’ailleurs le sentiment ou l’ordre d’idées qui le guide, car elle est fondée sur le sens droit et la raison. D’ailleurs, par la suite, comme nous le verrons jusqu’à la Renaissance, sauf dans une certaine mesure chez les Romains, cette façon de composer a toujours été adoptée et c’est son application qui a le plus contribué à rendre créatrices les grandes périodes de l’art.
L’influence de l’Égypte a du reste singulièrement rayonné et elle n’est pas douteuse dans la conception des temples grecs, où s’affirment également la logique et la sincérité d’expression. On trouve, à cet égard, dans le petit temple égyptien d’Éléphantine, élevé sous la 18e dynastie, une preuve qui a son intérêt, car on y constate le principe de la cella entourée de portiques (voir fig. 3 et 4) et la combinaison dont le style grec a tiré de si heureuses conséquences.
L’art égyptien, indépendamment de la façon remarquable dont il a indiqué les véritables et fondamentales bases de la composition, résumées dans la concordance de la structure et de la forme, nous offre aussi d’utiles indications sur le mode décoratif qu’il a constamment appliqué avec une pensée dirigeante, sans aboutir à une monotonie aussi absolue qu’on le croit généralement.
Dans les formes appliquées aux éléments de la construction et dans la sculpture, il a montré une singulière puissance d’interprétation de la nature, pour en styliser les éléments; de même dans l’emploi de la couleur, il a su admirablement tenir compte du contraste que présente la lumière si vive de l’extérieur avec l’obscurité calme de l’intérieur des temples. Le dessin, par intailles faites dans l’enduit qui recouvre la pierre, est souvent très beau. Ce genre de décoration indique un procédé ouvrant des horizons toujours nouveaux. Peut-être est-il destiné à nous être utile dans nos constructions modernes, lorsque nous sommes amenés à renoncer aux ressources de la mouluration que donne la pierre, dont l’emploi tendra de plus en plus à se restreindre: par raison d’économie, et aussi parce que son usage ne se prête pas à la bonne installation des services nouveaux, réclamés dans la plupart de nos bâtiments.
Plan du temple d’Eléphantine.
Dans la Chaldée et l’Assyrie qui ne possédaient presque uniquement que de l’argile, nous voyons, comme en Égypte, l’architecture prendre naissance et se développer méthodiquement, mais suivant des expressions différentes qui sont la conséquence de la diversité des programmes et des matériaux. Ce ne sont plus des temples, mais des palais immenses et riches qui s’y élèvent. Ce n’est plus le plafond de pierre qui domine la conception, mais la voûte surmontée de terrasses. Les extérieurs sont mouvementés, en raison des dispositions intérieures, et percés de fenêtres seulement dans les parties supérieures. Les murs, faits d’argile comme les voûtes, ne présentent que des parois dépourvues de toute mouluration, de toute saillie; la pierre est rare et figure seulement dans les soubassements, sous forme de revêtements et parfois de dalles sculptées.
Dans la construction des voûtes qui sont en berceau, ou parfois en forme de dômes, la brique séchée au soleil et celle durcie au feu sont employées très habilement sans le secours de cintres.
La décoration est fournie à l’intérieur par des dalles de pierre ou d’albâtre ornées de bas-reliefs et formant lambris dans les parties basses des murs; souvent les enduits colorés couvrent les surfaces limitées par des bordures de poterie émaillée et dont les tons se limitaient au bleu, au blanc, au noir et au jaune.
Il n’est pas nécessaire, en raison du but poursuivi ici, de développer davantage les indications relatives à cette époque chaldéenne et assyrienne; il suffit d’y constater, comme en Égypte, l’influence de l’emploi judicieux de la matière qui est à la base du problème architectural.
Si nous n’y trouvons pas de constructions à grande portée et n’y puisons qu’un enseignement limité, il n’en est pas de même en Perse où le même mode de bâtir se développe dans des conditions bien autrement importantes; la voûte en coupole sur pendentifs y apparaît alors dans de larges espaces, pour couvrir les plans, de forme carrée à la base. Ces ouvrages sont exécutés par les Perses comme par leurs prédécesseurs chaldéens, en briques, mais alors généralement très durcies par le feu.
Fig. 4 — Perspective extérieure du temple d’Eléphantine.
Dans ces palais, indépendamment des ornements sculptés qui encadraient les baies et affirmaient certaines lignes, la brique employée en parements comportait une ornementation colorée due à l’émail, dont on peut avoir une idée précise au musée du Louvre, grâce aux spécimens rapportés par M. et Mme Dieulafoy; à ce sujet il y a lieu de signaler un fait tout récent qui a son importance.
D’après un céramiste savant et habile, les briques en question ne seraient pas de nature argileuse, mais seraient dues à l’emploi d’un mortier de chaux, préparé de telle façon qu’il pût être cuit et donner une matière solide et résistante, analogue à un produit céramique. M. C. Bigot, à l’appui de ses expériences, a reconstitué la matière dont il s’agit et exécuté des reproductions du Taureau ailé et de la frise des Archers, qui proviennent du palais de Darius et figurent au Musée du Louvre.
Ce résultat est remarquable et peut avoir, s’il est appliqué à des conceptions nouvelles, des conséquences très heureuses et fort utiles à la décoration des matériaux agglomérés qui tend à se développer aujourd’hui.