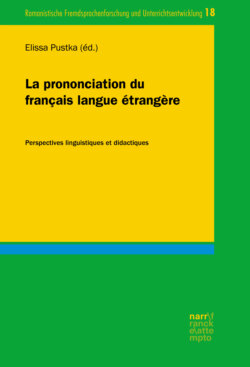Читать книгу La prononciation du français langue étrangère - Группа авторов - Страница 41
1 Introduction1
ОглавлениеEn théorie, l’inclusion des variétés régionales dans l’enseignement du FLE ne devient pertinente qu’à un niveau très élevé – du moins si l’on croit le CECRL, le cadre européen commun de référence pour les langues (cf. Falkert 2019). Celui-ci ne décrit aucun lien entre l’apprenant.e et les variétés régionales2 du français du niveau A1 à B2. Ce n’est qu’au niveau C1 que la description de la compétence sociolinguistique y fait explicitement référence : « Peut reconnaître un large éventail d’expressions idiomatiques et dialectes et apprécier les changements de registres ; peut devoir toutefois confirmer tel ou tel détail, en particulier si l’accent n’est pas familier. » (Conseil de l’Europe 2001 : 95). Cependant, admettons que les apprenant.e.s soient mis.e.s en contact avec des francophones d’une variété non-standard avant d’atteindre le niveau C1 : comment vivront-ils/elles le décalage entre le français qu’ils/elles entendent et celui qu’ils/elles ont appris ? Est-ce que leur ignorance des variétés du français ne rendrait pas leurs premiers échanges encore plus problématiques, étant confronté.e.s à des difficultés qu’ils/elles ne soupçonnaient pas ?3 Suivant la théorie que la fréquence serait nécessaire à l’acquisition des unités linguistiques (cf. Bybee 2001, Ellis 2002), ne pas être familiarisé.e plus tôt avec les accents4 régionaux pourrait alors entraver sérieusement la conversation avec la bonne majorité, voire la totalité des francophones5. Si cela concerne aussi des régions françaises (puisque la variation géographique y est également présente6), cela serait particulièrement regrettable en ce qui concerne le Québec, l’Afrique subsaharienne et le Maghreb puisque ces espaces francophones hors de France ont beaucoup de poids démographique7. La question de l’intégration de la variation régionale dans l’enseignement du FLE dans les pays non-francophones (germanophones ou autres) est donc très pertinente.
En parlant de francophonie, la question de définition de personne native survient rapidement et on constate que ce concept n’est pas très clair. En général, les Français.e.s, les Québécois.e.s, les Belges francophones et les Suisses romand.e.s parlent le français comme L1 alors que le français est la L2 pour la plupart des personnes du Maghreb et de l’Afrique subsaharienne francophone (cf. les contributions concernant le Maghreb et l’Afrique subsaharienne dans Reutner 2017. Dans ce qui suit, nous regrouperons ces deux groupes (L1 et L2), que nous appellerons francophones ou natifs, et les mettrons en contraste avec un troisième groupe (FLE ; Français Langue Étrangère) : les personnes apprenant le français à l’école comme langue étrangère et vivant dans une région où le français ne sert pas comme langue d’usage, c’est-à-dire qu’il n’est ni langue véhiculaire ni vernaculaire.
Nous affirmons qu’il est crucial d’intégrer la variation dans l’enseignement du FLE ; cependant, avant d’entrer dans la conception didactique des moyens de sensibilisation possibles, il faut une prise de conscience préalable de l’état des choses actuelles. Contrairement à l’anglais (p. ex. Carrie 2017 ; Ladegaard/Sachdev 2006 ; Rindal 2010), il n’existe que très peu d’études traitant de la perception des variétés régionales du français par des apprenant.e.s (Bergeron/Trofimovich 2019 ; Hume/Lepicq/Bourhis 1993 ; Neufeld 1980).
Cette étude vise donc à élargir l’éventail des travaux d’investigation sur ce sujet. Dépassant la question de la compréhension, nous tenterons d’analyser la façon qu’ont les francophones L1-L2 et les apprenant.e.s FLE de percevoir les variétés régionales. Nous interrogerons deux types de normes : les normes explicites sur lesquelles s’appuie consciemment une personne pour décrire la variété la plus correcte ou la plus belle du français ; et les normes implicites, soit les critères inconscients rapprochant ou non une variété de ce même idéal.8 Nous supposons que l’évaluation de stimuli de différentes variétés sera influencée par des stéréotypes et que l’analyse de ces évaluations révèlera les attitudes perceptives inconscientes des participant.e.s. Si les évaluations des francophones s’avèrent plus stéréotypées que celles des apprenant.e.s – c’est-à-dire moins tolérantes aux variétés s’éloignant de l’idéal commun du français parisien –, il faudra réfléchir à des mesures poussant les francophones à percevoir de façon positive la diversité des variétés francophones, que ce soit leur propre variété ou les variétés des autres francophones. Par contre, dans le cas où les apprenant.e.s montrent des évaluations plus négatives que les francophones, il faudra développer des méthodes de sensibilisation dans le contexte du FLE.
Ces réflexions nous amènent à formuler la question suivante, qui nous guidera à travers ce projet et à laquelle nous essayerons de répondre à la fin de cet article (section 6, Discussion) : Qu’est-ce que les évaluations révèlent sur les normes implicites des francophones et des apprenant.e.s ? Les normes implicites convergent-elles avec les normes explicites ?
L’enjeu de ce travail consiste à analyser les évaluations de stimuli natifs et non-natifs9 par (1) un groupe natif et (2) un groupe d’apprenant.e.s (élèves et étudiant.e.s germanophones de FLE). Le but est de pouvoir comparer leurs connaissances des variétés régionales ainsi que leurs représentations mentales (explicites et implicites) des normes de prononciation (cf. aussi Chalier à paraître pour la perception des normes dans la francophonie et Pustka/Chalier/Jansen 2017 pour les représentations de normes de prononciation). Dans le cadre de cet article, nous tenterons donc de répondre aux quatre questions de recherche suivantes :
1 Les évaluations du degré d’accent, de la compréhensibilité, du caractère exemplaire (beau français)10 et de l’acceptabilité d’un accent se distinguent-elles en fonction du niveau de maîtrise du français (juges natifs/natives vs apprenant.e.s débutant.e.s vs apprenant.e.s intermédiaires) ?
2 Est-ce que la capacité à déterminer si un accent est natif ou non-natif dépend du niveau de langue de la personne qui le juge ?
3 Est-ce que la capacité à identifier correctement l’origine géographique d’un accent dépend du niveau de langue de la personne qui l’entend ?
4 Quelles sont les attitudes explicites des apprenant.e.s envers les variétés régionales ?