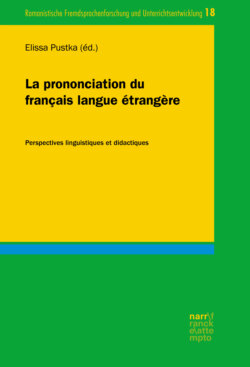Читать книгу La prononciation du français langue étrangère - Группа авторов - Страница 43
2.2 Qu’en pensent les apprenant.e.s ?
ОглавлениеComment donc savoir quelle norme enseigner en FLE et quelle place accorder à la variation ? Il est intéressant de noter que les apprenant.e.s manifestent souvent une position claire à cet égard, du moins en ce qui concerne la production. Voici l’exemple de Wachs (2011 : 191) :
Si on pose ces questions1 aux apprenants de français, ils répondent dans leur grande majorité qu’ils veulent parler ‘le bon français’ et ‘bien le prononcer’, c’est-à-dire parler le ‘français de référence’ : un français non marqué, non stigmatisant.
Detey et Le Gac (2008 : 476) ont également dévoilé le souhait d’élèves d’apprendre et d’enseignant.e.s d’enseigner une variante qu’ils/elles appellent le français standard.
Il est encore plus intéressant de voir que, malgré leur proximité géographique et une probabilité élevée d’entrer en contact avec des francophones du Québec, les anglophones du Canada (cf. Hume/Lepicq/Bourhis 1993) et même les immigrant.e.s vivant au Québec (cf. Bergeron/Trofimovich 2019) donnent des jugements plus favorables au français standard qu’au français québécois. Cela s’explique probablement par le fait que, dans l’enseignement du français en Amérique du Nord, une norme européenne continue à prévaloir : malgré une tendance à inclure plus de contenu (culturel) lié au Québec observée entre 1960 et 2010 (cf. Chapelle 2014), les manuels transmettent toujours majoritairement la norme parisienne (cf. aussi Wagner 2015). Dans cette même voie, beaucoup de professeurs de FLE considèrent le français du Québec comme « moins authentique » et « inapproprié » pour l’enseignement du français (cf. Wernicke 2016).
Mettre l’accent sur une variété que l’on appellera standard risque de conduire les apprenant.e.s à avoir « une vision confuse et réductrice de la langue » et à être surmené.e.s quand on leur présente des variétés (cf. Merlo 2011 : 27). Neufeld a déjà démontré en 1980 que les apprenant.e.s avancé.e.s – quoique pouvant émettre un jugement discriminatoire envers les stimuli d’apprenant.e.s – avaient manifesté des problèmes pour affirmer si une personne était un.e Francophone du Canada ou un.e Francophone d’un autre pays. Utilisant la technique du matched guise, Bergeron et Trofimovich (2019) ont fait un constat similaire : même des apprenant.e.s du français habitant au Québec depuis plusieurs années étaient incapables de différencier les stimuli québécois des stimuli français, confondant surtout les registres formels du français québécois avec le français de France. De plus, ces auteures ont constaté des réactions négatives envers le français parlé au Québec2.
A notre connaissance, il n’existe pas d’étude traitant de la perception des autres variétés francophones par des apprenant.e.s de français, d’où la nécessité de travaux sur ce sujet.