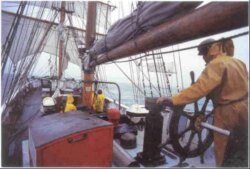Читать книгу SOUS LA VOILE - Peter Foerthmann - Страница 19
ОглавлениеLa consommation d’un autopilote
La consommation en énergie d’un autopilote dépend non seulement de sa puissance, mais aussi d’autres facteurs tels que :
· la longueur et le déplacement du bateau : plus le bateau est grand, plus l’autopilote consommera de l’énergie ;
· le type de gouvernail : l’autopilote devra exercer plus de force sur un gouvernail monté sur la quille et non compensé que sur un gouvernail semi-compensé à guibre. Les gouvernails entièrement compensés et sans guibre demandent encore moins d’efforts ;
· la vitesse à laquelle la position du gouvernail doit être corrigée : cette vitesse dépend de la stabilité de cap du bateau et donc indirectement de la forme de sa carène ;
· le réglage et la prise des voiles : un bateau dont les voiles sont mal réglées et ont trop de prise du côté du vent demande nettement plus d’efforts de la part de l’autopilote qu’un bateau bien équilibré ;
· les conditions de la mer : plus la houle est forte et plus les embardées sont grandes, plus l’autopilote aura à intervenir ;
· la précision de pilotage souhaitée : plus vous voulez que le bateau se conforme au cap de consigne, plus l’autopilote aura du pain sur la planche ;
· le logiciel ou précision du réglage manuel : plus les algorithmes de l’ordinateur de bord sont ciblés, c.-à-d. au diapason du bateau qu’ils sont appelés à piloter, plus vous épargnerez de l’énergie. La consommation énergétique d’un autopilote réglé manuellement dépend quant à elle en grande partie de la sensibilité de cet autopilote et de sa facilité de réglage.
Comment économiser de l’énergie ?
Une fois qu’on a tenu compte de tous ces aspects susceptibles de réduire déjà considérablement la consommation en énergie, reste à diminuer la fréquence des corrections de cap. Pour ce faire, il y a lieu d’agrandir l’angle dont le bateau peut s’écarter de sa route avant que l’autopilote n’ait à intervenir, autrement dit, d’offrir au bateau une plus grande liberté de manœuvre entre deux corrections de cap.
Tous les autopilotes modernes sont autodidactes, c.-à-d. programmés pour reconnaître certains lacets récurrents. Leur cycle de fonctionnement, ainsi que le temps de fonctionnement du moteur s’en trouvent écourtés. En présence d’un mouvement qui leur est familier, cela leur permet également d’intervenir très rapidement et de déployer, à ce stade précoce, moins d’efforts que s’ils intervenaient plus tard. Hélas, la liste des mesures visant à économiser de l’énergie s’arrête là.
La consommation moyenne dont font état les fabricants de pilotes de cockpit est basée sur un cycle de fonctionnement de 25%. Concrètement, cela supposerait que l’autopilote n’ait à intervenir qu’à concurrence de 15 min./heure, ce qui ne nous paraît pas très réaliste. La consommation moyenne effective risque donc d’être plus élevée.
C’est surtout quand on fait de longs voyages qu’on se rend compte de l’abîme entre la théorie et la pratique. Sur un bateau, la maîtrise de l’énergie est pourtant doublement importante, car chaque ampère que l’on consomme doit être généré à bord. La différence entre la consommation moyenne indiquée par les constructeurs et le temps de fonctionnement effectif du moteur de l’autopilote peut être considérable. La réalité ne correspond jamais à une moyenne et la consommation réelle est toujours supérieure à la moyenne.
Un bateau uniquement équipé d’un échosondeur, d’un GPS de poche, de lampes à paraffine, d’un régulateur d’allure et sans réfrigérateur – dont la consommation est donc réduite au maximum – ne risque pas d’épuiser ses batteries. Or, ce bateau n’a aucune commune mesure avec la moyenne des yachts de croisière. La flotte de l’ARC, qui passe chaque automne par les îles Canaries, en dit long à ce sujet. Depuis une dizaine d’années, les yachts qui y participent ont en moyenne une longueur 13 m/44 ft. Ceux de moins de 33 ft se comptent sur les doigts de la main. En plus, ils sont généralement super équipés, non seulement d’instruments de navigation sophistiqués tels que GPS, lecteurs de carte et radar, onde courte, radio SSB et VHF, mais aussi d’un réfrigérateur, de pompes, d’un dessalinisateur et d’un éclairage extérieur.
Sur un bateau de 13 m/44 ft croisant sous des latitudes plus chaudes, l’ensemble de ces appareils consomme en moyenne 120 ampères-heures (Ah) par jour – sans compter la consommation d’un autopilote électrique. Cet exemple montre clairement à quel point la maîtrise de l’énergie est importante à bord d’un yacht à voile. L’impact d’un autopilote sur le budget énergétique est considérable, surtout lorsqu’il s’agit d’un modèle hautement performant. Tous les livres consacrés au problème de la maîtrise de l’énergie à bord d’un bateau sont unanimes : qui prête trop peu d’attention à ce problème complexe avant le départ le regrettera amèrement une fois en mer.
Pilote de barre à roue Autohelm
Pour un bateau de 13 m/44 ft, comme celui que nous avons pris en exemple, les constructeurs conseillent d’utiliser un autopilote qui consomme de 2,7 à 6 A/heure. Cela veut dire que s’il fonctionne en permanence, cet autopilote fera grimper la consommation totale du bateau d’au moins 50% sur une période de 24 heures. En plus, on ne peut pas perdre de vue que si la tension devient trop faible (moins de 10,5 V), certains appareils branchés sur le circuit électrique du bateau tomberont en panne. À la lumière de toutes ces données, une batterie d’une capacité de 600 Ah n’est pas un luxe superflu.
Les générateurs à vent, eau, vagues et énergie solaire peuvent aider, mais comme ils sont tributaires des conditions atmosphériques, jamais au point de pouvoir répondre systématiquement à ces besoins en énergie supplémentaire journaliers. Le navigateur et organisateur de courses Jimmy Cornell l’a d’ailleurs confirmé à l’issue d’un debriefing avec les navigateurs qui avaient participé à la course Europa de 1992. En plus, si un des générateurs d’appoint a des problèmes ou tombe en panne, les autres devront forcément tourner plus longtemps et risqueront, en l’absence d’une bonne isolation acoustique, d’empester rapidement la vie à bord. La chaleur supplémentaire qu’ils génèrent peut, quant à elle, parfois venir à point, par exemple aux heures les plus fraîches aux Bermudes...
Les problèmes d’énergie sont bien entendu moins cuisants sur des bateaux de plaisance, du fait qu’on n’est jamais très loin d’un port où il y a moyen de recharger les batteries.