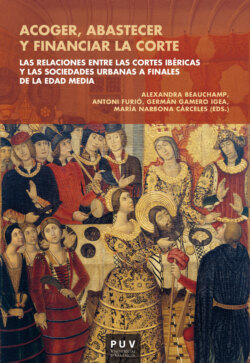Читать книгу Acoger, abastecer y financiar la corte - AA.VV - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеUNE COUR EN VILLE, AU QUOTIDIEN. ALPHONSE LE MAGNANIME ET NAPLES (1442-1458)
Roxane Chilà Université Bordeaux Montaigne
Les études curiales qui fleurissent à l’heure actuelle bénéficient de la dynamique initiée par les travaux sur les spectacles offerts par la royauté française à ses sujets à l’occasion des entrées de ville, des funérailles, des lits de justice etc., qui ont souligné l’importance politique des fêtes et des cérémonies curiales1. Les villes qui abritent les cours et servent de décor à ces festivités se trouvent alors propulsées au premier plan de l’analyse; l’étude des fêtes et celle des palais urbains sont les domaines par excellence de la mise en relation de la cour et de la ville2. Le langage symbolique déployé dans l’architecture et lors des spectacles, ainsi que les messages politiques qu’il véhicule, permet de comprendre en profondeur l’idéologie royale. Christiane Klapisch-Zuber a souligné que le rituel contribue à la fois à établir, confirmer et parfois transformer les relations de pouvoir entre gouvernants et gouvernés3. Il «signifie et construit» des rapports de pouvoir.
Cependant, les critiques adressées par les historiens français (dont justement Christiane Klapisch-Zuber et Alain Boureau4) aux travaux «cérémonialistes» pointent le manque de prise en compte du religieux et de l’influence de la liturgie dans ces analyses, et encore l’importance cruciale d’une contextualisation fine pour faire émerger le sens des cérémonies ou des rites, termes auxquels Alain Boureau propose de substituer ceux de commémoration ou de célébration. Une autre démarche, complémentaire, susceptible d’enrichir les travaux sur les cours urbaines, consiste à prendre délibérément le contrepied de cette histoire de la présence curiale en ville faite au miroir des célébrations et des événements exceptionnels. Il s’agit alors de centrer l’enquête sur les lieux de vie et de sociabilité des curiaux au quotidien; les pratiques religieuses et de consommation; les rapports des hommes du roi et des habitants de la capitale. C’est aussi le projet de la présente contribution.
Une telle démarche est particulièrement salutaire dans le cas de la Naples d’Alphonse le Magnanime. Roi d’Aragon depuis 1416, Alphonse est l’héritier de Ferdinand Ier de Trastamare, élu en 1412 pour succéder à la maison de Barcelone sur le trône aragonais. En 1420, la reine de Naples Jeanne II d’Anjou, sans enfant, propose à Alphonse de l’adopter et de faire de lui son héritier5. La Sicile est déjà aragonaise depuis 1282 et, quand l’offre de la reine angevine arrive, Alphonse se trouve en Corse. D’horizon politique familier, l’Italie devient alors pour trente ans le champ de bataille du Magnanime. En effet, Jeanne de Naples, après avoir offert son royaume, suscite un concurrent à Alphonse en adoptant à sa place Louis d’Anjou en 1423. Les princes aragonais et angevins guerroient par intermittence jusqu’en juin 1442, date à laquelle Alphonse –bientôt célébré comme le «Magnanime» par les humanistes qu’il a réunis autour de lui, dont Lorenzo Valla et Antonio Beccadelli– fait la conquête définitive de Naples. La prise de la ville signe la défaite complète de son rival. Cette victoire, qui ajoute au patrimoine familial la couronne de Naples à celle d’Aragon, est célébrée seulement en février 1443, avec quelques mois de délai imposés par une campagne militaire dans les Marches (contre Francesco Sforza). Ce délai permet toutefois aux autorités municipales et aux humanistes de l’entourage royal, ainsi qu’aux communautés florentine et catalane de Naples, de mettre au point une entrée grandiose et une journée de festivités extraordinaires. Alphonse célèbre le premier triomphe urbain depuis l’antiquité impériale, et ses thuriféraires font en sorte que l’événement soit connu dans toute la péninsule italienne, où l’arrivée de ce roi étranger est accueillie avec circonspection.
C’est l’une des grandes entreprises du règne du Magnanime que de soigner son image de patron des lettres et des arts, mettant la cour au diapason de la floraison humaniste que connaît la péninsule italienne au milieu du XVe siècle. La destruction des archives de Naples en 1943 a privé les historiens des archives royales et les conséquences historiographiques de l’incendie sont sensibles: ne subsistent en Italie, pour faire l’histoire d’Alphonse le Magnanime, que les chroniques et la production humaniste commanditée par lui, ce qui introduit un biais méthodologique considérable. La légende dorée du «roi qui a fait la Renaissance à Naples» tend à déterminer l’analyse d’un règne souvent lu au prisme de l’acculturation réussie du conquérant au vent nouveau de l’humanisme, renouant avec les langues antiques et exhumant les textes des Anciens.
Pourtant, l’installation de la cour d’Alphonse le Magnanime à Naples ne saurait se réduire à cette réussite culturelle, ni l’histoire des relations entre la ville capitale et la société curiale s’arrêter à l’emblématique triomphe de 1443. D’ailleurs, une lecture précise des chroniques donne un autre son de cloche: entre la capitale méridionale et les officiers domestiques et administratifs venus de la péninsule ibérique, les relations sont complexes, teintées de xénophobie et de mauvais souvenirs laissés par l’incendie général de la ville basse et les violences des armées du Magnanime en 14236. C’est pourquoi il est utile de proposer une histoire des relations entre la ville et la cour qui s’écarte délibérément de ce qu’on pourrait qualifier d’ «histoire en mode majeur», dans laquelle la voix du pouvoir est assourdissante dans les fêtes et les célébrations monarchiques. Passons en «mode mineur», étudions la place de la cour et des curiaux dans la vie quotidienne à Naples, dans les rues, un jour banal7. Nous déambulerons des lieux institutionnels de la cour aux lieux de vie des curiaux en ville, avant de nous attacher au roi et à la manifestation de sa présence dans la capitale de son royaume italien.
FIG. 1. LA NAPLES MÉDIÉVALE DANS LES MURAILLES ANGEVINES, LES CHÂTEAUX ET LE LITTORAL ACTUEL
Source: SMURRA, 2001, p. 17.
1. LA COUR EN MIETTES: PLUSIEURS LIEUX CURIAUX EN VILLE
Naples dispose de deux résidences royales. La plus ancienne est Castel Capuano8. Édifiée sur ordre du roi normand Guillaume Ier, elle sert de 1160 à 1282, jusqu’à ce que Charles Ier d’Anjou décide la construction d’un autre château, Castelnuovo. Couramment désigné en italien par l’expression «maschio angioino» qui signifie «donjon angevin», ce château donnant sur la baie, hors des murs de la ville, manifeste par sa situation le caractère exogène de la domination politique du royaume. Une nette hiérarchisation se dessine en faveur de Castelnuovo, la plus grande et la plus récente de ces résidences, dès la période angevine précédant la conquête du Trastamare.
Pendant presque la totalité du règne d’Alphonse le Magnanime, Castelnuovo est un gigantesque chantier: Naples est conquise en 1442, mais c’est seulement en 1457 que les travaux de Castelnuovo semblent toucher à leur fin car le roi commence à y célébrer des banquets qu’il donnait jusqu’alors à proximité de l’église de l’Incoronata, près du château, dans la zone hors les murs nommée «le Correge», dont on sait qu’elle était régulièrement utilisée pour des joutes par le Magnanime comme par ses prédécesseurs9. Des considérations pratiques et stratégiques président aux travaux du château: déplacement de l’entrée, ajout de tours, adduction d’eau, creusement d’une citerne10. Il faut insister sur le fait que le château est la pièce maîtresse du dispositif de défense de la ville et sa principale garnison. En raison de l’ampleur des travaux, le nombre exact d’occupants permanents du château est impossible à établir, tant pour les civils que pour les gens d’armes. Mais il est évident qu’avec ces travaux et la double fonction du château, politique et militaire, la place a beaucoup manqué à Castelnuovo. Le châtelain lui-même, le Valencien Arnau Sanz, pourtant commandant en chef de la garnison, ne vivait pas dans le château. Il disposait à proximité immédiate d’une maison dont la location était prise en charge par le roi11. C’est un privilège très rare que celui de résider à Castelnuovo. Il est accordé en 1457 à l’humaniste lombard Pier Candido Decembrio, avec le titre honorifique de secrétaire royal et une pension viagere12. Le cas de Decembrio est unique et certainement une marque de considération extraordinaire.
Le manque de place, conjugué aux désagréments causés par les travaux, peut se lire en creux dans les nombreuses délocalisations dans Naples des organes de l’administration et des conseils, comme on le verra plus loin. Même les écuries sont concernées par cette logique d’externalisation, puisqu’en mai 1446 le trésorier Guillem Pujades note dans ses comptes qu’il retient 54 ducats pour le loyer de deux maisons de la rua catalana, où se trouvent une partie des chevaux du roi13. Cette «rue catalane» se trouve à proximité de Castelnuovo mais à l’intérieur des murailles, c’est la première à droite après avoir franchi la porte de la ville la plus proche du château. De nombreuses auberges s’y trouvent car c’est généralement par là qu’on entre dans Naples en arrivant de Rome. La zone devait regorger d’écuries.
L’externalisation concerne aussi les différentes administrations qui assurent le gouvernement des États du Magnanime, à commencer par les deux emblématiques institutions de la Vicaria et de la Sommaria. La Vicaria est la cour d’appel du royaume de Naples (Regno). Cette institution d’origine angevine est maintenue sous les Trastamare. En octobre 1453, les registres du trésorier Matteu Pujades mentionnent un paiement au majordome Alfonso d’Avalos pour une maison que le roi lui achète près de l’église San Gregorio (à la limite entre les sieges Capuano et Montagna, voir Figure 2) afin d’y installer la Vicaria14. L’importante activité de cet organe judiciaire essentiel du Regno est donc délocalisée au cœur de la ville, à l’instar de ce qui a eu lieu avec la Sommaria, au moins deux ans plus tôt. La Sommaria révise les comptes des officiers et ses attributions judiciaires lui permettent de poursuivre ceux qui rendent des comptes fautifs ou frauduleux. Elle juge aussi les litiges relatifs à l’administration des finances du Regno. Installée depuis 1451 dans une maison près de Santa Maria Maggiore15, elle est déplacée près du centre du siège Nido en mars 1456 (voir Figure 4). C’est l’enregistrement de son loyer de 80 ducats par an qui nous renseigne sur sa localisation dans la capitale à cette date. De plus, on apprend à cette occasion que la maison en question abrite le dépôt de draps de la garde-robe16. Le mois suivant, le roi achète la maison, pour 3000 ducats. Cet achat témoigne de la nécessité pérenne d’installer hors des murs des résidences royales des activités nécessitant de l’espace pour fonctionner ou des capacités de stockage.
FIG. 2. LES SIÈGES, CIRCONSCRIPTIONS MUNICIPALES DE NAPLES, ET LE TRACÉ DES MURAILLES ANGEVINES
Source: ã de l’auteur.
Pendant le règne du Magnanime, le principal pôle d’externalisation de fonctions politiques ou subalternes (stockage) est l’arsenal, à droite du môle qui se trouve au pied de Castelnuovo et que l’on distingue sur la Figure 2. Cet arsenal a d’ailleurs bénéficié de nombreux travaux et agrandissements. Sa proximité avec Castelnuovo et la rua catalana fait de ce vaste espace une sorte d’annexe du château, notamment un lieu de stockage: on y entrepose par exemple des tables utilisées pour un banquet à Castelnuovo en 145617. En 1466, le fils du Magnanime en fait sortir une centaine de lances à l’occasion d’une joute18. Mais l’arsenal n’est pas qu’un dépôt du château. Il est surtout un lieu fréquenté par les officiers curiaux et les membres de l’administration de la couronne. Il a abrité la scrivania de ració jusqu’en 1466, date à laquelle elle est déplacée en ville, vers une maison du secrétaire Diomede Carafa dans le siège Nido. Cette scrivania de ració est la structure de l’hôtel royal en charge des paiements des quitacions (salaires) de la totalité du personnel domestique ou assimilé, ordonnés par le biais d’ordres écrits, les albarans de quitació ou les albarans de vestir selon que le paiement a lieu en numéraire ou en nature19. Compte tenu de la centralité de l’administration financiere dans la vie curiale, en raison aussi des fréquentes allées et venues qu’elle génère, on peut considérer que l’arsenal est l’un des lieux essentiels du travail et de la sociabilité curiale. Il faut donc se représenter un va-et-vient permanent entre Castelnuovo et l’arsenal: un flux d’officiers de l’hôtel royal, d’objets encombrants, mais aussi les parcours des officiers vers le cœur de la ville et le siège Nido, après qu’on y a installé le dépôt d’étoffes de la garde-robe royale, pour les paiements sous forme de coupons de drap. De plus, sa localisation au débouché immédiat du môle assure à l’arsenal la fréquentation de tous les marchands et hommes d’affaires arrivant à Naples, dont beaucoup en provenance de la couronne d’Aragon ont des liens familiaux avec les officiers du trésor royal20.
En plus d’abriter la scrivania de ració, l’arsenal semble avoir servi de quartier de logements pour certains des officiers royaux, dont le trésorier Guillem Pujades. En 1456, les envoyés de la Generalitat de Catalogne Bernat Fiveller et Pere Joan de Sant-Climent, ainsi que l’envoyé à Naples des Corts de Catalogne, Pere Dusay, sont accueillis à l’arsenal par Guillem Pujades. Le trésorier est alors coordonnateur des préparatifs que le Magnanime ordonne pour la croisade contre les Turcs et il héberge à l’arsenal Pere Dusay21.
FIG. 3. LA ZONE DE L’ARSENAL À NAPLES
Il faut ajouter à ce dossier sur la dispersion des lieux curiaux dans Naples le fait que le roi quitte régulièrement la ville pour Torre del Greco, située à quelques kilomètres dans la baie. À partir de 1448, le roi a une maîtresse, la napolitaine Lucrèce d’Alagno, installée par ses soins dans la rocca (la forteresse) qui donne son nom à la petite agglomération maritime. Alphonse passe un temps considérable à Torre del Greco, entre un tiers et la moitié de l’année durant la décennie de liaison notoire des amants, de 1448 à la mort du roi en juin 1458. D’après les récits des ambassadeurs qui fréquentent alors la cour napolitaine, le roi fait de nombreux aller-retour entre Naples et Torre del Greco, souvent dans la journée22. On doit donc logiquement considérer qu’une partie du personnel domestique du Magnanime y était à demeure. De plus, les témoignages d’ambassadeurs permettent d’établir que des membres du conseil royal se rendent quotidiennement à Torre del Greco. En septembre 1451, l’ambassadeur catalan Antoni Vinyes note avec préoccupation que le gouverneur de Catalogne Bernat de Requesens, ennemi politique de sa faction, a même loué un logement à Torre del Greco:
Monseigneur Requesens a loué une baraque ou grange à Torre del Greco, et il n’en bouge ni le jour ni la nuit. Pour cette raison, je dois y aller plus souvent qu’autrement, afin de lutter contre son influence dans l’esprit du roi23.
En attribuant à Requesens une «baraque ou grange», il signale aussi que le gouverneur est prêt à s’avilir par un logement indigne pour faire le siège du roi. Cette observation donne également une idée de la pression foncière engendrée par la décision du Magnanime de faire de la demeure de Torre del Greco une résidence royale très fréquentée. Le moindre logement de la petite agglomération devait alors être investi par les officiers domestiques. Les répercussions des séjours royaux à Torre del Greco sont importantes pour les officiers et les membres de la société curiale contraints à de nombreux déplacements entre ce lieu et leurs lieux habituels de vie et de travail dans Naples.
La conjonction des contraintes matérielles subies par la cour aragonaise à Naples et des décisions du roi conduit à un émiettement autour de Castelnuovo, en ville et dans la baie de Naples, des lieux curiaux. Cette dispersion est une caractéristique essentielle des conditions de service des officiers domestiques ou administratifs.
2. LES CURIAUX EN VILLE
Une importante majorité des hommes au service d’Alphonse le Magnanime sont arrivés avec lui en Italie, pendant l’une ou l’autre des campagnes de conquête, entre 1432 et 1442. Entre les hommes d’armes, les officiers de l’hôtel, les membres des conseils et de l’administration royale, il s’agit de plusieurs milliers de personnes. La conquête est allée de pair avec l’arrivée dans la capitale de tous ces étrangers, les «Catalans», comme les Napolitains les nomment sans s’embarrasser de détails, qu’il a fallu loger alors que le conflit avec les Angevins avait ravagé la ville. Parmi les éléments cruciaux de la culture matérielle et de la vie quotidienne en ville, on compte le logement et la question de la citoyenneté urbaine –avec son incidence sur les impôts dont on est redevable. Dans la Naples du XVe siècle, l’espace enclos par les murailles (voir Figures 1 et 3) n’est pas totalement urbanisé, il reste des aires d’habitat moins dense dans la ville basse, c’est-à-dire en direction du littoral. Sur le plan administratif, la ville est découpée en cinq circonscriptions principales, les seggi, c’est-à-dire les sièges. Le mot seggio désigne à la fois l’ensemble du territoire et la loggia qui sert d’expression monumentale à son identité politique. Chaque siège envoie un représentant au conseil de gouvernement municipal de Naples, appelé Tribunale San Lorenzo, du nom de l’église où ce conseil se réunit. De la même façon que l’espace intramuros n’est pas entièrement bâti, il n’est pas non plus entièrement réparti entre les cinq sièges: deux zones hors sièges se trouvent dans la ville basse, l’une à proximité de Castelnuovo et l’autre correspondant au marché24. Les habitants de ces espaces sont, de fait, privés de toute représentation politique.
Dans ce contexte, il faut distinguer entre trois statuts politiques des résidents de la capitale:
• les simples résidents;
• les citoyens napolitains;
• les citoyens napolitains membres des sièges.
Ces trois statuts correspondent à trois degrés de privilèges:
• les simples résidents sont exclus de toute forme de privilèges urbains;
• les citoyens napolitains sont exemptés de toute la fiscalité directe et d’une partie de la fiscalité indirecte sur les denrées alimentaires. Ils ont cependant un représentant, l’élu du Peuple, au Tribunale San Lorenzo, qui compte donc six membres.
• Les citoyens membres des sieges, eux, cumulent cet avantage fiscal et la participation effective au gouvernement urbain. Ils sont susceptibles d’être choisis dans le cadre de leur siège pour y exercer annuellement des fonctions locales et peuvent être désignés comme représentants de leur siège au Tribunale San Lorenzo.
L’appartenance aux sièges peut être acquise de naissance si l’on appartient à une famille dont les hommes sont déjà membres. Sinon, la procédure d’agrégation à un siège conjugue, selon les statuts qui peuvent varier entre les sièges, une démarche de cooptation prenant en compte le statut matrimonial (il faut épouser une femme originaire d’une famille de membres du siège) et le critère résidentiel: il faut évidemment résider dans le territoire du seggio auquel on veut appartenir. Ce paysage administratif et social est complexifié par le fait que deux des cinq sieges sont réputés nobles, ceux de Nido et Capuano. Leurs territoires correspondent à une grande partie de la ville haute, qui est de fait un territoire aristocratique. L’accès à un logement ou à la propriété foncière à Naples détermine donc l’accès à la représentation politique et à une forme de noblesse urbaine caractéristique de certaines villes italiennes (le cas de Venise est mieux connu, quoique différent). L’organisation sociologique de Naples suit donc son profil topographique, avec les élites locales dans la ville haute et, au fur et à mesure qu’on descend vers le rivage, une proportion plus forte de peuplement de niveau socio-économique modeste, avec une large part d’étrangers simples résidents. De façon assez attendue, les hommes du roi peinent à accéder à la ville haute et particulièrement aux sièges nobles.
Les quelques officiers du Magnanime qui parviennent à acquérir des résidences dans la ville haute sont davantage des proches du roi que des individus qui se définiraient socialement par leur office dans l’hôtel royal. Le majordome Alfonso d’Avalos, dont la maison située près du siège noble de Capuano sert à installer la Vicaria, a déjà été évoqué. Alfonso est le frère cadet du grand sénéchal Iñigo d’Avalos qui avait réussi à acquérir la maison près de Santa Maria Maggiore ayant servi à l’installation de la Sommaria. Les freres d’Avalos sont les fils du connétable de Castille Ruy López d’Avalos (ou Dávalos selon la graphie castillane), fidele soutien de la politique de puissance de Ferdinand de Trastamare et de ses fils25. Le connétable est exilé sans remède en 1423 pour avoir soutenu le coup de Tordesillas, et à partir de cette date, ses fils sont de toutes les entreprises d’Alphonse le Magnanime. Les frères d’Avalos, omniprésents dans les récits des ambassadeurs, représentent ce qui s’approche le plus d’amis d’enfance pour lui. Leur service et dévouement constants leur valent d’ailleurs d’être les seuls officiers d’origine ibérique arrivés dans le royaume de Naples à recevoir des fiefs en Italie et des offices italiens de tres haut niveau (la fonction de grand connétable d’Ifíigo)26. Leur neveu, le grand sénéchal Iñigo de Guevara, semble également résider dans le ressort du siège Capuano: un ambassadeur qui assiste à la messe à San Giovanni a Carbonara, au Nord-Est de Naples, l’y rencontre27.
Le siège aristocratique Nido accueille en 1450 l’humaniste sicilien Antonio Beccadelli, dit le Panormitain, secrétaire du Magnanime. Beccadelli souhaite clairement accéder au statut social de membre d’un siège noble: il épouse en 1446 une femme issue d’un lignage du seggio Capuano, avant d’obtenir du roi la citoyenneté napolitaine en 1450 et d’être accepté dans le seggio Nido28. Autre Sicilien, le vice-chancelier Battista Platamone installe sa famille dans une maison de la place qui donne son nom au siège Nido, tout comme le juriste aragonais Valenti Claver, membre éminent du conseil royal29. Le secrétaire valencien Joan Olzina possède, lui, plusieurs maisons et terrains près du siège Nido, qu’il a obtenus sur ordre du roi: en 1455 le Magnanime a ordonné aux dominicains de San Domenico Maggiore de vendre ces parcelles à son secrétaire30. Ces efforts pour s’implanter dans la ville haute témoignent de l’importance symbolique de l’accession à la propriété dans cet espace aristocratique. Les interventions du roi en faveur de ses officiers traduisent aussi les résistances de la société locale à ces transactions et à ces implantations.
D’autres personnalités curiales, peut-être moins déterminées à s’implanter durablement et à faire souche à Naples, s’installent dans le ressort de sièges inférieurs en prestige. Antoni Olzina, neveu du secrétaire Joan Olzina et scrivà de ració de l’hôtel du Magnanime, est installé au siège Portanuova, et le chancelier Arnau Roger de Pallars au siège du port, près de San Giovanni Maggiore31. L’hypothèse logique pour l’écrasante majorité des officiers royaux issus de la couronne d’Aragon est qu’ils se sont installés dans la ville basse, hors des circonscriptions des sièges (cf. Figure 3): dans ces zones plus populaires, ils ne sont pas en butte à la résistance des élites accédant à la représentation politique municipale. En effet, l’espace enclos dans les murailles, mais hors de la juridiction des sièges, appartient au domaine royal. Il présente aussi l’avantage de se trouver à proximité du port, du château, de la zone de l’arsenal et de la rua catalana, déjà évoquée, avec ses auberges et ses écuries. D’ailleurs, le roi prend des initiatives pour urbaniser la zone du marché, puisqu’il y a les coudées franches. Le 16 octobre 1450, le châtelain de Castelnuovo, Arnau Sanz, reçoit un privilège l’autorisant à construire des bâtiments dotés de portiques sur la place du marché pour y installer des boutiques et des logements32.
On constate surtout, grâce aux listes de locataires des institutions monastiques que de nombreux Catalans ont colonisé les quartiers extérieurs au territoire des sièges à partir des années 144033. Les sœurs dominicaines de San Sebastiano e Pietro, elles, ont dix-sept locataires «catalans» entre 1442 et 1469, dont la plupart louent une maison et une boutique ou bien encore des auberges34. Les artisans qui leur louent des boutiques sont des maîtres travaillant le bois ou le métal, tous susceptibles d’être arrivés en Italie avec les armées du Magnanime. Les propriétés des sœurs sont toutes situées autour de la place de l’église San Pietro Martire, où le Magnanime décide d’installer la nécropole des Trastamare à Naples. Dans les registres locatifs des ermites de saint Augustin (Sant’Agostino Maggiore) on trouve douze «Catalans» entre 1452 et 1469, sur les quatre-vingt-deux locataires. Les propriétés des ermites sont dispersées entre la place du marché et la rua catalana. On observe, significativement, que pendant le règne du Magnanime, la totalité des auberges que possède Sant’Agostino Maggiore sont confiées à des Catalans35. Ils jouent logiquement un rôle de brokers, de facilitateurs, dans les affaires que les nouveaux arrivants à Naples veulent faire avec la cour ou le milieu commercial. La part des officiers royaux, du milieu curial à proprement parler, parmi les Catalans de la ville basse, est impossible à déterminer, mais ils devaient représenter, avec les marchands étrangers, l’élite de la société cosmopolite de la ville basse, entre la place du marché et ses chantiers de construction, et la rua catalana.
3. LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE GEOGRAPHIE SYMBOLIQUE DU POUVOIR A NAPLES
L’appartenance à l’hôtel royal est génératrice d’identité et de sociabilités qui participent de la sociologie urbaine. Par exemple, certains fournisseurs ou artisans agrégés à l’hôtel du roi reçoivent le privilège d’utiliser des enseignes les signalant comme tels. Le peintre Jacomart, à son retour de Naples à Valence en 1451, obtient le privilège d’utiliser à Valence une enseigne aux armes royales36. Sous le regne du fils du Magnanime, l’achat d’une enseigne de ce type est même pris en charge par le roi lui-même, pour son chausseur Pietro Catalano37. La manifestation des liens avec le roi et la cour construit un marquage visuel de l’espace urbain, et a évidemment des retombées économiques significatives pour ces artisans. Autre élément de repérage visuel de l’identité curiale et de sa présence en ville, l’usage de la livrée ou du moins des couleurs et de l’emblématique du roi dans le vêtement des officiers de l’hôtel. Aucun terme spécifique équivalant au français «livrée» n’apparaît dans la documentation, mais certaines commandes textiles d’Alphonse le Magnanime sont sans ambigüité. En 1441, il demande à son tailleur Anne de Clèves des tenues identiques pour ses pages «et d’autres de son hôtel38». Le libre de notaments du trésorier Matteu Pujades, pour la période d’août et septembre 1446, permet de suivre étape par étape, à travers les paiements, la réalisation de pourpoints et de tabards pour les pages du roi39. Le 21 août 1446, le trésorier achète pour 78 ducats de velours rouge à un marchand génois pour les tabards40; 25 ducats au brodeur Antonello dello Perrino le 27 août41; 15 ducats au brodeur Pere Daus le 31 août42; 20 ducats de drap blanc de Perpignan acheté à Coluccio d’Afflito le 4 septembre, pour faire des crevés aux tabards des pages43; le même jour, les tissus sont cardés par Pere Frances44; puis de nouveaux paiements sont faits aux brodeurs les 9 et 13 septembre45.
La présence dans l’espace urbain de signes marquant l’appartenance des hommes au roi est seulement l’un des facteurs de l’élaboration d’une géographie manifestant la présence du pouvoir royal en ville. Dans le cas de la Naples du Magnanime, le spectacle royal et les monuments monarchiques sont intrinsèquement liés à l’histoire de la présence de la communauté catalane à Naples. En effet, on a vu plus haut que la nécropole royale des Trastamare fondée par Alphonse le Magnanime dans la capitale italienne se trouve dans l’église dominicaine de San Pietro martire. Cette humble église est située dans la ville basse, et de nombreux locataires catalans évoqués précédemment sont installés à proximité immédiate. Son frère Pedro, tué en 1436 lors du siège de Naples, y est enseveli en grande pompe en 1445. Isabella di Chiaromonte, première épouse de son fils Ferrante, rejoint cette nécropole en 1465. C’est un lieu modeste, par rapport aux principaux lieux de culte de Naples précédemment liés à la monarchie angevine: l’église des franciscains de Santa Chiara, la cathédrale, l’église San Giovanni a Carbonara. Mais la petite église de San Pietro martire a retenu l’attention du Magnanime pour plusieurs raisons: depuis le XIIIe siècle au moins (ses origines ne sont pas documentées), elle abrite une chapelle des Catalans46. Comme dans les autres grandes escales marchandes méditerranéennes, les nations commerçantes disposent de ce type de fondations, gérées par la communauté, qui permettent de répondre aux besoins spirituels des voyageurs et de socialiser à toutes fins utiles avec des compatriotes. Malgré sa localisation dans un espace à la dignité relativement faible dans la socio-topographie napolitaine du XVe siècle, San Pietro martire ancre la royauté Trastamare dans un espace proche du château et permet aussi l’affirmation d’un lien fort avec la communauté marchande catalane de la ville et avec la couronne d’Aragon.
Par ailleurs, il s’agit d’une église associée à une fondation dominicaine, convenant particulièrement à la stratégie religieuse du Magnanime en Italie, qui met en avant ses liens avec les frères prêcheurs pour mieux se démarquer de la dynastie angevine revendiquant des liens étroits avec les franciscains et qui a exploité politiquement la figure familiale de saint Louis de Toulouse. Depuis l’élection de Ferdinand de Trastamare à la couronne d’Aragon, la dynastie est en quelque sorte débitrice de l’ordre des prêcheurs à travers l’un de ses plus fameux représentants, le Valencien Vincent Ferrier. Sa renommée de prédicateur lui a conféré une autorité morale se manifestant entre autres par le fait qu’il a voté le premier parmi les neuf membres de la commission. En se prononçant pour le Trastamare, le dominicain a pesé fortement sur l’élection, qu’il a d’ailleurs proclamée en personne. La canonisation de Vincent Ferrier, en 1455, est saluée à Naples par une procession et son culte est très clairement limité aux personnes originaires de la couronne d’Aragon car les chroniques napolitaines ignorent totalement l’événement célébré à la cour. Un retable représentant le saint est commandé à Colantonio; il ornait l’autel d’une chapelle qui lui était dédiée dans l’église San Pietro martire, précisément47. Dans la chapelle des Catalans se rejoignent la communication monarchique et l’une des principales structures de la sociabilité catalane à Naples.
FIG. 4. SAN PIETRO MARTIRE, ICONOGRAPHIE ET LOCALISATION
La zone comprise entre Castelnuovo et la place du marché, avec San Pietro martire entre les deux, est l’espace où la présence de la cour d’un souverain d’origine étrangère à Naples doit, selon toute logique, être la plus sensible: on y voit les couleurs et emblématique royales sur les tenues, les enseignes et les armes, on y entend parler catalan et aragonais. On pourrait d’ailleurs proposer de considérer la ville basse comme la ville curiale, par opposition avec la ville haute, espace aristocratique autochtone, lui tournant le dos. Malgré cette discontinuité essentielle qui organise l’expérience urbaine à Naples sous le règne du Magnanime, certaines des pratiques de ce roi contribuent cependant à faire en sorte qu’il parcoure sa capitale de façon relativement équitable. Ses sujets pouvaient le voir régulièrement en ville, circulant dans les rues et assistant aux offices. En effet, on peut reconstituer, grâce à la documentation financiere, les lieux ou le roi entend la messe. Son chambellan Pedro de Cardona procède systématiquement, à ces occasions, à des aumônes au nom du roi, qui sont reportées dans la documentation financiere. Pedro de Cardona avance les sommes, puis est défrayé. Les comptes montrent (pour les brèves périodes couvertes par les registres de Guillem Pujades en 1442 et 1446) que le roi fait environ tous les deux ou trois jours une offrande à l’une des églises de Naples ou il a assisté à l’office, souvent des monasteres48. Ainsi, entre le 28 juillet 1446 et le 4 septembre, Alphonse assiste à la messe à Castelnuovo, dans la chapelle Santa Barbara, à trois reprises, et quatorze fois dans des églises de la ville, d’après les remboursements effectués par le trésor au chambellan Pedro de Cardona49. Le roi visite, dans l’ordre: l’église Santa Marta, le monastère Santa Maria Egiziaca (deux fois de suite), le monastère San Domenico, le monastère Santo Gallucio, le monastère San Sebastiano, le monastère Sant’Eugerio, le monastère San Lorenzo, le monastère Santa Chiara, le monastère Santa Maria del Carmine, l’église Sant’Eligio, l’église Santa Maria donna Regina, l’église San Giorgio, l’église Sant’Agostino [alla Zecca]. Ces divers lieux de culte se répartissent dans toute la ville, sans exception. Le jour de la Saint-Dominique (le 5 août) il entend la messe à San Domenico Maggiore, de même le 10 août avec la Saint-Laurent, le 15 à Santa Maria del Carmine, le 25 à Sant’Eligio et 28 à Sant’Agostino. Les dates associées aux paiements dans les registres sont celles de leur enregistrement, et non celles des déplacements effectifs du prince, mais la comparaison de ces données avec un sanctoral permet de mettre en évidence que le roi assiste à la messe dans les églises consacrées aux saints dont c’est le jour de la fête. Ce choix lui permet d’honorer de sa présence et de ses offrandes la totalité des églises de la capitale, sans distinction ni préséance.
Par ailleurs, Alphonse met un point d’honneur à assister à la prise de voile des novices dans les monastères des lieux où il se trouve, quand il en a la possibilité. Cela s’ajoute aux déplacements dictés par le sanctoral et permet au roi de cultiver ses liens avec toutes les communautés, comme en témoigne l’enregistrement des sommes importantes offertes pour doter les novices50.
Malgré le faible nombre des témoignages documentaires de cette pratique, on peut être assuré de son caractère régulier par un passage des instructions données par le roi à ses envoyés à Rome, en mars 1444. Parmi les requêtes que les deux hommes doivent présenter au pape Eugene figure la demande suivante: Alphonse le Magnanime lui demande de renoncer à la sentence d’excommunication encourue par ses hommes et lui-même pour avoir enfreint la clôture de certaines communautés régulières du royaume de Naples (il cite notamment les clarisses napolitaines de Santa Chiara) pendant les événements de la guerre de conquête. Il demande à ses envoyés d’en appeler à sa clémence en soulignant que le roi se rend
[...] en personne pour entendre les offices divins dans tous les monasteres pour les fêtes et les célébrations en l’honneur des saints, pour les réceptions, les processions ou bénédictions de moines auxquelles il est souvent invité en raison des aumônes et des bénéfices qu’il donne à ces occasions aux dits monasteres51.
Ceci confirme que cette pratique est probablement une habitude de longue date d’Alphonse, qui doit honorer de sa présence les communautés régulières des lieux à proximité desquels il se trouve en fonction du calendrier sanctoral et des cérémonies de prononciation des vœux des moines et moniales. L’humaniste Antonio Beccadelli corrobore les dires du roi en rapportant dans son fameux recueil d’anecdotes sur le Magnanime qu’il a offert de doter toutes les femmes se destinant à devenir religieuses. D’après lui, elles arrivent chaque jour plus nombreuses, sans que le roi ne change son projet; au contraire, il se réjouit de ces vocations52.
* * *
Plusieurs phénomènes distincts et caractéristiques du règne du Magnanime émergent quand on centre l’enquête historique sur les non-événements, la banalité du quotidien. Il s’agit principalement de deux logiques, apparemment contradictoires. D’abord, une nette dynamique de requalification de la ville basse, offrant aux nouveaux venus de l’espace intramuros et des facilités juridiques pour s’installer, tend à modifier le profil socio-topographique de Naples. La ville basse n’est plus seulement un pôle économique autour du môle et des entrepôts des nations marchandes; elle accueille une partie du personnel curial et bénéficie d’un important investissement symbolique avec San Pietro martire, sa chapelle des Catalans et les sépultures des premiers Trastamare de Naples. Le roi participe pleinement à cette requalification sociale, en favorisant les chantiers dans les espaces appartenant au domaine royal et en investissant d’une dignité nouvelle la petite église dominicaine. Mais pour autant, cette évolution indéniable ne met pas un terme à la césure fondamentale entre la ville haute, aristocratique et autochtone, et une ville basse qui, malgré un prestige accru, voit son cosmopolitisme ancien se renforcer. En tout cas, l’accroissement démographique de Naples, et particulièrement le grand nombre de résidents étrangers ne bénéficiant d’aucune exemption fiscale, a assurément représenté une aubaine pour les finances municipales –ce n’est, bien súr, qu’une fraction des répercussions, en termes de consommation, de la présence de la cour en ville.
Par ailleurs, quand on s’attache à l’analyse du comportement individuel du roi, il est éclatant que l’attitude d’Alphonse le Magnanime tranche nettement avec celle des Trastamare de Castille, Jean II et Henri IV, «rois cachés». Certes, Alphonse s’absente longtemps de Naples et avec régularité, pour se rendre à Torre del Greco, à la guerre ou à la chasse. Mais quand il est dans sa capitale, il s’impose une discipline religieuse qui lui fait quitter plusieurs fois par semaine sa résidence et parcourir les rues de la ville pour se rendre à des offices ou il est visible, potentiellement, par tous ses sujets, sans afficher de préférence pour un lieu ou un ordre. Les fréquentes expéditions de chasse du roi, qui sont l’occasion de réunions nobiliaires importantes, jouent un rôle équivalent pour les élites aristocratiques du Regno: elles sont une occasion de voir le souverain, d’approcher sa personne, à défaut de lui parler. Bien sûr, les grandes festivités du règne, à commencer par le spectacle inédit du triomphe de 1443, n’ont pas été abordées ici, pour ménager de la place à ces aspects plus obscurs du règne, mais il me faut pointer que les itinéraires de ces festivités, qui parcourent Naples sans négliger aucun quartier, aucun siège, relèvent du même comportement que les visites régulières du roi dans toutes les églises, paroissiales et monastiques, de la ville. Alphonse le Magnanime, conquérant étranger en Italie, met en place une stratégie de publicité de son pouvoir fondée autant sur le spectacle régulier de sa personne que sur des célébrations fastueuses.
SOURCES EDITEES
BARONE, Nicola, «Le cedole di tesoreria dell’Archivio di Stato di Napoli dall’anno 1460 al 1504», Archivio Storico per le Province Napoletane, vol. IX et X, 1884 et 1885, pp. 5-34, pp. 205-248, pp. 387-429, pp. 601-637 et pp. 5-47 (1885).
BECCADELLI, Antonio, Dels fets e dits del gran rey Alfonso, éd. de Eulalia DURAN I GRAU, Barcelone, Barcino, 1990.
DE BOFARULL Y SANTS, Francisco (1899), «Alfonso V de Aragón en Nápoles», dans Juan VALERA (éd.), Homenaje a Menéndez y Pelayo en el año vigésimo de su profesorado, Estudios de erudición española, Madrid, Victoriano Suárez, 1899, pp. 615-635.
COMPAGNA, Anna Maria, Fonti aragonesi. Frammenti di cedole della Tesoreria (1438-1474), Albarani della Tesoreria (1414-1488), vol. 10, Naples, Accademia Pontaniana, 1979.
GARZILI, Paolo (éd.), Notar Giacomo, Cronica di Napoli, Naples, Stamperia reale, 1845.
GIANNONE, Pietro, Storia civile del Regno di Napoli, Naples, N. Naso, 1723.
GIMENO BLAY, Francisco, GOZALBO GIMENO, Daniel, TRENCHS ODENA, José, Ordinacions de la Casa i Cort de Pere el Ceremoniós, Valence, Universitat de València, 2011.
MADURELL MARIMON, Josep Maria, Mensajeros barceloneses en la corte de Nápoles de Alfonso V de Aragón, Barcelone, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1963.
MINIERI-RICCIO, Camillo, «Alcuni fatti di Alfonso I di Aragona dal 15 aprile 1437 al 31 di maggio 1458», Archivio Storico per le Province Napoletane, VI, 1881, pp. 1-36, pp. 231-258, pp. 411-461.
NAVARRO ESPINACH, Germán, IGUAL LUIS, David [éd.], La Tesorería General y los banqueros de Alfonso V El Magnánimo, Castellón de la Plana, Sociedad Castellonense de Cultura, 2002.
PIGNATELLI, Ettore, MANFREDI, Michele [éd.], I diurnali del Duca di Monteleone, Bologne, Zanichelli, 1960.
SENATORE, Francesco [éd.], Dispacci sforzeschi da Napoli, Salerne/Naples, Carlone, 1997.
SUMMONTE, Giovanni Antonio, Storia della città e del Regno di Napoli, 4 tomes, Naples, A. Bulifon, (2ème éd.), 1675.
TUTINI, Camillo, Dell’origine e fondazione de seggi di Napoli, Naples, Gessari, 1754.
BIBLIOGRAPHIE
BARRETO, Joana (2013), La Majesté en images: portraits du pouvoir dans la Naples des Aragon, Rome, École Française de Rome.
BOUCHERON, Patrick, CHIFFOLEAU (2004), Jacques, Les Palais dans la ville: espaces urbains et lieux de la puissance publique dans la Méditerranée médiévale, Lyon, Presses universitaires de Lyon.
BOUREAU, Alain (1991), «Les cérémonies royales françaises entre performance juridique et compétence liturgique», Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 46/6, pp. 1253-1264.
BRYANT, L. (1986), The King and the City in the Parisian Royal Entry Ceremony. Politics, Ritual and Art in the Renaissance, Genève.
CHILÀ, Roxane (2013), «“Il y en a plein la ville!”» Éléments pour une histoire des Catalans à Naples à partir du règne d’Alphonse le Magnanime» dans Arriver en ville, Cédric QUERTIER, Roxane CHILÀ et Nicolas PLUCHOT (éds.), Paris, Publications de la Sorbonne, pp. 145-159.
CHILÀ, Roxane (2015), «Espaces curiaux et espaces de la communication politique dans le Royaume de Naples sous le règne d’Alphonse le Magnanime (1442-1458)» dans Denis MENJOT et Léonard COURBON (éds.), La Cour et la ville dans l’Europe du Moyen Âge et des Temps Modernes, Turnhout, Brepols, pp. 105-116.
CROUZET-PAVAN, Élisabeth (2013), «Des traces invisibles: quand les sources parlent des pas et des mouvements dans la ville (Italie, fin du Moyen Âge)», dans Patrick BOUCHERON (éd.), Marquer la ville. Signes, traces, empreintes du pouvoir, Paris, Publications de la Sorbonne, pp. 231-252.
FORONDA, François (Inédite), La Privanza ou le régime de la faveur, autorité monarchique et puissance artistocratique en Castille (XIIIe-XVe siècle), thèse de doctorat dirigée par Claude GAUVARD et José Manuel NIETO SORIA, soutenue en 2003 à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne.
GENTILE, Pietro (1909), La politica interna di Alfonso V d’Aragona, Mont Cassin, Tipografia di Montecassino.
GENTILE, Pietro (1938), Lo Stato napoletano sotto Alfonso I d’Aragona, Naples, I.T.E.A.
GIESEY, Ralph E. (1987), Le Roi ne meurt jamais. Les obsèques royales dans la France de la Renaissance, Paris, Flammarion.
GUENÉE, Bernard et LEHOUX, François (1968), Les Entrées royales françaises, 1328-1515, Paris, CNRS, 2 vol.
HANLEY, Sarah (1991), Le Lit de justice des rois de France: l’idéologie constitutionnelle dans la légende, le rituel, le discours, Paris, Aubier.
JACKSON, Richard A. (1984), Vivat rex. Histoire des sacres et couronnements en France, 1364-1825, Paris, Ophrys.
KLAPISCH-ZUBER, Christiane (1985), «Rituels publics et pouvoir d’État», dans Culture et idéologie dans la genèse de l’État moderne, Rome, École française de Rome, pp. 135-144.
LECUPPRE-DESJARDINS, Élodie (2004), La Ville des cérémonies: essai sur la communication politique dans les anciens Pays-Bas bourguignons, Turnhout, Brepols.
MANGONE, Fabio (2011), Castelcapuano: da Reggia a tribunale, Naples, Massa.
MIRANDA, Armando (2011), «Dissoluzione e redistribuzione di un grande dominio feudale: il territorio dei Caldora», dans Francesco SENATORE et Francesco STORTI (éd.), Poteri, relazioni, guerra nel regno di Ferrante d’Aragona, Naples, ClioPress, pp. 67-142.
RYDER, Alan (1976), «Antonio Beccadelli: a Humanist in Government», dans Cecil CLOUGH (éd.), Cultural Aspects of the Italian Renaissance, Essays in Honour of Paul Oskar Kristeller, Manchester, Manchester University Press, pp. 123-140.
RYDER, Alan (1990), Alfonso the Magnanimous, King of Aragon, Naples and Sicily, 1396-1458, Oxford, Royaume-Uni, Clarendon Press.
RYDER, Alan (1976), The Kingdom of Naples under Alfonso the Magnanimous: the Making of a Modern State, Oxford, Clarendon Press.
SANCHIS SIVERA, Josep (1930-1931), «Pintores medievales en Valencia», Archivo de arte valenciano, vol. XVI-XVII, pp. 3-64.
SMURRA, Rosa (2001), «Una storia di ‘integrazione’ nella Napoli angioina», Ricerche di Pedagogia e Didattica, 6/1, pp. 1-36.
VITI, Paolo (1987) «Pier Candido Decembrio», Dizionario Biografico degli Jtaliani, vol. 33, Rome, Treccani, en ligne: <http://www.treccani.it/enciclopedia/pier-candido-decembrio_(Dizionario-Biografico)/>.
1. GUENÉE, LEHOUX, 1968; JACKSON, 1984; GIESEY, 1987; BRYANT, 1986; HANLEY, 1991.
2. BOUCHERON, CHIFFOLEAU, 2004; LECUPPRE DESJARDINS, 2004; CHILÀ, 2015.
3. KLAPISCH-ZUBER, 1985.
4. Ibid., p. 135; BOUREAU, 1991.
5. RYDER, 1976; ID., 1990.
6. GARZILI, Notar Giacomo, Cronica; GIANNONE, Storia civile; ANONYME, I diurnali del Duca; SUMMONTE, Storia della città e del Regno; CHILÀ, 2013.
7. Sur ce sujet, voir les propositions de CROUZET-PAVAN, 2013.
8. MANGONE, 2011.
9. Luca Amadei à la Balia de Sienne, 23 janvier 1457, F. SENATORE éd., Dispacci sforzeschi, 2007, p. 484.
10. F. DE BOFARULL Y SANTS, «Alfonso V de Aragón en Nápoles», 1899, pp. 615-635, p. 626; Archivo de la Corona de Aragón (ACA), Reg. 2736, f° 12v.º
11. C. MINIERI RICCIO, «Alcuni fatti», 1881, p. 459.
12. VITI, 1987, en ligne.
13. «se reté devers si per lo loguer de dues cases que té a la ruga cathalana en les quals han stat partida dels cavalls del Senyor Rey», NAVARRO ESPINACH, IGUAL LUIS, 2002, p. 202.
14. C. MINIERI-RICCIO, «Alcuni fatti», p. 425.
15. GENTILE, 1909, p. 46, p. 81.
16. C. MINIERI-RICCIO, «Alcuni fatti», 1884, p. 449.
17. A. M. COMPAGNA, Fonti aragonesi, 1979, p. 48.
18. N. BARONE, «Le cedole», 1881, p. 207.
19. GIMENO BLAY, GOZALBO GIMENO, TRENCHS ODENA, 2011, pp. 156-159.
20. Les Amigo ou Sellent de Catalogne par exemple.
21. «Mossen Civeller e en Pere Joan de Sant-Climent signiffiquen aturar, e pus lo seynor rey va anarsen ab e sperar fins lavors. Tots tres [Fiveller, Sant-Climent et Dusay] van, e a la Daraçana és lur major star ab en Puyades, e alii menya mossen Dusay qui nonch és sinó ab son fill e i bort, e possa a la Daraçana on en Pujades li ha feta una cambra de fust e alíi stà.» Pere Boquet aux conseillers de Barcelone, 5 mai 1456, J. M. MADURELL I MARIMON éd., Mensajeros barceloneses, p. 521.
22. Antoni Vinyes aux conseillers de Barcelone, 22 septembre et 7 octobre 1451, ibid., p. 388, p. 393.
23. «Item, lo dit mossèn de Requesens ha logada una barracha o pallar a la Torra del Grech, e nit, ni dia, no’s mou d’ella, e per ço me cové anarhi pus sovint, que no’s feria, per tenirli esment a les sues mans», Antoni Vinyes aux conseillers de Barcelone, 19 septembre 1451, ibid., p. 381.
24. SANTANGELO, 2009.
25. FORONDA, 2003, p. 46.
26. MIRANDA, 2011.
27. Alberico Maletta à Francesco Sforza, 29 août 1455, F. SENATORE éd., Dispacci sforzeschi, 2007, p. 242.
28. RYDER, 1976.
29. GENTILE, 1938, p. 11.
30. Archivio di Stato di Napoli (ASN), Corporazioni religiose soppresse, 452, San Domenico Maggiore, lettre C, f° 1r.
31. GENTILE, 1938, p. 11.
32. ACA, C, Reg. 2914, f0 102v.0: «[...] licenciam concessimus construendi seu construi faciendi aliquas domos ad latus muri dicte civitatis nostre Neapolis [...]; in dictis domibus per eum fabricandis ad latus dicti muri facere porticum sive porticos qui a recto limite parietis isparum domorum exeant versus et supra plateam dicti mercati ponitos supra columnas in dicta platea exigendas et constituendas qui portici a dicta pariete muri per palmos sexdecum parum plus vel minus se extendant super quosquidem porticos domos ipsas sublevare possit [...]».
33. ASN, Corporazioni religiose soppresse, 452, San Domenico Maggiore, lettre C, f° 1r.º
34. ASN, Corporazioni religiose soppresse, 1395-1, San Sebastiano e Pietro, f° 20r.º-131r.º
35. ASN, Corporazioni religiose sopresse, 13, Sant’Agostino Maggiore, f° 1r-76r.º
36. SANCHIS SIVERA, 1930, p. 3-64.
37. N. BARONE, «Le cedole», 1881, p. 633.
38. Archivo del Reino de Valencia (ARV), MR, 8790, f° 99r.º
39. ARV, MR, 4908, f° 35r.º-50v.º
40. Ibidem, f° 35r.º
41. Ibidem, f° 38v.º
42. Ibidem, f° 40v.º
43. Ibidem, f° 44r.º
44. Ibidem, f° 46v.º
45. Ibidem, f° 47v.º, f° 50v.º
46. ASN, Intendenza di Napoli, primo versamento, busta 744. C’est Gaetano Damiano, à l’Archivo di Stato di Napoli, qui m’a mise sur la piste de cette fondation; qu’il en soit ici chaleureusement remercié.
47. BARRETO, 2013, pp. 134-139.
48. ARV, MR, 9408, passim. La formule employée est: Item a […] del dit mes pos en data al magnifich don Pedro de Cardona camarlench del senyor rey per la offerta que feu lo dit senyor oyent missa lo present jorn que es sant […] en lo monestir / en la iglesia etc.
49. ARV, MR, 9408, f° 17v.º-57r.º
50. ARV, MR, 9408, f° 32r.º, Margarita de Sorrente et Francesca de Naples prennent le voile à San Sebastiano et reçoivent 67 ducats.
51. ACA, C, 2698 f° 47v.º-48r.º: «Item supplicaran al dit sant pare que le placia per sa bulla dispensar ab lo dit senyor que no incorrega sanciones [...] com se esdevinga lo dit S. anar personalment per hoyr los divinals officis en tos dits monastirs en les festes e solemnitats de les sants e recepcions processions o benediccions de monges a les quals sovin es invitat per les almoynes e beneficis que en tals casos fa als dits monastirs.»
52. «Virginibus vero omnibus Christi Dei verissimi sacris initiari capientibus dotem, sine qua haud recipi mos est, regem elargitum constat. Cumque essent fere innumerabiles, quae dotis spe proposita mundo renunciarent sacrasque nuptias adirent, nunquam tamen a tam liberali et religioso proposito destitisse. Immo vero quo plures ac plures sese quotidie ad sacerdotium offerrent, eo libentius atque benignius omnes excipere atque dotare consuesse.» BECCADELLI, Dels fets e dits, p. 94.