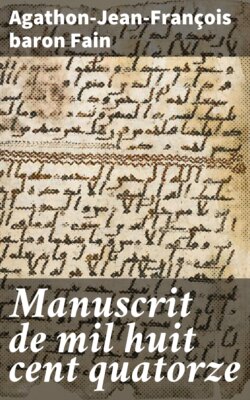Читать книгу Manuscrit de mil huit cent quatorze - Agathon-Jean-François baron Fain - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE II. PROPOSITIONS DE FRANCFORT.
Оглавление(Suite de novembre.)
Des ouvertures pour la paix venaient d'être faites.
Le 5 novembre, le prince régent d'Angleterre avait déclaré dans le parlement «qu'il n'était ni dans l'intention de l'Angleterre, ni dans celle des puissances alliées, de demander à la France aucun sacrifice incompatible avec son honneur et ses justes droits.»
Le 14 novembre, le baron de Saint-Aignan arrive à Paris, chargé par les alliés de faire des communications qui confirment ces dispositions pacifiques. M. de Saint-Aignan, écuyer de l'empereur, était dans ces derniers temps ministre de France à la cour de Weimar. Une bande de partisans l'avait enlevé de sa résidence; mais sa réputation personnelle, son alliance avec le duc de Vicence, et l'intérêt que lui portait la cour de Weimar, avaient concouru à sa délivrance. M. de Metternich avait pensé à profiter de son retour en France pour faire parvenir des propositions à Napoléon. Il avait donc appelé M. de Saint-Aignan à Francfort. Le 9 novembre, dans un entretien confidentiel, auquel assistaient M. de Nesselrode, ministre de Russie, et lord Alberdeen, ministre d'Angleterre, M. de Metternich avait posé les bases d'une pacification générale; et M. de Saint-Aignan les avait recueillies sous sa dictée. Ce sont ces bases que M. de Saint-Aignan apporte à Napoléon1.
Note 1: (retour) Les pièces de cette négociation ont été imprimées dans le numéro du Moniteur qui devait paraître le 20 janvier 1814, et qui a été retiré après l'impression. Ces pièces sont dans le supplément de la première partie.
Les alliés offraient la paix à condition que la France abandonnerait l'Allemagne, l'Espagne, la Hollande, l'Italie, et se retirerait derrière ses frontières naturelles des Alpes, des Pyrénées et du Rhin.
Après les conditions proposées à Prague quatre mois auparavant, celles-ci devaient paraître bien dures. Abandonner l'Allemagne, ce n'était que se soumettre à ce que les derniers événements de la guerre avaient à peu près décidé; abandonner l'Espagne, ce n'était que convertir en obligation formelle la disposition volontaire où l'on était déjà de céder à la résistance des Espagnols: mais renoncer à la Hollande, que nous possédions encore tout entière, et qui semblait nous offrir tant de ressources; mais abdiquer la souveraineté de l'Italie, qui était encore intacte, et dont les forces suffisaient pour faire diversion à toute la puissance autrichienne, c'étaient des sacrifices immenses, que Napoléon ne pouvait faire qu'à une paix prompte, franche, et qui préservât la France de toute invasion étrangère. Cependant ce n'était pas la cessation des hostilités qui était offerte à Napoléon pour prix de son adhésion aux bases proposées; c'était seulement l'ouverture d'une négociation. Ce point est important et mérite qu'on veuille bien y faire attention. En effet, un dernier article dicté à M. de Saint-Aignan portait que si ces bases étaient admises, on proposait d'ouvrir la négociation dans une des villes des bords du Rhin, mais que la négociation ne suspendrait pas les opérations militaires. Ainsi Napoléon, en renonçant à l'Allemagne et à l'Espagne, en détachant de sa cause la Hollande et toute l'Italie, n'obtenait pas même la certitude de préserver la France d'une invasion; la paix définitive n'en restait pas moins incertaine et flottante dans l'avenir des opérations militaires.
Ces propositions, apportées par M. de Saint-Aignan, étaient donc non seulement dures et humiliantes, mais encore d'une franchise suspecte. Cependant on ne les rejette pas.
Le 16 novembre, M. le duc de Bassano écrit à M. de Metternich qu'une paix qui aura pour base l'indépendance de toutes les nations, tant sous le point de vue continental que sous le point de vue maritime, est l'objet constant des voeux et de la politique de Napoléon, et qu'il accepte la réunion d'un congrès à Manheim.
Mais à Francfort on ne trouve pas que cette réponse soit assez précise. M. de Metternich répond qu'on ne pourra négocier que lorsqu'on saura avec plus de certitude que le cabinet des Tuileries admet les bases précédemment communiquées.
Voilà donc le mois de novembre perdu en préliminaires! Certains salons de Paris veulent en rejeter tout le blâme sur le duc de Bassano: on l'accuse d'avoir répondu à Francfort d'une manière trop vague, et l'on affecte de désespérer du succès de toute négociation tant que ce ministre restera aux affaires étrangères. Ceci tient à des intrigues qui commençaient à agiter la haute société, et qui n'ont eu que trop d'influence sur les événements de 1814.
Quel que fût le crédit personnel du duc de Bassano, il n'allait pas jusqu'à résoudre des difficultés d'une nature aussi grave; et dans de telles circonstances, l'opinion du ministre devait toujours céder à la détermination d'un prince «qui se servait des hommes de mérite sans les associer à son autorité, qui leur demandait plus d'obéissance que de conseils2,» et dont tout le monde célèbre ou blâme l'immuable volonté. Le duc de Bassano, «distingué par son mérite non moins que par son intégrité, joignait à une fidélité incorruptible l'heureux talent d'ôter à la vérité ce qu'elle avait de désagréable, sans jamais la déguiser3.» De son côté, Napoléon, loin de craindre la vérité, l'attirait à lui par les voies les plus contradictoires, et par les correspondances les plus confidentielles. On ne pouvait lui rien cacher; on ne lui cachait rien.
Note 2: (retour) Duclos.
Note 3: (retour)3 Portrait du ministre de Julien, par Gibbon, tome IV, chap. xix, pag. 351.
Napoléon n'ignore pas que c'est contre sa personne que se dirigent les censures qui semblent ne s'adresser qu'à son ministre; mais, dédaignant d'approfondir les secrètes intentions des frondeurs, et ne voulant y voir que les préventions d'un parti qu'on peut ménager, il croit devoir y céder, et, par cette concession faite au retour de la confiance, il prélude aux concessions plus importantes qu'il veut faire à la pacification générale. Le 20 novembre, il rappelle le duc de Bassano au ministère de la secrétairerie-d'état, et, dans le choix de celui qui le remplace aux affaires étrangères, il donne une nouvelle preuve de ses intentions conciliantes. Le duc de Vicence a mérité, dans sa brillante ambassade de Pétersbourg, l'estime de l'empereur Alexandre; c'est lui que l'empereur Alexandre et l'empereur d'Autriche semblent demander pour négociateur; c'est à lui que Napoléon croit devoir confier son portefeuille des relations extérieures.
Le nouveau ministre est chargé de rassurer entièrement les alliés sur les dispositions pacifiques de Napoléon. Le 2 décembre, il écrit à M. de Metternich que Napoléon adhère très positivement aux bases générales et sommaires communiquées par M. de Saint-Aignan.
Le corps législatif était convoqué pour le 2 décembre; on l'ajourne au 19, dans l'espérance qu'à cette époque tous les délais préliminaires seront épuisés, et même que le congrès de Manheim sera ouvert: mais douze jours s'écoulent sans que la négociation fasse aucun progrès. On reçoit enfin une lettre de M. de Metternich; elle est du 10 décembre, et contient la nouvelle inattendue que les alliés ont jugé à propos de consulter l'Angleterre, et que leur décision dépend de sa réponse.
La gazette de Francfort, du 7 décembre, avait déjà publié une proclamation datée du 1er, qui aurait dû faire pressentir un changement dans les intentions des alliés. On y faisait sérieusement un crime à Napoléon des levées d'hommes qui avaient lieu dans toute la France: parce que les souverains du Nord avaient parlé de paix, il semblait que le gouvernement français n'eût plus de dispositions défensives à prendre. A la suite de ces récriminations peu pacifiques, les alliés promettaient ironiquement à la France de ne mettre bas les armes qu'après avoir abattu sa prépondérance.
L'espoir d'une négociation franche et loyale s'affaiblissait donc de plus en plus.
Le jour fixé définitivement pour l'ouverture du corps législatif arrive..., et, dans son discours d'ouverture, Napoléon n'a rien à dire sur la négociation qui est le sujet de l'attente générale, si ce n'est que «rien ne s'oppose de sa part au rétablissement de la paix.»