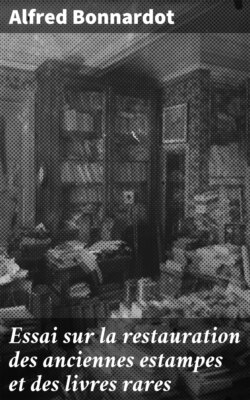Читать книгу Essai sur la restauration des anciennes estampes et des livres rares - Alfred Bonnardot - Страница 5
ОглавлениеCHAPITRE II. — BLANCHIMENT DES ESTAMPES.
Un simple bain à l’eau froide suffit souvent au bout de 24 heures pour désenfumer et éclaircir une vieille estampe; mais lorsque après 2 ou 3 jours de mouillage elle parait encore d’une teinte trop foncée et nuisible aux effets du burin, on peut, pour la blanchir, ou mieux pour l’éclaircir suffisamment, avoir recours à deux substances chimiques qui ont la propriété de désenfumer en peu de temps les estampes les plus foncées (), pourvu que cette teinte soit occasionnée, comme il arrive ordinairement, par l’action de l’hydrogène sulfuré qui se rencontre dans l’air. Ces liquides sont: 1° le deutoxyde d’hydrogène, ou eau oxygénée; 2° le gaz chlore dissout dans l’eau, ou les composés de chlore et d’oxydes alcalins. Je pourrais ajouter l’action du soleil sur le papier mouillé, procédé mis en usage pour le blanchiment des toiles, et qui certainement réussirait également sur le papier; mais il est fort lent. J’en reparlerai dans une autre occasion. (Voyez chap. IV, Taches d’huile.)
Deutoxyde d’hydrogène. — C’est un liquide dont la préparation est très compliquée et la conservation difficile. M. Thénard, qui l’a découvert, en parle très longuement dans le second volume de son Cours de chimie. On ne le trouve jamais tout préparé chez les plus fameux fabricants de produits chimiques, tels que Quesneville et Rousseau, de sorte que le prix pour une petite quantité reviendrait fort cher. J’en aurais cependant fait l’essai, si je n’avais été convaincu, après la lecture du travail fondé sur les expériences du célèbre chimiste, que ce liquide peut être remplacé par des substances bien moins coûteuses, surtout plus faciles à conserver. Je signalerai certains cas où son usage pourrait être tenté, s’il s’agissait d’estampes de grand prix.
Gaz chlore dissout dans l’eau. — Les propriétés du chlore en dissolution sont aujourd’hui très connues. On verra à l’article décoloriage de quelle manière il agit sur les couleurs végétales et autres. Je connais un célèbre collecteur d’estampes qui depuis trente ans, m’a-t-il dit, se sert de chlore assez concentré () pour blanchir. — Or ses estampes, d’une parfaite conservation y semblent donner à son système une grande autorité ; le fait est que le chlore blanchit au degré qu’on veut les estampes, sans altérer le moins du monde l’encre d’impression, même à l’état de concentration, même au bout de vingt-quatre heures. Je n’oserais néanmoins en conseiller l’usage, surtout à l’état gazeux, qu’avec beaucoup de réserve, car on lit à ce sujet dans le Cours de chimie du professeur Dumas (tom. IV, p. 44), a propos de la fabrication du papier: «Les chiffons fins doivent être blanchis au chlorure de chaux liquide, et non au chlore gazeux: ils sont bien moins altérés et donnent un papier plus nerveux et moins cassant. Il faut laver les papiers avec attention, car le chlore qu’ils retiennent se convertit bientôt en acide chlorhydrique, qui détruit peu à peu la fibre du papier.»
Il faut user avec la même circonspection de la dissolution concentrée de chlore. Quand on l’emploie mêlé à dix à douze fois son volume d’eau, il ne peut y avoir aucun danger, surtout si on retrempe ensuite l’estampe pendant douze heures dans l’eau pure. Le chlore à froid, avec ces proportions d’eau, décompose assez rapidement la teinte foncée des estampes, pourvu que cette teinte n’ait pas pour origine un corps huileux ou certaines couleurs minérales. La préparation, chez soi, du chlore liquide, est très facile, mais fort désagréable, a cause de son odeur très pénétrante, qui altère les papiers de tenture et dépolit plusieurs métaux. Le mieux est de se le procurer tout fait, à raison de 50 cent. environ le litre, chez les marchands de produits chimiques cités ci-dessus. On doit le conserver dans un flacon à bouchon de verre fermant hermétiquement, et coller sur le flacon une feuille d’étain, car le chlore liquide se décompose rapidement par la lumière, même très faible.
Quand on verse le chlore dans la bassine, il faut opérer près d’une cheminée allumée ou en plein air. On peut couvrir la bassine d’une toile cirée pour retarder l’évaporation du gaz, ou mieux encore, imiter l’opération usitée pour le blanchiment des toiles; jeter dans la bassine quelques morceaux de craie (carbonate de chaux), qui neutralise la vapeur du chlore sans diminuer en rien sa puissance; ou enfin, ce qui revient à peu près au même, on emploiera le liquide suivant.
Chlorure de chaux. — Les Anglais blanchissent depuis long-temps leurs toiles au chlorure de chaux liquide. On blanchit chez nous, par le même procédé, des papiers dont on n’a pas toujours lieu de se féliciter, sans doute parce qu’il y a abus. Le chlorure de chaux s’achète en poudre fine et séche, ou sous forme d’une masse blanchâtre et pâteuse (à cause de l’humidité qu’elle attire); du reste il coûte bon marché : pour 50 cent. on a de quoi éclaircir bien des gravures. On met 50 grammes de cette pâte dans un grand flacon qu’on remplit d’eau; on agite fortement, et quand le liquide est éclairci et l’excédant de la matière déposé au fond du vase, on le verse dans la bassine, à demi remplie d’eau, ayant soin de s’arrêter quand la dissolution commence à se troubler. On délaie le résidu dans une nouvelle quantité d’eau qu’on réserve pour une autre occasion. On recommencera ce délayage jusqu’à ce que le chlorure ait perdu toute sa force. Les premières eaux chargées de chlorure sont naturellement les plus concentrées; aussi les faut-il mêler à douze ou quinze fois leur volume d’eau pure dans la bassine. Il vaut mieux risquer d’être obligé d’en ajouter que d’en mettre un excès.
L’eau tenant en dissolution cette quantité de chlorure n’altère nullement, même après un long séjour, le noir d’impression; mais, selon l’opinion d’un habile préparateur de chimie, plus concentrée, elle rendrait au bout de quelques mois le papier cassant. Il faut surveiller l’opération et retirer l’estampe dès qu’on la trouve suffisamment éclaircie. On se méfiera donc du chlorure, ainsi que du chlore, comme d’un ennemi perfide, et on l’emploiera à l’état le plus faible possible, mais assez fort pour obtenir l’effet désiré. Cependant il est des cas que je citerai à l’article décoloriage, où il faut le faire agir à l’état assez concentré ; mais en même temps j’indiquerai les moyens de prévenir probablement ses ravages ultérieurs, en cas que le fait soit positif. On doit absolument, si l’on ne préfère essayer l’eau oxygénée, recourir au chlorure de chaux pour les estampes enfumées au point d’être presque indéchiffrables. Mais, je le répète, on se contentera de les éclaircir, et non de les rendre blanches comme neige, et de les mettre en presse, après leur avoir fait perdre dans un bain légèrement acidulé l’odeur de chlore qu’elles pourraient retenir. J’aurai à peu près les mêmes remarques à faire sur le liquide suivant, presque toujours employé par les vitriers et par la majeure partie des amateurs.
Eau de Javelle. — Nommée chimiquement chlorure de potasse (), on l’achète à très bon marché chez les marchands de couleurs. La potasse ou la soude qu’elle contient comme élément, outre le chlore, doit avoir une certaine action sur le noir d’impression; c’est ce qui a lieu, en effet, même dans l’eau de Javelle délayée de six à huit fois son volume d’eau. J’ai plusieurs fois répété une expérience assez intéressante sur les trois liquides chloreux destinés au blanchiment. J’ai plongé dans chacun d’eux à l’état concentré, pendant douze heures, des fragments de gravures anciennes ou modernes, sur bois, sur pierre ou sur cuivre; à l’eau-forte ou au burin. Voici le résultat: dans le chlore et le chlorure de chaux, nulle altération du noir; papier très blanc, mais peut-être portant en lui un germe de destruction. L’effet de l’eau de Javelle était plus déplorable. Les fragments de vieilles estampes sur bois ou sur cuivre, au burin ou à l’eau-forte, étaient très altérés. Le noir était devenu grisâtre, terne, sans cohérence; entraîné par le liquide, il déteignait en partie sous l’éponge. J’ai vu un jour un feuillet de livre (impression de 1561) réduit à une trace à peine visible; une belle épreuve d’un Isr. Silvestre a subi le même sort. On voit qu’il faut se servir de ce liquide avec discrétion, et en surveiller de près les effets présents, sans parler des effets désastreux qui peuvent dans l’avenir s’exercer sur la pâte même du papier. Quant aux fragments de lithographie et d’imprimerie moderne, ils sont sortis de l’eau de Javelle avec le noir aussi brillant qu’avant l’immersion. Ce résultat fait l’éloge de l’encre de nos graveurs et de nos imprimeurs (); les fabricants de papiers seuls me semblent avoir fait des progrès désespérants.
La teinte grisâtre que l’eau de Javelle communique au noir d’impression se ravive peut-être un peu () dans de l’eau légèrement imprégnée d’acide hydrochlorique; le noir que le chlorure de chaux a terni y recouvre à l’instant même son éclat primitif.
Il faut se garder d’employer (à l’état concentré surtout) le chlorure de chaux ou l’eau de Javelle autrement qu’à froid; sinon l’on risque de communiquer à l’estampe un germe de destruction plus ou moins prochaine.
Si, malgré l’immersion dans un de ces trois liquides, il restait encore sur l’estampe des taches jaunâtres, elles sont d’une autre nature que la teinte générale. (Voyez l’article Taches. )
Blanchiment partiel. — Souvent une estampe n’exige qu’un blanchiment partiel. Dans celles composées de deux morceaux, c’est quelquefois le milieu qui a jauni, peut-être parce qu’on les avait réunis avec de la colle de graine de lin, usitée au 17e siècle; le plus souvent c’est un des coins, un côté ou une partie pliée, qui, dépassant un livre ou un carton, a reçu l’impression de l’air. Pour éviter un lavage complet de toute la surface, on peut avoir recours à divers procédés que j’indiquerai ci-après (chapitre 3 ).
Après un blanchiment général ou partiel, il faut, je le répète, retremper l’estampe dans de l’eau acidulée, afin de prévenir ou au moins d’atténuer l’effet des substances employées. On raccordera, dans les cas de blanchiment partiel, les endroits éclaircis, avec la teinte jaune générale. On se sert, pour atteindre ce but, de réglisse noire en dissolution plus ou moins concentrée, mêlée en certains cas d’un peu d’encre commune. On raccorde au pinceau ou avec un linge trempé dans la dissolution ou autrement, en ayant soin de ne pas dépasser la limite de la partie à raccorder. On pourrait peut-être rétablir la teinte en exposant l’estampe à la vapeur (formée d’une manière factice) de l’hydrogène sulfuré ; mais ce gaz est si dangereux, que je n’oserais en conseiller l’emploi.