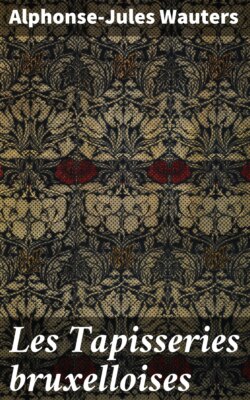Читать книгу Les Tapisseries bruxelloises - Alphonse-Jules Wauters - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление§ Ier.
Table des matières
Un mérite que l’on ne contestera pas au peuple belge et qu’il peut revendiquer comme un de ses plus beaux titres à l’estime des autres nations, c’est d’avoir à plusieurs reprises, et chaque fois avec un égal succès, conquis l’une des premières places dans le monde industriel. En vain les circonstances qui assurent la grandeur des sociétés politiques: l’étendue du territoire, l’unité de race, la longue durée d’un même ordre politique, lui ont fait défaut; son assiduité et son aptitude au travail lui ont fait surmonter toutes les difficultés, et chaque fois qu’une phase heureuse s’est manifestée dans son existence, il en a profité pour regagner le terrain perdu précédemment. C’est ainsi, pour ne pas sortir de l’histoire de l’industrie, c’est ainsi qu’après avoir cessé au XVe siècle d’être le plus grand producteur de draps, il a, sous les ducs de Bourgogne, reporté son activité sur le tissage du lin, la fabrication des tapisseries, celle des armes blanches et des armes à feu; c’est ainsi encore, qu’après les troubles de religion et l’émigration d’une grande partie de la population manufacturière, il a cultivé, avec un rare succès, l’ébénisterie, la carrosserie, l’industrie des dentelles, celle des cuirs ouvragés et tant d’autres sources de richesses; c’est ainsi encore qu’au sortir de la révolution de 1789 et surtout depuis 1830, on a vu se manifester un réveil prodigieux qui tend à transformer tout le pays en un immense atelier.
Dans ces annales si remplies de succès éclatants et de désastres, il est une page que l’on n’a pas mise suffisamment en lumière et qui offre un intérêt immense, tout d’actualité : c’est l’histoire de l’industrie de la tapisserie de haute et de basse-lice, sur laquelle nous sommes réduits à consulter un travail écrit principalement pour la France: le petit volume intitulé les Tapisseries, par Albert Castel, dans la Bibliothèque des Merveilles .
Combler une pareille lacune n’est ni dans nos désirs, ni dans nos moyens. Il faudrait, pour atteindre un pareil but, de longues études, un travail de plusieurs années. Mais nous avons une tâche à accomplir, tâche que nous ne pouvons ajourner, en présence d’un fait que de récentes recherches nous ont permis d’établir. Dans presque toutes les publications dont les anciennes tapisseries ont été l’objet, on ne fait aux travaux des tapissiers de Bruxelles qu’une part assez médiocre: parfois on se borne à mentionner simplement cette ville comme une de celles où l’on a fabriqué des tentures; ailleurs on omet complètement d’en parler. La phrase suivante, empruntée à un travail paru il y a 20 ans, caractérise cette tendance de quelques écrivains: «Un
» grand nombre de localités y participèrent, y est-il dit
» à propos de l’industrie des tapisseries; peu à peu elle
» s’introduisit dans les autres parties du pays, mais elle n’y
» acquit jamais la même importance (qu’à Audenarde);
» exceptons en toutefois Bruxelles, qui s’est fait aussi une
» certaine célébrité dans ce genre d’industrie .»
Les pages qui suivent répondront à cette expression dédaigneuse; bornons-nous ici à affirmer, au contraire, que l’on ne connaît jusqu’à présent, avec certitude, aucune tapisserie «à personnages» sortant des ateliers d’Audenarde; non-seulement Bruxelles peut hardiment et hautement en réclamer un grand nombre, mais il est facile d’établir que cette ville a été en Europe, pendant quatre siècles, un des plus importants, et, presque toujours, le plus important des centres de l’industrie en question; que les tapissiers y ont produit des œuvres de tout premier ordre, œuvres restées sans rivales; qu’ils ont fondé au dehors de fécondes colonies, réalisé des améliorations considérables dans les procédés, combattu jusqu’au dernier moment pour conserver leur industrie au pays et persisté dans leurs efforts jusqu’à la terrible révolution de la fin du siècle dernier. C’est ce que nous allons essayer d’établir .
Avant d’aborder notre sujet, quelques mots d’explication sur les différents genres de tentures:
«Les tapisseries, dit M. Sehoy , étaient de haute ou de basse-lice. Ce nom leur vint des lices, pièces mobiles d’un métier à tisser; au moyen de ces pièces et des pédales on faisait ouvrir les fils de la chaine d’un tissu pour donner passage à la navette et par conséquent au fil de la trame. Ces lices, — longs fils de chanvre, laine ou soie, — pouvaient être assemblées et tendues sur les métiers de deux façons différentes.
» Quand la chaîne était horizontale et que tous les fils de la trame restaient dans le même plan, on tissait en basse-lice; si, au contraire, la chaîne s’élevait verticalement et les fils de la trame étaient également tendus dans le sens vertical, on avait la haute-lice.
» On appelait lices à grandes coulisses celles qui servaient à passer les fils d’or et d’argent dans les tapisseries riches.»
Quant à l’expression de tapis sarrasinois, sur la signification de laquelle on n’est pas d’accord, elle désignait évidemment le travail de basse-lice, qui n’est jamais nommé dans les documents anciens, tandis qu’il est souvent question de celui de haute-lice. L’un et l’autre se pratiquaient également dans les Pays-Bas, mais pendant longtemps le dernier prévalut et ce fut dans ce genre que les tapissiers bruxellois obtinrent leurs plus éclatants triomphes.