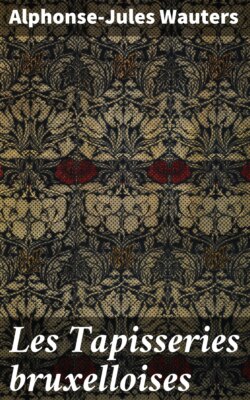Читать книгу Les Tapisseries bruxelloises - Alphonse-Jules Wauters - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
§ II.
ОглавлениеTable des matières
Nous ne nous étendrons pas sur les origines de l’art de la tapisserie. Qui ne sait que, dans l’antiquité comme au moyen âge, on se plaisait à décorer, les jours de fête, les édifices et les habitations privées de tentures de laine et de soie historiées?
Née dans l’ancienne Babylonie, cette industrie passa dans l’Asie Mineure, où elle eut son siège principal dans la ville de Pergame. Elle se transplanta ensuite à Alexandrie, où, selon Pline, on fit pour la première fois au métier des tapisseries ornées de dessins, en laine de diverses couleurs. Introduite enfin à Rome, elle se répandit dans toutes les parties de l’empire des Césars et survécut aux invasions des barbares, à la chute de la dynastie carlovingienne, à l’anarchie féodale.
Au XIVe siècle, on la trouve florissante à Arras, dans cette cité déjà connue, aux premiers siècles de notre ère, par la beauté de ses fabricats, et qui était, dès le XIe siècle; le centre d’un commerce très-actif. Toutes les premières mentions d’achats, de fabrications de tapisseries se rapportent à la capitale de l’Artois. Ce sont des bourgeois de cette ville, entre autres Jean Gosset, Michel Bernard, Pierre Le Comte, Jean des Croisettes, Jean Remont, Jean Walois ou Le Walois, qui en vendent aux premiers ducs de Bourgogne de la maison de France. Ce qui sort de leurs magasins est remarquable tant par la variété des matières employées que par la différence des sujets: tantôt ce sont des tapis sarrasinois d’or, c’est-à-dire imitant les étoffes de l’Espagne ou de l’Égypte, alors obéissant aux Sarrasins; tantôt des tapis de fin fils d’Arras, «ouvrés à or de Chypre,» c’est-à-dire mélangés de fils d’or travaillés comme on le faisait dans l’île de ce nom, encore appartenant à des rois chrétiens; tantôt des tapis de haute-lice «de couleurs de pers (ou vert-bleu), semés de perselles.» Déjà, à cette époque, les fabricants mettaient à contribution toute la littérature sacrée et profane, ancienne et récente, ce qui suppose une culture d’esprit considérable, soit chez eux, soit chez ceux qui les aidaient de leurs conseils; culture dont l’étendue étonne peu, si l’on songe au grand nombre de trouvères qui sont sortis, au, XIIIe siècle, de l’Artois et des contrées voisines.
A côté de l’Histoire de saint Jean, que Philippe-le-Hardi paya 700 francs d’or (à raison de 30 aunes, soit 20 ⅓ de francs par aune), en 1385-4386 ; de l’Histoire de saint Antoine, pour laquelle il donna 1,000 francs; de deux Histoires du Credo, à douze prophètes et douze apôtres, et du Couronnement de Notre-Dame, pour lesquels Dordin reçut 1,800 francs le 24 novembre 1395; de cinq tapis ouvrages d’Arras: la Nativité de Notre-Seigneur, la Résurrection du Ladre, la Passion et Crucifiement, l’Ascension, les Quinze signes et jugement de Noire-Seigneur, que Philippe dit le Bon acheta en 1440-1441, etc., se placent des sujets tout différents: l’Histoire de Charlemagne, pour laquelle le duc de Touraine donne 800 francs, le 14 août 1389; l’Histoire de la bataille de Roosebeek, vaste tapis de 56 aunes de long sur 7 de large, que Michel Bernard vend 3,300 livres au duc Philippe-le-Hardi, en 1383-1386 , etc. L’histoire ancienne ne se montre guère dans cette collection de tentures ou, si elle y figure, c’est presque toujours à travers les enjolivements, dans le goût du moyen âge, que les trouvères et les romanciers lui avaient imposés. A côté de la tapisserie dite des Sept Sages, de l’Histoire de Jason, en deux pièces; on rencontre l’Histoire de Helcanus qui a perdu sa dame et celle de Sémiramis de Babylone. Mais ce qui était surtout et de préférence mis à contribution, c’étaient les annales du moyen âge et les grands poèmes de cette époque: d’une part, dix pièces de l’Histoire de Liége, souvenir aussi cruel pour les Liégeois que glorieux pour Jean-Sans-Peur; l’Histoire du duc Guillaume de Normandie, «comment il conquit l’Angleterre;» l’Histoire de messire Bertrand du Guesclin, l’Histoire de Godefroid de Bouillon; d’autre part, les deux tapis dits tous deux des Douze pairs de France, celui des Neuf preux et des neuf preuses, celui des Neuf preuses seulement, l’Histoire de Regnier qui fit un champ de bataille, l’Histoire de Laurent Guérin qui chassa le sanglier, le Chastel de franchise, l’Orgueilleux de la lande nommé Parceval le Gallois, le Dom de la Roche, etc. .
Non contents de mettre à contribution les faits historiques et les traditions romanesques, les tapissiers de l’Artois abordèrent résolument ce genre dans lequel l’école flamande devait obtenir une suprématie si éclatante: la reproduction de scènes empruntées au monde physique, à la nature même. Avant Jean Van Eyck, qui le premier retraça dans ses tableaux un paysage, avant Thierri Bouts ou de Harlem, qui passe pour en avoir peint avec grand succès, ils se firent, comme on dirait aujourd’hui, des peintres réalistes. Parmi les tapisseries que le duc Jean-Sans-Peur achète à Jean Remont, en mars 1412-1413, pour les donner au duc d’Albany, régent d’Écosse, figurent cinq pièces représentant chacune une dame et des petits enfants, coûtant 200 francs pour 200 aunes (à 16 sous l’aune); vers le même temps Jean Walois fait payer au duc 78 francs 15 sous pour une tapisserie de 70 aunes carrées (à 18 sous l’aune), où se trouvent des «personnages s’ébattant de chasses;» en 1427-1428, Philippe dit le Bon achète à ce même Walois une «chambre de tapisserie,» destinée au prieur du Pont-Saint-Esprit, chambre en plusieurs pièces, semée de roseaux, et où est représentée une chasse d’ours. Il semble que ces sujets d’un genre nouveau plaisaient singulièrement aux étrangers, car lorsque le duc Philippe dit le Bon veut, en septembre 1455, gratifier de tapisseries le duc de Gueldre et le comte de Meurs, qui étaient venus à Arras pour assister aux négociations avec la France, ce qu’il donne au duc, c’est une «chambre à devis de chasse d’ours,» coûtant 504 livres (pour 280 aunes à 36 sous); ce qu’il offre au comte, c’est une «chambre à devis de bocage d’oiseaux et de verdure de plaisance «(cinq pièces coûtant 274 livres 10 sous, soit 183 aunes à 30 sous). Et remarquez que le duc s’en réserve plus d’une du même genre. En 1420, il a encore la «riche» chambre dite la Chambre aux petits enfants, une autre appelée la Chambre de la plaidoirie d’amour, où l’on voyait «plusieurs personnages d’hommes et de femmes et plusieurs écritures d’amours et de rondeaux;» l’Histoire de la Jeunesse et déduit, appelée la Chasse du cerf; une tapisserie de bergerie, sur champ vert; une tapisserie du Parc des Bergers, une tapisserie «à plusieurs herbages et fleurettes, avec un chevalier, une dame et six enfants;» neuf grandes pièces et deux moindres «de volerie, de pluviers et de perdrix, avec le duc Jean (Jean-Sans-Peur) et sa femme, à pied et à cheval.»
Entre la littérature si originale et si variée des trouvères et les peintures de l’école flamande où apparaissent tant de genres auparavant inconnus, l’art de la tapisserie se place comme pour familiariser les esprits aux créations des premiers, pour préparer l’effet produit par les secondes. Le naturalisme de Jean Van Eyck et de son école s’essaie, se prépare dans ces tissus qui habituent les princes et leurs cours aux scènes de la vie naturelle, que l’ascétisme des temps antérieurs avait pour ainsi dire fait oublier.
Jusque vers le milieu du xve siècle, la fabrique d’Arras reste dans toute sa splendeur. C’est dans cette ville que, pour adoucir la colère du sultan Bajazet et obtenir la délivrance de l’héritier du duché de Bourgogne, Jean, dit depuis Sans Peur, on acheta «des draps de hautes-lices» représentant l’Histoire d’Alexandre. Les ateliers d’Arras travaillèrent également pour les rois de France, les églises, les monastères, etc. C’est là aussi que furent achevées, au mois de décembre 1402, les belles tapisseries de la cathédrale de Tournai. Elles sont dues à Pierot ou Pierre Frères et représentent divers épisodes de la légende des saints Piat et Eleuthère.
Restaurées aujourd’hui, grâce à un subside accordé par le Gouvernement belge à la cathédrale de Tournai, et photographiées à cette occasion, les tentures de Frères fournissent des indications précieuses pour le progrès de l’art. Les scènes qu’elles nous offrent, à l’exception des deux compositions placées aux extrémités et qui datent évidemment d’une époque postérieure, semblent des miniatures détachées d’un missel de l’époque: c’est le même faire, la même naïveté, la même abondance de détails; les personnages sont, pour ainsi dire, entassés les uns sur les autres; l’air et l’espace y manquent. Les mouvements généralement raides et guindés, les figures, d’un aspect trivial, dénotent un talent qui essaie de reproduire la nature, mais à qui manquent la hardiesse et la sûreté de la main. C’est encore de l’art mystique, traditionnel, asservi; l’heure des innovations fécondes, de l’émancipation de la forme n’a pas encore sonné .
Comme l’a très-bien prouvé M. Proyart dans un travail lu à l’Académie d’Arras , la prospérité de cette ville ne survécut pas à la conquête d’Arras par les Français et au despotisme brutal dont Louis XI l’accabla. Lorsqu’il en chassa les habitants, trop attachés à la domination bourguignonne, pour les remplacer par une autre population choisie un peu partout et très à la hâte; lorsqu’il substitua à son vieux et glorieux nom le nom dérisoire de Franchise, il acheva de tuer la brillante industrie qui avait ajouté un nouveau fleuron de gloire à la couronne murale d’Arras. Par une de ces vieilles habitudes qui sont si difficiles à déraciner, on continua en Italie à appeler les tapisseries des Arazzi; mais quand cette dénomination se répétait avec enthousiasme à la cour des papes et à celle des Médicis, elle ne s’appliquait plus à des tentures venant de l’Artois; les ateliers de ce pays s’étaient fermés sous le coup d’une domination oppressive.
Déjà avant 1477, Arras semble avoir abdiqué sa suprématie dans l’art de la tapisserie. Les ducs de Bourgogne cessent, dès le milieu du xve siècle, d’y faire des achats; ils semblent reporter leurs préférences sur Tournai, qui appartenait pourtant au royaume de France, et leur était par conséquent étrangère. Là vivait un artiste dont il n’est pas inutile de citer ici le nom, car c’est le plus ancien que l’on sache avoir travaillé pour les fabricants de tapisseries: «Et cil», dit Le Maire, dans sa Couronne margaritique,
«Et cil qu’on prise au soir et au matin,
Faisant patrons Bauduin de Bailleul.»
Lorsque, en 1448, le duc Philippe-de-Bourgogne chargea Robert Dury et Jean de l’Ortie, «marchands ouvriers de «tapisserie, demeurant à Tournai,» d’exécuter pour lui huit tentures de haute lice représentant l’Histoire de Gédéon et qui devaient être terminées à la date du 15 août 1453, il fut stipulé que les patrons ou dessins de modèle devraient être exécutés par Baudouin ou par un meilleur peintre si Dury et Lortye pouvaient en trouver. Le duc paya pour ces tapisseries, qui mesuraient 1,120 aunes, 8,940 écus d’or et en donna en outre 300 autres pour les cartons . Ces tentures étaient célèbres; elles ornèrent longtemps le palais de Bruxelles, où elles étaient suspendues, dans la grande salle, lorsque Charles-Quint y abdiqua en faveur de Philippe II; c’était, dit à cette occasion un écrit du temps, «la plus «riche et exquise tapisserie qu’on ne sauroit avoir vue .» Elle se trouvait encore au palais en 1597 et, selon toute apparence, elle fut comprise parmi les objets précieux qui furent transportés à Vienne, en 1794. Ce fut encore à Tournai, de Pasquier Garnier, que le duc Philippe acheta, en 1461-1462, «six tapis de muraille», figurant l’Histoire du roi Assuérus et de la reine Esther, et quatre pièces de l’Histoire du Chevalier au Cygne , et, le 22 avril 1461, différentes pièces, notamment la Passion de Jésus-Christ et des Paysages avec paysans et bûcherons, qu’il paya 4,000 écus d’or de 48 gros .
La fabrication tournaisienne persista assez longtemps. Le 14 mars 1495-1496, un autre marchand, nommé Antoine Grenier, reçut le solde d’une tapisserie qui avait été donnée par l’archiduc Philippe-le-Beau au cardinal d’Amboise . Plus tard, Jean Grenier livra à Philippe, en 1504, un tapis «richement fait à la manière du «Portugal et de l’Inde», et qui devait être envoyé à des seigneurs français, et, en 1505, différentes pièces de tapisserie. Il reçut pour le premier 784, pour les secondes 2,422 livres. A la même époque, Clément Sarasin fabriqua pour l’évêque de Tournai trois tapis à ses armes et deux autres, l’un représentant Saint-Martin et l’autre Saint-Nicolas, que le prélat offrit à une église de Blois . Enfin, lorsque Marguerite d’Autriche alla visiter le roi d’Angleterre Henri VIII après qu’il eut conquis Tournai, en 1513, la ville lui offrit, comme le plus beau cadeau qu’elle pût lui faire, six pièces dites de la Cité des Dames . Tournai pourrait réclamer ces tentures de Dijon que Jubinal a décrites et fait reproduire et où s’étale fièrement, ostensiblement, un grand G, terminé vers le haut par un 4 retourné et orné. Exécutées au commencement du XVIe siècle, pour perpétuer le souvenir du siége de la capitale de la Bourgogne en 1513, elles offrent trop d’analogie avec d’autres produits de l’industrie flamande pour lui être disputées. On pourrait y voir une œuvre des célèbres tapissiers tournaisiens Grenier, car les G du genre de celui que l’on y remarque ne sont autre chose que des signes de marchand ou de fabricant. Les initiales, il est vrai, furent souvent employées comme marques du lieu de fabrication: l’exemple de Bruxelles en est une preuve manifeste, mais ici le fait n’est pas probable.
Tournai fut l’une des localités où la fabrication de la tapisserie persista, mais elle ne se maintint pas, au XVIe siècle, au rang élevé qu’elle occupait. Elle ne produisit plus des œuvres capitales comme celles dont nous venons de parler, mais du travail plus commun, plus fructueux aussi et d’un placement plus régulier. Pour ne plus avoir à y revenir, disons que l’industrie des tapis cessa d’être prospère à Tournai dès 1705 et n’alimentait plus que quinze métiers en 1774 .
L’histoire de la fabrication des tapisseries dans les autres villes du pays est fort peu connue et réclame des investigations nouvelles; ce que l’on en sait jusqu’à présent est tout à fait insuffisant.
Nous ne connaissons, pour Valenciennes, que Jean de Florence, «ouvrier de tapisserie et de haute-lice,» qui, en 1418, répara différentes tapisseries appartenant à la duchesse Jacqueline de Bavière .
La petite ville d’Enghien a vu fleurir le même genre d’industrie, mais Colyns, son historien, n’en dit rien, et jusqu’à présent nous n’en savons que peu de chose. Un Laurent Flascoen, tapissier de haute-lice, travaillait à Enghien du temps de Charles-Quint. Quelques pièces provenant d’Enghien et ayant été saisies par ordre du duc d’Albe à l’hôtel de Berghes, à Mons, furent vendues publiquement à Bruxelles, en 1570 . A en juger par le prix que l’on en donna, 9 sous 6 deniers l’aune, leur valeur n’était pas grande, mais cette circonstance ne préjuge rien, car le moment était peu favorable. Au surplus, l’industrie de la tapisserie à Enghien fut gravement atteinte par la tourmente du XVIe siècle. La réforme religieuse y avait conquis un grand nombre d’adhérents; plusieurs de ceux-ci, entre autres les peintres Pierre Huart et Vincent Van Geldere, les hauts-liciers Jean Larchier, Berthout De Cantere, Adrien De Pluckere, Jean Cools et Nicolas Provyns, n’attendirent pas l’arrivée des bandes du duc d’Albe et prévinrent par leur départ les conséquences des poursuites qui furent dirigées contre eux en 1568. Bannis à perpétuité, ils allèrent, ainsi que des milliers de leurs compatriotes, porter à l’étranger leurs capitaux et leur activité . Cependant l’industrie reprit de nouveau et se perpétua à Enghien jusque dans les dernières années du XVIIe siècle. Elle a été caractérisée par un industriel français qui visita alors la Belgique et rédigea pour la communauté des tapissiers de Paris un mémoire d’où nous extrayons ce qui suit: «Celle (la fabrique) «d’Anguien a beaucoup été dans ses commencemens pour » les personnages, qui ont toujours été très-mal dessinez. » Cette fabrique est devenue fort atténuée et très-aride; un » de leurs deffauts ordinaires est de mal monter leurs » ouvrages, ce qui est cause que leurs chaînes ne sont pas » bien couvertes. Leurs verdures sont passables, quoique » toujours travaillées dans un certain goût antique qui en » diminue bien le prix .» Nous ne reproduisons ce passage, hâtons-nous de le dire, que comme renseignement: l’artisan auquel on le doit a apprécié à sa manière le travail des différents centres de fabrication de tapisseries en Belgique; on ne peut évidemment accepter ses assertions que sous bénéfice d’inventaire.
Il faut peut-être attribuer à Enghien les belles tapisseries à armoiries que l’on conserve au musée de Berne et dont l’une, qui n’a pas moins de 20 pieds de longueur, représente les insignes de l’ordre de la Toison d’or. On y distingue un monogramme encore inexpliqué, formé de deux e adossés, peut-être une double initiale du nom de la ville d’Enghien (en flamand Edingen),
Dans la Flandre, il y avait des tapisseries à Lille, à Douai, à Gand, à Bruges, à Alost et surtout à Audenarde. A l’exception de cette dernière ville et de Lille, nous sommes encore, à peu de chose près, dans l’ignorance de ce que les tapissiers y firent.
Les fabricants de tapis de Gand sont déjà mentionnés en 1302; mais, à cette époque, ils étaient encore réunis aux coutiers ou fabricants de coutils. Ils adoptèrent depuis pour armoiries un écusson de gueules aux deux lions d’or lampassés et armés d’argent, tenant un tapis de sinople, chargé d’une fleur de lis d’argent .
Il est souvent question, mais d’une manière assez vague, des tapisseries de Bruges, où les tapissiers formaient une corporation qui obtint son autel dans l’église Saint-Gilles, le 29 décembre 1425 . Cette cité fut peut-être pour les tapisseries plutôt un entrepôt qu’un centre de fabrication, comme ce fut aussi le cas pour Anvers. Jusqu’à présent, les célèbres tentures appartenant authentiquement à ces deux villes, les fabricants y ayant travaillé ne sont cités que très-rarement. Mais, à cet égard, on ne peut rien préciser: des lumières inattendues jailliront peut-être de recherches plus approfondies. D’après les relations des fêtes données à Bruges par Charles-le-Téméraire, on voit que les riches, les splendides tapisseries y abondaient et paraient, à l’occasion, les édifices et même les rues; on y étalait quelquefois un luxe qui frappait l’étranger d’étonnement et donnait la plus haute idée de la prospérité de nos provinces.
En 1429-1430, la ville de Bruges fit confectionner par Pierre De Meester, tapissier sarrasinois (sarasinoyswercker), et sur les dessins du peintre Gilles De Stichele, des tapis destinés à recouvrir les bancs et les dosserets de la salle échevinale à l’hôtel de ville. En 1439, un marchand de cette cité fournit pour la chambre du jeune comte de Charolois, au palais, pour 316 livres 17 sous 6 deniers, une «tapisserie
» moult riche, historiée de l’Histoire du Sacrement» . Le 18 octobre 1478, Maximilien d’Autriche et Marie de Bourgogne y achetèrent d’un marchand tapissier, Philippe Sellier, pour les offrir au grand chambellan du roi d’Angleterre Edouard IV (dont Marguerite d’Yorck, la veuve du Téméraire, était la sœur), différentes tapisseries, notamment l’Histoire de l’empereur Maximien, l’Histoire d’Absalon, l’Histoire des Trois Rois; ici le travail était des plus beaux, car il fut payé largement: la première de ces tentures coûta 366 livres 12 sous, soit 48 sous de deux gros (ou 2 l. 8 s.) par aune pour 152 ¾ aunes; la deuxième 270 l, ou 8 l. 3 ½ s. environ par aune pour 33 aunes; la troisième 210 l., ou 6 livres environ par aune pour 35 ¾ aunes . Dans son catalogue du Musée de Cluny, M. du Sommerard attribue à Bruges une belle tapisserie du temps de Louis XII, signée David fecit , et qui représente dame Arithmétique enseignant les règles du calcul à des seigneurs et des clercs placés autour d’elle. Elle porte pour marque un B retourné.
Pour la fabrication brugeoise, le mémoire français cité plus haut donne aussi des indications précieuses: «La
» ville de Bruges le dispute à toutes ces villes (les villes des
» Pays-Bas) pour l’ancienneté ; elle ne s’appliquoit autrefois
» qu’à la haute lisse, mais dans ses desseins, ses figures et
» ses fleurs, on y apperçoit une négligence extraordinaire,
» qui fait que le tout n’est pas assez nuancé ; leurs couleurs
» ont longtemps surpassé toutes les autres fabriques par
» leur beauté. Cette fabrique n’est pas difficile à connaître;
» son travail est tout de laine et peu de soye; elle donne
» beaucoup dans l’antiquité et c’est ce qui la rend aride et
» d’un grain dur et mal travaillé, ce qu’on remarque aisément
» à ses chaînes grasses et velues. Pour ce qui est de
» ses verdures, le goût n’en est pas des plus estimés; elle a
» cependant changé aujourd’hui quelque chose dans sa
» manière de travailler, mais non pas dans le fond, car
» cette fabrique est toujours la même .»
A Lille, les hauts-liciers apparaissent dès la fin du XIVe siècle et les bas-liciers dès le commencement du XVe siècle; mais ce ne fut que vers l’an 1600 que l’industrie de la tapisserie s’y développa, grâce à l’arrivée de maîtres et d’ouvriers d’Audenarde. Pour les temps antérieurs il y a pénurie de renseignements; en 1367, ce fut à Arras que le magistrat acheta les tapis offerts au nom de la ville au roi de France Charles V et au comte d’Étampes. L’époque de la maison de Bourgogne reste muette sur les produits lillois, dont la marque distinctive consistait en un écusson de gueules à la fleur de lis d’argent .
On a souvent et longuement parlé d’Audenarde dans tous les travaux qui ont pour objet l’art de la tapisserie de haute-lice. Sans vouloir déprécier la part qui revient à cette ville, part très-belle et que nous serions désolé d’amoindrir, nous croyons qu’elle n’a pas été suffisamment déterminée. Audenarde, pensons-nous, s’est presque toujours borné à reproduire le genre de tenture auquel son nom s’est attaché : les scènes champêtres, les reproductions de paysages, de sujets à fleurs et à fruits, genre qui reçut le nom de verdures et aussi d’Audenardes, d’après la localité même où on les fabriquait. Cette industrie prit rapidement une extension considérable; au XVIe et au XVIIe siècles elle faisait vivre des milliers de personnes, tant dans les environs d’Audenarde que dans la ville même . Ses produits, peu dispendieux, se multiplièrent à l’infini et se répandirent au loin. Plusieurs fabricants, se trouvant dans de mauvaises conditions, émigrèrent à différentes époques et contribuèrent à relever à Paris, à Lille, en Angleterre, etc., la tapisserie qui y était, soit dans l’enfance, soit languissante; nous aurons occasion plus loin de rappeler, à plus d’une reprise; qu’ils ont largement contribué à répandre au loin notre réputation industrielle, mais il n’est pas prouvé qu’on leur doive de grandes tapisseries à personnages, de grandes scènes religieuses, historiques ou légendaires; plusieurs attributions de ce genre, souvent rappelées, sont manifestement fausses.
Pour toute ville de rang inférieur, il était difficile de soutenir à cet égard la concurrence des villes importantes. Le fait est facile à prouver. Que fallait-il en premier lieu aux fabricants de grandes tapisseries? Des peintres, nous devrions dire des peintres de talent, de véritables artistes, pour en dessiner les cartons, pour en surveiller l’exécution au point de vue artistique. Certes Audenarde a produit des hommes d’une véritable valeur, mais il ne s’y est pas perpétué, comme à Bruxelles, par exemple, une école dont tous les chefs, tous les membres principaux, jouissaient d’une réputation justement méritée. L’art ne se développe, ne se maintient que dans un certain milieu, dans des conditions de luxe, d’enseignement, de relations, qui sont fatales. Là seulement grandissent les talents et viennent grandir les talents sortis d’ailleurs. C’est pourquoi la fabrication des belles, ou, comme on disait, des riches tapisseries, se concentra surtout à Bruxelles.
Cette règle, hâtons-nous de le dire, n’est pas absolue. Elle se modifie souvent sous l’influence de circonstances particulières et, parfois, grâce à un homme d’un mérite supérieur. Rien n’empêche qu’à certains jours la tapisserie audenardaise soit sortie de son rôle ordinaire. Ainsi la célèbre tenture dite du Château des Aygalades et où l’on a vu une allusion, tantôt à l’histoire de Pétrarque et de Laure, tantôt à celle du roi Louis XII, tantôt à celle du roi David, en vient probablement. La lettre A se distingue nettement sur la ceinture du jeune prince que l’on encense et à qui l’on offre des fleurs. Cette tapisserie, exécutée évidemment pendant les premières années du XVIe siècle, appartient certainement à l’art flamand; elle se distingue par la variété des costumes et des coiffures et aussi, paraît-il, par l’éclat des couleurs .
Ce fut le 11 juin 1441 que la ville d’Audenarde donna au métier des tapissiers son premier règlement, sa véritable charte d’institution. Cette corporation se forma donc presque en même temps que celle de Bruxelles, sept années plus tôt. Son histoire est encore obscure et ne s’éclaire que vers l’an 1600; à partir de cette époque, les courageux efforts que l’on fit pour maintenir l’industrie d’Audenarde sont mieux connus .
Le mémoire français que nous avons déjà cité s’exprime comme suit à propos des tentures fabriquées à Audenarde:
«La fabrique d’Oudenarde s’est autrefois rendue célèbre
» par ses verdures; elle a fait peu de personnages; cependant
» quelques tentures en sont sorties en différens temps,
» non pas avec la même approbation que les verdures; ce
» qui en est cause, c’est que ces personnages sont, pour
» l’ordinaire, mal façonnez, d’un travail dur et confus
» et encore plus mal dessinez. Depuis, cette fabrique s’est
» comme renfermée à travailler en petits personnages et
» elle auroit surpassé en ce genre toutes les plus célèbres
» de l’Europe si elle eût eu des officiers de tête et entendus
» dans leur art. Les peintres les plus habiles se trouvent
» souvent dans l’obligation d’en retoucher les traits par le
» peu d’application qu’apportent ses ouvriers à en suivre
» le goût et l’ordonnance. Leurs verdures tirées sur les
«dessins de Fouquières, ont été autrefois assez estimées,
» quoique Bruxelles s’en fût servi auparavant; sa fabrique
» est facile à connaître: le travail en est doux, moëlleux et
» d’un goût égal; leur verd tend toujours sur le même teint
» et leurs couleurs sont souvent fausses. Leurs marques
» d’ordinaire sont une forme d’ornement avec une espèce
» de croix et une autre marque en façon de cœur, avec des
» lunettes par dessus» .
La pénurie de documents que nous avons constatée en Flandre se rencontre aussi en Brabant. A Anvers, comme nous l’apprend le travail de Mertens et Torfs , les tapissiers furent séparés du métier des tisserands en drap et érigés en communauté distincte, en 1416. Dans cette métropole du commerce et de l’art belge, le négoce des tapisseries était si actif que l’on y construisit pour elles une halle spéciale: de Tapessiers pand. C’est en 1551, et grâce à la féconde initiative de Van Schoonbeke, que s’éleva cet édifice, dont l’histoire serait à la fois curieuse et instructive . Au XVIIe siècle, la fabrication des tapisseries ne constituait plus à Anvers le monopole d’une corporation; elle y était entièrement libre et n’y subissait aucun contrôle, comme nous aurons occasion de le dire.
» Anvers, dit le rapport français cité plus haut, ne
» le cède aucunement à Bruxelles pour l’antiquité de sa
» fabrique; autrefois elle ne faisoit que des verdures, qui
» ont été jugées les plus belles de l’Europe; mais depuis
» elle est tombée dans un goût jaunâtre et approchant d’un
» morne qui dégoûte; les personnages y sont mal dessinés,
» n’ayant point de correcteurs; outre cela une fabrique mal
» conduite, les uns resserrant l’ouvrage, les autres le
» lâchant, ce qui cause de grandes difficultés à tendre
» leurs tentures. A présent ses ouvriers, plus éclairés, la
» rendent plus égale et moins desseichée; leur chaîne est
» souvent vicieuse, l’ouvrage en devient plus mol et le tout
» n’en est pour cela pas meilleur; aujourd’hui leurs couleurs,
» quoique beaucoup plus belles qu’elles n’étoient au temps
» passé, mais mal employées, rendent leurs personnages
» d’une nature irrégulière. Ce qui les trompe avec d’autant
» plus de facilité, c’est qu’ils prennent pour originaux des
» copies de Bruxelles, dont la fabrique est aujourd’hui la
» même que celle d’Anguien; il y a cependant quelque
» différence dans l’ouvrage, ses nuances sont diverses et
» ses laines desseichées. Pour marque ils ont une espèce
» d’ornement confus en manière de chiffres .»
Dans le pays dé Liège, il se fabriquait des tentures à Saint-Trond. A l’hôtel de Berghes, à Mons, il s’en trouvait de fort usées, qui furent confisquées, puis vendues en 1570, au prix de 8 sous 1 denier maille l’aune . Pour ce qui est de Liège même, on a voulu, tout récemment, faire honneur à cette cité des magnifiques tapisseries que l’on conserve à Madrid et où sont représentées les principales scènes de l’Apocalypse, avec un talent bien supérieur à celui qu’Albert Dürer déploya lorsqu’il traita, en gravures, les mêmes sujets. M. Wittert , l’auteur à qui l’on doit cette hypothèse prétend en outre que ces tentures furent exécutées dans la ville de Saint-Lambert, d’après les dessins et sous les yeux de Roger Van der Weyden, grâce aux conseils du théologien Nicolas de Cusa et du chartreux Denis de Ryckel, ses amis. Tout cela n’est que supposition pure. Cusa, quoique l’un des archidiacres de l’église de Liège, passa loin de cette ville presque toute son existence, car il fut le secrétaire et l’ambassadeur de trois papes: Eugène IV, Pie II et Nicolas V, puis fut nommé évêque de Brixen dans le Tyrol; ces fonctions ne lui permirent de faire que de rares apparitions à Liège, où la règle rigide de Saint-Bruno ne laissait pas à Denis de Ryckel la faculté de se montrer souvent. Rien, d’ailleurs, ne nous prouve que Roger y vécut. C’est à Bruxelles qu’il naquit, qu’il travailla, qu’il mourut; là, nommé peintre de la commune, il dessina, il peignit, il enseigna . Là aussi, selon toute apparence, il présida à l’origine de la corporation des tapissiers et il eut, avant de mourir, la gloire de voir son nom immortalisé par les peintures qui ornèrent pendant trois siècles l’Hôtel de Ville et par les tentures qui paraient le camp de Charles-le-Téméraire et que la ville de Berne étale avec orgueil comme le plus beau souvenir de la résistance énergique de la Suisse aux convoitises bourguignonnes.