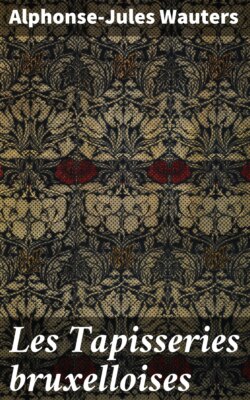Читать книгу Les Tapisseries bruxelloises - Alphonse-Jules Wauters - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
§ III.
ОглавлениеTable des matières
On ignore complètement à quelle époque l’industrie des tapisseries s’implanta à Bruxelles. On ne peut que former à ce sujet des conjectures. Il est à supposer qu’à la suite des croisades, des relations plus fréquentes se sont établies entre le Brabant et l’Orient et ont fait connaître à ses habitants les goûts somptueux des peuples du Midi.
Dès le XIVe siècle, on fabriquait en Brabant, non-seulement de simples tapis, mais de grandes tentures à personnages. A la date du 13 mars 1377-1378, on paya à Guillaume d’Yssche, tapissier (tapetisarius), 6 peters pour un tapis rouge aux armes du duc Wenceslas et de la duchesse Jeanne, destiné à être placé sous leurs pieds, devant l’autel de la chapelle du palais de Bruxelles . Dans l’inventaire des joyaux et autres objets de prix du duc Philippe dit le Bon, en date de 1420, plusieurs tapisseries sont accompagnées de la mention: et est de Brabant, qui en dénote l’origine:
«Un grand vieux tapis de l’histoire de Renaud de Montauban,
» comment il vainquit le roi Dennemont devant
» Angourie. Et est de Brabant.»
«Un autre vieux tapis de haute-lice ouvré de jeune
» homme et de femme jouant de plusieurs jeux. Et est de
» Brabant.»
«Une autre riche chambre, appelée le Couronnement de
» Notre-Dame, et a deux personnages des ducs Antoine de
» Brabant, de sa femme et de leurs enfants. Et est tout de
» Brabant .»
Les artisans qui se livraient à ce genre de travail formèrent d’abord, sous le nom de Tapyt ambacht ou Corporation du Tapis, une subdivision du grand métier des tisserands, ou, comme on disait alors, du grand métier. Sur sept jurés ou doyens ils en nommaient un, qui était chargé de faire tous les ans, de concert avec le clerc ou secrétaire et le valet ou huissier de la gilde de la draperie, des rondes ou quêtes (ommegangen) chez ses confrères, soit pour contrôler leur fabrication, soit pour recueillir de l’argent afin de couvrir les dépenses communes. Le juré des tapissiers en fit deux en 1417, le 16 mai et le 2 juin, et reçut chaque fois, de ce chef, une rétribution s’élevant à 20 placques .
C’est en 1340 que l’on rencontre pour la première fois une mention du métier des Tisserands de tapis (Tapitewevers). Pendant la campagne du duc Jean III contre la France, cette corporation déclara, en présence de chevaliers, d’écuyers et d’autres bourgeois de Bruxelles, que dans la suite la ferme de Waterloo, appartenant à l’abbaye de Forêt, ne serait plus astreinte à lui fournir un chariot en cas de guerre . Les tapis étant quelquefois mis en gage chez les lombards par les fabricants, les patriciens avaient le déplaisir de voir ceux où leurs armes étaient placées, exposés en vente et aliénés à vil prix; c’est pourquoi il fut défendu d’en engager de pareils, si ce n’est avec le consentement formel de ceux auxquels ils appartenaient (21 juin 1411) . Pendant un certain temps, l’accès de la corporation fut assez facile, car un nommé Martin Pennys y fut admis en ne donnant qu’une gelte ou pot de vin, et ensuite il prétendit être reçu comme maître aux mêmes conditions, mais les circonstances ou les idées ayant changé, les jurés du grand métier et du métier du tapis voulurent lui faire payer 4 vieux écus, comme le prescrivait, disaient-ils, une ordonnance récemment promulguée. Portée d’abord devant les doyens et huit de la gilde de la draperie, la contestation fut, en dernier ressort, soumise aux magistrats communaux, qui la décidèrent en donnant gain de cause aux jurés ( 23 décembre 1428) .
La draperie marchant toujours vers sa décadence et l’industrie de la tapisserie se développant au contraire de plus en plus, ceux qui se livraient à cette dernière demandèrent et obtinrent, vers 1448, leur organisation en un métier distinct, désigné sous le nom de Métier des legwerckers (legwerckers ambacht), de leg, leeg, bas, ce qui proviendrait peut-être de ce que le travail était d’abord de basse-lice, ou de leggen, poser, placer, parce que la tenture était fabriquée sur un métier. La nouvelle corporation était subordonnée, comme celle des tisserands, à la gilde de la draperie et également comprise dans la nation dite de Saint-Laurent. Dans l’origine et afin, sans doute, de se mettre au niveau des autres corporations, ses membres. contractèrent des dettes nombreuses. Quelques-uns d’entre eux voulurent affecter le produit de la taxe hebdomadaire sur les maîtres et les ouvriers à acheter des tentes, pour le cas où ils seraient appelés à un service militaire; des pots ou vases, pour les banquets, etc., mais un débat surgit à ce propos en 1449; la majorité préféra rembourser au plus tôt les dettes contractées, et le magistrat se prononça aussi en ce sens, le 19 avril 1450 .
Peu de temps après, le 7 avril 1450-1451, on rédigea pour les fabricants de tapis des statuts, qui reproduisent, avec de légères variantes, les principales dispositions auxquelles étaient astreints les membres des métiers de Bruxelles. Les unes concernent les différentes classes d’artisans: l’apprenti (leerknape), le valet (knape) ou ouvrier, le maître (meester); les autres réglementent la fabrication ou d’autres points.
Au maître est réservé le droit de fabriquer et de vendre; l’ouvrier ne peut le faire qu’avec l’aveu de son patron, ni travailler, même au moyen de ses propres fils, de ses propres étoffes, que pour son usage particulier et cela avec l’autorisation de son maître (§ 17). Pour être reçu maître, il faut être bourgeois de Bruxelles et avoir appris le métier. Chaque maître ne peut avoir plus d’un apprenti, non compris ses enfants, issus de mariage légitime; ceux-ci, comme les autres apprentis, sont assujettis à un stage de trois ans, mais ils ne sont tenus de travailler que trois jours, les mots par semaine sont évidemment sous-entendus (§§ 1, 3, 5, 14). L’étranger peut travailler comme maître à Bruxelles, s’il prouve qu’il a appris le métier pendant trois ans dans une autre ville franche et s’il paie, pour droit d’entrée, 4 florins ridders, outre deux geltes ou pots de vin pour les jurés. Si le candidat à la maîtrise veut d’abord apprendre, il donne 2 florins et une gelte de vin lors de sa réception comme apprenti et autant lors de son admission comme maître, sauf que les fils de maîtres ne doivent que le vin. Pour être accepté comme ouvrier on ne donne qu’un demi-florin et une gelte de vin (§ 2, 4).
Défense est faite de vivre en concubinage, sous peine de perdre les franchises du métier; d’insulter les jurés ou leur clerc ou secrétaire, de travailler les dimanches et jours de fête (§§ 21, 22). Les rétributions, sous peine d’une amende de 15 livres paiement, se payent dans l’année (§ 25). On est tenu d’assister aux processions solennelles, où la corporation prend place devant celle des tisserands en lin (§ 26). L’apprenti ne peut quitter son maître, ni rester absent plus de quatorze jours, à moins de nécessité, et le maître doit donner, dans les trois jours, avis de cette absence. Quant à l’ouvrier, il lui est défendu de quitter son patron pour aller travailler ailleurs, sans en avoir prévenu (§ 13).
A côté de ces dispositions s’en placent d’autres relatives à la fabrication. Défense est faite de travailler le matin avant qu’on n’ait sonné la cloche dite du jour, et le soir après la cloche dite dernière cloche (§ 7). Tout ce qui se fait avec du lin (linenwerpten), tels que serges, taies d’oreille, etc., doit se teindre au lieu dit de Blauwerie (littéralement la Teinturerie en bleu (§ 8). Défense est faite, sous peine d’une amende énorme, une livre de gros, d’employer le poil de vache, le poil de chèvre, les déchets provenant de n’importe quel animal, les fils prohibés (§ 15). Nul objet neuf ne peut être mis en vente s’il n’a été examiné, approuvé et scellé ou timbré ; seulement les fabricats étrangers peuvent se débiter au marché franc et se vendent, le vendredi, au Marché au bois (§ 9). L’opération du scellage se fait dans la chapelle de l’hôpital Saint-Christophe, rue de Ruysbroeck, où les jurés siègent à cet effet trois fois par semaine: le mardi, le jeudi et le samedi, de 8 à 9 heures, du 1er octobre à Pâques; de 9 à 10 heures, le restant de l’année.
On ne peut étaler ensemble, sans les distinguer, les fabricats bruxellois et ceux du dehors, ni mélanger les uns et les autres (§§ 11, 16, 24). Une disposition relative à la fabrication même, enjoint d’établir (scerrien?) chaque pièce sur vingt-quatre (twist) portées de douze fils chacune (§ 12). Lorsque les jurés font leur tournée (ommegaen), ils ne peuvent être qu’au nombre de deux et chacun reçoit deux sous pour son salaire (§ 27) .
Cette espèce de constitution du métier subsista sans recevoir de graves atteintes. Seulement, fait important à noter, le scellage ou timbrage des tapis faits à Bruxelles fut aboli par le magistrat à la demande du métier, le 14 novembre 1472, et comme la gilde de la draperie recevait une part du revenu que le métier en retirait, à charge de présenter tous les ans un cadeau au duc de Brabant , il lui fut fait abandon d’une rente de 16 florins par an que le métier possédait à charge de la ville . L’examen des fabricats continua à s’opérer dans la chapelle Saint-Christophe, par les soins des quatre jurés, qui se faisaient remplacer par des anciens (ouders, c’est-à-dire des maîtres ayant précédemment porté le titre de juré) lorsqu’il s’agissait d’objets sortis de leurs ateliers; il leur fut alloué à chacun un émolument annuel de 50 sous, à charge de se faire confectionner une robe de cérémonie ou tabbaert, etc. Défense fut faite de céder à un tiers l’ouvrage que l’on avait accepté. On prit aussi des mesures pour améliorer la fabrication des tentures. Le grand banquet annuel cessa de se faire aux frais de la corporation et la taxe en vin, qui se payait lorsqu’on y entrait, fut augmentée. Enfin, on réglementa la présence aux assemblées du corps et aux funérailles des membres (10 juin 1473) .
A ces innovations en succédèrent bientôt d’autres. L’examen des fabricats à Saint-Christophe fut supprimé et remplacé par une expertise qui se faisait chez le maître même, pendant que la tapisserie se trouvait encore sur le métier là où elle avait été confectionnée. Les jurés furent autorisés à visiter les ateliers quand ils le voudraient, mais pas moins de trois fois l’an, et on leur laissa la faculté de se faire exhiber les fils, la laine, etc., dont on se servait. Si le fabricant ne voulait pas se conformer à cette prescription, il était tenu de jurer qu’il l’observait. De leur côté, les jurés furent alors astreints à présenter leurs comptes tous les ans, à la Saint-Jean, ou, au plus tard, dans les quinze jours, et à les faire clôturer le 1er octobre. On institua un valet de la corporation chargé de conserver les joyaux, les meubles, etc., et d’avertir les jurés lorsqu’une personne se présentait pour être admise. Ce fut alors qu’on fixa à 7 ans le minimum de l’âge où les fils de maîtres pouvaient se faire inscrire et à 8 l’époque minimum de l’admission des apprentis (10 juillet 1475) .
Vers le même temps, la corporation eut un débat avec les peintres de Bruxelles, parce que quelques-uns de ses membres se servaient de cartons ou dessins sur papier, faits au charbon ou à la craie par des personnes étrangères au métier des peintres. Avant de porter leur contestation devant les magistrats, les deux métiers parvinrent à s’entendre. Les tapissiers furent autorisés à dessiner, l’un pour l’autre, des étoffes, des arbres, des animaux, des barques, de l’herbe, etc., pour leurs verdures, c’est-à-dire pour les tapisseries représentant des paysages, et à compléter ou corriger eux-mêmes leurs cartons au charbon, à la craie, à la plume. En tout autre cas, s’ils ne s’adressaient à un peintre, ils encouraient une amende, dont le taux devait être déterminé par la corporation dont celui-ci faisait partie (ordonnance du magistrat en date du 6 juin 1476) .
A l’époque où de si fréquents changements se manifestaient dans son organisation, se succédant pour ainsi dire d’année en année, le métier était parvenu à l’apogée de sa splendeur; il possédait sur la Grand’Place de Bruxelles une maison, l’Arbre d’Or, qui, plus tard, devint la Maison des Brasseurs . Son autel se trouvait dans l’église du Sablon, où la corporation faisait dire toutes les semaines trois messes que les religieux du prieuré de Rouge-Cloître exonéraient comme détenteurs de certains biens grevés de cette charge. Pour arriver à de tels résultats, le métier devait avoir réalisé de rapides progrès et multiplié à la fois la qualité et la quantité de ses produits. C’est en 1466 que nous trouvons pour la première fois des achats de tapisseries opéré à Bruxelles par la maison ducale de Bourgogne.
Le 18 juillet 1466, elle paya au tapissier Jean De Haze, qui demeurait dans cette ville, 2,131 livres 7 sous, pour huit pièces de tapisseries de verdure, ayant chacune en son milieu, ouvrées en or, les armoiries du duc: six servant à couvrir les murailles, une pour le dressoir et une pour la table du banquet. Les huit pièces mesuraient 409 3/4 aunes et furent payées 104 sous de 2 gros l’aune carrée . L’année suivante, Jean De Rave (nom qui est peut-être mal lu) reçut le solde du prix de 507 aunes de tapisseries représentant l’histoire d’Annibal . Cette dernière avait été, en 1466, donnée par le duc Philippe de Bourgogne au pape Paul II; elle consistait en six pièces, ornées des armoiries du donateur .
Une influence heureuse a évidemment présidé à cette période de l’existence du métier. Cette influence, c’est celle du peintre Roger Vander Weyden, qui, depuis la mort de Jean Van Eyck jusqu’à son décès, en 1464, occupa sans contestation le premier rang parmi les peintres flamands ou belges. Sorti de l’atelier de Jean, qui ne communiqua qu’à lui seul les procédés dont il avait enrichi l’art de la peinture. Roger succéda à la réputation de son illustre maître. Il n’avait pas encore visité l’Italie qu’il y avait déjà des imitateurs ; il n’était pas mort qu’on y exaltait son talent ; ses cendres étaient à peine refroidies que l’on y célébrait à la fois le disciple et le maître:
Il gran Joannes, el discepol Rugero .
Cet artiste éminent, dont le souvenir devait se perdre dans sa patrie et dont les actions devaient être attribuées: eh partie à un Roger de Bruges qui n’exista jamais, en partie à un Roger Vander Weyden qui n’eut de son bisaïeul que le nom et la profession, mais de qui on ne connaît pas un tableautin , cet artiste éminent, dis-je, exerça une action dont chaque jour on constate de plus en plus l’étendue. Ses élèves, parmi lesquels il faut ranger Memling, Schongauer et peut-être Antonello de Messine, dont les œuvres présentent tant d’analogie avec celles du peintre de la châsse de Sainte-Ursule, répandirent au loin ses enseignements et ses procédés, et les premiers graveurs subirent évidemment l’influence de ses compositions, dont quelques-unes ont longtemps joui d’une réputation méritée.
L’art de la tapisserie ne put se soustraire à l’ascendant de cet homme supérieur. Les lignes suivantes, empruntées à la biographie de Roger de Bruges par Van Mander, en sont la preuve. «A cette époque, dit l’artiste écrivain, on
» avait encore l’habitude de garnir les salles, comme de
» tapisseries, de vastes toiles sur lesquelles étaient peintes de
» grandes figures au moyen de couleurs à la colle ou au
» blanc d’œuf. En cette sorte d’ouvrages, Roger était un excellent
» maître, et je crois avoir vu de lui, à Bruges, plusieurs
» de ces toiles, qui étaient merveilleuses pour le temps
» et dignes d’éloges, car, pour exécuter de grandes figures,
» il faut avoir du génie et posséder à fond la science du
» dessin, dont les défauts sont beaucoup moins apparents
» dans les peintures de moindre dimension .» En effet, on a cru remarquer dans une Adoration des Rois, de la Pinacothèque de Munich, le résultat des habitudes contractées par le maître en travaillant, à la détrempe, à des cartons pour tapis. Dans ces derniers, les couleurs doivent être moins fondues et les contours plus accusés que dans la peinture à l’huile. Roger se sera accoutumé à cette manière, comme il arrive aux artistes qui se sont longtemps occupés de fresques .
Ces rapprochements, qui restaient dans le vague il y a vingt ans, lorsque nous écrivions les lignes dont nous donnons ici la reproduction, ont pris corps depuis que l’on connaît les tapisseries de Berne et de Madrid, où se révèle la sûreté de main, l’imagination féconde d’un grand maître. Il n’est plus douteux aujourd’hui que Roger a tracé des cartons pour les tapissiers en même temps qu’il peignit à l’huile. Le métier n’a peut-être fait choix de la chapelle-Saint-Christophe, située vers le milieu de la rue de Ruysbroeck, pour y placer le siège des opérations de vérification et de scellage des tapisseries, que parce que la maison de Roger, rue de l’Empereur, était pour ainsi dire contiguë. Circonstance curieuse: Roger meurt le 16 juin 1464; bientôt on ne considère plus le scellage comme nécessaire et la chapelle Saint-Christophe cesse d’être le lieu affecté à l’examen des tentures nouvelles .
Aucune œuvre de Roger n’avait plus de réputation que ses tableaux de l’hôtel de ville de Bruxelles, tableaux dont l’exécution est antérieure à l’année 1441 . Ils ont par malheur disparu, probablement depuis le bombardement de Bruxelles en 1695, mais ils revivent dans les tapisseries conservées à Berne depuis le pillage par les Suisses du camp de Charles-le-Téméraire, après les défaites de ce prince à Granson et à Morat. Reproduites une première fois en gravures à l’eau forte dans l’ouvrage de M. Achille Jubinal, les Anciennes Tapisseries historiées , elles ont depuis été photographiées en plusieurs formats et il en a été publié des fragments en différents endroits . Une première question se présente: ces tentures constituent-elles une imitation complète des tableaux? Ont-elles été travaillées d’après des cartons spéciaux?
Après avoir penché pour la seconde de ces hypothèses, nous inclinons vers la première. La reproduction des longues inscriptions des tableaux, celle de tous les épisodes qui y sont mentionnés, le caractère archaïque des compositions, dont la partie inférieure laisse à désirer, où l’on ne réserve au ciel qu’un espace ménagé d’une main avare, comme si le peintre hésitait à s’engager dans les perspectives; tout, en un mot, décèle les premiers tâtonnements d’un artiste. D’autre part, les groupes sont bien espacés, les têtes pleines de caractère et de naturel, les étoffes et autres accessoires rendus avec cette supériorité qui fut toujours l’une des qualités distinctives de l’art flamand.
Les tableaux de Vander Weyden ayant fait l’objet de plusieurs travaux et les tapisseries de Berne ayant déjà été décrites , nous n’en dirons pas davantage. Remarquons-le toutefois, la photographie nous explique, mieux que les descriptions ne l’avaient fait, la disposition des tableaux de Roger. Il y en avait un grand et deux autres de moindre largeur. Sur le grand on voyait Trajan imploré par une veuve et le même empereur faisant exécuter le coupable dont cette veuve s’était plainte; sur le deuxième, le pape Grégoire célébrant la messe, puis contemplant la tète de Trajan, dont la langue s’était conservée pour attester à jamais l’intégrité de ce monarque; enfin, sur le troisième, Herkenbald était représenté tuant son fils et, plus loin, recevant miraculeusement l’hostie consacrée.
Contemplée par tous les princes qui visitèrent l’hôtel de ville, depuis le milieu du XVe siècle jusqu’à la fin du XVIIe, exaltée par une foule d’écrivains: le bohémien Schaschek, Albert Dürer, don Calvete de Estrella, Guicciardin, Lampsonius, etc., l’œuvre de Roger, où dominait un sentimentalisme profond, devint et resta populaire. En 1513, l’Histoire d’Herkenbald fut encore reproduite en tapisserie, pour l’église Saint-Pierre, de Louvain, comme nous le dirons bientôt; en 1553, Henri Aldegraver, élève d’Albert Dürer, prit encore pour sujet d’une de ses gravures: le comte Archambault, qui coupe la gorge à un de ses neveux parce qu’il avait attenté à la chasteté de plusieurs femmes, gravure que l’on intitule d’ordinaire: le Père sévère .
On a signalé dans quelques-unes des tapisseries de Berne une particularité que nous ne pouvons passer sous silence. On y voit, dans le haut, un petit écusson d’argent au chef d’azur? Est-ce une altération des armoiries de Louvain, qui sont, comme on sait, de gueules à la fasce d’argent? Faut-il y voir un témoignage de la provenance des tapisseries? N’est-ce qu’une attribution à Herkenbald, que l’on disait être comte du Burban ou Brabant, de l’écusson des premiers comtes de Louvain? Il y eut certainement des tapissiers de haute-lice à Louvain , mais si peu, qu’en 1513, lorsque l’église Saint-Pierre voulut se procurer une tenture historiée, ce fut à un maître de Bruxelles qu’elle s’adressa. Ces suppositions paraissent donc douteuses.
Quelques autres tapisseries offrent de grandes ressemblances avec celles dont nous venons de parler. Elles représentent l’Histoire de Jules César. Les défauts, comme les qualités, sont les mêmes: groupes accumulés les uns sur les autres; avant-plan et arrière-plan un peu sacrifiés, variété étonnante dans les physionomies, exactitude minutieuse dans la reproduction des armures, masses d’hommes disposées avec art, chocs de cavaliers reproduits avec habileté, tout frappe dans ces compositions. Quel pas immense s’est réalisé depuis l’art timide des tapisseries de Tournai? quel souffle puissant a élevé le peintre au-dessus du miniaturiste? quel souci de l’expression? Appliquez cet accoutrement du XVe siècle, non à des légionnaires, mais aux soldats des princes bourguignons, et vous aurez la véritable reproduction d’une bataille de l’époque du peintre. Les figures principales sont vivantes. Ces traits où la duplicité se trahit ne sont pas ceux de Jules-César, qui avait tant de grandes qualités en même temps que de si étranges faiblesses, mais bien ceux de ce duc affublé par l’histoire de l’épithète de bon, ce duc si fatal à sa famille, dont il hâta la perte pour mieux en recueillir l’héritage; à sa race, dont il prépara la ruine; à ses voisins, qu’il sacrifia à sa politique; à son peuple, dont il fit couler le sang par torrents.
L’Histoire de César est disposée en quatre grandes tentures, dont chacune se compose de deux sujets distincts. On remarque d’abord la formation du premier triumvirat entre Pompée, Crassus et César, et la réception par celui-ci d’une députation des peuples Gaulois. Sur une deuxième tapisserie, César triomphe d’Arioviste, près de Besançon, et, débarqué en Angleterre, emporte une ville d’assaut. Une troisième nous montre le conquérant arrivant au bord du Rubicon, puis renversant avec sa cavalerie les escadrons ennemis; entre ces deux scènes, on distingue un cours d’eau, le Rubicon, des eaux duquel sort une femme vêtue de pourpre, les cheveux tombant sur les épaules, et qui adresse à César ces quatre vers, dont la forme bizarre trahit, chez les artisans qui ont exécuté la tenture, l’ignorance de la langue française:
«Tuy Jule Chesar et les tiens
» Qui te meut prendre tes moyens.
» Contre moy portant mes banières
» Fais tu de mes logis frontières .»
L’entrée triomphale de César et celui-ci siégeant dans le Sénat au milieu de ses ennemis secrets, forment les dernières scènes de cette quadruple composition, que l’on a attribuée, à tort selon moi, à un artiste de la France . La sobriété et la grâce, ces deux qualités qui sont en quelque sorte innées chez les artistes de cette contrée, manquent tout à fait aux tapisseries de la Vie de Jules-César.
Un des sujets affectionnés par le moyen âge était la reproduction des scènes de l’Apocalypse. Il en existe une, très-considérable, dans la cathédrale d’Angers; il y en avait une autre, en une seule tapisserie, à Saint-Lambert, de Liège ; mais on n’en saurait trouver de plus belle que celle qui se conserve à Madrid et que l’on dit avoir été exécutée sur les dessins de Roger Vander Weyden. Un écrivain habitant Liége, M. Wittert , a récemment prétendu que cette dernière sortait des ateliers liégeois et que Roger en avait composé les cartons d’après les conseils du cardinal Nicolas de Cusa, écolàtre de Liège, et du chartreux Denis de Ryckel. La première hypothèse est tout à fait insoutenable; la dernière, pour être acceptée, devrait être étayée de preuves qui jusqu’à présent font défaut, M. Wittert établit entre les tapisseries de Madrid et les gravures sur bois d’Albert Dürer, représentant également l’Apocalypse, une comparaison de laquelle il résulterait, d’après lui, que Dürer a copié Roger et lui est resté très-inférieur. Le plagiat me paraît contestable, puisque Roger n’est pas le seul qui ait traité le sujet en question; quant à la supériorité des tapisseries comme composition, elle ne pourrait servir, si elle était évidente, qu’à faire attribuer à un grand peintre les cartons des tentures.
Les tapisseries de l’Apocalypse figurent dans l’inventaire des meubles et joyaux de Charles-Quint, dressé à Bruxelles au mois de mai 1536 . Elles ont été attribuées à Roger parles critiques allemands , ainsi qu’une suite de sept compositions que des écrivains du XVIIe siècle baptisent du nom des Sept péchés capitaux et consacrées à la Colère, l’Avarice, la Gourmandise, l’Orgueil, la Paresse, l’Envie et la Luxure. Enfin on signale encore une grande ressemblance entre les tapisseries de l’Apocalypse, mentionnées plus haut, et cinq autres: Jésus au Jardin des Olives, Jésus succombant sous le poids de la croix, le Christ en croix, le Christ de la Miséricorde et la Descente de croix. Ces dernières, qui ont quatre mètres de hauteur sur trois de large, «offrent absolument » les mêmes caractères que l’Apocalypse: même divinité, » même ciel, mêmes anges, mêmes personnages, même » richesse d’ornements et de costumes, mêmes groupes, » mêmes paysages, mêmes arbres,» etc. . Ces hypothèses n’ont pu être acceptées que lorsqu’on ne connaissait pas suffisamment les tapisseries de Madrid. Aujourd’hui que l’on en a publié de bonnes photographies, il n’est plus permis d’attribuer à Roger ni les Sept péchés capitaux, ni les Scènes de l’Apocalypse, qui appartiennent évidemment au XVIe siècle. Dans ces dernières, le temple près duquel l’apôtre bien aimé se prépare à écrire les visions est construit en style gréco-romain; notre artiste bruxellois n’a jamais reproduit les formes empruntées à la renaissance, ni abandonné pour elles l’architecture ogivale, cette architecture qui, pendant sa vie et dans sa patrie, enfanta tant de merveilles?
Mais il existe à Madrid une série de cinq tapisseries que l’on attribue avec raison à Vander Weyden et dont la composition rappelle en effet sa manière. Ce sont des sujets religieux, traités avec cette puissance, cette vigueur d’expression qui forment le caractère dominant des œuvres de Roger. Ni son illustre maître, Jean Van Eyck, ni ses propres élèves et, en particulier, ce Memling si remarquable par la grâce et la suavité des productions de son pinceau, n’ont pu inspirer ces productions dans lesquelles se manifeste un profond sentimentalisme. Ces tentures présentent toutes les qualités que conservèrent longtemps les tapisseries flamandes: les scènes y sont multipliées afin d’y attirer et d’y retenir tour à tour le regard dans chacune des parties et les détails sont multipliés avec une profusion qui étonne et charme à la fois. Leur riche bordure est formée de vases desquels jaillissent des arbrisseaux; ces vases sont superposés sur les côtés de la tapisserie, adossés l’un à l’autre en haut et en bas.
1° Notre Seigneur au jardin des oliviers nous montre le Christ agenouillé et les bras étendus, prononçant ces mots: Pater si non potest hic calix...., mots qui sont inscrits dans une banderole. Autour de lui s’étendent des hauteurs boisées et à ses pieds, dans des poses variées et pleines de naturel, dorment trois apôtres. A droite (c’est-à-dire dans la tenture vers la droite), on voit de nouveau ceux-ci, couchés dans un site derrière lequel on remarque une vallée où l’on distingue tout un cortége militaire et, au fond, une grande ville, avec des tours, des églises, etc., ville qui n’est autre que Jérusalem. A gauche cette cité reparait au delà d’un profond ravin et plus haut se trouve un ange entouré de nuages.
2° Jesus-Christ tombe accablé sous le poids de la croix. Le Christ, épuisé de fatigue, est entouré de bourreaux qui le frappent du pied et le meurtrissent de coups de corde; tandis que le vieux Simon essaie de l’aider, un vieux juif montre à celui-ci, en ricanant, la scène principale. De l’autre côté, la Vierge et les saintes femmes s’empressent auprès du Christ en déplorant ses souffrances. Le fond est occupé par des arbres, à droite desquels une imposante escorte sort d’une prison par une grande porte cintrée. Elle est formée de cavaliers: les uns, ce sont des soldats romains, bardés de fer comme les chevaliers du moyen âge; les autres vêtus de robes et la tète couverte d’un turban; parmi ceux-ci on remarque le grand prêtre des Juifs. Des piquiers et des musiciens, ces derniers couverts de casaques bariolées, les précèdent. Dans un coin du même côté, on distingue une ville que domine une montagne où un magistrat préside une assemblée judiciaire. A gauche s’élève une hauteur escarpée, dont le sommet est occupé par des croix; une troupe de soldats conduit au supplice les larrons, dont le dernier est tenu par deux gardes dont l’un a pour coiffure la cagoule des pénitents du midi de l’Europe.
3° Dans le Christ en croix nous voyons Jésus-Christ entièrement nu, sauf un léger vêtement qui lui couvre les reins. Ses traits expriment la douleur au plus haut degré. Au-dessus de sa tète, un écriteau porte l’inscription: Jésus de Nazareth, roi des Juifs, dans les trois langues hébraïque, grecque et latine. Vers le haut est un chœur d’anges; dans le bas un groupe formé de la Vierge et des saintes femmes, qui prient à genoux, et des disciples; saint Jean, agenouillé, embrasse avec ferveur les pieds de son divin maître; à gauche sainte Véronique, près de laquelle sont debout deux vieillards, tient déployé le mouchoir ayant gardé l’empreinte du visage du Sauveur. Au fond on voit: à droite Jésus-Christ portant sa croix et accablé de coups; à gauche un paysage boisé, orné d’édifices de tous genres.
4° Le Christ de la Miséricorde reproduit la scène du crucifiement, qui est placée cette fois dans un paysage splendide, où l’on remarque un lac entouré de bosquets et de riantes campagnes, peuplées d’animaux de tout genre. Des personnages nus semblent prêts à se baigner dans la pièce d’eau. A droite, une jeune femme, les cheveux épars sur le dos, à genoux, reçoit dans une coupe richement ciselée le filet de sang qui jaillit de la poitrine du Christ; elle est entourée de banderoles portant le mot misericordia, et derrière elle, une belle jeune femme, symbolisant sans doute la colère divine apaisée par la mort du Christ, remet l’épée dans le fourreau. En regard de ce groupe s’en présente un autre, plus remarquable encore: la Vierge accablée de douleur est représentée de la manière la plus frappante; saint Jean, avec sa tète expressive, ses cheveux abondants et crépus, réalise un type que l’on peut qualifier d’admirable .
5° Le Christ descendu de la croix présente une grande ressemblance avec le beau tableau du musée de Madrid, où Vander Weyden a traité le même sujet et que la photographie a fait connaître. A notre avis, le sujet y est traité avec plus de talent et d’ampleur et le dessin y est d’une correction où nous reconnaissons la main d’un grand artiste plus que dans le tableau dont nous venons de parler. Le Christ, étendu de gauche à droite, est supporté par plusieurs personnes, dont deux sont placées sur autant d’échelles s’appuyant aux bras de la croix. Près d’un de ces vieillards, dont on remarque la belle tète barbue, est placé un serviteur au type quelque peu grossier, qui, d’une main, retient l’échelle de gauche, et, de l’autre, s’appuie sur la croix, par un geste dont on ne saurait assez admirer le naturel. Joseph d’Arimathie, dont le nom est inscrit sur ses vêtements et qui a à la ceinture une escarcelle, supporte, avec vigueur et respect, le poids du corps du Christ, dont les pieds sont soutenus par une jeune femme, ayant la chevelure contenue par une résille, et richement vêtue d’une robe élégante, ouverte sur les côtés. A l’avant-plan sont disposés les autres acteurs habituels de cette scène dramatique: à gauche, la Vierge levant les bras vers le corps de son Fils et qu’une femme aide, par un geste plein de sollicitude, et saint Jean; à droite, une autre jeune femme, à genoux, regarde le Christ dans une pose et avec un geste plein de grâce et de naturel. Tout en haut on voit deux anges; le paysage du fond présente: au milieu, une grande ville, ayant à gauche une montagne surmontée de trois croix, et à droite, une hauteur boisée.
Les détails qui précèdent, en établissant l’originalité et la valeur des tapisseries, attestent aussi le talent de celui qui en a donné les modèles. Ils n’ont jamais été communs les hommes qui ont su donner à leurs œuvres ce cachet particulier. Les tentures mêmes appartiennent bien au XVe siècle, comme les détails que l’on y remarque en font foi, leur origine flamande, ou plutôt belge, est également incontestable; enfin, les ressemblances que certains personnages présentent avec les mêmes types reproduits par Vander Weyden, permettent de les attribuer soit à ce peintre, soit à ceux, artistes ou hauts-liciers, qui travaillaient sous sa direction .