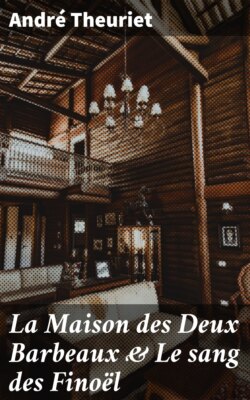Читать книгу La Maison des Deux Barbeaux & Le sang des Finoël - André Theuriet - Страница 4
I
ОглавлениеEn1860, la raison sociale:–Lafrogne père et fils, droguistes à Villotte,–figurait encore en tète des factures de la maison, bien que, depuis plu-sieurs années déjà, Lafrogne père dormît sous les hautes herbes du cimetière Sainte-Marguerite. Cet établissement, fort achalandé, était connu dans tout le Barrois sous le nom de Magasin des Deux Barbeaux, grâce à l’idée ingénieuse du père Lafrogne, qui avait pris pour enseigne les armes de Villotte: «deux barbeaux adossés, sur champ d’azur semé de croizettes d’or.»
Situé rue du Bourg, dans un quartier mi-bourgeois et mi-commerçant, la maison Lafrogne est un des spécimens les plus purs de l’architecture lorraine de la fin du XVIe siècle. La façade, bâtie en pierre dure de Savonnières, a pris avec le temps de jolis tons d’un gris rosé. La porte d’entrée en bois plein, délicatement ouvragée et agrémentée d’un heurtoir en fer, est encastrée dans une arcade dont un chérubin joufflu forme la clé, et dont l’entablement est lui-même surmonté d’un cartouche qui renfermait jadis les armoiries du seigneur du logis, mais où maintenant s’étale prosaïquement le numéro de la maison. Les chambranles des fenêtres sont ornés de sirènes, sculptées en haute bosse, qui sortent la poitrine nue d’une gaîne de feuillage, et soutiennent de leurs têtes fines et rieuses un fronton échancré. Pour relier les détails de cette décoration élégante et sobre, de légers pilastres cannelés séparent les croisées à petits carreaux verdâtres, et sur leurs chapiteaux corinthiens s’appuie la frise d’un attique percé de doubles lucarnes; l’ensemble est complété par une dernière corniche où surplombent à chaque extrémité des gargouilles de pierre qui, dans les jours d’orage, versent sans façon les eaux pluviales sur la tète des passants.
La maison se compose de deux corps de logis séparés par une cour intérieure. En1860, la portion donnant sur la rue du Bourg était réservée à l’habitation; les bâtiments de derrière, communiquant avec la rue de la Municipalité, comprenaient la foulerie, le pressoir, les bureaux et surtout les magasins, qui occupaient presque tout le premier étage. Là, de vastes pièces sèches, aérées et profondes, prolongeaient en enfilade leurs cloisons garnies dans toute la hauteur de casiers à tiroirs; deux rangées de buffets massifs formaient au milieu un couloir obscur, tandis qu’au long des murailles s’alignaient des tonneaux ventrus, pleins jusqu’aux bords des substances sans nombre employées dans la droguerie: gommes-guttes, couperoses, bois de Brésil, garance, avelines et roses de Provins, jujubes et fleurs de bouillon blanc. Au plafond pendaient des fagots de bois de réglisse, des bottes d’armoise et de mélilot, de gigantesques chapelets de racines d’iris et de têtes de pavot. Quand parfois le soleil, filtrant à travers les guirlandes séchées, envoyait sa lumière oblique dans ce fouillis, des flots d’atomes odorants s’envolaient de tous côtés et teignaient les rayons lumineux de couleurs étranges. Parfois aussi, d’un tiroir entr’ouvert, une aromatique senteur de vanille ou de noix muscade s’exhalait au passage et faisait rêver à la flore merveilleuse et lointaine des Antilles ou des Indes hollandaises.
Pour dire la vérité, personne ne rêvait guère dans cette maison des Deux Barbeaux. Les fils de Claude Lafrogne n’étaient pas enclins à de pareilles distractions. L’aîné, Hyacinthe, touchait à ses cinquante ans, et Germain, le cadet, en avait près de quarante. Restés célibataires, ils vivaient avec leur tante Lénette (diminutif de Madeleine), une verte vieille fille de soixante-douze ans, sœur de feu Mme Lafrogne, qui les avait bercés au maillot et qui depuis les avait élevés, catéchisés et dorlotés avec un dévouement infatigable. Mlle Lénette était la cheville ouvrière de la maison, elle tenait les clés des armoires, réglait la dépense, ordonnait les repas et répondait de tout. C’était une grande et maigre personne, ne perdant pas un pouce de sa longue taille, alerte et d’une propreté méticuleuse, fort dévote, très-rigoureuse pour elle-même et pour les autres, toujours levée avant le jour et ne laissant pas aux servantes le temps de bayer aux corneilles; au demeurant, une fille de grand sens et de bon conseil, très-respectée de ses neveux, qui ne concluaient jamais une affaire avant de l’avoir consultée.
Hyacinthe était son Benjamin, bien qu’il eût déçu les espérances et les ambitions de la famille. Au collégè, il avait eu la réputation d’un fort en thème, et le père Lafrogne s’était nourri de l’espoir de voir son aîné entrer dans la magistrature. On l’avait en conséquence envoyé à vingt ans faire son droit à Paris, et, comme la tante Lénette ne pouvait se décider à l’abandonner seul dans cette ville de perdition, elle l’y avait suivi. Logé derrière Saint-Sulpice, rue du Ganivet, obligé de passer par la chambre de sa tante pour rentrer dans la sienne, Hyacinthe avait vécu quatre ans à Paris sans se douter des plaisirs ni des dangers de la grande ville. Il était revenu à Villotte avec son brevet de licencié et toutes les innocentes candeurs d’un jeune homme qui n’a vu le monde qu’à travers les fumées d’encens de l’église Saint-Sulpice. Ingénu et rougissant comme une jeune fille, naïf comme un enfant et d’une simplicité touchante, il ne pouvait croire au mal. Les hâbleries et les duplicités de la chicane étaient pour lui lettres closes; aussi fit-il un détestable avocat.
L’histoire de l’unique plaidoirie d’Hyacinthe Lafrogne sert encore aujourd’hui de thème aux plaisanteries de la basoche de Villotte. Il avait été chargé de défendre d’office une femme accusée d’avoir volé une paire de bas. Le délit était patent, la prévenue ayant été trouvée nantie des objets volés; Hyacinthe n’en plaida pas moins l’innocence de sa cliente.
–Messieurs, dit-il d’une voix honnêtement émue, quand Pharaon, roi d’Egypte, fit rechercher la coupe qui lui avait été dérobée, on la retrouva dans le sac de Benjamin, et cependant Benjamin était innocent: tel est le cas de ma cliente...
Pardon, maître Lafrogne, interrompit le président, qui avait l’humeur bourrue et narquoise, Benjamin n’avait pas mis lui-même la coupe dans son sac, tandis que votre cliente avait mis à ses pieds les bas en question. Votre argument pèche par la base.
Les saute-ruisseau, l’huissier audiencier, le greffier et le ministère public lui-même partirent d’un si bel éclat de rire que le débutant s’embrouilla dans sa harangue, bredouilla et se rassit tout mortifié. La cause était entendue. Hyacinthe quitta l’audience en jurant qu’on ne l’y reprendrait plus. Épices pour épices, dit-il à son père, j’aime encore mieux en vendre que d’en recevoir.
Ce fut la seule malice qu’il se permit pour soulager son cœur.
Il était à cinquante ans tel qu’il s’était montré à vingt-quatre. Ses cheveux avaient grisonné, mais ses joues étaient roses, et ses yeux bleus avaient conservé leur limpidité enfantine. En fait de femmes, il n’avait jamais connu que la tante Lénette; ce sexe lui faisait peur et jamais on n’avait pu le décider à se marier. Casanier et même un peu tatillon, il se plaisait au logis, tenait les livres, s’occupait de la correspondance et se récréait le soir en lisant des tragédies classiques et des romans de chevalerie. On le rencontrait parfois le dimanche, après les vêpres, sur les bords du canal, marchant le dos un peu voûté à cause de sa grande taille frêle. Il portait encore, comme au temps passé, de petits anneaux d’or aux oreilles; il était vêtu d’une antique et longue redingote noisette; ses chemises, façonnées à la vieille mode, avaient des devants plissés à la main, sur lesquels tombaient gauchement les bouts d’une cravate noire frippée; son pantalon de lasting, trop court, laissait voir de gros bas tricotés par Mlle Lénette, et des souliers noues de cordons trop longs; il y avait dans sa mise quelque chose de suranné, de naïf et de flottant comme son propre esprit.
Germain, le cadet, était d’humeur aussi sauvage, mais d’un tout autre tempérament; sauf en un point: leur commune aversion pour le mariage,–les deux frères différaient de goûts, de caractère et de tournure. Tandis qu’Hyacinthe, paisible, frileux et sédentaire comme un chat domestique, redoutait le bruit et les exercices violents, Germain était un marcheur infatigable et un farouche chasseur. Grand, bien râblé, haut en couleur, barbu, il avait l’œil vif, un nez en bec d’aigle, de belles dents blanches et des éclats de voix retentissants comme la fanfare d’un cor. Tout le temps que lui laissaient les achats et la vente était consacré à la chasse. De septembre à mars, on entendait sa trompe et les aboiements de ses chiens résonner dans les grands bois qui avoisinent Villotte. Moins novice qu’Hyacinthe et plus tourmenté par le sang, il était aussi moins vertueux, et les mauvaises langues prétendaient qu’il se permettait de temps à autre quelques escapades à Cythère; mais il se montrait sur ce point fort secret et réservé, et il y a lieu de croire que ses aventures galantes se bornaient à de brèves et brusques amourettes de chasseur.
Ces divergences de caractère n’empêchaient pas les deux frères de s’aimer et de vivre en bon accord. Ils s’étaient créé, en compagnie de la tante Lénette, un petit monde à trois qui leur suffisait. Du1er janvier à la Saint-Sylvestre, leur vie coulait paisible et méthodique. En hiver, après la fermeture du magasin, ils se réunissaient dans la salle à manger du rez-de-chaussée, et attendaient l’heure du souper autour du poêle qui ronflait doucement. Hyacinthe lisait, Germain nettoyait son fusil, la tante tricotait, et l’unique servante, Catherinette, filait au rouet près de ses maîtres.
Le dimanche, Hyacinthe, qui était resté fort pieux, accompagnait à la grand’messe de Notre-Dame la tante Lénette, parée d’une antique robe de taffetas marron et d’un châle fond blanc à palmettes multicolores; au retour, on s’arrêtait chez le pâtissier de la rue Entre-Deux-Ponts, et on y achetait invariablement quatre petits pâtés chauds qui constituaient l’extra du dîner dominical, et qu’Hyacinthe emportait précieusement dans un papier gris.
En été, dès la Saint-Jean, la tante et Germain allaient s’installer dans une ferme que la famille possédait à Rembercourt, aux bords de l’Ornain, et à six kilomètres de la ville. Mlle Lénette y passait toute la belle saison; elle y faisait sa récolte de fruits, ses conserves et ses confitures, et ne rentrait à Villotte qu’en octobre, pour la vendange et la lessive. La simplicité de ce modeste train de vie permettait aux Lafrogne de réaliser de belles économies. Leurs rentes montaient par an à vingt-cinq mille francs; ils en dépensaient six mille à peine; et le chiffre de ces revenus accumulés avait fini par doubler le capital. Les gens de Villotte faisaient des gorges chaudes sur les habitudes parcimonieuses des deux frères. On les accusait d’être par trop regardants. La société bourgeoise les considérait comme deux ours qu’il fallait renoncer à apprivoiser; mais les boutiquiers, tout en se moquant de leurs toilettes et de leurs allures, les estimaient à cause de leur fortune et de leur solidité commerciale. Quant au menu peuple, qui a une aptitude spéciale pour saisir les rapports comiques des choses et caractériser d’un mot les ridicules des gens, il les avait surnommés «les deux Barbeaux», et le nom leur était resté.
Les plaisanteries des habitants de Villotte effleuraient à peine l’épiderme des «deux barbeaux». Ils laissaient rire et, le dimanche soir, en compagnie de la tante et d’un vieil ami d’Hyacinthe, nommé M. Nivard, ils se gaussaient à leur tour des ménages de notaires et d’avoués où l’on se ruinait en bons dîners, tandis que les enfants allaient à l’école en bas troués et que les filles coiffaient sainte Catherine. Ils se consolaient de tous les quolibets en savourant les joies intimes de cette vie à trois que pas un nuage n’avait troublée depuis la mort de Lafrogne père.
La tante Lénette leur épargnait tous les soucis du ménage. Ils ignoraient les agaçantes préoccupations qui empoisonnent la vie des célibataires. Ils trouvaient toujours leur linge préparé à point et en parfait état, leur diner servi au coup de midi, leurs paletots d’hiver bien doublés et douillets dès le premier givre, et leurs vêtements de toile fleurant la lessive, dès que les chaleurs de juin dardaient dans les rues du bourg. Rien ne leur manquait, et, pour achever de leur dorer l’existence, de beaux biens au soleil les assuraient contre les hasards des crises commerciales et les troubles des révolutions.
Leur ferme de Rembercourt était d’un bon rapport, les futaies de leurs bois de Fains faisaient l’admiration du pays, et leurs vignes de la côte Notre-Dame, exposées en plein midi, dans une coulée qu’on nomme le Cugnot et où la réverbération de deux pentes caillouteuses ferait mûrir des oranges, leurs vignes donnaient un petit vin de pineau qui, pour son bouquet délicat et sa jolie couleur groseille, n’avait pas son égal dans toute la contrée.
Ils vivaient ainsi d’une vie bourgeoise et doucement heureuse, quand, un soir de mars1862, un incident fort inattendu jeta la perturbation dans ce milieu paisible, comme une pierre lancée dans un buisson met en émoi une bande d’étourneaux qui y picoraient tranquillement.
Le crépuscule était tout à fait tombé. Catherinette venait de poser la lampe sur le marbre du poêle, auprès duquel Hyacinthe lisait l’histoire de la Belle Mélusine; Mlle Lénette dressait le couvert, et Germain, qui rentrait de la passe aux bécasses, était en train de déboucler ses guêtres boueuses, quand on heurta à la porte de la rue. Au bout de quelques secondes, Catherinette, qui était allée ouvrir, cria du fond du corridor:
Mademoiselle, c’est le facteur qui a une lettre pour vous... Il dit que c’est huit sous, rapport à un affranchissement insuffisant.
– Insuffisant! s’exclama Germain, diantre soit des maladroits qui ne pèsent pas leurs lettres avant de les jeter à la boîte.
–Faut-il la refuser? demanda la tante.
–Non, répondit le scrupuleux Hyacinthe en interrompant sa lecture, il ne faut jamais refuser une lettre... J’y vais.
Il s’enfonça dans l’ombre du corridor, à l’extrémité duquel la lanterne du facteur brillait sous le porche comme un ver luisant; puis, ayant payé les huit sous, il rentra en soupesant une enveloppe carrée bordée d’un large liséré noir. – Elle pèse lourd, en effet, fit-il, elle est timbrée de Paris et à votre adresse, ma tante.
– Voilà qui est bizarre, murmura la vieille fille, qui devint rêveuse; lis-nous cela, Hyacinthe, moi je n’ai pas mes lunettes.
Hyacinthe déchira l’enveloppe et en tira une feuille de vélin épais et cassant comme du carton.
– Sac à papier! s’écria-t-il, quel luxe! je ne m’étonne plus que le poids ait été dépassé.
– Quand on se donne de ces genres-là, grommela Germain, on pourrait bien aussi faire la dépense de deux timbres.
– Quelles pattes de mouche!poursuivait Hyacinthe. Il se rapprocha de la lampe et parvint enfin à lire: «Ma chère parente...»
Il s’interrompit d’un air ébaubi. Germain, de son côté, avait poussé une exclamation, et Mlle Lénette, qui disposait les assiettes sur la table, s’était arrêtée au milieu de sa besogne.
– Ah! dit-elle, ce doit être de votre cousine de Paris. Continue, Hyacinthe.
Il reprit: «Ma chère parente,
Bien que nous nous soyons à peine connues, permettez-moi de me rappeler à votre souvenir dans les douloureuses circonstances où je me trouve.
Peut-être ignorez-vous encore le malheur qui m’a frappée: M. de Goulaines, mon mari, est mort il y a un an. Lorsque cette affliction m’a été envoyée, j’étais tellement anéantie que j’ai laissé à des amis le soin de vous en faire part, et peut-être ma lettre de deuil ne vous est-elle point parvenue. Veuillez m’excuser, et, bien que l’éloignement ait depuis trop longtemps interrompu nos relations de famille, je ne doute pas que l’excellente sœur de mon père ne sympathise avec mes chagrins; aussi je me permets de vous écrire pour vous demander conseil.
Mon pauvre mari, qui était dans l’industrie, est mort laissant des affaires fort embrouillées, et, tout compte fait, il ne me reste plus qu’une rente de. trois mille francs. C’est bien peu, même en province; à Paris, c’est presque la misère, surtout quand, comme moi, on a une fille de dix-huit ans. Laurence vient de passer brillamment ses examens à l’Hôtel-de-Ville, et elle a un diplôme qui lui permettra de se caser comme institutrice quelque part; mais, en attendant qu’elle trouve une bonne place, grâce aux belles relations que nous avons conservées, j’ai dû me préoccuper des nécessités de la vie et je me suis résignée à quitter Paris pour m’établir en province. Une fois ce parti pris, je devais naturellement songer à choisir pour résidence la ville où je suis née et où j’ai encore des parents.
Je viens donc vous prier, ma chère tante, de vouloir bien m’aider de votre expérience. Je voudrais trouver un petit appartement modeste et convenable tout à la fois, dans les prix de quatre ou cinq cents francs. Mes cousins, dont je serai heureuse de faire la connaissance, pourront sans doute facilement me dénicher cela. Je n’attends plus que votre réponse pour m’occuper de mon déménagement, et je compte, si elle est favorable, me mettre en route avec Laurence dès les premiers jours d’avril.
Veuillez, ma chère parente, excuser la liberté que je prends et agréer les affectueux respects de votre nièce, qui vous embrasse de tout cœur, ainsi que ses cousins.
ROSINE DE COULAINES.»
Il y eut un moment de profond silence tandis qu’Hyacinthe repliait machinalement le papier qui craquait dans ses doigts.
– Voilà une tuile! s’exclama tout à coup Germain, il n’y a que des Parisiens pour agir avec ce sans-façon!.. Une parente que nous ne connaissons ni d’Ève ni d’Adam, et avec laquelle en trente ans nous avons à peine échangé deux lettres!
Mlle Lénette ne répondait pas. Elle restait rêveuse, les sourcils froncés, et semblait fouiller dans ses souvenirs.
– Si ces dames viennent demeurer à Villotte, nous aurons souvent leur visite! ajouta Hyacinthe, qui se sentit un frisson dans le dos rien qu’à l’idée d’être obligé de recevoir les deux Parisiennes.
– Il faut jeter la lettre au panier, et voilà tout! reprit violemment Germain; nous ne les avons jamais vues, et franchement nous ne pouvons pas de gaité de cœur bouleverser notre vie pour deux étrangères...
– Ce sont vos cousines, les propres enfants de mon frère Thoiré, objecta Mlle Lénette sortant tout à coup de sa méditation.
– Mais, tante Lénette, vous ne nous aviez jamais parlé de ces parentes-là?
– C’est vrai, je les avais quasi oubliées. Depuis son installation à Paris, mon frère Edme Thoiré nous avait un peu oubliés lui-même. Sa fille avait épousé un M. de Coulaines, un songe-creux qui avait la tête pleine de belles inventions et le gousset toujours vide. Je me souviens qu’il essaya une fois d’emprunter de l’argent à votre père; Lafrogne refusa net, ce qui jeta un froid entre les deux familles, et depuis on cessa de s’écrire. Sa veuve et sa fille n’en sont pas moins vos proches parentes, mes enfants, et vos seules parentes.
– Bah! matante, s’écria Germain, qu’a-t-on besoin de tant de parents? A nous trois, nous nous suffisons et nous sommes heureux, c’est l’essentiel!
– Tu as raison, mon garçon, et je ne me plains pas... C’est égal, poursuivit Mlle Lénette, en jetant un regard mélancolique vers le vieux baromètre pendu entre les deux fenêtres, je ne puis m’empêcher d’avoir un fond de tristesse quand je me reporte à cinquante ans en arrière, quand je songe comme notre famille était nombreuse et comme elle s’est fondue avec le temps!.. Si mon père Jean Thoiré revenait au monde, il serait bien marri en voyant sa maison sans enfants, lui qui prétendait qu’avec ses trois filles et son garçon il peuplerait toute la rue du Bourg... Je me rappelle que la dernière fois que nous nous sommes trouvés réunis, c’était à l’occasion de ton baptême, Germain. Mon frère Thoiré, le père de cette Rosine qui m’écrit, était venu exprès de Paris avec sa petite; il y avait aussi ma sœur Loulette, la religieuse; toute la famille était là. – Ma fi! dit mon père, puisque nous voilà tous en famille, il faut, avant la cérémonie, que je voie encore une fois mes enfants et petits enfants rassemblés sous le même plafond. On monta donc dans la chambre verte où ta mère Mimi, qui relevait de ses couches, était alitée; toi, tu geignais doucement près d’elle, dans ta barcelonnette. Quand nous fumes tous montés et rassemblés près de l’accouchée: – Ça, comptons-nous d’abord, reprit le père. Et il se trouva que nous étions sept, en comptant la petite Rosine, Hyacinthe, et le nouveau-né. On se plaça par rang d’âge; le père d’abord, puis mon frère Edme qui était l’aîné, puis Loulette, moi ensuite, enfin Mimi dans son grand lit, et les marmots près du berceau. – Allons, mes enfants, dit le père, je suis content de vous voir encore une fois tous dans ma maison... Embrassons-nous! – Alors il embrassa sur les deux joues mon frère Edme, celui qu’on appelait Thoiré tout court, à cause de sa qualité d’aîné; Edme embrassa Loulette, et ainsi le baiser de famille fit tout le tour du cercle jusqu’à la petite Rosine, qui te le donna, à toi Germain, en se haussant sur ses petons pour atteindre ta tête dans la barcelonnette haut perchée... Et, depuis, nous ne nous sommes plus retrouvés ensemble, ajouta la tante Lénette, en se mouchant bruyamment pour dissimuler son émotion.
Hyacinthe, de son côté, écrasait une larme dans les coins de ses yeux, et Germain alla gravement embrasser la tante.
– Voilà pourquoi, continua Mlle Lénette en replaçant son mouchoir dans sa poche toute bruissante de trousseaux de clés, il ne faut pas se montrer trop dur pour cette cousine, qui est une Thoiré, après tout... Néanmoins, mes enfants, vous êtes les maîtres, et ca que vous ferez sera bien fait.
–Il suffit, ma tante, je leur écrirai demain qu’elles peuvent venir, répondit Hyacinthe avec un soupir.
– C’est entendu, fit Germain, et moi je m’occuperai de leur trouver un logement... Maintenant, si nous soupions!