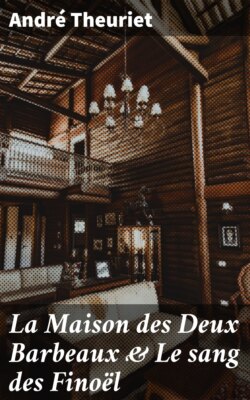Читать книгу La Maison des Deux Barbeaux & Le sang des Finoël - André Theuriet - Страница 5
II
ОглавлениеQuinze jours après, Hyacinthe, prévenu par un billet de Mme de Coulaines, endossait sa redingote noisette et se rendait à la station de Villotte pour y attendre ses cousines qui devaient débarquer par le train de cinq heures. On entrait en avril; mais, comme il arrive fréquemment dans ce bon pays du Barrois, le renouveau débutait mal. Un vent du nord-ouest chassait dans le ciel de gros nuages noirs qui de temps à autre crevaient en giboulées sur la ville; les gouttières des chéneaux, inondées par ces brusques averses, débordaient bruyamment sur les dalles des trottoirs, et dans les jardins du quai des Gravières les pruniers en fleurs avaient l’air de grelotter sous leur blanche toilette de printemps.
Hyacinthe, tout en se morfondant près de la barrière qui le séparait de la voie, avait fort à faire pour abriter sa redingote sous un vaste parapluie d’alpaga marron. Un long sifflement arriva enfin du fond de la vallée à travers la rafale, et, peu après, le train haletant et fumant s’arrêtait sous la marquise de la station.
Dix ou douze paysans descendirent d’abord des wagons de troisième classe, puis deux dames à la tournure jeune sortirent d’un compartiment de première. L’aîné des Lafrogne, qui de sa vie n’avait voyagé qu’en troisième, regardait avec stupéfaction ces deux belles dames à l’élégante toilette noire, et, ne pouvant croire qu’elles fussent les deux parentes pauvres qu’il attendait, examinait encore s’il ne se trouvait pas sur le quai d’autres voyageuses répondant au signalement; mais tout le monde était bien descendu, et on refermait déjà les portières.
Les deux dames, relevant leurs jupes, hésitaient à quitter la marquise, et leurs regards inquiets semblaient chercher quelqu’un sur la chaussée où la pluie clapotait.
Hyacinthe prit son grand courage, s’approcha en secouant son parapluie ruisselant, et, s’adressant à la plus âgée, demanda timidement si ce n’était pas à madame de Coulaines qu’il avait l’honneur de parler. Puis, en rougissant, il ajouta:
– Je suis Hyacinthe Lafrogne.
– Oh!mon cher cousin, s’écria la dame avec volubilité, que je suis aise de vous voir!.. mais quel temps, dites-moi! Nous sommes déjà trempées...
Elle l’embrassa sans façon et lui présenta sa fille Laurence. Celle-ci, à demi-aveuglée par la pluie qui fouettait ferme, lui tendit la main, tandis que ses deux grands yeux noirs lorgnaient curieusement la figure falote de ce singulier cousin.
– Quel temps! répéta Mme de Coulaines; Laurence, occupe-toi de nos caisses.
On entra dans la salle des bagages. Ces dames en avaient à elles seules une charretée. Hyacinthe contemplait d’un air effaré cet empilement de malles et de sacs de voyage.
– Avez-vous une voitufe, mon cousin? demanda Mme de Coulaines.
–Une voiture!.. non, mais j’ai amené avec moi notre garçon Césarin, qui transportera vos colis sur sa brouette. Quant à nous, ma cousine, nous pouvons partir à pied.
– A pied? Il pleut à verse! s’écria la dame en regardant le ciel ruisselant.
– Oh! ce n’est qu’une allevasse (une giboulée), balbutia humblement Hyacinthe, et nous ne demeurons pas très-loin de la gare.
Il donna ses instructions à Gésarin; puis, rouvrant son large parapluie, il offrit le bras à Mme de Coulaines et l’on partit. Laurence, mal abritée sous son en-tout-cas, les suivait en sautillant de pavé en pavé, et de temps à autre jetait un regard mélancolique sur la boue qui mouchetait ses souliers molière à hauts talons. Ils traversèrent ainsi toute la rue Entre-Deux-Ponts, dont les boutiquiers, assis derrière leurs vitrines, examinaient sournoisement les deux Parisiennes escortées par l’aîné des Barbeaux.
– Nous voici chez nous, dit enfin Hyacinthe en heurtant à la porte de la rue du Bourg.
Catherinette était accourue au coup de marteau. Lafrogne introduisit dans le vestibule ses parentes, qui secouèrent sans façon leurs jupes trempées sur le carrelage blanc et noir scrupuleusement lavé et frotté chaque jour par la vieille servante.
Droite dans sa robe de laine et sous son bon-net de linge à grands tuyaux, Mlle Lénette, accourue pour souhaiter la bienvenue à ses nièces, se tenait sur le seuil de la salle à manger. Ses yeux gris perçants dévisagèrent les deux Parisiennes, sans qu’un trait de sa physionomie prudente et froide révélât ses impressions. Elle embrassa gravement la mère et la fille et reçut sans sourciller leurs bruyantes accolades. Puis, comme Césarin venait d’arriver avec les malles, elle engagea les deux voyageuses à monter dans leurs chambres afin de changer de vêtements.
L’appartement réservé à Mme de Coulaines et à sa fille était situé au premier, sur la rue, en face de celui où couchaient Mlle Lénette et Germain. Il se composait d’une grande pièce, désignée par les maîtres du logis sous le nom de la «chambre verte», et d’un cabinet contigu où la tante serrait ses robes et emmagasinait ses conserves.
– Voici votre chambre, Rosine, dit Mlle Lénette en poussant la double porte du palier, et voici la vôtre, ma mie, ajouta-t-elle en désignant à Laurence la porte vitrée du cabinet. Vous resterez avec nous jusqu’à ce que vous puissiez vous installer dans le logement que Germain a retenu... Maintenant, mettez-vous à votre aise, et, si vous avez besoin de quelque chose, appelez Catherinette.
Césarin venait de déposer en soufflant le dernier colis sur le parquet. Il redescendit avec la tante Lénette. – Ouf! dit-il en passant à. Catherinette, en ont-elles emporté des affutiaux, vos Parisennes? J’en avais ma charge, vrai!
– Tout ça c’est des arias! grogna la vieille servante, qui essuyait en rechignant le carrelage boueux du vestibule.
Pendant ce temps, Mme de Coulaines et sa fille, dépaysées comme des oiseaux qu’on a changés de cage, restaient gelées et immobiles au milieu de la chambre verte. Austère, glaciale, sans feu, sans tapis, sans bourrelets aux portes, avec ses murailles tendues de verdures, sa glace en deux morceaux, ses fenêtres drapées de maigres rideaux de damas fané, cette pièce leur faisait froid dans le dos. Laurence, assise sur sa malle, considérait d’un œil morne la file des petits ronds de sparterie verdâtre qui allait de la porte d’entrée à celle du cabinet, comme pour indiquer aux pieds des hôtes qu’il ne fallait se poser que là, afin de respecter le parquet ciré et luisant comme un miroir. Elle inventoriait d’un air de pitié les fauteuils de paille, les vases de fleurs artificielles, la toilette en forme de trépied antique, le guéridon massif avec un dessus de marbre où s’étalaient un sucrier de cristal taillé et la carafe pareille. Tout ce luxe peu hospitalier des Lafrogne avait pourtant arraché, la veille, une exclamation admirative à Germain, lorsqu’il était venu jeter un coup d’œil sur les apprêts de Mlle Lénctte: –Sarpejeu! matante, s’était-il écrié, vous avez bien fait les choses, et elles seront logées comme des princesses!
A voir leurs mines dédaigneuses, elles ressemblaient en effet à des princesses, mais à des princesses exilées do leur royaume et regrettant amèrement leur nid douillet et capitonné de la rue du Bac.
– Brr! soupira Laurence en secouant ses épaules, c’est un tombeau que cette chambre. Nos cousins ne font donc jamais de feu?
– Que veux-tu? reprit sa mère, ce sont les habitudes parcimonieuses de la province. Nos cousins sont fort riches et ils ne dépensent pas leurs revenus.
– On s’en aperçoit, dit la jeune fille, je suis gelée et je n’aurai jamais le courage de m’habiller.
A la fin elles surmontèrent pourtant l’engourdissement qui les clouait sur place; le sentiment des convenances joint à un réveil de coquetterie les poussa à ouvrir leurs caisses et à procéder minutieusement à leur toilette.
Laurence, qui venait de quitter le deuil, remplaça son costume de voyage par une jolie tunique de velours anglais à deux tons avec les manches et la jupe de soie pareilles. Mme de Coulaines tira du fond de son coffre et revêtit une élégante robe de faille noire. Tous ces apprêts prirent du temps, et, quand les deux voyageuses descendirent, il était sept heures, le souper était servi. Mlle Lénette s’impatientait, et Germain, qui rentrait de la chasse, affamé, commençait à grogner contre les retardataires.
A la vue de leurs cousines, vêtues comme pour une fête, les deux Barbeaux échangèrent avec Mlle Lénette des regards effarouchés. Germain salua gauchement, et la tante s’écria:
– Vraiment, ma nièce, vous avez eu tort de faire des frais de toilette; avec nous il faut agir sans cérémonie.
– Je vous assure, ma tante, répliqua Mme de Coulaines, que telle n’a pas été notre intention. Nous sommes habillées comme à notre ordinaire.
A leur ordinaire !.. Les deux frères en étaient presque suffoqués. Ainsi ces toilettes à tralala étaient leurs vêtements de tous les jours, et elles voyageaient en premières!
– Il n’est pas étonnant, pensaient-ils, qu’en vivant de la sorte elles aient mangé leur dernier sou. – Quant à Mlle Lénette, elle était souverainement choquée en voyant que sa nièce, veuve depuis un an seulement, portait déjà de la soie, ce qui paraissait scandaleux à Villotte, où les veuves portent au moins pendant deux ans leur deuil en laine. Dès ce premier soir, les deux Parisiennes furent étiquetées dans son cerveau comme des créatures frivoles et dangereuses, et Mlle Lénette ne revenait pas facilement sur ses premières impressions.
On se mit à table. Le souper avait été corsé de quelques plats de supplément, en l’honneur des nouvelles venues. Les radis et le beurre dans des bateaux de porcelaine blanche, la rouelle de veau garnie de champignons, le gigot rôti, la salade de barbe de capucin et le gâteau de riz parurent aux deux frères le summum des somptuosités gastronomiques, tandis que Mme de Coulaines et sa fille, imbues de cette idée toute parisienne qu’en province on a de tout à profusion et pour rien, trouvèrent ce menu d’une simplicité voisine de la lésinerie. Au dessert, un fromage du cru, des confitures, une assiette de poires tapées et de cerisesséchées au four, achevèrent de désillusionner ces dames sur les bombances de leurs cousins de Villotte.
La nappe était à peine enlevée qu’on entendit résonner le marteau de la porte d’entrée et que Catherinette annonça M. Nivard, l’ami d’Hyacinthe.
– Oh! vous avez du monde? s’écria le visiteur avant même d’avoir franchi le seuil de la salle à manger, je ne veux pas vous déranger et je m’en vais.
– Non, non, entre donc! répondit le candide Hyacinthe, tu ne nous déranges pas, ce sont nos cousines de Paris, Mmes de Coulaines...
Il s’en doutait parbleu bien, malgré ses mines surprises, et la curiosité seule l’avait poussé à venir ce soir secouer le marteau des Lafrogne, afin d’être l’un des premiers à dévisager de près les fameuses cousines.
Il se coula discrètement près du poêle, en saluant et en murmurant force excuses; puis il s’assit juste en face des Parisiennes, qui, de leur côté, examinaient avec une inquiétude mal dissimulée ce singulier spécimen des indigènes de Villotte.
Delphin Nivard, célibataire de quarante-huit ans et chef de bureau à la préfecture, offrait, en effet, à l’analyse une particularité fort originale: atteint d’une alopécie précoce, il avait la figure complétement glabre. Pas un cil aux paupières, pas un vestige de sourcils, pas un poil de barbe. Sur ce visage rond, blafard et uni comme un œuf, trois détails tranchaient seuls: une perruque brune coupant d’une ligne trop précise la peau mate du front et des tempes, un nez bourgeonné dénotant une persistante âcreté du sang, et deux petits yeux verts dardant un regard effronté et maladif entre deux paupières clignotantes. A l’aspect de cette face pâlote et dévastée, on se demandait quelle passion virulente avait ainsi ravagé à blanc l’organisme de ce bureaucrate de province. Nivard passait à Villotte pour un pince-sans-rire, très-friand d’histoires scandaleuses et très-mauvaise langue. Sa conversation était malveillante et sa plaisanterie venimeuse, comme si son sang vicié eût fini par communiquer à son esprit une recrudescence de malignité.
Dès qu’il fut installé devant son verre de fignolette, il se mit à parler, s’adressant ostensiblement à Mme de Coulaines, qu’il finit par interroger sur les embellissements de Paris.
La dame, qui était bavarde, ne se fit pas prier pour répondre. Elle n’était pas fâchée d’éblouir sa tante et ses cousins par les détails des plaisirs de la grande ville et l’étalage de ses brillantes relations. Avec l’étourderie d’une linotte, elle effleurait les sujets les moins canoniques: les actrices en renom, les spectacles à la mode, les derniers scandales parisiens; – toutes choses qui choquaient beaucoup plus Mlle Lénette qu’elles ne l’émerveillaient. La dévote demoiselle hochait la tête, en trouvant ce babillage singulièrement déplacé. Hyacinthe rougissait au moindre mot un peu léger. Quant à Nivard, tout en donnant la réplique à Mme de Coulaines, il ne laissait pas de lorgner Mlle Laurence, qui s’était accoudée au marbre du poêle et écoutait la conversation avec une moue dédaigneuse.
Les petits yeux égrillards et perçants du chef de bureau semblaient prendre plaisir à se fixer sur cette jolie personne dont le teint blanc, le regard expressif, le profil de médaille s’accusaient doucement sous la lumière dorée de la lampe. Les œillades de Nivard se prolongeaient avec une telle insistance qu’elles finirent par agacer Germain, qui, rencoigné dans l’ombre, contemplait aussi sa cousine avec un mélange de défiance et d’admiration.
Le sauvage chasseur était ébaubi et scandalisé tout à la fois de l’élégance recherchée de sa mignonne parente. Ses yeux curieux étudiaient timidement les détails de cette toilette de jeune fille qui lui apparaissait comme l’épanouissement d’un luxe inconnu et raffiné:–les petits souliers mordorés et décolletés laissant voir un fin bas bleu à coin brodé de noir; le corsage bombé où achevait de se faner un bouquet de violettes acheté à la gare avant de quitter Paris; le cou bien dégagé et se mouvant avec une grâce aisée dans la blancheur d’un grand col évasé, les cheveux noirs ébouriffés avec art et retombant sur le dos en longues grappes qu’un ruban cerise nouait à la hauteur de la nuque. – Tout cela dégageait un parfum étrange de civilisation mondaine qui intriguait Germain et le troublait.
La voix trainante et profonde de la cloche de la tour de l’horloge, sonnant le couvre-feu, interrompit cette périlleuse contemplation et mit fin au babil de Mme de Coulaines. Les habitudes de la maison étaient inflexibles; on s’y couchait et on s’y levait à la cloche du beffroi. – Nivard, qui était au courant du régime des Barbeaux, prit congé de la compagnie. Les deux frères allèrent faire leur tournée dans les magasins. Mlle Lénette, ayant conduit elle-même ses parentes jusqu’à leur appartement et allumé leur bougie, les embrassa gravement en leur souhaitant une bonne nuit.
Le lendemain Laurence de Coulaines, réveillée par les voix criardes des laitières qui parcouraient la rue du Bourg, eut un moment d’angoisse et de stupéfaction en ne se retrouvant pas dans sa petite chambre de la rue du Bac. Elle ne savait plus où elle était. Le grain rude des draps, dont la toile était filée chez Mlle Lénette, la rappela au sentiment de la réalité.
Elle se frotta les yeux, regarda autour d’elle et poussa un soupir à la vue de son étroit cabinet éclairé par le jour grandissant. Les murs, tapissés de papier gris, étaient uniquement garnis dans toute leur longueur de porte-manteaux vides et de rayons sur lesquels s’étalaient les pots de confitures et les bocaux de conserves de la tante Lénette. Au milieu de cette pièce démeublée, le lit de fer sans rideaux, la table de bois blanc servant de toilette et deux chaises de paille formaient un ensemble si pauvre et si peu confortable que Laurence fut près d’en pleurer. Ne se sentant pas d’humeur à paresser dans un aussi triste séjour, elle sauta hors du lit, chaussa ses pantoufles et courut à la fenêtre.
Dès qu’elle eut poussé les persiennes, le spectacle du dehors la rasséréna. Un joli soleil de printemps emplissait la rue, jetant des touches rosées sur les sculptures des façades grises et rayant d’éclairs argentés les pavés encore humides. Des jardinières longeaient la chaussée, roulant sur leurs brouettes des charpagnes pleines de légumes et criant d’une voix chantante «les panais, les carottes et les choux». En haut, les hirondelles revenues caracolaient dans l’air, avec de petits cris, et frisaient de leurs ailes noires les corniches des toits. Aux deux extrémités de la rue, des côteaux de vigne, fermant l’horizon, découpaient leurs terres brunes sur le ciel bleu.
L’espoir, quand on a dix-huit ans, ne replie jamais son aile. Il se mit à reprendre l’essor dans le cœur de Mlle de Coulaines, ragaillardie par cette claire matinée de printemps et par la chanson argentine des cloches d’église qui tintaient pour la première messe.
Elle laissa ses fenêtres entr’ouvertes et, se remuant avec précaution pour ne pas éveiller sa mère, qui aimait à faire la grasse matinée, elle commença gaîment sa toilette. Mais, quand elle eut versé dans sa cuvette le contenu d’un pot à eau et d’une carafe, elle s’aperçut qu’elle avait épuisé sa provision d’eau. Habituée à s’inonder d’abondantes ablutions, Laurence fit une moue désappointée en se voyant réduite à la portion congrue:–Quoi! murmura-t-elle, ils économisent même l’eau!
Tant pis, advienne que pourra! – Elle était résolue à aller bravement en quérir elle-même une pleine cruche à la cuisine. Elle s’enveloppa dans un peignoir, noua en une seule torsade son épaisse chevelure qui tombait en moutonnant jusqu’à la souple cambrure de sa taille, puis elle entr’ouvrit doucement la porte, se glissa dans le couloir. et tout à coup recula avec un cri effarouché jusque dans sa chambre, dont elle referma précipitamment la porte.
Germain était sur le palier. Il projetait d’aller dans les bois de Rembercourt essayer un chien et il venait de quitter sa chambre, boutonné dans sa veste de chasse et guêtre jusqu’aux genoux. Dans l’ombre bleue du couloir, il eut le temps d’apercevoir sa jeune cousine tenant le pot à eau d’une main, et de l’autre serrant sur sa poitrine son peignoir attaché à la hâte. Cela dura à peine une seconde. Il entrevit dans un éblouissement un blanc visage éclairé par deux grands yeux noirs, au milieu d’un nuage de cheveux à demi dénoués, puis il y eut comme un envolement de toutes ces choses charmantes, et la vision s’évanouit derrière la porte brusquement close.
Le cadet des Lafrogne rougit jusqu’à la racine des cheveux. Fort embarrassé lui-même, il eut d’abord bonne envie de battre en retraite; puis le sentiment des devoirs de l’hospitalité et peut-être aussi quelque diable le poussant, il hésita, revint gauchement sur ses pas, et s’approchant de la porte du cabinet:
– Ma cousine? murmura-t-il d’une voix étranglée.
Profond silence de l’autre côté de la cloison.
– Ma cousine, répéta-t-il en grattant timidement à la serrure, désirez-vous quelque chose?
La porte s’entre-bâilla, et une jolie figure, illuminée d’un sourire, se pencha hors de l’entrebâillement.
– Pardon, mon cousin, j’aurais désiré de l’eau... Voudriez-vous prier la servante de m’en monter une cruche?
– Je vais moi-même vous en chercher à la pompe, balbutia Germain légèrement troublé.
Il s’éloigna d’un pas rapide. Cinq minutes s’écoulèrent, puis le vigoureux chasseur reparut portant un énorme broc de grès tout ruisselant d’eau fraîche.
Il gratta de nouveau contre la cloison:
–Voici le broc plein d’eau, ma cousine.
–Bien, mon cousin, ayez la bonté de le poser près de la porte.
Il obéit et s’éloigna; mais, arrivé sur la première marche de l’escalier, il s’arrêta et se retourna curieusement.
La porte s’était rouverte à demi, un bras nu en sortit, un joli bras blanc et potelé avec un petit signe noir au-dessus du coude, s’empara du broc, tandis qu’une voix rieuse répétait: – Merci, mon cousin!
Ce fut tout; mais pendant le reste de la journée, sous les branches tombantes des grands hêtres de Rembercourt, Germain eut de notables distractions. Tout en foulant la mousse des sentiers, il revit, non sans émotion, le spectacle affriolant de cette blanche figure aux cheveux moutonnants, de ces beaux yeux pleins de sourires et de ce bras nu avec le petit signe noir au-dessus du coude.