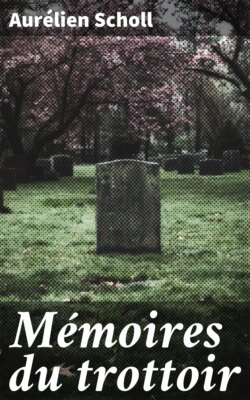Читать книгу Mémoires du trottoir - Aurélien 1833-1902 Scholl - Страница 5
III
LA NOBLESSE DE MAZAS
ОглавлениеN certain Alexandre-Bernardin Dominguez, de Buenos-Ayres, âgé de vingt-cinq ans, vient d’être condamné à douze ans de travaux forcés. «C’est, dit le compte rendu, un fort joli garçon; il prétend avoir été capitaine d’artillerie dans son pays; on lui prête de nombreuses bonnes fortunes et on le dit poète.»
Les faits qui l’amènent devant la cour d’assises remontent à1876. Il avait été condamné par contumace à dix ans de travaux forcés, pour plusieurs escroqueries, ornées de quelques faux.
Après trois années, qu’il passa en Belgique et en Allemagne, où il fit de nombreuses dupes, Dominguez revint à Paris, se croyant oublié; mais la police avait gardé son signalement et il fut arrêté à l’hôtel du Louvre, où il demeurait sous le nom de marquis de Castel Bravo.
C’était un soir de l’hiver dernier, fin décembre, si je ne me trompe. J’étais assis, chez Bignon, à l’une des tables du fond, avec deux ou trois de mes amis de Saint-Pétersbourg. A notre droite, trois jeunes gens causaient assez gaiement; ils parlaient espagnol. A notre gauche était assis le plus jeune fils de M. Janvier de la Motte, celui qui fait d’amusants vaudevilles sous le pseudonyme de Beauvallon; il avait pour compagnon un propriétaire normand, quelque ancien ami des grands jours d’Évreux.
Une dame entra. Le plus jeune des Espagnols lui adressa quelques mots au passage; elle en parut fort irritée.
–Qu’est-ce que c’est? demanda Beauvallon en pâlissant.
–Un de ces individus, répondit la dame, qui se permet de m’arrêter au passage!
–Pouah! fit le vaudevilliste, des rastaquères en quête d’expositions. Ils cherchent de l’or dans leur pays et des truffes à Paris!
Le plus jeune des Espagnols se leva nonchalamment et s’approchant de M. Janvier de la Motte-Beauvallon: «Je suis étranger, monsieur, lui dit-il avec la plus grande politesse, Américain du Sud, et je ne puis laisser passer les paroles que vous venez de prononcer.»
–Parfaitement, monsieur, s’écria Beauvallon; vous avez été impertinent avec madame.
–Cela suffit, monsieur, interrompit l’Espagnol, voici ma carte.
–Voici la mienne, répondit Beauvallon, j’attends vos témoins, et le plus tôt sera le mieux!
L’Américain alla continuer son grog et reprit, avec ses camarades, une conversation souvent coupée d’éclats de rire.
–Comment s’appelle-t-il? demandai-je à Beauvallon.
–Voici.
Et il me fit passer la carte, sur laquelle je lus:
Marquis de Castel Bravo.
Le lendemain, les témoins de Dominguez vinrent présenter ses excuses au jeune Beauvallon, et le duel n’eut pas lieu.
En lisant hier la condamnation de ce malheureux jeune homme, je me suis rappelé sa physionomie pleine de charme et d’animation, ses yeux noirs et brillants, ses lèvres souriantes, et involontairement j’ai accusé Paris, Paris qui envoie au bagne pour douze ans ceux qu’il a entraînés et perdus!
Si Dominguez était resté à Buenos-Ayres, il n’eût pas éprouvé le besoin et il n’eût pas eu la possibilité de revêtir tant de formes et tant de masques, de s’affubler de tant de noms. duc de Trévise, comte de Guiche, vicomte de Montalba et marquis de Castel Bravo!
J’ai souvent rencontré de ces types à facettes dans les menus sentiers de la vie parisienne. Un jour même, il m’a fallu, bon gré mal gré, devenir le confident de quelques minutes d’un de ces paons exotiques.
Jusqu’au jour où il comparut devant le tribunal correctionnel, qui le condamna à six mois de prison pour avoir acheté à crédit et revendu à cinquante pour cent de perte un collier de vingt mille francs, personne ne connaissait le véritable nom de Thémistocle Bromberg. A l’hôtel du Louvre, il se faisait appeler le baron de Smolensk; au Grand-Hôtel, le comte de Wilna; il était reçu dans deux ou trois maisons sous le nom de vicomte d’Espansival, et dans les brasseries et caboulots du boulevard des Batignolles, il s’était présenté comme un peintre hongrois nommé Michel Kiraly.
Tantôt on le rencontrait au Bois, nonchalamment étendu sur les coussins d’une voiture armoriée, élégamment vêtu, portant haut la tête; tantôt on l’apercevait sous des vêtements râpés, coiffé d’un vieux chapeau mou, se glissant dans les petites rues des hauts quartiers et entrant dans quelque gargote où il se faisait servir une portion de bœuf et un demi-setier de vin bleu.
Un jour, à l’ambassade de. on m’avait présenté le comte de Wilna. Quelque temps après, aux Champs-Elysées, je vis un passant lui faire un petit salut de la main, en disant: Bonjour, Smolensk! Une autre fois à la Nouvelle Athènes, un jeune peintre de mes amis, Paul Robert, l’appela Kiraly.
–Qu’est donc ce jeune homme? lui demandai-je.
–Je n’en sais rien, répondit Robert. Il s’est trouvé en même temps que moi dans un groupe d’artistes à la brasserie Saint-Georges. On m’a dit qu’il était peintre; c’est un bohémien, ou tzigane.
–Avez-vous quelquefois vu de sa peinture?
–Jamais.
Il était une heure de l’après-midi. Une chaleur accablante tombait d’aplomb du haut des toits; à peine un rare passant apparaissait de loin en loin. Je traversais la rue Condorcet quand j’aperçus Bromberg qui cheminait lentement, son chapeau à la main.
Quand il avait commis quelque méfait, il laissait pousser sa barbe, pour qu’on ne le reconnût pas; puis, sachant combien l’oubli est prompt au cœur des Parisiens, il reparaissait subitement, rasé de frais, rajeuni, avec des allures pimpantes.
A ce moment, sa barbe était longue.
–Bonjour, monsieur, me dit-il; vous ne me reconnaissez pas?
–Je n’ai pas de raison de vous reconnaître.
–Cependant, je voudrais vous consulter sur un point. Il ne passe personne, on ne vous verra pas causer avec moi, et peut-être vous quitterai-je un peu consolé.
–Qu’avez-vous à me dire?
–J’ai à vous dire que je ne suis pas un malhonnête homme.
–Tant mieux pour vous, monsieur.
–Qu’ai-je donc fait, après tout, pour qu’on me tourne le dos? Je me suis affublé d’un titre de baron qui ne m’appartient pas? Mais tout le monde sait qu’un titre de baron s’achète pour six mille francs et que, pour dix mille, on peut être comte. Si j’avais payé mon titre, on n’aurait rien à me dire.
Quelle différence y a-t-il entre un homme qui est un vrai baron parce qu’il a donné six mille francs à un marchand italien, et un homme qui s’intitule baron parce qu’il pense que ce titre lui facilitera l’accès d’un monde qu’il aime et qu’il recherche? Le premier est-il beaucoup plus baron que le second?
Tenez, je vais vous dire mon histoire en deux mots, cela ne vous fera pas de mal et je trouverai une consolation dans cet épanchement.
Mon père tient, dans un faubourg de Linz, une petite auberge à renseigne du Mouton d’or. Ma mère faisait la cuisine elle-même, et il m’est arrivé plus d’une fois de servir la soupe et le jambon aux charretiers et aux paysans du cercle de la Mulh. J’allais à l’école avec les enfants pauvres de mon quartier, mais, le rabbin Zacharie Muller m’ayant pris en amitié, je reçus de lui des leçons particulières, qui, plus tard, m’ont permis de compléter moi-même mon éducation. Je sais le latin et le grec, je parle couramment le russe, le slave, l’allemand, l’anglais, l’italien, l’espagnol, le français même, comme vous pouvez en juger.
Dans une soupente, au-dessus de l’écurie du Mouton d’or, on m’avait ménagé une chambre. L’unité seule y était représentée: un lit, une table, une chaise. Un jour qu’un monsieur de Passeau m’avait donné un demi-florin de pourboire, je joignis un miroir à mon ameublement. Ce miroir, encadré de bois en acajou, fut à la fois mon confident et mon mauvais génie. C’est ce miroir qui m’a perdu. J’étais grand, bien fait, vigoureux, mais je n’avais pas attaché jusque-là un grand prix aux avantages physiques. Me comparant avec les brillants cavaliers que je voyais passer quelquefois sur la route, je me trouvai plus beau qu’eux. Pourquoi ces gens-là passaient-ils leurs journées en promenades et leurs soirées en plaisirs; pourquoi leurs compagnes étaient-elles si élégantes et si parfumées, tandis que je soignais les chevaux et que je faisais les doux yeux à la servante de notre voisin, le professeur Alkirch? Mon miroir criait à l’injustice.
Un soir, je m’enfuis de la maison paternelle et je partis à pied pour Passeau, où j’entrai comme interprète dans un hôtel. Au bout de quelque temps, le prince de Stelberg me prit comme valet de chambre et m’emmena à Vienne.
C’est à Vienne que je me façonnai aux belles manières. Je regardai comment les gens du monde saluaient les femmes, comment ils tenaient leur chapeau, de quel air ils s’accoudaient au piano, et le soir, dans ma chambre je me donnais des répétitions.
Quand j’eus réalisé quelques économies.
–Étaient-ce bien des économies? demandai-je.
–Peuh! je veux être franc avec vous; en rentrant du cercle, le prince laissait traîner des tas de louis sur les meubles; j’en ai pris le plus que j’ai pu. Il eut aussi le malheur de perdre des boutons en diamant et plusieurs objets de luxe dont les brocanteurs me donnèrent une dizaine de mille francs. C’est avec cet argent que j’arrivai à Paris. Un tailleur à la mode fit de moi un élégant de quelques semaines; je pris une voiture au mois et j’eus quelques succès auprès des demi-mondaines.
Il vient tant d’étrangers à Paris qu’un jeune homme aimable et habile peut se créer d’utiles relations rien que dans l’hôtel où il réside, sans parler du café voisin. Le tout est d’aller aux bons endroits. Encore faut-il pouvoir durer.
Mes ressources furent épuisées avant que j’eusse fondé le nombre de relations suffisant pour vivre. Un ancien chasseur de l’hôtel du Danube, à Odessa, qui se faisait appeler Dranam-Pacha, m’avait appris à tricher au jeu, mais les pontes de qualité me faisaient défaut. Un soir cependant je gagnai quelques centaines de louis à un prince russe, mais il cessa de me saluer sur le boulevard. Ah! j’ai tâté de tous les métiers sans pouvoir vivre d’aucun. Oui, monsieur, j’ai proposé des cartes obscènes aux passants; je suis allé dans les hôtels offrir de faux Corot et de faux Stevens aux nouveaux débarqués; métier perdu! les Américains mêmes commencent à s’y connaître. L’un d’eux, à qui j’offrais un petit Feyen-Perrin pour dix louis, m’a répondu: «Ce tableau est faux; c’est une croûte qui vaut dix francs pour un épicier.» Enfin je nouai d’utiles relations avec une marquise portugaise, âgée de soixante ans, mais très passionnée. Elle me remit à flot.
C’est alors que je pus devenir le brillant comte de Wilna et le sémillant d’Espansival.
–Pourquoi tant de noms?
–Pour dépister les créanciers.
–Jusqu’au jour où vous avez été pris la main dans le sac.
–Un malheur! monsieur, un malheur qui deviendra peut-être un bonheur. Jusqu’à ce jour, j’étais gêné dans mes opérations. Une fois en prison, je me suis dit:–Me voilà débarrassé une bonne fois de l’honneur! Maintenant, tout m’est égal. Plus de scrupules, plus de craintes! Je me sens deux fois plus fort qu’auparavant. Quelle belle vie de lutte je vais recommencer! J’étais si fier quand on annonçait dans un salon:
«Le comte de Wilna!»
C’était moi. J’allais saluer la maîtresse de la maison. Les demoiselles me regardaient d’un œil favorable. Et je me disais: Je pourrais être réellement comte de Wilna. Bromberg, le fils de l’aubergiste de Linz, aurait sa place tout comme un autre au banquet de la vie parisienne. Je circule comme un faux billet de banque, mais tout le monde peut s’y tromper, tant j’étais fait pour briller dans les salons! J’ai dansé avec la duchesse de X…, avec la marquise de F… Le prince de L… m’a appelé «son cher ami!» j’ai pu pénétrer jusque chez une majesté détrônée et, si je n’avais été arrêté sur la plainte d’un bijoutier maudit, j’allais être présenté au prince de Galles!–Oui monsieur! Voyez-vous ce qu’ensuite j’aurais pu faire à Londres! Comme j’étais posé!…
Bromberg poussa un profond soupir.
–Qu’allez-vous faire maintenant? lui demandai-je par curiosité. Il faudrait quitter l’Europe. Vous êtes intelligent, vous trouverez aux États-Unis quelques occasions de faire fortune honorablement.
–Honorablement? s’écria Bromberg, et pourquoi cela? Qu’est-ce que cela peut me faire maintenant?
–Mais alors?
–J’ai trouvé. Une vieille dame anglaise, veuve depuis1852, ne me connaît que sous le nom de Kiraly. Je lui ai fait la cour, et elle en est arrivée à me parler de mariage. Je vais l’épouser en Italie, dans quelque village, avec de faux papiers. Elle a dix millions, dix millions! J’achèterai un titre… et, dans deux ans vous entendrez parler du comte de San-Benito ou du prince de Villa-Vecchia, que sais-je? Ce sera moi!
Bromberg me fit un salut à la fois ironique et triomphant.
Il a dit: «dans deux ans.» C’est possible; mais je parie que, dans trois ans, quatre peut-être, nous lirons dans les Faits divers: «La cour d’assises de la Seine a condamné hier à dix ans de travaux forcés un aventurier du nom de Bromberg, dont l’existence a été des plus agitées.»
Bromberg après Dominguez, Wilna après Castel Bravo. Et après celui-là ce sera un autre–et toujours comme cela!