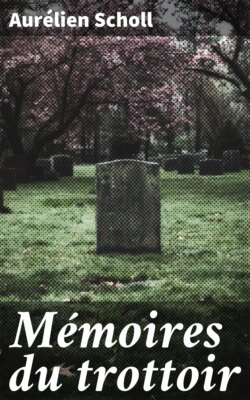Читать книгу Mémoires du trottoir - Aurélien 1833-1902 Scholl - Страница 6
ОглавлениеIV
LA NOBLESSE D’HOTEL
A vie nomade est encore la vie normale d’une grande partie de l’espèce humaine. Au lieu de demeurer sous la tente et de se transporter d’un lieu dans un autre avec leurs troupeaux, les pasteurs modernes se transportent de ville en ville avec leurs malles et mènent la vie d’hôtel. Ce sont les Anglais et les Américains qui ont, les premiers, adopté ce genre de vie, et leur exemple a été suivi par les chercheurs de fortune de toute nationalité, marquis italiens et comtes polonais, juifs allemands et gentilshommes dalmates, épiciers de Chicago et marchands de pétrole de la Cité, proxénètes enrichies et raccrocheuses mariées.
On a souvent demandé ce que devenaient les demoiselles du trottoir et les filles de maison. Les moralistes prétendent qu’elles finissent balayeuses de rues, quand elles ne sont pas mortes avant trente ans.
C’est une erreur ou un mensonge. Elles se marient et deviennent des femmes honnêtes; j’en ai vu deux ces jours-ci, l’une à Lagny, l’autre à Melun, qui sont des épouses modèles et que les curés donnent comme exemples à toutes les femmes de leur localité.
Un Parisien qui ferait un voyage de découverte en Russie, en Autriche et en Italie, reconnaîtrait sous des titres pompeux bon nombre des soupeuses du Helder et du Café américain. D’anciennes figurantes des Variétés, des beautés cotées deux louis sont, à l’heure actuelle, les épouses dévouées de deux grands manufacturiers et ennemies raisonnées du libre échange. Il n’y a pas de femmes perdues; elles se retrouvent toujours.
C’est un singulier assemblage que celui que présente, dans de certaines saisons, la salle à manger d’un des grands hôtels de Paris. Il y a de tout, des princes et des mouchards, des pasteurs anglicans et des filous de toute origine, des banquiers de Francfort ou d’Odessa et des grecs de Venise ou de Cracovie. Les gens vraiment riches ne sont point les plus corrects et les plus exacts dans leur toilette. Ceux qui ne payent ni leur chemisier ni leur tailleur sont toujours mieux mis que les autres. Tel gentleman que vous voyez en cravate blanche et en habit noir, irréprochable des pieds à la tête, n’a pas toujours dix francs dans sa poche, ou, s’il les a, c’est qu’il les tient de la générosité d’un voisin de chambre ou de la confiance d’une débitante de tabac du voisinage, qui les lui a prêtés parce qu’il avait oublié son porte-monnaie.
Désireux d’étudier Paris sous toutes ses faces, j’avais dîné un soir à la table d’hôte d’un des plus grands hôtels de Paris. J’avais pour voisin un jeune homme de haute mine, moustache blonde, démarche quelque peu hautaine, tenue de premier ordre. Pendant le cours du dîner, il me confia qu’il se nommait le comte de Danneberg, d’une famille bien connue en Finlande, mais brouillé, pour le moment, avec ses parents. Il se trouvait fort embarrassé pour faire bonne figure dans le monde et, en attendant des jours meilleurs, il plaçait des photographies obscènes, qu’il avait rapportées de Vienne.
Et le fier gentilhomme, tirant un paquet de sa poche, me proposa de lui en acheter quelques-unes à deux francs la pièce. Ce faisant, j’obligerais infiniment un fils de bonne maison.
J’ai revu ce gentilhomme au Bois, en voiture de grande remise, nonchalamment penché sur les coussins et saluant du bout des doigts les célébrités du monde galant; puis, dans un des grands cercles de Nice; il gagnait trente-cinq mille francs. Finalement, j’ai lu dans les petites nouvelles des théâtres qu’il allait épouser une actrice retirée, actuellement en possession de quelques centaines de mille francs, qu’elle ne doit qu’à son travail.
Les dépenses d’une maison montée sur un certain pied ont pris de telles proportions que l’amour du chez soi tend à disparaître de plus en plus de nos mœurs.
Un Anglais veuf voyage avec ses filles; il passe trois mois à Paris dans un family hotel, l’hiver à Cannes ou à Nice, le reste de l’année aux bains de mer. Il compte, pour trouver des gendres, sur une rencontre en wagon ou en bateau à vapeur, sur les hasards d’un bal de charité à l’hôtel Continental ou d’une sympathie qui peut éclore au prêche dans une église réformée.
La vie d’hôtel offre des avantages multiples. Un nombreux domestique est à vos ordres. Sur un coup de sonnette, vos habits sont brossés, raccommodés; à toute heure de jour et de nuit, thé, café, bouillon sont tenus à votre disposition. Les gens qui vivent à l’hôtel reçoivent des invitations et ne sont pas tenus de rendre les politesses qui exigent un salon et un personnel. On y a le loyer qu’on veut avoir. Le locataire du quatrième étage a une chambre et deux repas pour500francs par mois. Un chef de famille qui croit utile de donner une petite soirée avec romances au piano loue un salon pour la journée. C’est une affaire de25à50francs. Et ses filles font de la musique, chantent une romance, un duo. Au besoin, le tapis est enlevé et on danse.
Les Américains prisent tort cette existence libre et vagabonde. Une dame de New-York, ennuyée de la vie de ménage, laisse son mari aux affaires, et part pour l’Europe avec sa fille et sa nièce. Elle va de capitale en capitale, de ville d’eaux en ville d’eaux, nouant des relations, énonçant un chiffre de dot considérable pour ces demoiselles. De tem ps en temps, elle prend un amant, et, si elle est contente de quelqu’un d’entre eux, elle en fait un mari pour sa fille; elle ne lui fait épouser sa nièce que si elle tient à se conserver des droits sur le jeune homme.
Tout le monde a connu à Hyères et à Cannes le fameux baron Sterwich. Il se disait Danois, ancien officier.
Pourquoi pas? Il vivait au cercle et du cercle, tantôt celui-ci, tantôt celui-là, ne corrigeant la fortune que quand elle le méritait sérieusement. On citait des semaines entières d’une déveine effroyable; le baron perdait trois ou quatre cent mille francs. Alors, vous comprenez, il fallait que cela finît, et cela finissait.
A trente-six ans, le baron Sterwich se maria. Une dame veuve arrivait de l’Amérique du Sud avec une fille d’une rare beauté, Mariquita Martin, née d’un père français et d’une mère bolivienne. Des épaules et des bras superbes, une taille de mulâtresse; les yeux et les sourcils, deux diamants du Brésil sous deux arcs de velours noir. On parlait d’une fortune considérable. Le lendemain du mariage, la tête sur l’oreiller, le baron confessa qu’il ne lui restait qu’une quarantaine de mille francs et que leur bonheur dépendrait de sa veine au jeu. La jeune épouse, de son côté, avoua à son mari que les cent mille hectares inscrits au contrat comme lui appartenant étaient encore à l’état inculte et n’acquerraient une réelle valeur que le jour où le baron Haussmann établirait un boulevard sérieux au milieu des pampas. Là-dessus, on s’embrassa et tout fut dit.
L’hiver suivant, Sterwich était réduit à quia. Le ménage devait une vingtaine de mille francs aux fournisseurs parisiens et, la fin du mois approchant, l’hôtelier de Nice–où monsieur et madame étaient venus s’échouer–allait présenter sa note, laquelle montait bien à sept ou huit mille francs. D’autre part, le loueur de voitures, la modiste, la tailleuse, la lingère en étaient venus à parler de papier timbré.
Un jeune Russe, à peine majeur, naturellement prince, s’était épris des beaux yeux de Mariquita. Le baron et son épouse pensèrent que c’était à cet amoureux inexpérimenté de les tirer de ce mauvais pas.
On l’invita à dîner un jour de pluie. Vers neuf heures, le baron souleva le rideau de la fenêtre.
–Le temps est affreux, dit-il; impossible de sortir.
Mariquita, qui n’avait négligé aucun genre de provocation avec le prince et qui l’avait allumé du regard, du genou et du pied, s’écria:
–Faites une petite partie en prenant une tasse de thé!
–C’est cela, dit le Russe, enchanté de pousser ses affaires le plus possible.
L’échafaud fut dressé. Le baron battit les cartes.
–Je fais cinquante louis.
–Accepté.
–Pardon, interrompit Mariquita, je fais cinq louis dans le jeu du prince. Voulez-vous?
–Comment donc, madame!
Elle s’assit à côté de lui, s’appuyant sur son épaule, le brûlant de son haleine. A de certains moments, le jeune homme n’y voyait plus.
–Quitte ou double! disait le baron.
Et toujours quitte ou double.
Mariquita s’était penchée. Elle avait passé une main sous la table et, tout doucement, elle serrait le genou du prince russe qui, rouge jusqu’aux oreilles, jetait sur le mari des regards effarés.
A dix heures, il perdait trois cent mille francs.
–Tâchez d’aller jusqu’à onze heures, lui dit tout bas Mariquita; le baron a une course à faire. Nous resterons seuls.
Cette heure additionnelle coûta cent cinquante mille francs de plus au jeune homme, qui, s’il était heureux sous la table, ne l’était guère. dessus.
Cette comédie, Mariquita la recommence deux ou trois fois chaque hiver. Elle choisit un naïf, aussi jeune et aussi riche que possible, lui jette de longs regards, se retourne quand il passe. Il ne tarde pas à se faire présenter; elle en fait alors son danseur préféré,–puis on l’invite à dîner et on lui fait le coup de la table.
Cela n’empêche pas le baron et sa phosphorescente épouse d’être reçus dans la meilleure société de toutes les villes où il n’y en a pas de bonne.
Les Américains du Nord forment la race cosmopolite par excellence. Il semble qu’ils aient pour devise: «On n’est bien que hors de chez soi.»
On les trouve partout, sous les glaces des pôles, au soleil des tropiques. Ils promènent dans tous les sens leur aventureuse énergie, leur mépris de la mort. Dans les contrées les plus inexplorées de l’Afrique mystérieuse, quand arrive, après toute sorte de fatigues et d’épreuves, le premier Anglais qui ait foulé ce sol nouveau, il y trouve deux Américains installés depuis longtemps.
Aux Etats-Unis, un grand nombre de familles vivent à l’hôtel. Un de mes amis m’a raconté qu’il s’était trouve, sur le bateau à vapeur qui va de Memphis à Saint-Louis, avec un jeune ménage qui faisait pour la deux cent-huitième fois son voyage de noces.
Le steamer met deux jours à faire le trajet. Il s’y trouve des cabines nuptiales, assez confortablement installées. Les nouveaux mariés s’y étaient trouvés si bien qu’ils n’ont pu se décider à s’installer en terre ferme, et voilà deux ans qu’ils vont constamment de Memphis à Saint-Louis et de Saint-Louis à Memphis!