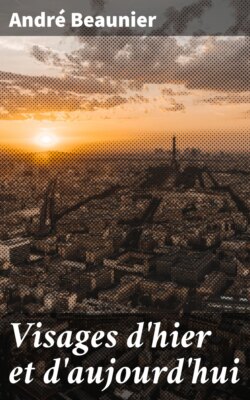Читать книгу Visages d'hier et d'aujourd'hui - Beaunier André - Страница 13
CESARE LOMBROSO
ОглавлениеJe n'ai vu Cesare Lombroso que peu de mois avant sa mort. C'était à Stresa, sur la rive du lac Majeur, pendant un bel été. Sa fille et son gendre Guglielmo Ferrero l'avaient prié de venir passer quelques jours auprès d'eux. Il devait rester un peu; et puis, subitement, il s'en alla. Il ne pouvait plus tenir en place. Comme il avait, toute sa vie, ardemment travaillé, il voulait travailler encore; il le voulait avec une obstination fébrile. Et il souffrait amèrement de sentir que, pour la première fois, le travail ne lui était plus une allégresse.
Mécontent de la difficulté soudaine, il voyagea. De semaine en semaine, vagabond malade et illustre, en peine d'écrire, il chercha, au nord de l'Italie, en Suisse, ailleurs, la tranquillité de sa pensée, le bon endroit où il se figurait avec passion que s'apaiserait son émoi et que renaîtrait son génie. Sa prodigieuse activité mentale, son entrain d'idéologue, sa vive gaieté intellectuelle qui jusqu'alors avaient si bien résisté à la fatigue de l'âge, tout cela s'alentissait en lui: alors, il s'en allait, frémissant et peureux, comme si l'atmosphère était la cause, et comme si d'autres ciels devaient lui rendre cette alacrité d'âme qui lui manquait. D'étape en étape, il se décourageait davantage. En fin de compte, il résolut de retourner à Turin, de rentrer tout de même chez lui. Et c'est là qu'une nuit il est mort, d'une crise cardiaque.
Il était, le jour que je le vis, un petit vieillard aimable et courtois qui, pour vous faire honneur, se dérange de sa tristesse. Il lisait et prenait des notes. Habillé d'une longue houppelande grise, la plume à la main, la cravate mince et blanche selon l'usage ancien des docteurs, il venait à vous gentiment, avec un sourire cérémonieux. Le visage était fin, malicieux; la curiosité du regard et sa mobilité indiquaient l'habitude perpétuelle d'observer, le désir alerte de connaître. Il se penchait vers vous, très attentif, prêt à noter en sa mémoire ce qu'on eût dit d'un peu valable. Et, à tout ce qu'on hasardait, il faisait un gracieux accueil. Sa parole était précise, nette; et déjà elle commençait d'être éloquente: mais, comme si une étrange timidité l'eût pris de n'être plus l'extraordinaire causeur de naguère, il tournait court et son silence était pathétique, tandis que les yeux étincelaient de continuelle ferveur.
Je croyais le revoir le lendemain. Mais, à l'aube, il avait décidé que le doux lac Majeur ne lui valait rien et qu'au bord du lac de Genève il serait mieux. Terrible odyssée et pèlerinage inutile. Cette tête ne renonça point à son génie facilement; elle ne s'avoua vaincue, en somme, qu'après avoir tout essayé.
Il était né à Venise en 1836 et il publia son premier mémoire en 1855. Maintenant qu'il est mort, son effort scientifique a duré cinquante-quatre ans. Il l'interrompit, un bout de temps, en 1859, pendant la guerre d'Italie, pour être médecin de l'armée. Et puis, ayant fait acte de bon citoyen, il se remit à sa besogne, qu'il n'abandonna plus, qu'il n'abandonna jamais et dont, pour mourir, il se détacha plus malaisément que de la vie.
Ses premières études, relatives au crétinisme, lui valurent l'étonnement de Virchow. On le chargea d'un cours, sur les maladies mentales, à l'Université de Pavie. Et puis il dirigea l'hôpital des fous, à Pesaro; ensuite, on lui donna la chaire de psychiatrie à l'Université de Turin. Sa renommée s'étendit bientôt; et il ne cessa point de multiplier l'objet de son expérience, d'élargir sa méthode.
Sa trouvaille fut d'appliquer à la psychologie les procédés de son enquête médicale. La pathologie le menait à conclure nouvellement sur la fragile santé du cerveau.
Je ne vais pas dresser l'inventaire de son œuvre, qui est immense; je ne souhaite que d'en marquer le caractère. Et, si je ne me trompe, le voici. Cesare Lombroso eut toute la minutie qu'impose la stricte méthode expérimentale; en même temps, il était admirable par sa puissante faculté inductive. Il ne croyait jamais avoir réuni un assez grand nombre de faits contrôlés; et les faits ne lui suffisaient pas, mais il était réclamé par les idées.
En 1872, il publia son Anthropométrie de quatre cents malfaiteurs vénitiens; la même année, la Folie criminelle en Italie. Et c'est le même homme qui, ensuite, généralisant les résultats d'une enquête formidable et délicate, émit, dans l'Homme criminel, les plus vastes hypothèses qu'autorise la science de la criminalité.
L'analyse expérimentale de la folie l'avait conduit à reconnaître les tares analogues que manifestent le cerveau du dément et celui du criminel. Pour le savant, le crime est un acte déraisonnable dont il faut expliquer psychologiquement les particularités. La notion même du crime est étrangère aux simples données scientifiques; elle est de nature morale et sociale. Ainsi la criminalité s'évade hors de la science absolue. Il y a quelques années, louant devant l'Académie des sciences feu le professeur Brouardel, le mathématicien Henri Poincaré s'effarait des problèmes si complexes que pose la médecine légale... «Nous ne sommes plus, disait-il, dans le domaine de la science pure, mais en pleine mêlée.» Il ajoutait qu'alors la plus petite erreur du savant risquait d'«abaisser l'humanité tout entière en obscurcissant l'idée de justice»... Science et réalité,—le contact de cela et de ceci est redoutable. Cesare Lombroso, fort de la science, ne craignit point la réalité. C'est ce qu'a de plus émouvant son œuvre patiente et audacieuse.
D'ailleurs, toute sa longue observation le fit aboutir à la thèse socratique de la faute qui est une erreur de l'esprit. Seulement, cette thèse, il lui donna la valeur d'une doctrine médicale, quand il sut indiquer avec rigueur les tares organiques qui ont le crime pour conséquence. Des centaines de cerveaux, de crânes et d'appareils nerveux qu'il examina lui démontrèrent que les individus anormaux sont de deux sortes, criminels-nés et criminaloïdes.
Sur les criminels-nés, on ne peut rien. Les criminaloïdes, il faudrait qu'on sût, mieux encore que les châtier, les guérir. Ainsi s'unissent, dans une opiniâtre et dangereuse trinité, psychologie, médecine et sociologie: la psychologie constate; la médecine essaye de soigner; cependant, la société a ses volontés impérieuses et urgentes. Pour les criminels-nés, la peine de mort est bonne; si elle a quelque utilité, elle n'a guère d'inconvénient. Pour les criminaloïdes, se pose l'interminable problème de la responsabilité. Comme si la question n'était pas encore assez variée, la philosophie s'en mêle; la métaphysique n'est pas loin.
Ajoutons que l'état du «criminaloïde» ne se définit pas avec une exactitude catégorique. Il admet des nuances. Ces nuances le relient, d'une part, au criminel inguérissable et, de l'autre, à l'homme normal. En cas de responsabilité nulle, l'imputabilité suffit; en cas de responsabilité parfaite, les codes ont leurs indiscutables tarifs: mais la responsabilité diminuée est l'angoisse d'une société réfléchie.
Cesare Lombroso a prétendu déterminer les tares physiologiques auxquelles les crimes correspondent. Il les a trouvées innombrables, diverses et si proches les unes des autres qu'après avoir lu ses livres on garde un sentiment de malaise. Son œuvre est une sorte d'épopée effrayante de la maladie criminelle. Cette sombre poésie résulte de l'abondance des faits et de l'incertitude alarmante du rêve qui en sort.
La dernière année de sa vie, comme on avait procédé, en France, à quelques exécutions capitales, Cesare Lombroso consacra une poignante page à les commenter: le savant et le philosophe qui a le plus songé, en savant et en philosophe, à la légitimité et à la valeur efficace de la peine de mort avouait qu'il n'osait plus conclure. Du moins, il aboutissait à une double conclusion. «J'ai ici vraiment une double personnalité», disait-il. Bref, il concluait à la peine de mort inexorable; et il concluait qu'il ne savait plus. On sentait que le souvenir de cerveaux ouverts et qu'il avait tenus dans ses mains le hantait: les uns, cerveaux de brutes abominables dont il faut que la société se débarrasse; les autres, cerveaux qu'il aurait peut-être fallu soigner, les pauvres malades!
Rêveries pathétiques, belles et redoutables! En attendant que les physiologistes et les moralistes aient achevé leur auguste besogne, la société a le droit et le devoir de vivre. Il est possible qu'un jour les études commencées par un Cesare Lombroso et continuées par d'autres hommes de science résolvent la question du crime et du châtiment; ce n'est, d'ailleurs, que possible.
Alors, pendant que travailleront, méditeront et douteront encore les Lombroso, que fera la société?
Nous avons aujourd'hui des penseurs,—c'est le nom qu'ils revendiquent,—des penseurs un peu niais, qui sacrifient gaillardement la société à des doctrines incomplètes. En attendant que les Lombroso aient conclu, nos penseurs se dépêchent de refuser à la société le droit de tuer. Cependant, les crimes se multiplient et la sauvagerie fait rage.
Notons que, malgré le souvenir angoissant des cerveaux qu'il avait examinés, taillés, analysés, Cesare Lombroso n'était pas, en principe, l'ennemi de la peine de mort.
On veut absolument poser la question de responsabilité. Elle est magnifique, en effet, et bien digne d'occuper nos penseurs, après qu'elle en a tourmenté d'autres, et de plus sérieux. Elle est magnifique et, probablement, insoluble.
De sorte que la société, qui a le droit et le devoir de vivre, et tout de suite, pourrait à la rigueur la négliger et en poser une autre, qui est plus simple et qui est une question de fait, la question de l'imputabilité. Même si tel individu n'est pas, philosophiquement, responsable de tel méfait, considérons tel méfait comme imputable à tel individu. Or, si ce méfait et les méfaits de ce genre mettent en péril la société, celle-ci est, à l'égard de cet individu, en état de légitime défense. Elle impute à cet individu ce méfait: cela suffit pour qu'elle se débarrasse du gaillard.
Les idées des savants gouvernent le monde. Mais ce n'est pas un gouvernement direct. Il y a un intermédiaire: les imbéciles, ceux-là précisément qui revendiquent le nom de penseurs. Les idées des savants n'arrivent au monde que transformées par le soin détestable de ces ministres. Et, à vrai dire, ce ne sont pas les idées des savants qui gouvernent le monde, mais, plus exactement, les contresens que les imbéciles ont faits sur les idées des savants. Et ainsi nos plus mols penseurs se réclament de Lombroso pour engager la société contemporaine dans une aventure de suicide absurde.
C'est une philosophie matérialiste qu'illustrent les œuvres de Lombroso. Son étude de l'âme demandait à la physiologie ses motifs, ses causes, ses arguments. Il consacra sa patience de savant à chercher les concomitances physiologiques des faits psychologiques, comme s'il était avéré que ces derniers fussent d'origine matérielle. Or, la difficulté est là; mais il l'a laissée aux métaphysiciens. Ceux-ci décideront si la pensée est produite par le cerveau ou si le cerveau n'est qu'une idée de l'âme.
En hâte, certains spiritualistes se fâchèrent. Et je me souviens de Tolstoï à qui on offrait de connaître Cesare Lombroso... «Jamais de la vie! répondit-il avec mauvaise humeur; pour qu'il me classe parmi les microcéphales!...»
Mais on ne peut tout de même appeler matérialiste un savant qui, de la pathologie physiologique, s'est élevé jusqu'aux idées les plus hautes et abstraites du devoir individuel, du devoir social et de la responsabilité. Il a conclu pratiquement, dans la mesure où les réalités scientifiques l'y conviaient; et, après un demi-siècle de travail incessant, il a réservé pour une suprême incertitude la part indéfinie de la métaphysique.
Maintenant il est mort. Il a enfin trouvé la paix et le calme qu'il désirait et quêtait, durant son dernier été, si frénétiquement.
Ce fut un homme étonnant, et qui jamais ne crut avoir assez bien établi les faits, et qui voulut sans cesse marier aux faits les idées. Il a dépensé à cette tâche presque paradoxale une extraordinaire puissance dialectique, un zèle adroit. Et il souriait; il était charmant, amusant et bon. Il semblait un patriarche de la science, l'héritier des héros spirituels que posséda l'Italie de la Renaissance et dont elle a légué le génie, dans le cours des âges, à quelques échantillons privilégiés de l'âme latine. Et puis, il était doux, affable et sensible. Mais, à présent, le lourd et fin cerveau de Cesare Lombroso se repose.