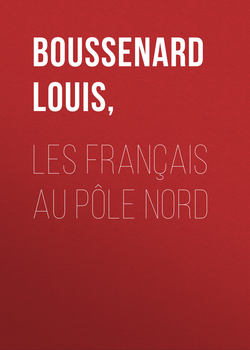Читать книгу Les français au pôle Nord - Луи Буссенар, Boussenard Louis - Страница 5
PREMIÈRE PARTIE
LA ROUTE DU POLE
V
ОглавлениеChute d'une montagne de glace. – Broyé ou submergé. – Un homme à la mer! – Héroïsme joyeux. – La récompense d'un brave. – Possessions danoises. – A travers la brume. – Dans le «Nid de Pie». – Regrets d'un pêcheur de baleines. – Toujours en avant! – Le comble de la misère humaine. – Près de pénétrer dans le cimetière des navires.
Malgré le froid intense, les matelots, tout chauds encore du soleil natal, trouvent que cette monotonie, parfois si éclatante et plus souvent lugubre, est relevée par le charme de la nouveauté.
Ils ont des étonnements naïfs, des admirations bruyantes, des métaphores audacieuses à l'aspect du tableau mouvant, si extraordinairement accidenté qui, bien que formé d'un seul élément, et n'affectant qu'une seule nuance, ne se ressemble jamais.
C'est au point que leur vigilance est parfois en défaut, tant ce féerique décor, sans cesse modifié, surexcite leur curiosité jusqu'à leur enlever l'appréhension du danger.
Du reste, ils n'ont pas eu le temps de se familiariser avec la configuration des icebergs ne montrant, comme on sait, au-dessus des eaux, que le quart de leur masse entière, et cachant sournoisement, sous les flots, une base très large, d'autant plus redoutable qu'on en ignore la forme et les dimensions.
Aussi, arrivera-t-il qu'un monticule errant, passant à une quinzaine de mètres, et regardé comme inoffensif, eu égard à son éloignement relatif, heurtera, par un de ses prolongements sous-marins, les œuvres vives du navire.
C'est ce qui se produit au moment où des cris violents interrompirent l'entretien du Basque et du Parisien.
Le chenal où s'avançait la Gallia rasait de près un immense glacier collé aux falaises de la côte, et le courant, assez rapide, en érodait profondément l'invisible piédestal.
Il y avait là des ébauches colossales d'une architecture fruste et tourmentée, où se confondaient, au milieu d'un pêle-mêle inouï, des piliers déjetés, des croupes de cathédrales, des tours balafrées de lézardes, des ogives rompues, des monolithes informes tombés on ne sait d'où, des pans ruinés, une cité de géants après un tremblement de terre.
Toutes ces masses, reliées entre elles par le froid, et solidaires comme si le meilleur ciment les unissait, éprouvaient, par cela même, des trépidations violentes, quand l'effort incessant des eaux, sapant leur base, en détachait un fragment.
Des craquements sonores, produits par le travail de désagrégation, retentissaient sans relâche, précédant, puis accompagnant la chute du bloc qui s'abîmait dans une pluie diamantée, puis soulevait une vague qui s'en allait mourir en clapotant sous les anfractuosités.
En raison de cette solidarité, l'ébranlement se répercutait sur la totalité du glacier, produisant des dégringolades incessantes, et un fracas rappelant celui d'un champ de bataille, mais avec une sonorité en quelque sorte exaspérée.
La goélette venait de s'écarter sur bâbord pour éviter l'approche d'un iceberg colossal, haut de plus de vingt mètres, taillé presque à pic, et dont la configuration bizarre rappelait celle d'un gigantesque bonnet de grenadier.
Le navire allait le laisser à trente mètres environ sur tribord, quand tout à coup un pan tout entier se détache de la falaise de glace, tombe dans le chenal, s'enfonce, disparaît, puis émerge, en soulevant une vague monstrueuse.
Celle-ci bondit et s'avance comme un mascaret, attaque le glaçon flottant, le fait osciller comme un fétu, et finalement le culbute sens dessus dessous.
Cette scène, longue à raconter, n'a pas duré plus de quinze secondes, et provoqua le cri d'angoisse échappé aux matelots.
Cependant, le navire n'eût couru aucun péril, sans la présence de l'iceberg malencontreusement placé par son travers.
Mais la fatalité permit que, au moment précis où il culbutait sous l'irrésistible poussée de la lame, la portion immergée heurtât, dans son mouvement de rotation, la coque…
La masse de bois gémit et semble près de se désarticuler. Les mâts oscillent, craquent jusque dans leur emplanture et menacent de venir en bas.
Un faux mouvement, une seconde d'hésitation, un de ces incidents qui déroutent les prévisions humaines, et c'en est fait!
La Gallia soulevée, puis brusquement jetée sur un de ses bords, va chavirer sur place.
Un frisson rapide secoue les plus braves qui se cramponnent machinalement au premier objet venu, et jettent sur leur chef un regard angoissé.
Le capitaine a vu et pressenti le danger.
Impassible au milieu du cataclysme d'où surgit une effroyable menace d'anéantissement, il s'écrie d'une voix qui domine le tonnerre des glaces et le rugissement des flots:
«Tiens bon, matelots!
«La barre à bâbord!.. toute!..»
Puis, il met la main sur le télégraphe de la machine, et commande:
«A toute vapeur!»
Pour la seconde fois l'organisme de bois et de métal frémit, et une poussée furieuse le projette d'arrière en avant.
Pendant un instant bien court et qui paraît affreusement long, chacun entend la fausse quille racler la glace, et l'hélice tourbillonner à vide.
Cela dure huit ou dix secondes à peine, mais quel moment terrible!
Et brusquement, la Gallia qui, chose à peine croyable, a glissé sur l'obstacle, comme sur le plan incliné d'un chantier, se trouve soulevée par l'arrière, pique de l'avant et menace de s'abîmer.
Par bonheur, l'iceberg est franchi au moment où la lame s'abat sur le gaillard d'avant.
En un clin d'œil le spardeck se trouve submergé. Les matelots, qui étreignent les haubans, les étais, et tout ce qui peut leur donner prise, enflent le dos sous cette formidable douche. Les chiens, par bonheur attachés solidement, poussent un hurlement lugubre.
La goélette, un moment alourdie, s'enfonce, puis se redresse à mesure que l'eau embarquée s'écoule par les dallots. Le pont est si parfaitement étanche que pas une goutte n'a pénétré dans l'intérieur.
La téméraire mais admirable manœuvre de son capitaine l'a sauvée!
«Pas de bobo! crie une voie joyeuse… la douche est seulement un peu fraîche…»
Mais un cri lugubre qui terrifie les plus braves interrompt soudain la plaisanterie de Plume-au-Vent.
«Un homme à la mer!
– Paraît qu'y en a un qu'en a pas eu assez, reprend l'enragé loustic en se dépouillant de sa veste fourrée.
«Il fait pourtant un peu frisquet, pour s'offrir un bain froid.
«L'animal est capable de me faire piger un rhume de cerveau.
– Stop!»
Pendant que la goélette marche encore sur son erre, un canot est armé.
La bouée de sauvetage a déjà été lancée à la mer.
A cinquante mètres, on aperçoit un homme qui se débat convulsivement, près d'être englouti.
«Mais il va y rester!..
«Y barbotte comme quelqu'un ne sachant pas nager, reprend le Parisien… un amateur, quoi!
«A moi de faire le terre-neuve!»
Et le voilà, sans plus tarder, debout sur la lisse, piquant, par principe, une tête superbe, sans paraître songer à ce froid atroce de 20°.
«Courage! Parisien… courage!..» crient les camarades, pendant que le vapeur s'éloigne encore, et avant que le canot ait glissé sur ses palans.
Et il va, l'intrépide sauveteur, filant comme un poisson sur les flots glacés, se dressant parfois jusqu'à mi-corps, pour chercher la place où se débat le malheureux.
Il l'aperçoit enfin, à une trentaine de mètres, n'ayant plus la force de se mouvoir, déjà raidi par le froid, et pouvant à peine râler un appel suprême.
«Au… secours!
– Mais il a manqué la bouée, grogne le Parisien.
«Croche donc la bouée!.. cachalot en détresse!
«Bon le v'là qui coule!»
En cinq ou six brasses Plume-au-Vent arrive au point où l'autre a disparu. Il plonge à deux reprises et reparaît enfin, nageant d'une main et hâlant de l'autre la fourrure dans laquelle s'agite faiblement le pauvre diable.
Par bonheur, la bouée a dérivé à portée de sa main.
Il s'y accroche, à bout de force et d'haleine, mais joyeux toujours, joyeux par caractère, et plus encore du devoir accompli.
«Et tu sais, faut pas faire des manières et essayer de me faire boire un coup… sinon, je recommence à taper, comme tout à l'heure, là-dessous, chez les phoques.»
Puis un éclat de rire s'échappe de ses lèvres violacées.
«Diable m'emporte! C'est Constant Guignard, dit-il en reconnaissant l'homme qu'il vient d'arracher à la mort.
«Guignard… le bien nommé… vrai!.. quelle guigne!..
«Ohé! du canot!.. ohé!.. par ici… s. v. p…! dépêchez-vous… je crois qu'on a oublié le robinet d'eau chaude.»
L'embarcation, qui volait sur les flots, arrive en ce moment.
Le Parisien, transi jusqu'aux moelles, claquant des dents, raide comme un glaçon, mais blaguant quand même, est hissé à bord en même temps que l'autre, cramponné à la bouée avec l'inconsciente énergie des noyés.
Le maître, Guénic, est à la barre.
«Tiens, petit, dit-il au sauveteur en lui tendant une vaste et chaude fourrure, entortille-toi là dedans.
– C'est pas de refus, maître, vu que… ça doit être un déplorable métier que celui de phoque dans ces parages.
– Et siffle-moi ça, continue le maître en lui offrant une bouteille pleine d'un liquide ambré.
«C'est du vrai lait de tigre, mon gars, de la pure essence de vitriol… ça te réchauffera.
«Et puis, tu sais, petit, ajoute le vieux marin d'une voix attendrie, t'es un matelot… un vrai… je m'y connais.»
Pendant ce temps, Constant Guignard, frictionné à tour de bras, ouvrait lentement des yeux atones et demeurait incapable de prononcer un mot.
«Allons, mon pauvre vieux, reprend le Parisien après une ample rasade, sirote aussi une bonne goutte.
«C'est souverain contre les pâmoisons…
«Ben oui! c'est nous… les copains… t'es pas noyé… rassure-toi donc… t'es pas encore à point pour faire un figurant à la Morgue.»
Cinq minutes après, la baleinière accostait la Gallia.
Pendant que le Parisien sautait allégrement sur le pont au milieu des matelots qui ne lui ménageaient pas leur sympathie, le docteur faisait transporter Guignard au poste des blessés, puis engageait le sauveteur à l'y accompagner.
«Pardon excuse, monsieur le docteur, mais, avec votre permission, dit-il, je vais aller me faire un brin rissoler devant mon fourneau de chauffe.
«Voyez-vous, après une bonne suée, il n'y paraîtra plus.
– Ma foi, mon garçon, c'est une idée.
«Cependant, venez me voir quand vous serez réchauffé.»
Le brave Parisien allait enfiler l'escalier de la machine, quand il se trouve en présence du capitaine qui le regarde de ses yeux tranquilles et lui tend la main.
Confus de cet honneur et certes bien plus intimidé qu'au moment où il se précipitait dans les flots, Plume-au-Vent met respectueusement sa main dans celle de son chef et demeure bouche béante, interloqué.
«Farin, mon brave, dit le capitaine de sa voix chaude et sympathique, au nom de l'équipage et du mien, merci!..»
Et le chauffeur, de plus en plus troublé, ne trouvant pas un mot à répondre, mais tout fier de ce témoignage d'estime, porte la main à son bonnet, salue militairement et disparaît dans l'écoutille.
«Que ne puis-je entreprendre avec de tels hommes! dit à part lui le capitaine en se rendant lui-même à l'infirmerie.
«Oh! j'arriverai là-bas!.. je le sens… je le veux.»
La goélette avait repris sa marche à travers le chenal où les obstacles semblaient s'accumuler à plaisir. Mais du moins l'incident qui faillit dès le début anéantir l'expédition, ou tout au moins porter le deuil dans l'équipage, eut cela de bon que chacun redoubla de vigilance.
Et certes, jamais on n'en a plus besoin en remontant le cercle polaire qui semble fuir devant l'étrave de la Gallia.
Le passage toujours obstrué par les glaces flottantes se maintenait libre, c'est-à-dire, que sa surface ne gelait pas. Du reste, la température, tout en restant assez basse, était moins rigoureuse depuis que le soleil ne disparaissait presque plus à l'horizon. La série des interminables journées arctiques allait commencer. Tout faisait prévoir une prochaine désagrégation du colossal amas de glaçons contre lequel on allait bientôt se heurter.
Depuis longtemps on avait dépassé le fiord d'Arsuth, où se trouve la fameuse mine de cryolithe, nommée Iviktutk. Puis, Friedricshaab, Fiskernaes et enfin Godthaab, la seconde ville de l'inspectorat du Sud. Une triste bourgade plus froide, plus désolée que Julianeshaab. Le 65° était franchi, mais aussi quelles fatigues écrasantes, pour un résultat aussi modeste!
L'implacable brume persistait toujours et s'interposait obstinément devant le soleil, qui, pendant trois mois, allait rayonner sur le désert de glaces.
Et toujours la lutte sans trêve contre les écueils mouvants, aperçus vaguement à travers l'énervante opacité du brouillard! Les manœuvres incessantes qui courbaturaient l'équipage, les arrêts interminables, les retours précipités, la vapeur instantanément renversée, tout cela pour arriver à s'élever de quelques minutes!
Cependant cette brume, en dépit de son opacité, couvre la mer d'une couche très mince, à ce point que les matelots de vigie dans le gréement, se trouvent en plein soleil 4.
Là-haut, d'incomparables jeux de lumière sur les sommets des icebergs et des falaises, en bas, une houle de vapeurs humides, tourbillonnant comme un suaire de gaze, et se résolvant en gouttelettes qui recouvrent d'un enduit de givre les hommes et les choses.
Grâce à cette particularité, le capitaine, toujours alerte comme un gabier, put prendre des hauteurs astronomiques en se hissant dans le tonneau fixé au sommet du grand mât et auquel les baleiniers donnent le nom de nid-de-pie.
C'est ainsi que, le 30 mai, son observation lui donna la certitude que le cercle polaire était enfin franchi.
Il y eut à bord une petite fête remplaçant la cérémonie classique et démodée du passage de la ligne, un bon repas, double ration de vin et de spiritueux et quelques chansons joyeuses où Plume-au-Vent déploya ses talents de virtuose.
Puis le soleil, après la vue duquel on soupirait depuis longtemps, apparut enfin, et pour ne plus disparaître de trois mois.
Les oiseaux, invisibles jusqu'alors, se montrent en essaims innombrables, jacassant à tue-tête, familiers d'ailleurs, au point de venir tourbillonner à travers le gréement du navire. Mouettes, damiers, pétrels, eiders, guillemots, zigzaguent et s'ébattent en pleine lumière, piquent des têtes au milieu des eaux vertes, vont s'éplucher sur les blocs errants, et repartent pour recommencer, indéfiniment.
Les monstres marins, sortis de l'hivernale torpeur, éveillés par cette incandescence qui les met en belle humeur, folâtrent lourdement dans les eaux libres. On voit des troupeaux entiers de phoques se vautrer avec délices sur quelque fragment bien horizontal d'icefield en dérive, et venir plonger curieusement jusque sous l'étrave du navire.
Une ourse même se montra, flanquée de ses deux oursons, humant de loin les émanations parties du vapeur, inquiète du branle-bas occasionné par sa présence.
Le docteur Gélin, grand chasseur, parlait même de lui envoyer une balle express, alléguant la saveur exquise d'un jambon d'ours, fût-il polaire.
Mais le capitaine lui fit observer en souriant que le gibier se trouvait au moins à mille mètres, et que la balle de sa bonne carabine Dougall serait inévitablement perdue.
«Damnée réfraction! dit le docteur en reconnaissant qu'il est victime d'une illusion d'optique très fréquente là-bas.
«Je m'y laisse pourtant prendre comme un conscrit.
– Baleine par l'avant! s'écrie le maître d'équipage dont les yeux luisants aperçoivent une colonne de vapeur chassée par l'évent d'un cétacé.
– Une baleine! riposte une voix bien connue.
«Plus que ça de goujon!
– Ris tant que tu voudras, failli Pantinois, n'empêche que ça me chavire, de ne pas seulement pouvoir lui loger quinze pouces de harpon entre les côtes.
– Voyons, maître Guénic, il y a temps pour tout.
«Que diable feriez-vous d'une pareille sardine?
«Son huile!.. demandez-voir à notre camarade, Monsieur Dumas, dit Tartarin, ce qu'il en pense pour la cuisine.
«Y aurait donc ses baleines qui pourraient vous tenter…
«Est-ce que vous voudriez vous mettre marchand de parapluies?
– Gamin, va! dit le maître, incapable de tenir son sérieux.
– C'est p't-ête pour offrir à madame votre épouse une garniture pour son corset.
– Oui!.. oui!.. tu trouves toujours autant de trous que de chevilles, toi.
«Mais si t'avais évu celui de pratiquer la grande pêche, tu verrais voir, comme ça vous emballe un homme, de capturer un gibier de ce gabarit!»
Mais la Gallia n'avait pas de temps à perdre, quelques pressantes que fussent les occasions.
Oiseaux, plantigrades et cétacés ne furent point inquiétés.
Le surlendemain, à huit heures du matin, par trois degrés au-dessous de zéro, on se trouvait en vue de l'île Disco, dont la pointe est par 69° 11′ de latitude Nord.
C'est le chef-lieu de l'inspectorat septentrional du Groenland et le lieu de résidence du second «colonibestyrere» qui séjourne à Godhawn, situé au Nord de la baie du même nom, défendu contre la haute mer par un immense éperon granitique dont le prolongement s'étend fort loin.
La goélette, profitant de l'état du chenal pour l'instant débarrassé des icebergs, passa au large de l'île, continuant imperturbablement sa route vers les régions septentrionales.
Elle reconnut le détroit de Waïgatz, puis le vaste fiord Onemak, barré en son milieu par l'île Oubekjend; côtoya les gigantesques falaises et le hardi promontoire découvert en 1587 par le vieux John Davis. Cet amas de rochers que domine un cône majestueux de treize cents mètres, le Kresarsoak des Esquimaux, nommé par l'intrépide navigateur «Hope Sanderson», du nom d'un de ses commanditaires, faillit lui être fatal, alors qu'il courait à l'aventure, sur son petit navire de cinquante hommes, le Sunshine (clair de soleil). Il trouva par bonheur une large ouverture conduisant au Nord, et put se réfugier là où se trouve aujourd'hui la station danoise d'Upernavik.
La goélette avait mieux à faire que de s'arrêter au mouillage, sinon dangereux du moins incommode et difficile, au fond duquel s'élèvent quelques huttes désolées où végètent les infortunés sujets de Sa Majesté Danoise. Si Julianeshaab est lugubre et Godhawn atroce, Upernavik est pire; aussi l'Européen se demande avec un serrement de cœur comment des êtres humains peuvent exister au milieu d'une pareille abjection. Passons sur la lèpre qui les ronge, sur l'effroyable pourriture dans laquelle ils se vautrent, l'odeur qui s'exhale de leurs tanières transformées en charniers, sur les mangeailles en décomposition dont ils se gorgent…
Aussi, le capitaine s'empressa-t-il de laisser sur tribord le chef-lieu, faisant autant que possible forcer de vapeur afin de s'élever à tout prix, craignant, non sans raison, d'être serré par la banquise, et de perdre, comme le fait s'est souvent présenté, une année entière.
Il est en effet une question urgente, essentielle, que le voyageur à la recherche des «eaux libres du Nord» ne doit jamais oublier, c'est de se trouver de bonne heure en présence de la banquise ou Pack du Milieu. Si la saison navigable dure de juin à septembre, l'expérience chèrement acquise par les baleiniers démontre que le moment le plus favorable pour gagner la baie de Melville est le mois de juin. Car, à cette époque, on peut toujours, en cas d'insuccès partiel, renouveler une ou plusieurs fois la première tentative, sans courir trop grand risque d'être pris dans les glaces. On se rappelle, à ce sujet, les échecs éprouvés en 1849 par l'Etoile-du-Nord, parce qu'elle n'atteignit la banquise qu'en juillet, et en 1857 par le Fox de Mac-Clintock arrivé en août, et presque aussitôt enserré.
Une fois à la baie de Melville en temps opportun, le navigateur n'a plus alors qu'à prendre corps à corps, et résolument, le dernier obstacle, mais le plus redoutable de tous, car aussitôt ces colonnes d'Hercule franchies, il vogue enfin dans les eaux libres.
C'est alors qu'il lui faut redoubler d'habileté, de vigilance et d'énergie, car malgré l'énorme supériorité des navires à vapeur sur les anciens voiliers, la baie de Melville, autrefois la terreur des baleiniers, ne vaut guère mieux aujourd'hui que sa réputation.
Encore, comme en font foi les annales de la navigation arctique, arrive-t-il trop souvent que tous les efforts demeurent inutiles, en présence de catastrophes que la vaillance humaine est impuissante à conjurer, notamment quand le vent du Sud souffle avec violence et pousse les glaçons en dérive sur le pack. Alors, les navires, pressés entre les deux masses, sont écrasés comme des noix. C'est ainsi que périrent en quelques minutes, quatorze baleiniers, pendant la campagne de 1819. En 1821, il y en eut onze de broyés, et sept en 1822. Le désastre de 1830 fut épouvantable. Le 19 juin, le vent se mit à souffler du Sud-Sud-Ouest, chassa les glaces dans la baie, et serra la flotte entière contre la banquise. Dans la soirée, la tempête augmenta, et des masses énormes montèrent les unes sur les autres. Pendant la nuit, une véritable montagne de glace s'écroula sur les navires et en fracassa dix-neuf, à ce point que les fragments en étaient méconnaissables. L'un deux, le Ratler, complètement retourné, fut aplati, la quille en l'air!
Quelle résistance, en effet, peut opposer, aux forces infinies de la nature, un bateau, quelle que soit sa solidité?
D'Ambrieux, qui connaissait ce douloureux martyrologe des baleiniers, se préparait pourtant, avec son habituelle sérénité, à affronter la terrible baie, sans s'émouvoir de l'appellation sinistre sous laquelle on la désigne encore à notre époque: Le Cimetière des Navires.
4
C'est du reste un fait observé fréquemment sur les paquebots faisant la traversée d'Amérique. Par le travers de Terre-Neuve, les mâts sortent à moitié du brouillard, pendant que la partie inférieure du navire demeure invisible.