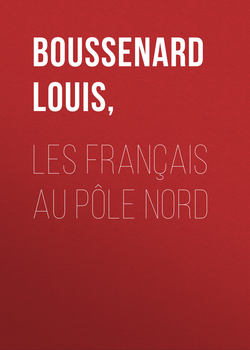Читать книгу Les français au pôle Nord - Луи Буссенар, Boussenard Louis - Страница 8
PREMIÈRE PARTIE
LA ROUTE DU POLE
VIII
ОглавлениеHistoire d'Oûgiouk. – Comment on déshabille un ours polaire. – Capacité d'un estomac groenlandais. – Un amateur de tripes. – Symphonie de blanc et de bleu. – La tempête. – Déviations de la boussole. – A Port-Foulque. – Forêts en miniature. – A terre. – Tentative malheureuse d'un cocher improvisé. – Des effets d'une morue sèche sur un attelage récalcitrant. – Un ours blessé.
Le docteur n'avait point exagéré le poids réellement surprenant du monstre si proprement dépêché par Dumas dit Tartarin, cuisinier de la Gallia.
La femelle pesait cinq cent cinquante kilogrammes, et les oursons chacun trois cents.
Une véritable montagne de victuailles, et trois fourrures splendides qui furent préparées ultérieurement d'après le procédé groenlandais, par le nouveau passager, désormais en sûreté à bord, grâce au tour d'adresse exécuté par monsieur Dumas.
Le pauvre diable, fou de terreur, claquant des dents, à la pensée du danger auquel il a miraculeusement échappé, raconte son histoire.
Oh! très sommairement. Car, en sa qualité d'Esquimau pur sang, de nomade errant sur le désert de glace, il possède un vocabulaire des plus restreints. Une centaine de mots anglais ou danois, accrochés de bric et de broc, en fréquentant les baleiniers.
Quelques matelots de la Gallia sont eux-mêmes nantis d'un nombre égal d'expressions groenlandaises.
Avec beaucoup de gestes et pas mal de bonne volonté, on finit par s'entendre.
L'homme était le chef d'un petit clan anéanti l'année précédente par la variole. Ainsi réduit à une épouvantable solitude, il avait hiverné sur la côte, dans une hutte de neige. Manquant de provisions, réduit à manger ses chiens, il cherchait à rallier Upernavik, au moment où la goélette franchissant la baie de Melville se trouvait arrêtée par les glaces.
L'apparition du navire modifia aussitôt ses intentions. Le prenant pour un baleinier, il résolut de venir offrir au capitaine ses services, ou tout au moins de lui demander assistance. Il se mit en marche sur le floe, mais, tout en cheminant, fut éventé de loin par une famille d'ours blancs qui lui donnèrent la chasse.
Telle fut à peu près la substance du récit, nécessairement fort incomplet, que fit à ses sauveurs le Groenlandais Oûgiouk, c'est-à-dire le Grand-Phoque, dont le nom revint à satiété, pendant la narration.
Il termina en disant qu'il avait faim, qu'il avait soif, et ne savait que devenir. Les capitaines blancs en général étant des pères pour les Esquimaux, le capitaine de la goélette était son père, à lui, Oûgiouk. Il ne pouvait, par conséquent, le laisser dans la détresse. Bref un petit boniment point maladroit, et rendu intéressant par la bonne figure sympathique et la situation cruelle du postulant.
Bien que d'Ambrieux eût résolu en principe de n'adjoindre à son œuvre que des éléments exclusivement français, l'humanité lui faisait un devoir de garder à bord le Grand-Phoque. Impossible, en effet, de le rapatrier, puisque le temps manquait. Impossible également de le renvoyer à Upernavik avec un traîneau, des vivres et des chiens, le nombre de ces auxiliaires à quatre pattes étant à peine suffisant.
Donc, Oûgiouk restera sur la goélette en qualité de passager.
Enfin rassuré sur les éventualités du lendemain, se croyant matelot pour tout de bon, passablement excité par une rasade copieuse qui l'a fortement allumé en éteignant sa soif, le Grand-Phoque devient étonnamment prolixe. Il baragouine, interpelle un à un les marins, veut savoir leur nom, court visiter les chiens et les fait aboyer avec fureur, en leur jetant des syllabes gutturales, et finalement revient près des trois ours.
Cet amas de chair fraîche l'attire, le fascine d'autant plus qu'il est à jeun, et que les provisions de la cambuse ne paraissent pas l'allécher outre mesure.
Ses petits yeux bridés scintillent comme des diamants noirs, sa bouche palissadée de défenses à rendre jaloux un morse, s'entre-bâille jusqu'à ses oreilles, et ses joues, de la nuance d'une vieille casserole graisseuse, se gonflent comme deux outres, quand l'hiatus qui sépare le nez du menton se ferme, dans le mouvement rythmique d'une mastication imaginaire.
Dumas s'est emparé de l'ourse, et armé du grand couteau professionnel, détache par principes la peau du colosse.
Mais les principes du maître-coq ne sont pas ceux de l'homme des glaces qui proteste avec véhémence, et finalement enlève des mains de son sauveur le vaste tranche-lard.
Avec une adresse merveilleuse et une célérité inouïe, ma foi, ce petit homme rabougri, tontonnant, remuant, bavard, coupe, rogne, dissèque, écorche, décolle, arrache, tant et si bien, que l'animal est déshabillé en un tour de main.
A présent, la curée.
C'est plus curieux encore. Un seul coup suffit à ouvrir l'abdomen et à faire surgir de la cavité béante, un véritable monceau d'entrailles fumantes.
Oûgiouk saisit le foie, crache dessus et le lance par-dessus bord au grand scandale du cuisinier.
«Laissez-le faire, interrompt le docteur.
«Il a parfaitement raison, car le foie de l'ours est très malsain.
«On peut même être empoisonné si on a l'imprudence d'en manger.
«Je profite de l'occasion pour vous recommander de vous en abstenir en toute circonstance, comme aussi du foie de phoque.»
Les viscères de l'ours sont absolument vides. Preuve que depuis longtemps l'animal était soumis à un jeûne rigoureux.
La constatation de ce fait amène un vaste rire sur la face camuse du Groenlandais. Sans perdre un moment, il tranche au niveau de l'orifice inférieur l'intestin, encore tout chaud, l'introduit dans sa bouche, et absorbe avec d'intraduisibles mouvements de tête et de cou.
La bouche est pleine et les bajoues gonflées comme celles d'un singe dévalisant un verger.
Ne pouvant plus, sous peine d'asphyxie, introduire un atome de substance, Oûgiouk, d'un second coup de tranche-lard, abat, au ras de ses lèvres, le bout de boyau, fait un violent effort de déglutition, et le paquet franchissant l'isthme du gosier, tombe dans les profondeurs insondables d'un estomac polaire.
Puis il recommence, avec ce mouvement de va-et-vient familier aux canards, entonne une bouchée dont le volume ferait reculer un chien d'équarrisseur, bleuit quand la masse filandreuse pénètre dans le pharynx… et continue de plus belle.
Tant et si bien que la tripaille entière, l'estomac compris, y passa sans encombre. En tout, une dizaine de kilogrammes.
Souriant, heureux, épanoui, le brave Esquimau se frotte avec une béatitude comique le ventre, puis, se ravisant tout à coup, semble se dire:
«Mais il y a encore de la place.
«De quoi loger un dessert, une friandise, un rien.»
L'épine dorsale de l'ourse est capitonnée, au niveau des reins, d'une couche de graisse jaune qui tire l'œil d'Oûgiouk.
«Allons! les dernières bouchées, les meilleures, celles qui font la joie du gastronome, celles qu'on absorbe pour le divin plaisir de la gourmandise.»
Et le Grand-Phoque arrache une pleine poignée de graisse encore tiède, emplit sa bouche, écouvillonne la charge avec ses doigts, et finit, après un tassement laborieux, par introduire jusqu'aux derniers vestiges.
Les matelots témoins de ce festin qui eût fait frémir le bon Gargantua, le grand amateur de tripes, sont littéralement confondus, sauf les baleiniers, depuis longtemps édifiés sur les capacités d'une panse groenlandaise.
Plume-au-Vent et Dumas n'en peuvent croire leurs yeux.
Le cuisinier, pendant cet engloutissement qui n'a pas duré plus de cinq minutes, est passé par les phases de la surprise, de l'étonnement, puis de la stupeur.
On l'entend murmurer:
«C'est pas un hôme… c'est un puits… un gouffre… un abîme…
– N'est-ce pas, hein! Dumas.
«Je ne connais, moi, que mon fourneau de chauffe pour être aussi vorace.
«Et encore!
– Et c'est du monde! pécaïre!
– Ça y ressemble, tout de même.»
Puis, s'adressant au bonhomme qui essuie ses mains à sa face, il ajoute:
«Dites donc, monsieur Untel, si le cœur vous en dit, je vous emmènerai après la campagne.
«Je veux vous conduire aux restaurants à trente-deux sous, là où l'on donne du pain à discrétion.
«Fiche mon billet que vous aurez du succès, et que le patron fera une de ces têtes!..»
Le digne Oûgiouk, comme s'il eût compris et apprécié l'offre du Parisien, sourit en signe d'aquiescement, lui tend sa patte huileuse, puis, avisant une place libre entre deux rouleaux de cordages, s'allonge, ferme les yeux et se met à ronfler.
Pendant cet épisode répugnant, mais authentique, la Gallia qui s'est avancée vers le Nord-Ouest, a trouvé les eaux libres et réussi enfin à franchir la baie de Melville.
Ce n'est pas à dire pour cela que la mer soit débarrassée des glaces flottantes. Mais, les floes en dérive ne sont plus soudés ensemble, leur contexture n'est plus aussi rigide, ni leurs bords aussi vifs. La débâcle est sans doute commencée un peu plus haut, car la neige est fondue en partie, et les hummocks, dont les croupes émergent des plaques horizontales, laissent suinter de minces filets d'eau.
De loin en loin apparaissent de gros icebergs dont les pointes, émoussées sous l'action incessante du soleil qui ne descend jamais au-dessous de l'horizon, se sont mamelonnées en grosses protubérances d'aspect débonnaire.
La glace n'a plus sa physionomie rechignée des jours froids. On la sent mollir, s'adoucir, se faire moins inhospitalière, se laisser pénétrer par l'alanguissante senteur du renouveau qui plane sur le désert arctique.
La mer, d'un bleu turquoise, moutonne gaiement au pied des blocs en dérive, dont la base transparaît comme un cristal sous le flot qui la désagrège. Au-dessus, le ciel, d'un azur intense, forme un fond sur lequel se détachent étrangement, presque sans perspective, et avec une singulière crudité, les masses bleuâtres, çà et là plaquées de blanc mat.
Une véritable symphonie de bleu et de blanc à désespérer un peintre et à faire hurler notre public habitué à d'autres aspects, surtout à d'autres conventions.
Rien qui puisse reposer l'œil ou le distraire de cette énervante monotonie qui n'est pas sans charmes, et de cette incessante mobilité qui transforme, à chaque minute, le tableau invariablement composé des mêmes éléments, et toujours semblable à lui-même.
De temps en temps, cet étrange paysage fait de taches nacrées, mouvantes sur un fond de saphir, prend un peu d'animation. C'est une masse qui chavire brusquement dans un remous, oscille et continue à dériver avec sa lenteur immuable. C'est aussi une plaque de neige qui se décolle et glisse dans la mer avec un petit clapotement très doux, à peine perceptible. Puis l'apparition de phoques à la figure bonasse, qui batifolent avec des gestes de nageurs savourant avec béatitude leur première pleine eau. Puis encore des oiseaux qui, abandonnant résolument leurs hivernages du Sud, s'en vont à tire-d'aile vers le Septentrion, se posent un moment sur la croupe d'un iceberg, et repartent effrayés par la toux saccadée de la machine. Les canards, les oies, les eiders accourent en bandes innombrables, puis des essaims bruyants de grives d'eau, de tourne-pierres, de bruants des neiges et de canuts. Ces derniers ont même déjà quitté leur livrée grise d'hiver, pour la rutilante parure des jours d'été.
Et quand parfois, à la vue de gros nuages blancs produits par la condensation des brumes du Nord, qui arrivent en flocons détachés glissant sur l'azur céleste, l'œil se porte involontairement sur l'azur des flots constellé de glaces dérivant languissamment, on se demande si l'on se trouve en présence d'images réelles ou si l'on n'est pas le jouet d'un mirage.
Le 8 juin, la Gallia se trouvait enfin par le travers du cap York, dont les falaises, revêtues de glaces, coupaient à une grande hauteur la ligne d'horizon.
Le soixante-quinzième parallèle venait d'être franchi, et la Gallia naviguait définitivement dans les eaux du Nord qui s'étendent depuis le cap jusqu'à l'entrée du détroit de Smith.
Le capitaine, plein d'espoir, comptait arriver en trois jours au cap Alexandre, célèbre par l'hivernage du docteur Hayes qui donna au fiord, où s'abrita en 1860 (par 78° 15′), son navire, le nom de Port-Foulque.
Trois degrés en trois jours, ce n'était point être exigeant, surtout si la mer conservait son calme, l'atmosphère sa sérénité. Mais, hélas! qui peut répondre non seulement du lendemain, mais encore de l'heure à venir, sous une latitude où les variations les plus inattendues se produisent instantanément.
A mesure qu'elle s'avance vers le Nord-Ouest, pour doubler le cap Atholl, la Gallia rencontre des glaces de plus en plus nombreuses. Une désagréable facétie de la mer libre qui, loin de justifier son nom, est aussi encombrée que la baie de Melville.
Peu à peu, la température, jusque-là si clémente, s'abaisse de plusieurs degrés, le vent qui soufflait du Sud tourne au Nord, et le baromètre subit une dépression considérable.
Ne voulant pas risquer d'être pris par un grain en vue des abruptes falaises qui s'étendent jusqu'au petit détroit de Wolstenholme, le capitaine fit forcer de vapeur, quitte à heurter les icebergs, et mit résolument le cap sur les îles Carry, où il espérait trouver la mer entièrement débarrassée.
Il comptait de là se diriger vers le cap Sabine, couper le détroit de Hayes en vue des îles Henry et Bache, puis s'abriter derrière les monts Victoria et Albert, en attendant la débâcle définitive. La route minutieusement relevée, les corrections faites à la boussole pour éviter toute erreur au timonier, d'Ambrieux ayant pris toutes les précautions dictées par l'expérience, se reportait par la pensée au temps où le vieux Baffin s'en allait, à l'aventure, sur son petit navire de cinquante tonneaux, stupéfait, en approchant du détroit auquel il allait donner le nom de Smith, de voir son compas dévier de quantités incroyables. Aussi écrivait-il sur son journal: «Ce détroit, qui court au Nord de 78°, est remarquable en un point, parce que là est la plus grande variation de la boussole connue dans le monde entier. Car, par de bonnes observations, j'ai trouvé qu'elle était déviée de plus de cinq quarts ou 56° vers l'Ouest, de sorte que le Nord-Est-quart-Est est lu sur la boussole correspondant au Nord vrai du monde, et ainsi du reste.»
Et il y avait de cela plus de deux siècles et demi! (272 ans.)
Aussi, d'Ambrieux montant un navire dont il avait pu apprécier les qualités, secondé par un excellent équipage, traitait-il de misères les empêchements auxquels il se heurtait, en comparaison des difficultés écrasantes qui étaient le lot de ces intrépides chercheurs.
Cependant le vent fraîchissait de plus en plus. La goélette, forcée de marcher debout à la lame et à la brise, tanguait rudement et embarquait presque à chaque coup.
Le ciel se couvrit de nuées épaisses, et la neige se mit à tomber abondamment.
Pour comble d'ennui, l'eau embarquée se gelait presque instantanément sur le pont bientôt couvert d'une nappe unie comme un miroir, qu'il fallut recouvrir d'escarbilles.
A peine si l'on put s'élever d'un demi-degré qu'il fallut changer la route et abandonner le projet de rallier les îles Carry. Il y eût eu plus que de la témérité à continuer dans de telles conditions. Quoi qu'il pût advenir, le péril était moindre à naviguer près des falaises, hautes de quatre cents mètres, qui, du moins, abritaient en partie le navire contre les rafales.
Brusquement le temps s'éclaircit. L'ouragan balaya les nuées, et le soleil apparut radieux, dardant ses flots de lumière sur les éléments déchaînés.
Mais la furie de la tempête ne désarme pas. Le cap Parry se montre au loin, par 77°, comme l'arête monstrueuse d'un cétacé battu par les flots qui le criblent d'une averse de glaçons. Sur le front des falaises où le vent fait rage, s'élèvent d'épais tourbillons de neige qui, saisis par le mouvement giratoire des trombes, s'éparpillent comme d'impalpables duvets, avec des poudroiements diamantés.
La mer est étrange, formidable et sinistre. Tout craque, tout détone, tout mugit. Les icebergs, heurtés comme des galets, s'écrasent et disparaissent, en quelque sorte volatilisés. Là-bas, en avant du cap, une barre de rochers noirs, dépouillés de leur croûte hivernale, émergent de l'écume laiteuse qui rejaillit en colonnes de vapeurs.
La goélette, après vingt heures de lutte sans merci, doubla enfin le cap, et trouvant le détroit de Murchison débarrassé, s'y engagea lentement.
Elle passa ensuite entre les îles Herbert et Northumberland, obliqua vers le fiord de Peterhavick et continua sa navigation côtière jusqu'au cap Sanmarez, au moment où la tempête s'apaisait enfin.
Le capitaine Georges Nares, favorisé par un temps exceptionnel, avait mis seulement deux jours – du 25 au 27 juillet 1875 – pour aller du cap York au cap Alexandre. Le commandant de la Gallia fut trop heureux, malgré un temps épouvantable, d'accomplir le même trajet en quatre jours.
Le lendemain, 12 juin, la goélette laisse à deux milles et demi, par tribord, l'île Sutherland, faite d'un grès très grossier profondément érodé par l'action des glaces.
Enfin voici le cap Alexandre, un superbe promontoire dont l'altitude atteint quatre cent vingt-sept mètres, et qui avec le cap Isabelle, situé sur l'autre rive, forme l'entrée du défilé connu de géographes sous le nom de détroit de Smith.
La Gallia le contourne de près, au point qu'on peut distinguer à l'œil nu la couleur fauve de ses assises, et la colonne basaltique dont il est surmonté. Elle pénètre enfin, avec des difficultés inouïes, dans le fiord de Port-Foulque où elle se trouve en sûreté.
Le navire solidement ancré sur un fond rocheux, le capitaine autorisa l'équipage à débarquer, sans oublier les chiens, qui, soustraits à la claustration, manifestèrent leur allégresse par des cabrioles et des jappements éperdus quand ils se trouvèrent sur la glace.
On retrouva tout d'abord les épaves du premier hivernage du Polaris, mêlées sans doute à celles des Etats-Unis, le schooner du docteur Hayes. Lambeaux d'étoffes, ciseaux à glace, boîtes à conserve, bouteilles, cordages, engins de pêche, feuillets de livres, etc.
Puis un peu plus loin, en remontant la rive gauche du fiord toujours encroûté de glaces, trois iglous, ou cabanes indigènes. C'est-à-dire des tanières lamentables, édifiées à la diable avec des cailloux cimentés de terre et d'eau glacée.
Preuve que des nomades fréquentent parfois ces points désolés que l'on croirait visités par les seuls représentants de la faune arctique.
Enfin, chose particulièrement intéressante au point de vue anthropologique, on rencontra, un peu plus loin sous des glaçons peut-être séculaires, arrachés par la dernière tempête, les vestiges d'anciennes stations dont il est impossible de déterminer l'âge, même très approximativement. Des quantités énormes d'ossements de rennes, de morses, de bœufs musqués, de phoques, de renards, d'ours, de lièvres, montrent l'existence d'une faune très abondante à cette époque. Tous les crânes sont brisés, tous les os longs sont éclatés, pour en extraire la cervelle et la mœlle, comme le faisaient nos ancêtres des stations préhistoriques.
Il y a aussi des squelettes d'oiseaux, par milliers, surtout de guillemots et de mouettes-bourgmestre.
Le docteur met de côté quelques-uns de ces vestiges des temps écoulés, puis, s'écartant à l'aventure, vers un petit vallon bien abrité des vents du Sud, pousse un cri de joie qui fait accourir ses compagnons.
Imaginez la plus mignonne, la plus exquise forêt en miniature composée de saules et de bouleaux nains, dont une futaie pourrait tenir à l'aise dans la boîte d'un botaniste. Des troncs gros comme des porte-plumes, des branches aussi ténues que des brins de balai, des brindilles non moins déliées que des crins, tout cela couvert de minuscules bourgeons commençant à s'ouvrir sous la tiède caresse du soleil de juin.
Pauvre petit taillis étiolé! C'est à peine s'il trouve de quoi végéter sur cette glèbe de fer, et pourtant il égaye comme d'un sourire – ce sourire résigné des déshérités – la marâtre qui lui mesure si parcimonieusement l'atome indispensable à sa vie.
Puis, à l'entour de l'embryon de forêt, des mousses vertes comme des émeraudes et quelques graminées: des Poa arctica, des glyceria arctica, des alopecurus alpinus, des épilobus roses, des potentilles des neiges, des pavots aux pétales roses, des saxifrages bleus, rouges et jaunes, un véritable parterre, dont le docteur s'appropria discrètement quelques spécimens.
Pendant ce temps, le capitaine, voulant dégourdir les chiens et les soustraire à une immobilité si préjudiciable à leur santé, avait ordonné qu'on les mît aux traîneaux.
Il désirait, en outre, juger des aptitudes de ses hommes à diriger ces attelages fantaisistes.
Plume-au-Vent, lui, en sa qualité de grand maître de la vénerie, ou plutôt, comme il s'intitulait plaisamment, de capitaine des chiens, ne doutait en aucune façon de ses propres mérites.
Ses subordonnés, du reste, le connaissaient parfaitement, et lui obéissaient, jusqu'alors, au doigt et à l'œil. Depuis leur embarquement, il avait été leur pourvoyeur, et avait pour ainsi dire vécu dans leur intimité; aussi se vantait-il, on s'en souvient, d'en faire des chiens savants.
«Eh bien, mon garçon, lui dit avec bonhomie le capitaine, montre-nous le savoir-faire de tes élèves.
«Choisis ceux auxquels tu as le plus confiance et fais-les galoper sur cette belle glace unie.»
L'attelage s'opère sans trop de difficultés, le Parisien procédant par insinuation, et offrant à chacun de ses toutous un morceau d'ours tout cru qu'il sortait de ses poches.
Le traîneau prêt à partir, le conducteur improvisé s'accroupit sur la plate-forme et fait claquer son fouet comme il a vu faire aux gens de Julianeshaab.
Aussitôt, les chiens s'éparpillent dans toutes les directions, tirent à hue, à dia, en éventail, et communiquent au véhicule un mouvement en zigzag d'un comique achevé.
«Allez!.. mais allez donc, satanés cabots!» criait le Parisien vexé des rires fous de l'équipage.
Et les «satanés cabots» allaient, couraient, chacun pour son compte sans souci de l'inoffensive lanière qui claquait en pure perte.
Plume-au-Vent, très malin, s'avise alors d'un stratagème pour sauver au moins l'honneur, et clore, ne fût-ce qu'un moment, la bouche aux rieurs.
Il a encore dans sa poche une certaine quantité de viande. Vite il en lance un morceau devant la meute indocile, aussi loin qu'il peut. Naturellement, les chiens, mis d'accord par leur mutuelle avidité, s'élancent à fond de train, galopent vingt mètres, puis s'arrêtent, se gourmandent jusqu'à ce que le plus adroit ou le plus heureux ait gobé, comme une fraise, l'appât tentateur.
Puis, avec un ensemble surprenant, ils se retournent, s'assoient sur leur derrière, tournent vers leur automédon des yeux chargés de muettes prières et sollicitant une seconde ration.
«Pétard! grogne le Parisien, sentant le ridicule de la position.
«Allons, faut repiquer!»
Un autre morceau de viande obtient le même succès d'estime, et la course progresse d'une égale quantité.
Mais c'est tout. Prières, menaces, coups de lanière, tout est inutile.
Au loin, c'est-à-dire à cinquante mètres, les lazzis pleuvent dru comme grêle sur le loustic dont chacun a essuyé les brocards.
Plume-au-Vent, de plus en plus ennuyé, ne sachant à quel saint se vouer, crie, se démène de plus belle et ne réussit même pas à faire lever ses élèves gravement accroupis sur leur arrière-train.
Fort heureusement Dumas, dont l'épiderme provençal n'a pas été entamé par les plaisanteries d'antan, sauve la situation.
Dumas a une idée qu'il s'empresse de mettre au service de son camarade.
Très simple comme les idées géniales, celle du cuisinier se manifeste sous l'apparence d'une morue sèche amarrée à un bout de ligne.
Dumas accourt devant l'attelage récalcitrant, dont l'odorat est sollicité par les violents effluves de saumure qui s'exhalent de la morue.
La tentation est irrésistible. Aussitôt les chiens se dressent sur leurs pattes, et Dumas, les jugeant suffisamment excités, se met à courir. Tout naturellement ils se précipitent comme une meute qui lance à vue un sanglier. Dumas, voyant le succès de sa ruse, gagne au large en homme capable de rivaliser avec le héros dont les pieds légers ont été chantés par le divin Homère.
La morue tiraillée par la ficelle, saute et rebondit sur la neige, devant le nez des chiens de tête, leur échappant sans cesse, en raison de l'irrégularité du mouvement de translation.
Et Dumas, toujours galopant, réussit à entraîner ainsi le peloton indocile jusqu'à cinq cents mètres.
L'équipage, qui s'amuse comme un clan de demi-dieux, applaudit bruyamment.
De son côté, Plume-au-Vent ravi ne ménage à son camarade ni les éloges, ni les remerciements.
«Allons, ça va! Dumas, ça va… et raide!
«T'es un homme, toi, un vrai… ma parole!
«Mais, tu vas t'époumonner!
«Si tu montais avec moi, à présent que la carriole va son train.
– A ton idée, mon çer! Zé crois en effet que ça marçera sans embardées.»
Il s'installe près du Parisien qui brandit son fouet, le fait claquer à tour de bras, sans autre résultat d'ailleurs, que de cingler son compagnon et lui-même avec la mèche rebelle.
«Allons, bon! v'là encore la mécanique détraquée!
«Décidément, faudra que je demande au Grand-Phoque des leçons de fouet.
«Vois-tu, le fouet, n'y a que ça.
«Sans lui, rien à refrire avec ces maudites bêtes.
– Mais, nous n'allons pas rester en panne, comme sur un ponton, hein?
– Dame, faut rappliquer.
«Pétard! c'que les autres vont s'en payer à mes dépens!
– Eh! pécaïré!.. qu'est-ce qui les prend donque… ces faillis cabots?
«Vont-y s'emballer, autrement!..»
Les chiens, subitement devenus inquiets, tournent le museau vers la terre, pointent les oreilles, aspirent l'air par saccades, font entendre un rauque aboi, et détalent affolés vers le navire.
«Tiens-toi bien!» crie le Parisien, en se cramponnant au traîneau.
Dumas regarde en arrière et pousse un juron carabiné à l'aspect d'un ours se traînant sur trois pattes, retombant à chaque pas, et faisant des efforts désespérés pour avancer.
«Troun de l'air!.. un ours!.. ah ça! il en pleut, dans ce pays!
«Eh!.. il marçe à cloçe-pied!.. ce qu'il a l'air claqué, le povre!
– Claqué ou pas claqué… je tiens pas à le fréquenter, tant qu'y n'sera pas devenu descente de lit.
«Hardi! les chiens… hardi!»
Les pauvres bêtes épouvantées n'ont pas besoin d'encouragement. Rappelées au sentiment de l'unité par une mutuelle terreur, elles filent d'une telle vitesse, que le traîneau arrive en deux minutes au milieu des marins qui déjà se préparent à combattre l'intrus.