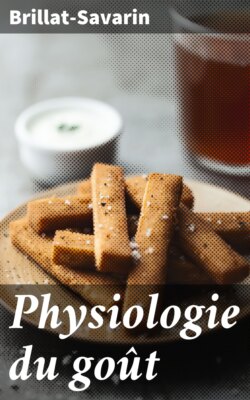Читать книгу Physiologie du goût - Brillat-Savarin - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеI am, Sir, oracle,
And, when I open my lips, let no dog bark.
(Shakespeare, Merchant of Venice, act. I, sc. 1.)
Les sens sont les organes par lesquels l'homme se met en rapport avec les objets extérieurs.
Nombre des Sens.
1.
N doit en compter au moins six:
La vue, qui embrasse l'espace et nous instruit, par le moyen de la lumière, de l'existence et des couleurs des corps qui nous environnent;
L'ouïe, qui reçoit, par l'intermédiaire de l'air, l'ébranlement causé par les corps bruyants ou sonores;
L'odorat, au moyen duquel nous flairons les odeurs des corps qui en sont doués;
Le goût, par lequel nous apprécions tout ce qui est sapide ou esculent;
Le toucher, dont l'objet est la consistance et la surface des corps;
Enfin le génésique ou amour physique, qui entraîne les sexes l'un vers l'autre, et dont le but est la reproduction de l'espèce.
Il est étonnant que, presque jusqu'à Buffon, un sens si important ait été méconnu, et soit resté confondu ou plutôt annexé au toucher.
Cependant la sensation dont il est le siège n'a rien de commun avec celle du tact; il réside dans un appareil aussi complet que la bouche ou les yeux; et ce qu'il y a de singulier, c'est que chaque sexe ayant tout ce qu'il faut pour éprouver cette sensation, il est néanmoins nécessaire que les deux se réunissent pour atteindre au but que la nature s'est proposé. Et si le goût, qui a pour but la conservation de l'individu, est incontestablement un sens, à plus forte raison doit-on accorder ce titre aux organes destinés à la conservation de l'espèce.
Donnons donc au génésique la place sensuelle qu'on ne peut lui refuser, et reposons-nous sur nos neveux du soin de lui assigner son rang.
Mise en action des Sens.
2.--S'il est permis de se porter, par l'imagination, jusqu'aux premiers moments de l'existence du genre humain, il est aussi permis de croire que les premières sensations ont été purement directes, c'est-à-dire qu'on a vu sans précision, ouï confusément, flairé sans choix, mangé sans savouré, et joui avec brutalité.
Mais toutes ces sensations ayant pour centre commun l'âme, attribut spécial de l'espèce humaine, et cause toujours active de perfectibilité, elles y ont été réfléchies, comparées, jugées; et bientôt tous les sens ont été amenés au secours les uns des autres, pour l'utilité et le bien-être du moi sensitif, ou, ce qui est la même chose, de l'individu.
Ainsi, le toucher a rectifié les erreurs de la vue; le son, au moyen de la parole articulée, est devenu l'interprète de tous les sentiments; le goût s'est aidé de la vue et de l'odorat; l'ouïe a comparé les sons, apprécié les distances; et le génésique a envahi les organes de tous les autres sens.
Le torrent des siècles, en roulant sur l'espèce humaine, a sans cesse amené de nouveaux perfectionnements, dont la cause, toujours active, quoique presque inaperçue, se trouve dans les réclamations de nos sens, qui, toujours et tour à tour, demandent à être agréablement occupés.
Ainsi, la vue a donné naissance à la peinture, à la sculpture et aux spectacles de toute espèce;
Le son, à la mélodie, à l'harmonie, à la danse et à la musique, avec toutes ses branches et ses moyens d'exécution;
L'odorat, à la recherche, à la culture et à l'emploi des parfums;
Le goût, à la production, au choix et à la préparation de tout ce qui peut servir d'aliment;
Le toucher, à tous les arts, à toutes les adresses, à toutes les industries;
Le génésique, à tout ce qui peut préparer ou embellir la réunion des sexes, et, depuis François Ier, à l'amour romanesque, à la coquetterie et à la mode; à la coquetterie surtout, qui est née en France, qui n'a de nom qu'en français, et dont l'élite des nations vient chaque jour prendre des leçons dans la capitale de l'univers.
Cette proposition, tout étrange qu'elle paraisse, est cependant facile à prouver; car on ne pourrait s'exprimer avec clarté, dans aucune langue ancienne, sur ces trois grands mobiles de la société actuelle.
J'avais fait sur ce sujet un dialogue qui n'aurait pas été sans attraits; mais je l'ai supprimé, pour laisser à mes lecteurs le plaisir de le faire chacun à sa manière: il y a de quoi déployer de l'esprit, et même de l'érudition, pendant toute une soirée.
Nous avons dit plus haut que le génésique avait envahi les organes de tous les autres sens; il n'a pas influé avec moins de puissance sur toutes les sciences; et en y regardant d'un peu plus près, on verra que tout ce qu'elles ont de plus délicat et de plus ingénieux est dû au désir, à l'espoir ou à la reconnaissance, qui se rapportent à la réunion des sexes.
Telle est donc, en bonne réalité, la généalogie des sciences, même les plus abstraites, qu'elles ne sont que le résultat immédiat des efforts continus que nous avons faits pour gratifier nos sens.
Perfectionnement des Sens.
3.
ES sens, nos favoris, sont cependant loin d'être parfaits, et je ne m'arrêterai pas à le prouver. J'observerai seulement que la vue, ce sens si éthéré, et le toucher, qui est à l'autre bout de l'échelle, ont acquis avec le temps une puissance additionnelle très remarquable.
Par le moyen des bésicles, l'oeil échappe, pour ainsi dire, à l'affaiblissement sénile qui opprime la plupart des autres organes.
Le télescope a découvert des astres jusqu'alors inconnus et inaccessibles à tous nos moyens de mensuration; il s'est enfoncé à des distances telles que des corps lumineux et nécessairement immenses ne se présentent à nous que comme des taches nébuleuses et presque imperceptibles.
Le microscope nous a initiés dans la connaissance de la configuration intérieure des corps; il nous a montré une végétation et des plantes dont nous ne soupçonnions pas même l'existence. Enfin, nous avons vu des animaux cent mille fois au-dessous du plus petit qu'on aperçoit à l'oeil nu; ces animalcules se meuvent cependant, se nourrissent et se reproduisent: ce qui suppose des organes d'une ténuité à laquelle l'imagination ne peut pas atteindre.
D'un autre côté, la mécanique a multiplié les forces; l'homme a exécuté tout ce qu'il a pu concevoir, et a remué des fardeaux que la nature avait créés inaccessibles à sa faiblesse.
A l'aide des armes et du levier, l'homme a subjugué toute la nature; il l'a soumise à ses plaisirs, à ses besoins, à ses caprices; il en a bouleversé la surface, et un faible bipède est devenu le roi de la création.
La vue et le toucher, ainsi agrandis dans leur puissance, pourraient appartenir à une espèce bien supérieure à l'homme; ou plutôt l'espèce humaine serait toute autre, si tous les sens avaient été ainsi améliorés.
Il faut remarquer cependant que, si le toucher a acquis uni grand développement comme puissance musculaire, la civilisation n'a presque rien fait pour lui comme organe sensitif; mais il ne faut désespérer de rien, et se ressouvenir que l'espèce humaine est encore bien jeune, et que ce n'est qu'après une longue série de siècles que les sens peuvent agrandir leur domaine.
Par exemple, ce n'est que depuis environ quatre siècles qu'on a découvert l'harmonie, science toute céleste, et qui est au son ce que la peinture est aux couleurs 9.
Note 9: (retour) Nous savons qu'on a soutenu le contraire; mais ce système est sans appui.
Si les anciens avaient connu l'harmonie, leurs écrits auraient conservé quelques notions précises à cet égard, au lieu qu'on ne se prévaut que de quelques phrases obscures, qui se prêtent à toutes les inductions.
D'ailleurs, on ne peut suivre la naissance et les progrès de l'harmonie dans les monuments qui nous restent; c'est une obligation que nous avons aux Arabes, qui nous firent présent de l'orgue, qui, faisant entendre à la fois plusieurs sons continus, fit naître la première idée de l'harmonie.
Sans doute les anciens savaient chanter accompagnés d'instruments à l'unisson; mais là se bornaient leurs connaissances; ils ne savaient ni décomposer les sons ni en apprécier les rapports.
Ce n'est que depuis le quinzième siècle qu'on a fixé la tonalisation, réglé la marche des accords, et qu'on s'en est aidé pour soutenir la voix et renforcer l'expression des sentiments.
Cette découverte, si tardive et cependant si naturelle, a dédoublé l'ouïe, elle y a montré deux facultés en quelque sorte indépendantes, dont l'une reçoit les sons et l'autre en apprécie la résonance.
Les docteurs allemands disent que ceux qui sont sensibles à l'harmonie ont un sens de plus que les autres.
Quant à ceux pour qui la musique n'est qu'un amas de sons confus, il est bon de remarquer que presque tous chantent faux; et il faut croire, ou que chez eux l'appareil auditif est fait de manière à ne recevoir que des vibrations courtes et sans ondulations, ou plutôt que les deux oreilles n'étant pas au même diapason, la différence en longueur et en sensibilité de leurs parties constituantes fait qu'elles ne transmettent au cerveau qu'une sensation obscure et indéterminée, comme deux instruments qui ne joueraient ni dans le même ton ni dans la même mesure, et ne feraient entendre aucune mélodie suivie.
Les derniers siècles qui se sont écoulés ont aussi donné à la sphère du goût d'importantes extensions: la découverte du sucre et de ses diverses préparations, les liqueurs alcooliques, les glaces, la vanille, le thé, le café, nous ont transmis des saveurs d'une nature jusqu'alors inconnue.
Qui sait si le toucher n'aura pas son tour, et si quelque hasard heureux ne nous ouvrira pas, de ce côté là, quelque source de jouissances nouvelles? ce qui est d'autant plus probable que la sensibilité tactile existe par tout le corps, et conséquemment peut partout être excitée.
Puissance du Goût.
4.--On a vue que l'amour physique a envahi toutes les sciences: il agit en cela avec cette tyrannie qui le caractérise toujours.
Le goût, cette faculté plus prudente, plus mesurée, quoique non moins active; le goût, disons-nous, est parvenu au même but avec une lenteur qui assure la durée de ses succès.
Nous nous occuperons ailleurs à en considérer la marche; mais déjà nous pourrons remarquer que celui qui a assisté à un repas somptueux, dans une salle ornée de glaces, de peintures, de sculptures, de fleurs, embaumée de parfums, enrichie de jolies femmes, remplie des sons d'une douce harmonie; celui-là, disons-nous, n'aura pas besoin d'un grand effort d'esprit pour se convaincre que toutes les sciences ont été mises à contribution pour rehausser et encadrer convenablement les jouissances du goût.
But de l'action des Sens.
5.--Jetons maintenant un coup d'oeil général sur le système de nos sens pris dans leur ensemble, et nous verrons que l'auteur de la création a eu deux buts, dont l'un est la conséquence de l'autre, savoir: la conservation de l'individu et la durée de l'espèce.
Telle est la destinée de l'homme, considéré comme être sensitif: c'est à cette double fin que se rapportent toutes ses actions.
L'oeil aperçoit les objets extérieurs, révèle les merveilles dont l'homme est environné, et lui apprend qu'il fait partie d'un grand tout.
L'ouïe perçoit les sons, non-seulement comme sensation agréable, mais encore comme avertissement du mouvement des corps qui peuvent occasionner quelque danger.
La sensibilité veille pour donner, par le moyen de la douleur, avis de toute lésion immédiate.
La main, ce serviteur fidèle, a non-seulement préparé sa retraite, assuré ses pas, mais encore saisi, de préférence, les objets que l'instinct lui fait croire propres à réparer les pertes causées par l'entretien de la vie.
L'odorat les explore; car les substances délétères sont presque toujours de mauvaise odeur.
Alors le goût se décide, les dents sont mises en action, la langue s'unit au palais pour savourer, et bientôt l'estomac commencera l'assimilation.
Dans cet état, une langueur inconnue se fait sentir, les objets se décolorent, le corps plie, les yeux se ferment; tout disparaît, et les sens sont dans un repos absolu.
A son réveil, l'homme voit que rien n'a changé autour de lui; cependant un feu secret fermente dans son sein, un organe nouveau s'est développé; il sent qu'il a besoin de partager son existence.
Ce sentiment actif, inquiet, impérieux, est commun aux deux sexes; il les rapproche, les unit et quand le germe d'une existence nouvelle est fécondé, les individus peuvent dormir en paix: ils viennent de remplir le plus saint de leurs devoirs en assurant la durée de l'espèce 10.
Tels sont les aperçus généraux et philosophiques que j'ai cru devoir offrir à mes lecteurs, pour les amener naturellement à l'examen plus spécial de l'organe du goût.
Note 10: (retour) M. de Buffon a peint, avec tous les charmes de la plus brillante éloquence, les premiers moments de l'existence d'Ève. Appelé à traiter un sujet presque semblable, nous n'avons prétendu donner qu'un dessin au simple trait; les lecteurs sauront bien y ajouter le coloris.
Définition du Goût.
6.
E goût est celui de nos sens qui nous met en relation avec les corps sapides, au moyen de la sensation qu'ils exercent dans l'organe destiné à les apprécier.
Le goût, qui a pour excitateurs l'appétit, la faim et la soif, est la base de plusieurs opérations dont le résultat est que l'individu croît, se développe, se conserve et répare les pertes causées par les évaporations vitales.
Les corps organisés ne se nourrissent pas tous de la même manière; l'auteur de la création, également varié dans ses méthodes et sûr dans ses effets, leur a assigné divers modes de conservation.
Les végétaux, qui se trouvent au bas de l'échelle des être vivants, se nourrissent par des racines qui, implantées dans le sol natal, choisissent, par le jeu d'une mécanique particulière, les diverses substances qui ont la propriété de servir à leur croissance et à leur entretien.
En remontant un peu plus haut, on rencontre les corps doués de la vie animale, mais privés de locomotion; ils naissent dans un milieu qui favorise leur existence, et des organes spéciaux en extraient tout ce qui est nécessaire pour soutenir la portion de vie et de durée qui leur a été accordée; ils ne cherchent pas leur nourriture, la nourriture vient les chercher.
Un autre mode a été fixé pour la conservation des animaux qui parcourent l'univers, et dont l'homme est sans contredit le plus parfait. Un instinct particulier l'avertit qu'il a besoin de se repaître; il cherche, il saisit les objets dans lesquels il soupçonne la propriété d'apaiser ses besoins; il mange, se restaure, et parcourt ainsi, dans la vie, la carrière qui lui est assignée.
Le goût peut se considérer sous trois rapports:
Dans l'homme physique, c'est l'appareil au moyen duquel il apprécie les saveurs;
Considéré dans l'homme moral, c'est la sensation qu'excite, au centre commun, l'organe impressionné par un corps savoureux; enfin, considéré dans sa cause matérielle, le goût est la propriété qu'a un corps d'impressionner l'organe et de faire naître la sensation.
Le goût paraît avoir deux usages principaux:
1° Il nous invite, par le plaisir, à réparer les pertes continuelles que nous faisons par l'action de la vie;
2° Il nous aide à choisir, parmi les diverses substances que la nature nous présente, celles qui nous sont propres à nous servir d'aliments.
Dans ce choix, le goût est puissamment aidé par l'odorat, comme nous le verrons plus tard; car on peut établir, comme maxime générale, que les substances nutritives ne sont repoussantes ni au goût ni à l'odorat.
Mécanique du Goût.
7.--Il n'est pas facile de déterminer précisément en quoi consiste l'organe du goût. Il est plus compliqué qu'il ne paraît.
Certes, la langue joue un grand rôle dans le mécanisme de la dégustation; car, considérée comme douée d'une force musculaire assez franche, elle sert à gâcher, retourner, pressurer et avaler les aliments.
De plus, au moyen des papilles plus ou moins nombreuses dont elle est parsemée, elle s'imprègne des particules sapides et solubles des corps avec lesquels elle se trouve en contact; mais tout cela ne suffit pas, et plusieurs autres parties adjacentes concourent à compléter la sensation, savoir, les joues, le palais et surtout la fosse nasale, sur laquelle les physiologistes n'ont peut-être pas assez insisté.
Les joues fournissent la salive, également nécessaire à la mastication et à la formation du bol alimentaire; elles sont, ainsi que le palais, douées d'une portion de facultés appréciatives; je ne sais pas même si, dans certains cas, les gencives n'y participent pas un peu; et sans l'odoration qui s'opère dans l'arrière-bouche, la sensation du goût serait obtuse et tout à fait imparfaite.
Les personnes qui n'ont pas de langue, ou à qui elle a été coupée, ont encore assez bien la sensation de goût. Le premier cas se trouve dans tous les livres; le second m'a été assez bien expliqué par un pauvre diable auquel les Algériens avaient coupé la langue, pour le punir de ce qu'avec quelques-uns de ses camarades de captivité, il avait formé le projet de se sauver et de s'enfuir.
Cet homme, que je rencontrai à Amsterdam, où il gagnait sa vie à faire des commissions, avait eu quelque éducation, et on pouvait facilement s'entretenir avec lui par écrit.
Après avoir observé qu'on lui avait enlevé toute la partie antérieure de la langue jusqu'au filet, je lui demandai s'il trouvait encore quelque saveur à ce qu'il mangeait, et si la sensation du goût avait survécu à l'opération cruelle qu'il avait subie.
Il me répondit que ce qui le fatiguait le plus était d'avaler (ce qu'il ne faisait qu'avec quelque difficulté); qu'il avait assez bien conservé le goût; qu'il appréciait comme les autres ce qui était un peu sapide; mais que les choses fortement acides ou amères lui causaient d'intolérables douleurs.
Il m'apprit encore que l'abscision de la langue était commune dans les royaumes d'Afrique; qu'on l'appliquait spécialement à ceux qu'on croyait avoir été chefs de quelque complot, et qu'on avait des instruments qui y étaient appropriés. J'aurais voulu qu'il m'en fît la description; mais il me montra, à cet égard, une répugnance tellement douloureuse, que je n'insistai pas.
Je réfléchis sur ce qu'il me disait, et, remontant aux siècles d'ignorance, où l'on perçait et coupait la langue des blasphémateurs, --et à l'époque où ces lois avaient été faites, je me crus en droit de conclure qu'elles étaient d'origine africaine, et importés par le retour des croisés.
On a vu plus haut que la sensation du goût résidait principalement dans les papilles de la langue. Or, l'anatomie nous apprend que toutes les langues n'en sont pas également munies; de sorte qu'il en est telle où l'on en trouve trois fois plus que dans telle autre. Cette circonstance explique pourquoi, de deux convives assis au même banquet, l'un est délicieusement affecté, tandis que l'autre a l'air de ne manger que comme contraint: c'est que ce dernier a la langue faiblement outillée, et que l'empire de la saveur a aussi ses aveugles et ses sourds.
Sensation du Goût.
8.--On a ouvert cinq ou six avis sur la manière dont s'opère la sensation du goût; j'ai aussi le mien, et le voici:
La sensation du goût est une opération chimique qui se fait par voie humide, comme nous disions autrefois, c'est-à-dire qu'il faut que les molécules sapides soient dissoutes dans un fluide quelconque, pour pouvoir ensuite êtres absorbées par les houppes nerveuses, papilles ou suçoirs, qui tapissent l'intérieur de l'appareil dégustateur.
Ce système, neuf ou non, est appuyé de preuves physiques et presque palpables.
L'eau pure ne cause point la sensation du goût, parce qu'elle ne contient aucune particule sapide. Dissolvez-y un grain de sel, quelques gouttes de vinaigre, la sensation aura lieu.
Les autres boissons, au contraire, nous impressionnent parce qu'elles ne sont autre chose que des solutions plus ou moins chargées de particules appréciables.
Vainement la bouche se remplirait-elle de particules divisées d'un corps insoluble, la langue éprouverait la sensation du toucher, et nullement celle du goût.
Quant aux corps solides et savoureux, il faut que les dents les divisent, que la salive et les autres fluides gustuels les imbibent, et que la langue les presse contre le palais pour en exprimer un suc qui, pour lors suffisamment chargé de sapidité, est apprécié par les papilles dégustatrices, qui délivrent au corps ainsi trituré le passeport qui lui est nécessaire pour être admis dans l'estomac.
Ce système, qui recevra encore d'autres développements, répond sans effort aux principales questions qui peuvent se présenter.
Car, si on demande ce qu'on entend par corps sapides, on répond que c'est tout corps soluble et propre à être absorbé par l'organe du goût.
Et si on demande comment le corps sapide agit, on répond qu'il agit toutes les fois qu'il se trouve dans un état de dissolution tel qu'il puisse pénétrer dans les cavités chargées de recevoir et de transmettre la sensation.
En un mot, rien de sapide que ce qui est déjà dissous ou prochainement soluble.
Des saveurs.
9.
E nombre des saveurs est infini, car tout corps soluble a une saveur spéciale, qui ne ressemble entièrement à aucune autre.
Les saveurs se modifient en outre par leur agrégation simple, double, multiple; de sorte qu'il est impossible d'en faire le tableau, depuis la plus attrayante jusqu'à la plus insupportable, depuis la fraise jusqu'à la coloquinte. Aussi tous ceux qui l'ont essayé ont-ils à peu près échoué.
Ce résultat ne doit pas étonner; car étant donné qu'il existe des séries indéfinies de saveurs simples qui peuvent se modifier par leur adjonction réciproque en tout nombre et en toute quantité, il faudrait une langue nouvelle pour exprimer tous ces effets, et des montagnes d'in-folio pour les définir, et des caractères numériques inconnus pour les étiqueter.
Or, comme jusqu'ici il ne s'est encore présenté aucune circonstance où quelque saveur ait dû être appréciée avec une exactitude rigoureuse, on a été forcé de s'en tenir à un petit nombre d'expressions générales, telle que doux, sucré, acide, acerbe, et autres pareilles, qui s'expriment, en dernière analyse, par les deux suivantes: agréable ou désagréable au goût, et suffisent pour se faire entendre et pour indiquer à peu près la propriété gustuelle du corps sapide dont on s'occupe.
Ceux qui viendront après nous en sauront davantage, et il n'est déjà plus permis de douter que la chimie ne leur révèle les causes ou les éléments primitifs des saveurs.
Influence de l'odorat sur le goût.
10.--L'ordre que je me suis prescrit m'a insensiblement amené au moment de rendre à l'odorat les droits qui lui appartiennent, et de reconnaître les services importants qu'il nous rend dans l'appréciation des saveurs; car, parmi les auteurs qui me sont tombés sous la main, je n'en ai trouvé aucun qui me paraisse lui avoir fait pleine et entière justice.
Pour moi, je suis non seulement persuadé que, sans la participation de l'odorat, il n'y a pas de dégustation complète, mais encore je suis tenté de croire que l'odorat et le goût ne forment qu'un seul sens, dont la bouche est le laboratoire et le nez la cheminée, ou, pour parler plus exactement, dont l'un sert à la dégustation des corps tactiles, et l'autre à la dégustation des gaz.
Ce système peut être rigoureusement défendu; cependant, comme je n'ai point la prétention de faire secte, je ne le hasarde que pour donner à penser à mes lecteurs, et pour montrer que j'ai vu de près le sujet que je traite. Maintenant je continue ma démonstration au sujet de l'importance de l'odorat, sinon comme partie constituante du goût, du moins comme accessoire obligé.
Tout corps sapide est nécessairement odorant: ce qui le place dans l'empire de l'odorat comme dans l'empire du goût.
On ne mange rien sans le sentir avec plus ou moins de réflexion; et pour les aliments inconnus, le nez fait toujours fonction de sentinelle avancée, qui crie: Qui va là?
Quand on intercepte l'odorat, on paralyse le goût; c'est ce qui se prouve par trois expériences que tout le monde peut vérifier avec un égal succès.
Première expérience: Quand la membrane nasale est irritée par un violent coryza (rhume de cerveau), le goût est entièrement oblitéré; on ne trouve aucune saveur à ce qu'on avale, et cependant la langue reste dans son état naturel.
Seconde expérience: Si on mange en se serrant le nez, on est tout étonné de n'éprouver la sensation du goût que d'une manière obscure et imparfaite; par ce moyen les médicaments les plus repoussants passent presque inaperçus.
Troisième expérience: On observe le même effet, si, au moment où l'on avale, au lieu de laisser revenir la langue à sa place naturelle, on continue à la tenir attachée au palais; en ce cas, on intercepte la circulation de l'air, l'odorat n'est point frappé, et la gustation n'a pas lieu.
Ces divers effets dépendent de la même cause, le défaut de coopération de l'odorat: ce qui fait que le corps sapide n'est apprécié que pour son suc, et non pour le gaz odorant qui en émane.
Analyse de la sensation du Goût.
11.
ES principes étant ainsi posés, je regarde comme certain que le goût donne lieu à des sensations de trois ordres différents, savoir: la sensation directe, la sensation complète et la sensation réfléchie.
La sensation directe est ce premier aperçu qui naît du travail immédiat des organes de la bouche, pendant que le corps appréciable se trouve encore sur la langue antérieure.
La sensation complète est celle qui se compose de ce premier aperçu et de l'impression qui naît quand l'aliment abandonne cette première position, passe dans l'arrière-bouche, et frappe tout l'organe par son goût et par son parfum.
Enfin la sensation réfléchie est le jugement que porte l'âme sur les impressions qui lui sont transmises par l'organe.
Mettons ce système en action, en voyant ce qui se passe dans l'homme qui mange ou qui boit.
Celui qui mange une pêche, par exemple, est d'abord frappé agréablement par l'odeur qui en émane; il la met dans sa bouche, et éprouve une sensation de fraîcheur et d'acidité qui l'engage à continuer; mais ce n'est qu'au moment où il avale et que la bouchée passe sous la fosse nasale que le parfum lui est révélé, ce qui complète la sensation que doit causer une pêche. Enfin, ce n'est que lorsqu'il a avalé que, jugeant ce qu'il vient d'éprouver, il se dit à lui-même: «Voilà qui est délicieux!»
Pareillement, quand on boit: tant que le vin est dans la bouche, on est agréablement, mais non parfaitement impressionné; ce n'est qu'au moment où l'on cesse d'avaler qu'on peut véritablement goûter, apprécier, et découvrir le parfum particulier à chaque espèce; et il faut un petit intervalle de temps pour que le gourmet puisse dire: «Il est bon, passable ou mauvais. Peste! c'est du chambertin! O mon Dieu! c'est du surène!»
On voit par là que c'est conséquemment aux principes, et par suite d'une pratique bien entendue, que les vrais amateurs sirotent leur vin (they sip it); car, à chaque gorgée, quand ils s'arrêtent, ils ont la somme entière du plaisir qu'ils auraient éprouvé s'ils avaient bu le verre d'un seul trait.
La même chose se passe encore, mais avec bien plus d'énergie, quand le goût doit être désagréablement affecté.
Voyez ce malade que la Faculté contraint à s'ingérer un énorme verre d'une médecine noire, telle qu'on les buvait sous le règne de Louis XIV.
L'odorat, moniteur fidèle, l'avertit de la saveur repoussante de la liqueur traîtresse; ses yeux s'arrondissent comme à l'approche d'un danger; le dégoût est sur ses lèvres, et déjà son estomac se soulève. Cependant on l'exhorte, il s'arme de courage, se gargarise d'eau-de-vie, se serre le nez et boit...
Tant que le breuvage empesté remplit la bouche et tapisse l'organe, la sensation est confuse et l'état supportable; mais à la dernière gorgée, les arrière-goûts se développent, les odeurs nauséabondes agissent, et tous les traits du patient expriment une horreur et un goût que la peur de la mort peut seule faire affronter.
S'il est question, au contraire, d'une boisson insipide, comme, par exemple, un verre d'eau, on n'a ni goût ni arrière-goût; on n'éprouve rien, on ne pense à rien; on a bu, et voilà tout.
Ordre des diverses impressions du Goût.
12.--Le goût n'est pas si richement doté que l'ouïe; celle-ci peut entendre et comparer plusieurs sons à la fois: le goût, au contraire, est simple en activité, c'est-à-dire qu'il ne peut être impressionné par deux saveurs en même temps.
Mais il peut être double, et même multiple par succession, c'est-à-dire que, dans le même acte de gutturation, on peut éprouver successivement une seconde et même une troisième sensation, qui vont en s'affaiblissant graduellement, et qu'on désigne par les mots, arrière-goût, parfum ou fragrance; de la même manière que, lorsqu'un son principal est frappé, une oreille exercée y distingue une ou plusieurs séries de consonances, dont le nombre n'est pas encore parfaitement connu.
Ceux qui mangent vite et sans attention ne discernent pas les impressions du second degré; elles sont l'apanage exclusif du petit nombre d'élus; et c'est par leur moyen qu'ils peuvent classer, par ordre d'excellence, les diverses substances soumises à leur examen.
Ces nuances fugitives vibrent encore longtemps dans l'organe du goût; les professeurs prennent, sans s'en douter, une position appropriée, et c'est toujours le cou allongé et le nez à bâbord qu'ils rendent leurs arrêts.
Jouissances dont le Goût est l'occasion.
13.
ETONS maintenant un coup d'oeil philosophique sur le plaisir ou la peine dont le goût peut être l'occasion.
Nous trouvons d'abord l'application de cette vérité malheureusement trop générale, savoir: que l'homme est bien plus fortement organisé pour la douleur que pour le plaisir.
Effectivement, l'injection des substances acerbes, âcres ou amères au dernier degré, peut nous faire essuyer des sensations extrêmement pénibles ou douloureuses. On prétend même que l'acide hydrocianique ne tue si promptement que parce qu'il cause une douleur si vive que les forces vitales ne peuvent la supporter sans s'éteindre.
Les sensations agréables ne parcourent, au contraire, qu'une échelle peu étendue, et s'il y a une différence assez sensible entre ce qui est insipide et ce qui flatte le goût, l'intervalle n'est pas très grand entre ce qui est reconnu pour bon et ce qui est réputé excellent; ce qui est éclairci par l'exemple suivant: premier terme, un bouilli sec et dur; deuxième terme, un morceau de veau; troisième terme, un faisan cuit à point.
Cependant le goût, tel que la nature nous l'a accordé, est encore celui de nos sens qui, tout bien considéré, nous procure le plus de jouissances:
1° Parce que le plaisir de manger est le seul qui, pris avec modération, ne soit pas suivi de fatigue:
2° Parce qu'il est de tous les temps, de tous les âges et de toutes les conditions;
3° Parce qu'il revient nécessairement au moins une fois par jour, et qu'il peut être répété, sans inconvénient, deux ou trois fois dans cet espace de temps;
4° Parce qu'il peut se mêler à tous les autres et même nous consoler de leur absence;
5° Parce que les impressions qu'il reçoit sont à la fois plus durables et plus dépendantes de notre volonté.
6° Enfin, parce qu'en mangeant nous éprouvons un certain bien-être indéfinissable et particulier, qui vient de la conscience instinctive; que, par cela même que nous mangeons, nous réparons nos pertes et nous prolongeons notre existence.
C'est ce qui sera plus amplement développé au chapitre où nous traiterons spécialement du plaisir de la table, pris au point où la civilisation actuelle l'a amené.
Suprématie de l'homme.
14.
OUS avons été élevés dans la douce croyance que, de toutes les créatures qui marchent, nagent, rampent ou volent, l'homme est celle dont le goût est le plus parfait.
Cette foi est menacée d'être ébranlée.
Le docteur Gall, fondé sur je ne sais quelles inspections, prétend qu'il est des animaux chez qui l'appareil gustuel est plus développé, et partant plus parfait que celui de l'homme.
Cette doctrine est malsonnante et sent l'hérésie.
L'homme, de droit divin, roi de toute la nature, et au profit duquel la terre a été couverte et peuplée, doit nécessairement être muni d'un organe qui puisse le mettre en rapport avec tout ce qu'il y a de sapide chez ses sujets.
La langue des animaux ne passe pas la portée de leur intelligence: dans les poissons, ce n'est qu'un os mobile; dans les oiseaux, généralement, un cartilage membraneux; dans les quadrupèdes, elle est souvent revêtue d'écailles ou d'aspérités, et d'ailleurs elle n'a point de mouvements circonflexes.
La langue de l'homme, au contraire, par la délicatesse de sa contexture et des diverses membranes dont elle est environnée et avoisinée, annonce assez la sublimité des opérations auxquelles elle est destinée.
J'y ai, en outre, découvert au moins trois mouvements inconnus aux animaux, et que je nomme mouvements de spication, de rotation et de verrition (à verro, lat., je balaye). Le premier a lieu quand la langue sort en forme d'épi d'entre les lèvres qui la compriment; le second, quand la langue se meut circulairement dans l'espace compris entre l'intérieur des joues et le palais; le troisième, quand la langue, se recourbant en dessus ou en dessous, ramasse les portions qui peuvent rester dans le canal demi-circulaire formé par les lèvres et les gencives.
Les animaux sont bornés dans leurs goûts: les uns ne vivent que de végétaux, d'autres ne mangent que de la chair; d'autres se nourrissent exclusivement de graines: aucun d'eux ne connaît les saveurs composées.
L'homme, au contraire, est omnivore; tout ce qui est mangeable est soumis à son vaste appétit; ce qui entraîne, pour conséquence immédiate, des pouvoirs dégustateurs proportionnés à l'usage général qu'il doit en faire. Effectivement, l'appareil du goût est d'une rare perfection chez l'homme, et pour bien nous en convaincre, voyons-le manoeuvrer.
Dès qu'un corps esculent est introduit dans la bouche, il est confisqué, gaz et sucs, sans retour.
Les lèvres s'opposent à ce qu'il rétrograde; les dents s'en emparent et le broient; la salive l'imbibe; la langue le gâche et le retourne; un mouvement aspiratoire le pousse vers le gosier; la langue se soulève pour le faire glisser; l'odorat le flaire en passant, et il est précipité dans l'estomac pour y subir des transformations ultérieures, sans que, dans toute cette opération, il se soit échappé une parcelle, une goutte ou un atome, qui n'ait pas été soumis au pouvoir appréciateur.
C'est aussi par suite de cette perfection que la gourmandise est l'apanage exclusif de l'homme.
Cette gourmandise est même contagieuse, et nous la transmettons assez promptement aux animaux que nous avons appropriés à notre usage, et qui font en quelque sorte société avec nous, tels que les éléphants, les chiens, les chats et même les perroquets.
Si quelques animaux ont la langue plus grosse, le palais plus développé, le gosier plus large, c'est que cette langue, agissant comme muscle, est destinée à remuer de grands poids, le palais à presser, le gosier à avaler de plus grosses portions; mais toute analogie bien entendue s'oppose à ce qu'on puisse en induire que le sens est plus parfait.
D'ailleurs, le goût ne devant s'estimer que par la nature de la sensation qu'il porte au centre commun, l'impression reçue par l'animal ne peut pas se comparer à celle qui a lieu dans l'homme; cette dernière, étant à la fois plus claire et plus précise, suppose nécessairement une qualité supérieure dans l'organe qui la transmet.
Enfin, que peut-on désirer dans une faculté susceptible d'un tel point de perfection, que les gourmands de Rome distinguaient, au goût, les poissons pris entre les ponts de celui qui avait été péché plus bas? N'en voyons-nous pas, de nos jours, qui ont découvert la saveur particulière de la cuisse sur laquelle la perdrix s'appuie en dormant? Et ne sommes-nous pas environnés de gourmets qui peuvent indiquer la latitude sous laquelle un vin a mûri, tout aussi sûrement qu'un élève de Biot ou d'Arago sait prédire une éclipse?
Que s'ensuit-il de là? qu'il faut rendre à César ce qui est à César, proclamer l'homme le grand gourmand de la nature, et ne pas s'étonner si le bon docteur fait quelquefois comme Homère: Auch zuweiler schlaffert der guter G***.
Méthode adoptée par l'auteur.
15.
USQU'ICI nous n'avons examiné le goût que sous le rapport de sa constitution physique; et à quelques détails anatomiques près, que peu de personnes regretteront, nous nous sommes tenus au niveau de la science. Mais là ne finit pas la tâche que nous nous sommes imposée; car c'est surtout de son histoire morale que ce sens réparateur tire son importance et sa gloire.
Nous avons donc rangé, suivant un ordre analytique, les théories et les faits qui composent l'ensemble de cette histoire, de manière qu'il puisse en résulter de l'instruction sans fatigue.
C'est ainsi que, dans les chapitres qui vont suivre, nous montrerons comment les sensations, à force de se répéter et de se réfléchir, ont perfectionné l'organe et étendu la sphère de ses pouvoirs; comment le besoin de manger, qui n'était d'abord qu'un instinct, est devenu une passion influente, qui a pris un ascendant bien marqué sur tout ce qui tient à la société.
Nous dirons aussi comment toutes les sciences qui s'occupent de la composition des corps se sont accordées pour classer et mettre à part ceux de ces corps qui sont appréciables par le goût, et comment les voyageurs ont marché vers le même but, en soumettant à nos essais les substances que la nature ne semblait pas avoir destinées à jamais se rencontrer.
Nous suivrons la chimie au moment où elle a pénétré dans nos laboratoires souterrains pour y éclairer nos préparateurs, poser des principes, créer des méthodes et dévoiler des causes qui jusque là étaient restées occultes.
Enfin nous verrons comment, par le pouvoir combiné du temps et de l'expérience, une science nouvelle nous est tout à coup apparue, qui nourrit, restaure, conserve, persuade, console, et, non contenté de jeter à pleine mains des fleurs sur la carrière de l'individu, contribue encore puissamment à la force et à la prospérité des empires.
Si, au milieu de ces graves élucubrations, une anecdote piquante, un souvenir aimable, quelque aventure d'une vie agitée, se présente au bout de la plume, nous la laisserons couler pour reposer un peu l'attention de nos lecteurs, dont le nombre ne nous effraie point, et avec lesquels au contraire nous nous plairons à confabuler; car si ce sont des hommes, nous sommes sûrs qu'ils sont aussi indulgents qu'instruits; et si ce sont des dames, elles sont nécessairement charmantes.
Ici le professeur, plein de son sujet, laissa tomber sa main, et s'éleva dans les hautes régions.
Il remonta le torrent des âges, et prit dans leur berceau les sciences qui ont pour but la gratification du goût: il en suivit les progrès à travers la nuit des temps; et voyant que, pour les jouissances qu'elles nous procurent, les premiers siècles ont toujours été moins avantagés que ceux qui les ont suivis, il saisit sa lyre, et chanta sur le mode dorien la Mélopée historique qu'on trouvera parmi les Variétés. (Voyez à la fin du volume.)
Origine des sciences.
16.--Les sciences ne sont pas comme Minerve, qui sortit tout armée du cerveau de Jupiter; elles sont filles du temps, et se forment insensiblement, d'abord par la collection des méthodes indiquées par l'expérience, et plus tard par la découverte des principes qui se déduisent de la combinaison de ces méthodes.
Ainsi, les premiers vieillards que leur prudence fit appeler auprès du lit des malades, ceux que la compassion poussa à soigner les plaies, furent aussi les premiers médecins.
Les bergers d'Égypte, qui observèrent que quelques astres, après une certaine période, venaient correspondre au même en droit du ciel, furent les premiers astronomes.
Celui qui, le premier, exprima par des caractères cette proposition si simple: deux plus deux égalent quatre, créa les mathématiques, cette science si puissante, et qui a véritablement élevé l'homme sur le trône de l'univers.
Dans le cours des soixante dernières années qui viennent de s'écouler, plusieurs sciences nouvelles sont venues prendre place dans le système de nos connaissances, et entre autres la stéréotomie, la géométrie descriptive et la chimie des gaz.
Toutes ces sciences, cultivées pendant un nombre infini de générations, feront des progrès d'autant plus sûrs que l'imprimerie les affranchit du danger de reculer. Eh! qui sait, par exemple, si la chimie des gaz ne viendra pas à bout de maîtriser ces éléments jusqu'à présent si rebelles, de les mêler, et d'obtenir par ce moyen des substances jusqu'ici non tentées, et d'obtenir par ce moyen des substances et des effets qui reculeraient de beaucoup les limites de nos pouvoirs!
Origine de la gastronomie.
17.
A gastronomie s'est présentée à son tour, et toutes ses soeurs se sont approchées pour lui faire place.
Eh! que pouvait-on refuser à celle qui nous soutient de la naissance au tombeau, qui accroît les délices de l'amour et la confiance de l'amitié, qui désarme la haine, facilite les affaires, et nous offre, dans le court trajet de la vie, la seule jouissance qui, n'étant pas suivie de fatigue, nous délasse encore de toutes les autres!
Sans doute, tant que les préparations ont été exclusivement confiées à des serviteurs salariés, tant que les cuisiniers seuls se sont réservé cette matière et qu'on n'a écrit que des dispensaires, les résultats de ces travaux n'ont été que les produits d'un art.
Mais enfin, trop tard peut-être, les savants se sont approchées.
Ils ont examiné, analysé et classé les substances alimentaires, et les ont réduites à leurs plus simples éléments.
Ils ont sondé les mystères de l'assimilation, et, suivant la matière inerte dans ses métamorphoses, ils ont vu comment elle pouvait prendre vie.
Ils ont suivi la diète dans ses effets passagers ou permanents, sur quelques jours, sur quelques mois, ou sur toute la vie.
Ils ont apprécié son influence jusque sur la faculté de penser, soit que l'âme se trouve impressionnée par les sens, soit qu'elle sente sans le secours de ses organes; et de tous ces travaux ils ont déduit une haute théorie, qui embrasse tout l'homme et toute la partie de la création qui peut s'animaliser.
Tandis que toutes ces choses se passaient dans les cabinets des savants, on disait tout haut dans les salons que la science qui nourrit les hommes vaut bien au moins celle qui enseigne à les faire tuer; les poètes chantaient les plaisirs de la table, et les livres qui avaient la bonne chère pour objet présentaient des vues plus profondes et des maximes d'un intérêt plus général.
Telles sont les circonstances qui ont précédé l'avènement de la gastronomie.
Définition de la gastronomie.
18.--La gastronomie est la connaissance raisonnée de tout ce qui a rapport à l'homme, en tant qu'il se nourrit.
Son but est de veiller à la conservation des hommes, au moyen de la meilleure nourriture possible.
Elle y parvient en dirigeant, par des principes certains, tous ceux qui recherchent, fournissent ou préparent les choses qui peuvent se convertir en aliments.
Ainsi, c'est elle, à vrai dire, qui fait mouvoir les cultivateurs, les vignerons, les pêcheurs, les chasseurs et la nombreuse famille des cuisiniers, quel que soit le titre ou la qualification sous laquelle ils déguisent leur emploi à la préparation des aliments.
La gastronomie tient:
À l'histoire naturelle, par la classification qu'elle fait des substances alimentaires;
A la physique, par l'examen de leurs compositions et de leurs qualités;
A la chimie, par les diverses analyses et décompositions qu'elle leur fait subir;
A la cuisine, par l'art d'apprêter les mets et de les rendre agréables au goût;
Au commerce, par la recherche des moyens d'acheter au meilleur marché possible ce qu'elle consomme, et de débiter le plus avantageusement ce qu'elle présente à vendre;
Enfin, à l'économie politique, par les ressources qu'elle présente à l'impôt, et par les moyens d'échange qu'elle établit entre les nations.
La gastronomie régit la vie tout entière; car les pleurs du nouveau-né appellent le sein de sa nourrice; et le mourant reçoit encore avec quelque plaisir la potion suprême qu'hélas! il ne doit plus digérer.
Elle s'occupe aussi de tous les états de la société; car si c'est elle qui dirige les banquets des rois rassemblés, c'est encore elle qui a calculé le nombre de minutes d'ébullition qui est nécessaire pour qu'un oeuf soit cuit à point.
Le sujet matériel de la gastronomie est tout ce qui peut être mangé; son but direct, la conservation des individus, et ses moyens d'exécution, la culture qui produit, le commerce qui échange, l'industrie qui prépare, et l'expérience qui invente les moyens de tout disposer pour le meilleur usage.
Objets divers dont s'occupe la gastronomie.
19.
A gastronomie considère le goût dans ses jouissances comme dans ses douleurs; elle a découvert les excitations graduelles dont il est susceptible; elle en a régularisé l'action, et a posé les limites que l'homme qui se respecte ne doit jamais outrepasser.
Elle considère aussi l'action des aliments sur le moral de l'homme, sur son imagination, son esprit, son jugement, son courage et ses perceptions, soit qu'il veille, soit qu'il dorme, soit qu'il agisse, soit qu'il repose.
C'est la gastronomie qui fixe le point d'esculence de chaque substance alimentaire; car toutes ne sont pas présentables dans les mêmes circonstances.
Les unes doivent être prises avant que d'être parvenues à leur entier développement, comme les câpres, les asperges, les cochons de lait, les pigeons à la cuiller, et autres animaux qu'on mange dans leur premier âge; d'autres, au moment où elles ont atteint toute la perfection qui leur est destinée, comme les melons, la plupart des fruits, le mouton, le boeuf, et tous les animaux adultes; d'autres, quand elles commencent à se décomposer, telles que le nèfles, la bécasse, et surtout le faisan; d'autres, enfin, après que les opérations de l'art leur ont ôté leurs qualités malfaisantes, telles que la pomme de terre, le manioc, et d'autres.
C'est encore la gastronomie qui classe ces substances d'après leurs qualités diverses, qui indique celles qui peuvent s'associer, et qui, mesurant leurs divers degrés d'alibilité, distingue celles qui doivent faire la base de nos repas d'avec celles qui n'en sont que les accessoires et d'avec celles encore qui, n'étant déjà plus nécessaires, sont cependant une distraction agréable, et deviennent l'accompagnement obligé de la confabulation conviviale.
Elle ne s'occupe pas avec moins d'intérêt des boissons qui nous sont destinées, suivant le temps, les lieux et les climats. Elle enseigne à les préparer, à les conserver, et surtout à les présenter dans un ordre tellement calculé que la jouissance qui en résulte aille toujours en augmentant, jusqu'au moment où le plaisir finit et où l'abus commence.
C'est la gastronomie qui inspecte les hommes et les choses, pour transporter d'un pays à l'autre tout ce qui mérite d'être connu, et qui fait qu'un festin savamment ordonné est comme un abrégé du monde, où chaque partie figure par ses représentants.
Utilité des connaissances gastronomiques.
20.--Les connaissances gastronomiques sont nécessaires à tous les hommes, puisqu'elles tendent à augmenter la somme du plaisir qui leur est destinée: cette utilité augmente en proportion de ce qu'elle est appliquée à des classes plus aisées de la société; enfin elles sont indispensables à ceux qui, jouissant d'un grand revenu, reçoivent beaucoup de monde, soit qu'en cela ils fassent acte d'une représentation nécessaire, soit qu'ils suivent leur inclination, soit enfin qu'ils obéissent à la mode.
Ils y trouvent cet avantage spécial, qu'il y a de leur part quelque chose de personnel dans la manière dont leur table est tenue; qu'ils peuvent surveiller jusqu'à un certain point les dépositaires forcés de leur confiance, et même les diriger en beaucoup d'occasions.
Le prince de Soubise avait un jour l'intention de donner une fête; elle devait se terminer par un souper, et il en avait demandé le menu.
Le maître d'hôtel se présente à son lever avec une belle pancarte à vignettes, et le premier article sur lequel le prince jeta les yeux fut celui-ci: cinquante jambons; «Eh quoi, Bertrand, dit-il, je crois que tu extravagues; cinquante jambons! veux-tu donc régaler tout mon régiment?--Non, mon prince; il n'en paraîtra qu'un sur la table; mais le surplus ne m'est pas moins nécessaire pour mon espagnole, mes blonds, mes garnitures, mes...--Bertrand, vous me volez, et cet article ne passera pas.--Ah! monseigneur, dit l'artiste, pouvant à peine retenir sa colère, vous ne connaissez pas nos ressources! Ordonnez, et ces cinquante jambons qui vous offusquent, je vais les faire entrer dans un flacon de cristal pas plus gros que le pouce.»
Que répondre à une assertion aussi positive? Le prince sourit, baissa la tête, et l'article passa.
Influence de la gastronomie dans les affaires.
21.
N sait que chez les hommes encore voisins de l'état de nature, aucune affaire de quelqu'importance ne se traite qu'à table; c'est au milieu des festins que les sauvages décident la guerre ou font la paix; et sans aller si loin, nous voyons que les villageois font toutes leurs affaires au cabaret.
Cette observation n'a pas échappé à ceux qui ont souvent à traiter les plus grands intérêts; ils ont vu que l'homme repu n'était pas le même que l'homme à jeun; que la table établissait une espèce de lien entre celui qui traite et celui qui est traité; qu'elle rendait les convives plus aptes à recevoir certaines impressions, à se soumettre à de certaines influences; de là est née la gastronomie politique. Les repas sont devenus un moyen de gouvernement, et le sort des peuples s'est décidé dans un banquet. Ceci n'est ni un paradoxe ni même une nouveauté, mais une simple observation de faits. Qu'on ouvre tous les historiens, depuis Hérodote jusqu'à nos jours, et on verra que, sans même en excepter les conspirations, il ne s'est jamais passé un grand événement qui n'ait été conçu, préparé et ordonné dans les festins.
Académie des gastronomes.
Tel est, au premier aperçu, le domaine de la gastronomie, domaine fertile en résultats de toute espèce, et qui ne peut que s'agrandir par les découvertes et les travaux des savants qui vont le cultiver; car il est impossible que, avant le laps de peu d'années, la gastronomie n'ait pas ses académiciens, ses cours, ses professeurs, et ses propositions de prix.
D'abord, un gastronome riche et zélé établira chez lui des assemblées périodiques, où les plus savants théoriciens se réuniront aux artistes, pour discuter et approfondir les diverses parties de la science alimentaire.
Bientôt (et telle est l'histoire de toutes les académies), le gouvernement interviendra, régularisera, protégera, instituera, et saisira l'occasion de donner au peuple une compensation pour tous les orphelins que le canon a faits, pour toutes les Arianes que la générale a fait pleurer.
Heureux le dépositaire du pouvoir qui attachera son nom à cette institution si nécessaire! Ce nom sera répété d'âge en âge avec ceux de Noé, de Bacchus, de Triptolème, et des autres bienfaiteurs de l'humanité; il sera, parmi les ministres, ce que Henri IV est parmi les rois, et son éloge sera dans toutes les bouches, sans qu'aucun règlement en fasse une nécessité.
G. de GONET Éditeur.
Définition de l'Appétit.
23.--Le mouvement et la vie occasionnent dans le corps vivant une déperdition continuelle de substance; et le corps humain, cette machine si compliquée, serait bientôt hors de service, si la Providence n'y avait placé un ressort qui l'avertit du moment où ses forces ne sont plus en équilibre avec ses besoins.
Ce moniteur est l'appétit. On entend par ce mot la première impression du besoin de manger.
L'appétit s'annonce par un peu de langueur dans l'estomac et une légère sensation de fatigue.
En même temps, l'âme s'occupe d'objets analogues à ses besoins, la mémoire se rappelle les choses qui ont flatté le goût; l'imagination croit les voir; il y a là quelque chose qui tient du rêve. Cet état n'est pas sans charmes; et nous avons entendu des milliers d'adeptes s'écrier dans la joie de leur coeur: «Quel plaisir d'avoir un bon appétit, quand on a la certitude de faire bientôt un excellent repas!»
Cependant l'appareil nutritif s'émeut tout entier: l'estomac devient sensible; les sucs gastriques s'exhalent; les gaz intérieurs se déplacent avec bruit; la bouche se remplit de sucs, et toutes les puissances digestives sont sous les armes, comme des soldats qui n'attendent plus que le commandement pour agir. Encore quelques moments, on aura des mouvements spasmodiques, on bâillera, on souffrira, on aura faim.
On peut observer toutes les nuances de ces divers états dans tout salon où le dîner se fait attendre.
Elles sont tellement dans la nature, que la politesse la plus exquise ne peut en déguiser les symptômes; d'où j'ai dégagé cet apophthegme: De toutes les qualités du cuisinier, la plus indispensable est l'exactitude.
Anecdote.
24.
'APPUIE cette grave maxime par les détails d'une observation faite dans une réunion dont je faisais partie,