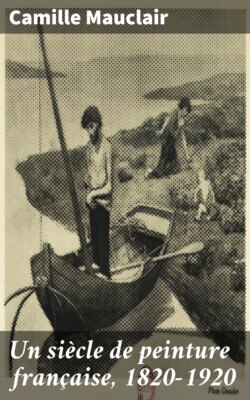Читать книгу Un siècle de peinture française, 1820-1920 - Camille Mauclair - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE PREMIER
J. D. INGRES (1780-1869) ET SES DISCIPLES
ОглавлениеTable des matières
La vie, l’œuvre, le caractère d’Ingres se présentent avec une parfaite cohérence, et à quatre-vingt-neuf ans, Ingres put mourir avec l’orgueilleuse certitude de ne s’être jamais contredit. Cependant, il a fallu la fin de la peinture romantique, la déchéance misérable de l’art académique et l’évolution de l’impressionnisme pour permettre à la critique contemporaine d’apercevoir nettement le sens et les conséquences de l’œuvre d’Ingres.
En opposant, avec violence et illogisme, l’art et l’es-thétique d’Ingres à l’art et à l’esthétique de Delacroix, la critique a commis une erreur qui a profité à l’académisme. Si, au lieu de considérer Ingres comme un soutien de l’Ecole qu’attaquaient les romantiques, la critique l’avait considéré sous son véritable jour, elle aurait reconnu que le réalisme d’Ingres était aussi ennemi de l’Ecole que le romantisme de Delacroix, et, au lieu d’opposer deux maîtres, elle les aurait réunis dans une même condamnation de la peinture officielle.
Ingres, élève de David, prix de Rome en1801, bientôt détaché, au nom de la vérité et de la vie, du faux idéalisme néo-romain de David et de ses disciples, Ingres a été un isolé qui, dès les premières années du XIXe siècle, a songé à remonter aux Primitifs, qui passaient pour des barbares informes, afin de leur demander le secret du style et l’amour des formes et de la psychologie. Plus tard, il a été moins heureux en s’inspirant de Raphaël, erreur qui lui a été durement reprochée. Mais il faut compter Ingres parmi les précurseurs du réalisme moderne, par ses dessins qui font de lui l’Holbein français, et par certaines de ses peintures.
Manet nous a aidés à comprendre Ingres. Sa vie artistique, toute remplie par la lutte contre la fausse habileté technique de l’Ecole, a été le recommencement de la lutte d’Ingres contre les principes de David. Mais l’effort d’Ingres avait été entravé par les admirateurs de Delacroix, et Manet a pu aller plus loin et forcer l’obstacle. Malgré d’incontestables et inévitables différences, les conceptions de Manet et d’Ingres se ressemblent et même leurs œuvres, si l’on veut bien considérer séparément les morceaux de vie pure et simple d’Ingres (ses vrais chefs-d’œuvre) et ses compositions raphaélesques. A la fin de sa vie Ingres devina avec sympathie ce que voulaient Manet et ses amis, qui détestaient autant que lui le romantisme: et en effet, en face de l’Ecole et des romantiques, Manet continua Ingres.
Nous voyons ces liens aujourd’hui. Mais à l’époque où l’on se bornait à opposer Ingres à Delacroix comme un poncif à un novateur, on ne pouvait ni apprécier le rôle très audacieux d’Ingres, songeant à Mantegna dans sa Francesca da Rimini en1819, ni surtout prévoir comment le génie de Delacroix reviendrait, par Delaroche, à la misérable peinture d’histoire de l’Ecole, tandis que le génie d’Ingres rendrait possibles Manet et Degas. On pouvait encore moins prévoir que Chassériau, puis Gustave Moreau, concilieraient à la fois Ingres et Delacroix, le coloris de l’un et la forme de l’autre, et que Puvis de Chavannes, issu visiblement de Chassériau dans ses fresques, remonterait par lui à la Stratonice d’Ingres puis aux Primitifs. On ne pouvait pas non plus supposer que le Jupiter et Thétis de1811inspirerait Gustave Moreau d’une façon frappante, et serait en même temps le premier tableau préraphaélite, le tableau qui, avec le Roger délivrant Angélique, donnerait l’exemple à Rossetti, à Holman Hunt, à Burne-Jones, et même à Boecklin peut-être, dans la recherche d’une peinture mythique, héroïque, légendaire et stylisée. On ne pouvait imaginer qu’un jour l’Olympia, de Manet, placée au Louvre en face de l’Odalisque, affirmerait une parenté, comme le portrait de Mme Rivière y appellerait la comparaison avec les merveilleux portraits de Degas. En un mot, on n’eût pas crû possible que le classique Ingres évoquerait aussi les noms de grands artistes tous ennemis de l’Ecole académique. Et, cependant, c’est la vérité.
Cette vérité exige aussi qu’on dise qu’Ingres, quoique très doctrinaire, fut incapable d’être suivi à la lettre, et qu’après les artistes de son entourage immédiat, il fut revendiqué par l’Ecole qui ne vit en lui que l’imitateur de Raphaël. C’est ainsi qu’un Cabanel ou un Bouguereau ont pu s’imaginer venir d’Ingres en ne faisant que le parodier dans ses faiblesses. Ingres a cru être unitaire; il ne l’a pas plus été que les autres créateurs. La Jeanne d’Arc, la Vierge à l’hostie, sont des œuvres médiocres, et ce sont celles-là que l’Ecole a imitées, ainsi que la trop célèbre Source, charmante, mais jusqu’aux limites de la fadeur; tandis que le Bain turc, œuvre où la tristesse et l’abêtissement de la volupté animale sont peintes avec une acuité que Baudelaire admirait comme «presque effrayante», le Bain turc est un chef-d’œuvre dont l’Ecole n’a jamais parlé.
La période où Ingres a cédé à l’incitation de Raphaël (Vœu de Louis XIII, 1824), (Apothéose d’Homère, 1827), (Martyre de saint Symphorien, 1834), après ses débuts merveilleux de portraitiste et d’interprète de l’Antique, cette période a marqué, quoiqu’il en ait pensé, sa déviation d’une admirable route, son retour inconscient à l’Ecole, le fléchissement de sa logique. A ce moment-là Ingres, jusqu’alors réaliste, a senti le besoin de se constituer un «idéal» comme les académiques dont son robuste bon sens et son amour de la vie l’avaient écarté. Il a cherché cet idéal dans Raphaël, lui qui manquait de cette grâce naturelle dont Prud’hon était enivré et n’avait créé de figures gracieuses que par l’ordonnance systématique de certaines courbes. L’Ingres audacieux qui, dès 1810, savait faire d’une femme nue l’unique sujet d’un tableau, cet Ingres, par haine des romantiques, s’est créé une petite chapelle, un culte raphaëlesque arrangé selon sa vision d’homme du XIXe siècle, et c’est la source de ses plus grands défauts, car Raphaël ne peut s’imiter ni se recommencer. De là les Vierges qui autorisent Bouguereau; le raphaëlisme a autant desservi Ingres que le préraphaëlisme l’avait servi. Dessinateur merveilleux, coloriste médiocre, Ingres, en se créant un «idéal» autre que la vie qu’il était fait pour exprimer, en est venu à un art de sécheresse d’où la couleur était de plus en plus bannie, et il n’a pas été récompensé de cette austérité, dont l’Ecole allait faire une pauvreté, par la trouvaille d’idées et d’expressions rares, car, en dehors de la vérité vitale, Ingres n’avait pas de rêves, pas de pensées hautes, pas de lyrisme ni d’émotion généralisée.
Ce réaliste admirable était le moins idéologue des peintres. C’est ce qui l’éloigna de l’école de David. C’est ce qui lui fit faire des tableaux d’histoire avec accessoires vrais, notons-le, bien avant les romantiques, dès1815. Et c’est aussi ce qui le dévoya lorsqu’il chercha, comme l’école de David, la «noblesse» dans le sujet.
Dans ce domaine, l’œuvre d’Ingres, plus parfait techniquement que celui de Delacroix, semble mort auprès. Subordonné à la correction linéaire, son idéalisme bourgeois n’essaie même pas de battre de l’aile auprès du grand vol de cet aigle farouche, de ce poète halluciné, fiévreux, tragique, inégal et passionnant, qui, malgré les fréquentes défaillances de sa forme, s’élève au ciel de Véronèse, de Rubens et de Rembrandt par l’élan de son imagination éperdue. Delacroix était le rêveur et le réalisateur de grandes choses, Ingres, le patient ouvrier de choses restreintes et subtilement harmonisées. Ses rares grandes compositions, conçues par l’intelligence, restent froides et pénibles. Ingres n’était ni un poète ni un génie. Uniquement plastique, il n’était sensible qu’aux géométries profondes du dessin. Il force l’admiration, il n’émeut pas, et Delacroix nous émeut toujours.
Il n’en est pas moins vrai qu’Ingres fut le premier des modernes et commença dès1810une tradition que le romantisme vint embrouiller et que Manet rétablit. Les Goncourt, si clairvoyants dans le rôle du XVIIIe siècle contre l’académisme se sont étrangement trompés sur Ingres. Ils eussent dû saluer en lui le révolutionnaire qui annonçait véritablement leur art de prédilection, l’art moderniste de Manet et de Degas, lesquels ne s’y sont trompés ni l’un ni l’autre. Ingres est bien plus près de nous que Delacroix, qui se rattache à Véronèse, à Rubens, à Titien. Il a pensé le premier à l’archéologie, aux Primitifs, à l’art oriental, qui ont tant séduit les modernes, et il y a pensé à cette époque où c’était une audace impardonnable. Ses femmes nues, ses portraits clairs, ont agi sur l’impressionnisme.
Mais ce n’était ni un coloriste ni un idéaliste, et quand il a cru être l’un et l’autre à la suite de Raphaël, il a perdu cette vigueur qu’il ne trouvait qu’en touchant la terre. Dans les figures où la tonalité intervient par contrastes très simples, comme le portrait de Mme Rivière, bleu et blanc, la force des valeurs donne une impression agréable, et on y goûte le charme de la crudité de certains Primitifs italiens et enlumineurs français. Mais, en général, cette peinture est d’un aspect pauvre, et on y trouve un abus de bleus ternes et de roses qui, malheureusement, rappellent moins la Vierge à la chaise qu’ils n’annoncent Cabanel. Ce sont des dessins coloriés plutôt que des peintures, et on y sent bien que la couleur était secondaire pour ce grand calculateur de lignes. A ce point de vue, le contraste de l’Odalisque et de l’Olympia au Louvre est une curieuse leçon. La couleur fâcheuse de l’Apothéose d’Homère prouve bien le conflit qui s’élevait entre Ingres réaliste et Ingres soucieux d’imagination allégorique: le dessin est beau dans une atmosphère conventionnelle, celle où Puvis de Chavannes devait trouver plus tard le moyen de rester si véridique quoique en plein rêve. Le geste du saint Symphorien, si vanté, reste inférieur en expression à la moindre attitude de Delacroix. Le Louis XIII, imité de Simon Guillain et de Philippe de Champaigne et accolé à des imitations de Raphaël, est un mannequin, la Jeanne d’Arc est banale, la Source a un visage vide de toute pensée; on ne peut plus regarder la tête inattentive du Roger quand on pense à Carpaccio, et la Muse étendant lourdement son bras sur la tête de Cherubini est simplement ridicule. Aucune expression profonde dans cette peinture sans pénombres, claire, sèche et logique.
C’est ailleurs qu’il faut chercher les mérites d’Ingres. C’est dans ses innombrables portraits au crayon, d’abord, qui constituent une merveilleuse galerie des types bourgeois de son temps, et qui sont d’incomparables documents sur une caste dont Ingres était lui-même par son amour de l’ordre, son humeur irritable et ses qualités intransigeantes, un représentant complet. C’est dans ses portraits d’hommes, dont celui de Bertin demeure le plus expressif; toute une façon de comprendre la vie sociale est signifiée par la face et l’attitude de ce bourgeois trapu et majestueux comme un César romain. Là, Ingres a réalisé une synthèse absolue, un chef-d’œuvre de psychologie générale. Il ne se montre pas moins grand dans ses effigies féminines. Elles expriment toute l’âme de la Française de1800à1850. Elles sont peintes avec toute la sensualité méridionale de cet homme violent, qui ne pouvait, dit-on, se retenir d’embrasser les bras de ses modèles, par amour de la belle chair autant que par admiration d’artiste réaliste devant la vie. Elles sont sans pensée, placides, animales, épanouies, belles comme des fruits, désirables mais par la seule évidence de leur santé, car jamais, sauf peut-être dans l’esquisse de Mme d’Haussonville et le portrait de Mme de Senonnes, elles ne comportent de mystère. Les figures féminines de Manet sont indéniablement venues de là, mais elles n’ont pas cette sensualité un peu abêtie. Il est plaisant de penser qu’Ingres, qui passa pour poncif et qui croyait à l’art «noble», a créé ces êtres faits pour la possession, ces objets de plaisir normal et sans complication morale, tels que les aime l’homme du midi français. A ce point de vue, aucun de nos «caractéristes» n’a été plus hardi.
Les bourgeois d’Ingres sont d’une vérité sérieuse qui touche à la caricature, et ils inspirent à tout esprit antisocial et épris de poésie une antipathie qui est un hommage implicitement rendu à la force expressive de leur peintre. Ils sont révélés avec une terrible exactitude. La sensualité d’Ingres a ce même caractère d’énergie. Le Bain turc l’affirme plus que toutes ses autres œuvres. Ce tableau rond, entièrement rempli de femmes nues aux faces stupéfiées par l’ennui, roses et grouillantes comme des replis d’entrailles, endormies dans une atmosphère étouffante, montrant des nudités lubriques, des visages bovins, c’est une vision d’une audace surprenante, que souligne encore l’impeccabilité du dessin, la douceur monotone du coloris. Le luxurieux analyste qui l’a peint est pourtant le solennel et ennuyeux auteur de l’Apothéose d’Homère! Au reste, toutes ses femmes, la Thétis ou l’Angélique avec leurs cous gonflés comme ceux des colombes et leurs yeux langoureux, sont conçues par un érotique, et il faut voir avec quel plaisir Ingres modèle les seins lourds de ses portraits de femmes, dans les robes Empire. Nous sommes, là, très loin de Raphaël, et là Ingres est lui-même, sans fausse poésie, sans idéalisme conventionnel. Sa façon gourmande de peindre la chair féminine arrive à être parfois gênante, déplaisante, comme la confidence indiscrète d’un Don Juan bourgeois. Rien n’est moins académique. Cette caresse continuelle se retrouve même dans ses figures plus discrètes, dans la hanche luisante de l’Odalisque, dans le dos moelleux et ambré de la Baigneuse, dans la gorge et le ventre de la Source, et on comprend l’admiration spéciale que leur garde un féministe comme Besnard, dont l’art librement charnel n’a rien d’académique, mais se réfère constamment à Ingres.
Que, par son retour regrettable à Raphaël, Ingres ait entravé lui-même l’évolution de son réalisme, que l’Ecole l’ait alors revendiqué après l’avoir détesté, qu’on l’ait sottement opposé à Delacroix au lieu de l’admirer pour d’autres raisons, que lui-même ait été très injuste envers son rival en ne voyant que ses incorrections et en ne comprenant rien à sa grande poésie lyrique, tout cela n’empêche pas que nous devions rendre hommage à cet incontestable initiateur. Il est naturel que les successeurs de l’impressionnisme, les chercheurs de caractère et de synthèse linéaire, séparent Ingres de l’Ecole, oublient son raphaélisme, et le considèrent comme un isolé qui a prévu leurs tendances. Cependant, une partie de nos peintres, ne se contentant plus des notations chromatiques de l’atmosphère qui ont été tout le but des impressionnistes, recherchent les lois d’une composition stylisée et s’adressent, comme M. Maurice Denis, à Ingres et à Poussin. D’autres, élèves de Gustave Moreau qui venait d’Ingres par Chassériau, tentent de concilier l’impressionnisme et les principes décoratifs. D’autres, fidèles à un réalisme transformé, voient en Ingres leur modèle après avoir cédé aux plus bizarres déformations. Tous s’accordent à délaisser la tradition imaginative de Delacroix comme dangereuse, et cette tradition, appauvrie et médiocrisée, ne se trouve plus guère que chez les peintres d’histoire de l’Ecole. Tous veulent une peinture sans éléments littéraires et poétiques, ou une composition dont l’intérêt soit avant tout dans l’agencement des lignes, et quoique Ingres ait manqué de cette couleur qu’ils désirent exalter comme élément expressif, ils s’autorisent de lui. Il est donc curieux de constater cet abandon de Delacroix, lequel symbolisa si longtemps la lutte contre le classicisme, et ce retour à Ingres, que l’Ecole croyait garder dans son panthéon. On cherche dans Ingres ce qu’elle n’a pas voulu y voir.
Cela est très légitime, à la condition de ne pas oublier que la grande vertu d’Ingres a été le dessin, ce dessin dont il disait pompeusement qu’il était la probité de l’art. Il est fâcheux de constater que la plupart de nos jeunes coloristes manquent de cette probité, même les meilleurs. Ingres eût manifesté au Salon d’Automne une de ces crises de fureur que lui donnait déjà le dessin outré de Delacroix. Si son influence, réveillée d’un long sommeil, peut ramener nos artistes à l’amour du dessin qu’ils méprisent par trop, on pourra dire que le vieux maître aura sauvé une seconde fois l’école française indépendante. Cependant, il restera toujours «M. Ingres». On l’appellera toujours ainsi, comme on disait «M. Taine» ou «M. Thiers». C’est la retenue instinctive du public devant les gens dont on admire le talent, mais qu’on ne peut pas aimer. Leur perfection logicienne satisfait l’es-prit, mais ne parle ni au cœur ni à l’imagination. Les chefs-d’œuvre d’Ingres sont les effets de la volonté intelligente; mais on ne vibre, en art, que pour d’autres raisons, et il faut au génie des défauts que le talent ne supporterait pas. C’est peut-être la dernière réflexion qu’on puisse se faire devant ces œuvres impeccables.
Tandis que l’école de David tombait très vite au-dessous du médiocre avec Picot ou Abel de Pujol, Ingres se voyait continué très honorablement, ou plutôt escorté au long de sa glorieuse carrière par des hommes de mérite, bien qu’ils aient renchéri sur ses défauts de frigide correction, et apporté à l’académisme une adhésion née surtout de la haine du romantisme. Le principal de ces élèves et acolytes fut Hippolyte Flandrin (1809-1864), qui fut surtout un artiste d’inspiration chrétienne, comme la plupart des Lyonnais. Et le meilleur de son œuvre, ce sont ses peintures murales, à la cathédrale de Nantes, à Saint-Séverin, à Saint-Vincent-de-Paul et à Saint-Germain-des-Prés de Paris, à Saint-Paul de Nîmes, à l’église d’Ainay: ce sont vraiment de nobles et savantes œuvres qui font honneur à l’art catholique dont aujourd’hui Maurice Denis et Georges Desvallières raniment encore le feu languissant. Parallèlement à Flandrin, il y eut à Lyon un groupe de peintres mystiques et préraphaélites de grand intérêt, Victor Orsel (1795-1850), Gabriel Tyr (1817-1868), Alphonse Périn (1798-1875). On peut les juger à Notre-Dame-de-Fourvières, de Lyon, et dans les chapelles de Notre-Dame-de-Lorette, de Paris. La peinture religieuse au XIXe siècle est trop gâtée par l’académisme, trop peu abondante en œuvres vraiment supérieures, pour que j’aie cru nécessaire de lui consacrer en ce livre un chapitre spécial. Cependant il est juste et nécessaire d’indiquer qu’auprès de quelques œuvres magnifiques de Delacroix des peintres moindres comme Flandrin, Orsel, Périn, Tyr, Desvallières, Denis, ont apporté une noble contribution à l’idéal chrétien. Et il ne faut pas hésiter à compter Flandrin parmi les artistes qui, avec Chassériau et Delacroix, formèrent certainement l’es-prit altier de cet autre grand Lyonnais, Puvis de Chavannes.
Auprès de Flandrin, dans l’atelier d’Ingres il y eut Amaury Duval (1808-1885), décorateur d’églises estimable et écrivain d’art délicat, Victor Mottez (1809-1897), qui tenta de ressusciter la Fresque, Ziégler (1804-1856), qui décora l’église de la Madeleine à Paris, Henri Lehmann (1814-1882), qui décora l’ancien Hôtel-de-Ville et le palais du Luxembourg. Mais les «Ingristes» se confondirent bientôt dans la médiocrité des académiques post-davidiens ou des éclectiques dont le plus renommé fut Paul Delaroche, bien oublié aujourd’hui: peintre d’histoire habile aux arrangements dramatiques, et même mélodramatiques, il montra plus de véritables dons picturaux dans sa très honorable décoration de l’hémicycle de l’Ecole des Beaux-Arts. Sigalon (1788-1837) est surtout connu pour sa copie du Jugement dernier de Michel-Ange. Heim (1787-1865), a été un habile peintre de genre; Schnetz (1786-1870) et Léopold Robert (1794-1835), connurent avec des scènes anecdotiques de la vie italienne des succès que nous ne comprenons plus, non plus que le prestige de Léon Cogniet (1794-1880), peintre d’histoire et de genre qui fut du moins un sage et efficace professeur. Couder (1789-1873), Court (1797-1865), Auguste et Alexandre Hesse, sont non moins oubliés et les renommées de Charles Gleyre (1806-1874), de Thomas Couture (1815-1879) ont bien pâli malgré l’éclatant succès des Illusions perdues et des Romains de la décadence. Mais tout cela n’est même plus apparenté moralement au robuste et sévère génie ingresque.