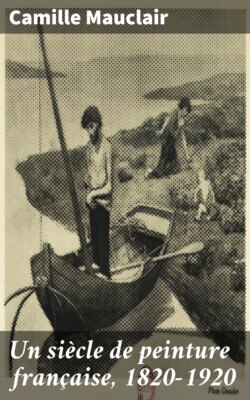Читать книгу Un siècle de peinture française, 1820-1920 - Camille Mauclair - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE III
LES PAYSAGISTES ROMANTIQUES ET MODERNES
ОглавлениеTable des matières
Les origines du paysage moderne.–Rousseau, Daubigny, Diaz, Troyon, Millet, Courbet, l’école de Barbizon.–Corot.–Claude Monet et l’étude de l’atmosphère.–Quelques contemporains.–Le «portrait de site».
Au moment où débutait le romantisme, le genre du paysage était à peu près abandonné en France. Il était considéré comme indigne de «la grande peinture». Le dogme fondamental de l’Ecole étant que le beau est le résultat des proportions parfaites dont le nu humain est le symbole, le paysage n’était tout au plus admis que comme fond conventionnel aux figures. L’œuvre d’art était une composition abstraite, faite à l’atelier, et on ne pensait même pas à étudier le plein air. On le voyait, sans songer à en faire un sujet de tableau. On était absorbé par le désir de styliser, d’arranger, de faire joli ou majestueux, selon les sujets, sans se préoccuper de la vérité. On se référait en toutes choses aux anciens, comme à des exemples définitifs: la mythologie régnait. Et on ne s’adressait même pas aux rares anciens qui ont possédé le sentiment de la nature, comme Virgile ou Lucrèce. On s’en tenait à Ovide et à ses mignardises apprêtées, et en cela on ne faisait que suivre le mode littéraire du XVIIe et du XVIIIe siècle, qui n’a rien vu, rien noté dans la nature, sauf La Fontaine et quelques phrases admirables de La Bruyère, tandis que le XVIe siècle avait eu Ronsard et la Pléïade pour comprendre les beautés du paysage. Les anciens ne voyaient guère dans les montagnes que des obstacles, dans les plaines des routes faciles, dans la mer un péril et dans les forêts une source de revenus. Ils étaient seulement sensibles aux jardins composés. La crise d’imitation latino-hellénique qui créa la Renaissance ne manqua pas d’imposer à l’art cette façon de penser. Pourtant, on a pu reconnaître en Léonard de Vinci, en Cima, en Giorgione, en Titien, les pères du paysage moderne, et les Flandres avaient eu Metsys, Memling, Gérard David, et Breughel, et Patinir.
Nos Primitifs bourguignons avaient aussi compris la vérité de la nature. La Hollande, étrangère à la Renaissance, multipliait, au XVIIe siècle, ses merveilleux paysagistes; nous avions eu, en ce même siècle, Poussin, le grand paysagiste décoratif sachant conserver à la nature son émotion majestueuse tout en la stylisant. Nous avions eu Claude Lorrain, visionnaire étincelant, coloriste percevant les transparences atmosphériques avec une intensité qui fait de lui le précurseur direct de Turner. Nous avions eu Watteau, poète exquis et triste, inventant le principe des couleurs complémentaires et plaçant ses figures dans des sites émouvants, dans de suaves crépuscules. Mais qu’étaient ces quelques exceptions en face de la majorité des peintres ne concevant le paysage que comme un arrangement pompeux ou une pastorale fade? Tandis qu’au dehors il y avait Ruysdaël, Hobbema, puis Gainsborough, Turner, nous n’avions rien que de taux aspects de tapisserie stylisés à la façon déclamatoire des fonds de tableaux italiens de la seconde Renaissance. Ruines artificielles, bocages fleuris, arbres empanachés, ruisseaux avec passerelles rustiques, c’était tout un décor aussi ennemi de la réalité que les bergerades de Florian, des petits poètes galantins. Les belles marines de Joseph Vernet, même, restaient sans imitateurs, et il semblait que le génie naturiste des Hollandais ne fût même pas soupçonné à une époque où la guerre nous ramenait à chaque instant dans le pays des Hobbema, des Ruysdaël, des Van Goyen et des Vermeer. Le dogmatisme romain rendait aveugles les peintres; au lieu de s’incliner devant le style incomparable de la nature elle-même, comme l’avaient fait les primitifs, ils s’obstinaient à lui imposer un style préconçu. Avec une morgue singulière, le XVIIe siècle corrigeait et «ennoblissait» la nature, et le XVIIIe, en la voyant d’un œil plus familier, n’en retint du moins que les petits aspects agréables; il en fut de même sous le Consulat et l’Empire, comme le firent avec esprit et véracité le Fragonard de la période rustique, et le délicieux Hubert Robert. L’art des jardins lui-même, que les Français portèrent à un si haut degré, n’était qu’une conséquence du style italianisé, et pas un peintre n’eut l’idée de tirer des féériques aspects de Versailles un tableau dont ils fussent l’unique sujet. Il faut en venir, sous l’Empire, à Gros pour créer le vaste paysage tragique qu’il jette derrière son Napoléon à Eylau. On peut donc dire que le romantisme a ressuscité le paysage français par delà deux siècles d’interruption. Par son initiative, un genre méprisé jusqu’à devenir presque nul est devenu l’un des plus importants de l’art pictural.
Ce réveil du sentiment de la nature est une des caractéristiques du romantisme. Il se manifeste avec une admirable spontanéité dans les lieder allemands, dans la poésie de Lamartine, puis dans Vigny et Hugo. Ingres n’en a pas souci. Delacroix peint plutôt des paysages de pierre, comme la Constantinople qui fait le fond des Croisés, comme la désolée perspective du Massacre de Scio; et la marine lugubrement puissante de la Barque de Don Juan fait regretter qu’il n’ait pas eu l’occasion d’aller plus fréquemment au devant de la grande nature. Mais presque aussitôt, tandis que devançant nos Paul Huet, nos Chintreuil, nos Georges Michel, en Angleterre Turner crée ses rêves inouïs, que Bonington étincelle trop fugitivement, que Constable invente le paysage en mouvement, naît en France une école qui va réaliser des chefs-d’œuvre.
Théodore Rousseau (1812-1868) apparaît comme le digne héritier des Hollandais et de Poussin, et obéit à cette double influence. Il essaie de concilier le sentiment décoratif des grands arbres de Poussin, de Lorrain et de Ruysdaël, avec la précision, l’intimité, le charme de vérité de Breughel et de Hobbema. Il est puissant, vaste, profondément ému par la grande poésie des arbres et des horizons. Il va s’installer en pleine forêt de Fontainebleau, et là le rejoindront successivement Daubigny, Diaz et Millet.
La conception du paysage de Théodore Rousseau est particulière. Ce qu’il voit avant tout dans la nature, c’est le dessin des arbres et du sol, c’est la contexture même des objets du paysage, plutôt que l’atmosphère qui le enveloppe. Rousseau, dit-on, peignait d’abord ses paysages et finissait par peindre le ciel. C’est probablement vrai, et cette façon de procéder était un reste de l’esprit classique. Il faut se représenter les paysagistes de1830comme des hommes simples, heureux d’aller à la découverte de la nature, curieux de tous les détails des forêts, des fermes, les aimant dans leur humble vérité, et non plus avec les intentions de pastorale du XVIIIe siècle. Ce qui passionne Rousseau, c’est l’ossature d’un chêne, ses robustes nœuds, ses racines, la puissante complication de ses branchages, que déjà Eugène Isabey, intermédiaire entre l’Empire et le romantisme, avait su voir et aimer. C’est encore l’aspect d’un pâturage, l’étude des accidents du sol. Il les dessine avec amour, avec une sincérité admirable. Il construit un groupe d’arbres avec autant de soin que les académiques en mettent à construire une figure nue. Il est merveilleusement doué pour exprimer la personnalité d’un arbre. Il est moins sensible à la couleur. Il dresse ses larges plans de feuillages, ses imposantes lisières de forêts, sur des ciels d’un beau ton assourdi, généralement à contre-jour, de façon à donner un ton uniforme aux silhouettes, et à accuser ainsi leur caractère massif et sculptural. Ce souci du sculptural est assez rare: la plupart des paysagistes modernes ont trop oublié que le paysage est avant tout un bas-relief modelé, dont il faut exprimer les plans, les volumes, la densité; la lumière n’intervenant qu’à titre d’élément changeant. Cet oubli n’a pas été un des moindres défauts des impressionnistes. La vision de Rousseau prolonge celle de Ruysdaël et de Poussin, mais il y a dans Ruysdaël une poésie plus profonde, un sentiment plus grand des lointains, du mystère des ombres. Rousseau est poète par l’impression de fécondité, de orce, et en cela il comptera dans l’avenir non seulement comme le rénovateur du paysage en France, mais encore comme un grand visionnaire des formes de la nature. Son exécution est grasse, riche, fougueuse. Il ne recherche pas les effets curieux de la lumière, ni les détails imprévus: il s’en tient à la grande ordonnance de Poussin.
Auprès de lui, Daubigny (1817-1878) apparaît moins puissant mais plus délicat. Il aime davantage les petits aspects. Un chemin creux longeant un champ de blé, une série de pommiers en fleurs, une prairie au printemps lui suffisent. C’est moins un romantique qu’un intimiste. Il y a quelque chose de Constable dans Rousseau, et il y a plutôt quelque chose de Patinir dans Daubigny; c’est un petit maître délicieux, d’une poésie lamartinienne. Il affectionne les atmosphères matinales, les effets couleur de perle, les notes suaves des fleurs sur les arbustes, et déjà il annonce les préoccupations impressionnistes. Chintreuil (1814-1873) plaît par ses recherches de la transparence; il aime les vastes espaces, les nuance avec finesse, ou alors se restreint à de petits coins verdoyants, dont il sait rendre la fraîcheur. Diaz (1808-1876), peintre de figures brillantes et molles, est beaucoup plus grand par sa façon d’exprimer les profondeurs des bois, les océans de verdure, le miroitement du demi-jour sur les feuilles, et il y dresse presque toujours les troncs fins et blancs des bouleaux, qui sont la note dominante de son œuvre. Sa facture annonce celle de Monticelli, qui la surpassera. Paul Huet (1804-1869) est un robuste et savant paysagiste. De tous ces hommes, Rousseau est le plus puissant, le plus imposant, mais il leur a donné une impulsion qui va être irrésistible; désormais les paysagistes, malgré le dédain de l’Ecole, vont se mettre en quête de tous les aspects, et découvrir pour ainsi dire leur pays. Le petit village de Barbizon, dans la forêt de Fontainebleau, va devenir le centre, fidèlement visité, d’une école qui durera jusqu’à nos jours. C’est là que vivront Rousseau et Diaz, et que Millet mourra pauvre et presque méconnu avant de renaître dans la gloire. Mais chaque province verra ses beautés chantées par des artistes locaux. Déjà Rousseau a cherché dans les marais des Landes le thème de quelques chefs-d’œuvre; Diaz a peint dans les Pyrénées ses étincelantes petites vues de neiges bleues et blanches. Daunigny a exprimé la Normandie. Troyon (1813-1865) se révèle à la fois comme un paysagiste et un animalier. De tout ce groupe, c’est lui qui peut-être vient le plus directement des Hollandais comme Potter et Wouwermans. Ses Bœufs allant au labour, dans l’aube pâlissante, son Retour du troupeau, attestent au Louvre un considérable talent. On reste étonné de la solidité, du mouvement, du style de ces œuvres qui n’ont plus rien de romantique et ne doivent leur beauté qu’à leur savant et énergique dessin, à leurs lumières dorées, à leur vérité rustique. Ce n’est déjà plus la poésie frémissante et pieuse de Lamartine. C’est l’observation moderne de la campagne, l’observation de Flaubert et du roman rustique de George Sand.
Auprès de ces maîtres il faut placer Camille Flers (1802-1868) et, tout au moins pour ses très beaux débuts, Louis Cabat (1812-1833), qui dévia depuis dans l’académisme.
A la même époque, en Provence, une école peu connue se manifeste. L’excellent peintre animalier Emile Loubon étudie avec sincérité, avec charme, les sites pierreux, les collines bleuâtres, les rudes rochers et les pins poussiéreux|de son pays. Il aura des émules en Auguste Aiguier, peintre de marines délicates, en Paul Guigou, en Monticerli, en Prosper Grésy. Cependant l’école de1830trouve en Courbet un précieux soutien. Mais déjà dans les sous-bois de Courbet se pressent le désir de noter l’atmosphère avec plus de soin tout en continuant à dessiner de très près les détails matériels du paysage. Nous touchons au moment où le paysage romantique et réaliste va sembler un peu lourd, un peu opaque, et aussi un peu trop sombre; les disciples de Rousseau affectent de tenir leurs œuvres, par souci du style, dans des colorations noirâtres, sourdes, où la lumière du soleil a peine à se jouer. A cet instant la France va s’enrichir d’un de ses plus grands peintres: Corot (1796-1875) va révéler la série de ses poèmes virgiliens.
Il débute par une suite d’études dans la campagne romaine, d’une science, d’une justesse incomparables. Puis, il lui suffit d’un bouquet d’arbres, d’une source, d’un coin de clairière pour réaliser ses émouvantes et suaves harmonies. Toute sa vie Corot sera honni par l’Ecole; longtemps il vivra pauvre, vendant si mal ses œuvres qu’au rare acheteur dont la venue l’étonné il offrira souvent une étude en surplus, avant de connaître à la fin de sa vie l’aisance et la renommée. Cet homme simple et bon, que ses admirateurs appellent «le père Corot», a dans l’âme une délicatesse infinie. Lui aussi stylise la nature à la façon de Ruysdaël, de Poussin et des romantiques, mais il ne simplifie la coloration que pour mieux faire sentir la fluidité de l’air qui enveloppe toutes choses. Un gris perle, un vert bleuâtre, quelques notes brunes, c’en est assez pour composer une véritable musique de nuances. Et il apporte dans le paysage la notion de l’infini, la vibration mystérieuse et magnétique de la poésie panthéiste. Il est le premier à mêler la silhouette d’un arbre à l’atmosphère, à supprimer la sécheresse des contours, découpés sur le ciel, à influencer les tons des objets selon la teinte du firmament et selon l’heure. Il exprime intensément la brume, la poésie de l’eau, la fuite indécise des lointains. Watteau seul, avant lui, a eu l’élégance de ses minces arbres penchés, sinueusement détachés du sol, avec leurs feuillages clairs en forme de bouquets. Il se ressouvient de Poussin et de Virgile en mêlant à ses paysages des figurines de nymphes, de naïades, d’une légèreté exquise. Et ce grand rêveur du demi-jour, ce grand harmoniste des feuilles et de l’eau est aussi un admirable peintre de figures. Ces figures, on ne les connaît que depuis peu, tant l’artiste a été injustement apprécié. Elles sont au nombre des plus belles et des plus savantes figures qu’on ait peintes au XIXe siècle. Corot est un de ces génies qui semblent être l’expression impersonnelle de la nature elle-même, de la poésie immanente des choses. En le contemplant on ne pense pas à la technique, on est pris tout entier par l’émotion de douceur, par la pénétrante sensation qu’il eut lui-même. Ce n’est qu’ensuite qu’on voit à quel degré atteignait sa science des valeurs, sa magistrale sûreté de coloriste.
Avec Corot, le paysage français atteint son apogée. Avec Corot est posé le grand principe du paysage moderne; l’atmosphère devient le thème essentiel et logique. C’est elle qui colore, et qui réagit sur tous les tons du tableau. Elle réduit toutes les couleurs à une harmonie dont le ciel est nécessairement la base, et ainsi le paysage se rapproche du principe de la symphonie. L’œuvre de Corot est le point de départ d’une évolution qui conduira à une fusion de la peinture et de la musique. Dans le grand désir de fusion des arts qui sera la recherche capitale de la fin du XIXe siècle et qui trouvera sa plus significative expression dans Wagner, l’œuvre de Corot aura déterminé l’orientation de la peinture de paysage vers les procédés musicaux, et elle aura aussi porté un nouveau coup aux notions fondamentales de l’Ecole. L’une de ces notions en effet est le ton local, c’est-à-dire la croyance à la coloration individuelle des objets, alors qu’en réalité, et scientifiquement, toute couleur vient de la lumière et se modifie avec elle. Il n’y a pas de couleurs fixes, il y a des variations de vitesse et d’incidence des ondes lumineuses selon les heures du jour. L’ombre n’est pas l’absence de lumière, mais une lumière différente et composée de certaines couleurs. La notion du ton local, disant qu’un arbre est vert ou un ciel bleu, n’a donc aucune réalité: il s’ensuit un envisagement tout nouveau de la peinture, et c’est à Corot qu’est due la position très nette de cette question. Il touche l’âme par des moyens musicaux, par le rythme et par le développement d’une tonalité et de ses dérivés. Il ne faisait point de théories et n’a guère été imité: il n’en est pas moins vrai que ce grand isolé a été l’initiateur de la conception impressionniste du paysage.
Il faut citer après lui Jules Dupré (1811-1889), qui a été un puissant réalisateur de morceaux, Harpignies (1819-1912), robuste et scrupuleux portraitiste de sites, mais trop peu sensible à l’atmosphère, Français (1814-1897), dont le talent éclectique concilia le paysage composé à l’étude sur nature, Jules Breton (1827-1910), qu’un sentimentalisme assez fade n’a pas empêché de tracer des scènes rustiques intéressantes, Hervier, les Lyonnais Vernay, Carrand et Ravier, John Lewis-Brown, excellent coloriste et alerte notateur de scènes de chasse, Louis Lépine (1835-1892), fin observateur de Paris, retrouvant parfois la suavité de Corot dans ses harmonies grises et dorées, et plus encore Eugène Boudin (1824-1898), véritable maître moderne, initiateur de Monet, auquel on doit d’admirables marines, des ciels septentrionaux d’une justesse saisissante, qui annoncent aussi l’impressionnisme par la libre originalité de leur composition. Enfin, l’âme de Corot semble revivre, avec plus de mélancolie grave, dans un paysagiste qui n’est pas placé à son rang, Auguste Pointelin, qui, en ses poétiques paysages du Jura, son pays natal, montre, outre une science attachante des harmonies verdâtres et rousses de ce pays triste et noble, un profond sentiment du crépuscule et des lumières diffuses.
Ainsi se dessine l’évolution du paysage français jusqu’en 1865, époque à laquelle la technique des tons divisés, dite «par taches» est essayée par Claude Monet dans ses premiers tableaux. De1870à1890cette vision nouvelle se développera et atteindra à sa plénitude. Nous étudierons à part la technique de ce groupement d’artistes. Mais Claude Monet et ses amis nous appartiendront en ce chapitre par le choix et le style de leurs sujets. Claude Monet (1840-1926), au début de sa vie, peignit des portraits, des intérieurs, des marines dans un style qui rappelle à la fois Courbet et Manet. Formé au Havre par Eugène Boudin à l’étude du plein-air, jusqu’alors inusitée, il fut amené par son instinct à se passionner pour les analyses de la lumière, et à considérer qu’elles devaient être prépondérantes dans l’étude du paysage. Sur ce point il devança Manet de quelques années. Le nom d’impressionnisme fut donné à ce genre d’études, par une circonstance fortuite: dans une exposition particulière d’un groupe d’artistes indépendants, désavoués par l’Ecole académique et refusant ses dogmes, en1874, Monet exposa un soleil couchant intitulé: impression, et par raillerie on affubla du nom d’impressionnistes les peintres qui peignaient dans la manière de ce tableau. Ce fut seulement après1870que Manet commença de peindre en plein air et inaugura ainsi la seconde période de son œuvre. Comme il était depuis longtemps considéré comme l’homme de toutes les audaces, le point de mire des polémiques, alors que Monet était inconnu, on s’habitua à voir en lui le chef des novateurs, alors qu’en réalité ce titre doit être rendu à Claude Monet. De plus, le nom tout fortuit d’impressionnisme se trouva présenter un sens assez acceptable, celui d’un art ne retenant que l’impression des choses, et c’est ainsi que ce jeu de mots finit par passer dans la critique pour le programme lui-même de Monet et de ses amis.
Monet s’attacha donc à exprimer les effets de la lumière solaire sur les objets plutôt que ces objets eux-mêmes. C’était le contraire du paysage romantique. Dans cette intention il peignit plusieurs séries de sites, dont chacun fut étudié une quinzaine de fois en des toiles séparées selon tous les éclairages de la journée, de façon à suivre toutes les variations de la lumière sur un même aspect naturel. Ainsi furent étudiés successivement une meule dans un champ, quelques peupliers sur une berge, un bouquet d’arbres au bord d’un étang, un village reflété dans une rivière, le portail de la cathédrale de Rouen, des vues de la Tamise, des bassins pleins de nymphéas dans sa propriété de Giverny. En ces diverses symphonies, car c’est leur véritable nom, Claude Monet montra qu’il savait comprendre et rendre la structure d’un arbre ou d’un sol, la fluidité de l’eau, ou exprimer la matérialité spéciale de la pierre: mais avant tout la vibration de la lumière l’intéressa. Ce grand peintre a su atteindre à des dissociations de tonalités qu’on n’avait jamais observées. Ces séries d’aspects multiples du même thème sont des lumières transposées, où la meule, le peuplier, le portail comptent tout juste comme prétextes, au lieu d’être, comme dans Rousseau, les sujets et les motifs d’intérêt du tableau. Mais Monet a prouvé aussi sa science de composition, sa connaissance des diverses formes de la matière vivante, dans ses paysages de falaises d’Etretat, dans ses marines de Belle-Isle, dans ses jardins et ses bois de pins du golfe Juan, où est rendue avec tant de vérité l’âme de la clarté méditerranéenne; qu’il peigne la mer furieuse et livide, qu’il la dissolve en vaporeuses bleuités sous le soleil, qu’il hérisse dans le vent les herbages rudes d’une falaise ou les pins tordus par la tempête, qu’il fasse frissonner les champs de tulipes rouges sous la brise hollandaise, qu’il groupe des maisons blanches et roses auprès d’une rivière bleue et brillante, qu’il étudie la neige, le givre rose, la Seine et ses canots blancs, la Tamise et le soleil glaçant d’or et d’argent les brouillards, les tournesols, les nymphéas, les champs d’avoine, les rochers bretons ou les rochers rouges de l’Esterel, ou encore une cabane de douanier perdue à la crête de la dune en face de la mer immense, ou enfin des faisans peints comme des amoncellements de pierreries, toujours Claude Monet reste lyrique, puissant, subtil et réel.
Ses tableaux sont beaux, non seulement à cause de leur technique, mais encore à cause de leur «sentiment». Il renouvelle avec une variété infinie sa manière de présenter un site, en trouvant dans la nature elle-même les plus beaux principes décoratifs. Parfois, un pan de falaise emplit toute une toile et laisse tout juste la place à un peu de ciel. Tantôt la mer remplit le cadre, sans premiers plans; tantôt, dans les Cathédrales, le tableau est entièrement composé d’un fragment de portail qui commence au bas, sans presque de recul, et monte jusqu’en haut sans qu’on voie le ciel. C’est comme un morceau de pierre colorée et encadrée. Monet ainsi néglige hardiment les plans qui aident à comprendre la perspective, les objets ou les bouquets d’arbres distancés comme des «portants» de théâtre. Le coloris seul d’un rocher, d’une eau, suffit à «dessiner» ses tableaux, fenêtres ouvertes sur la vie. Quand il compose d’une façon plus classique, il s’amuse alors à renverser les effets de lumière, à éclairer un premier plan en laissant les autres dans l’ombre, à combiner mille jeux de la couleur: c’est en cela que, malgré son réalisme, il rejoint Turner. On peut donc dire que la composition de Claude Monet suffit à elle seule à inaugurer un âge nouveau du paysage, quand même ses théories chromatiques ne lui assureraient pas une entière originalité. Nous pourrons le compter à la fois–et c’est une preuve de la relativité des «genres»–dans les réalistes, les impressionnistes et les lyriques. Car son coloris éclatant, son amour de la lumière, son intuition de la vibration des atomes, son don d’animer, de faire chanter le moindre coin de terre ou d’eau sous le soleil, atteignent à une sorte de joie panthéiste; lui aussi est poète. Corot écrit le poème des tendresses grises, Monet le poème du soleil, et tous les deux sont des lyriques presque musicaux. Mais chez Monet, la composition est purement réaliste et ne cède pas comme celle de Corot à une évidente préoccupation du style harmonieux de Watteau et de Ruysdaël.
Autour de Claude Monet se groupèrent quelques remarquables peintres. Camille Pissarro (1830-1903) fut le plus varié et le plus abondant. On lui doit un grand nombre de paysages, des scènes rustiques, et une suite d’études de Paris où son talent a atteint son apogée, avec une force étonnante chez un vieillard. Pissarro a commencé par se ressentir très nettement de Corot en ses premiers paysages, paisibles aspects de moissons et de plaines baignées de lumières blondes. Puis il a été influencé longtemps par Millet dans ses marchés, ses fermes, ses études de paysannes. Son œuvre est d’un charme fruste, d’une âme sincèrement éprise de la campagne, des vergers français, des silhouettes des humbles, elle a un parfum champêtre, et elle est d’un artiste savant et consciencieux. Il n’aura peut-être manqué à Pissarro que d’avoir échappé aux influences: son esprit modeste l’entraîne trop aisément à imiter ce qu’il admire, et c’est ce qui le relègue au rang des excellents artistes de second plan. Ses études des boulevards de Paris, vus d’étages élevés, sont admirables de justesse, de vie, d’atmosphère, de mouvement des foules, et compteront parmi ce que l’impressionnisme a produit de meilleur. On peut en dire autant d’Alfred Sisley (1839-1899), qui eut un sens exquis des ciels français, des rideaux de feuillages ensoleillés, des rivières claires, des petits chemins de campagne, des maisonnettes gaies dans la verdure, des vieilles églises dorées par le soleil, des grands vols de nuages dans l’azur, et qui souvent a rivalisé avec Monet.
Manet peignit peu de paysages. C’était avant tout un peintre de figures. Néanmoins on lui doit quelques belles études de jardins, des marines superbes, et dans maint tableau des paysages de fond qui sont d’un maître, notamment celui d’Argenteuil. Les paysages de Degas, sont plutôt des recherches de tonalités rares: mais ceux qui servent de fonds à ses scènes de courses sont très beaux. Enfin, nous retrouverons Millet parmi les Intimistes. Mais il est impossible de ne pas parler ici de ses études de vieilles églises de village, si simples, si vraies et si fines, et surtout de l’étonnant Arc-en-ciel du Louvre, qui, avec ses oppositions de soleil et de ciel livide, ses verdures blêmes, sa lumière étrange, est déjà une œuvre impressionniste, bien plus colorée et vibrante que ses toiles habituelles.
Les peintres de la génération suivante ont tous été influencés par l’impressionnisme. Ils semblent revenir maintenant à une conception plus stylisée du paysage, ou alors à l’intimisme où nous en retrouverons quelques-uns qui comptent parmi les premiers artistes du temps présent. M. René Ménard remonte à la tradition du paysage à figures de Poussin, aux arrangements décoratifs de Claude Lorrain, tandis qu’au contraire M. Le Sidaner, dont nous reparlerons, semble modifier la technique de Claude Monet et atteindre à une subtilité musicienne, à une émotion de nuances qui transfigure la réalité. Mais la jeune génération, tout en la respectant, échappe délibérément à l’autorité de Monet. C’est sur cette constatation que nous devrons arrêter l’étude de l’évolution du paysage français, en retenant ses trois grandes phrases: celle du réalisme décoratif issu, avec Théodore Rousseau de la tradition de Ruysdaël et de Hobbema, celle du sentiment poétique, née de Corot, celle enfin de l’étude de l’atmosphère, due à Claude Monet. D’abord épris des détails agrestes, du dessin des choses de la nature, le paysage se préoccupe ensuite de leur signification morale, de leur âme, de leur mystère, et enfin il identifie cette âme à la lumière elle-même qui devient l’es-– sentiel de la peinture. Commencé dans l’atelier d’après des croquis sur nature, arrangé, composé, le paysage aboutit à s’installer dans un site avec une quinzaine de toiles auxquelles l’artiste travaille successivement en les changeant d’heure en heure. Conçu d’abord presque sculpturalement, par grandes masses décoratives, avec la préoccupation de bien exprimer la solidité matérielle du bois ou du rocher, le paysage se volatilise, devient fluide, n’est plus qu’une musique de couleurs, une caresse de lumières transparentes au travers desquelles on perçoit le site qui les prétexte, comme un thème de sonate reparaissant à travers ses variations. L’ancienne idée du pittoresque, trouvant un site intéressant lorsqu’il accumule des détails curieux, cède complètement à cet amour passionné de l’aération, de la clarté, des effets du soleil et du demi-jour. C’est là le grand trait caractéristique de l’histoire du paysage depuis Rousseau jusqu’à nos jours. Ainsi le réalisme se transforme, reflète toute la sensibilité moderne, et la peinture se délivre peu à peu de son caractère matériel pour arriver à une sorte d’immatérialité relative, sous l’influence de la musique qui prend le premier rôle dans l’histoire des arts modernes.
La constatation de cette tendance n’empêchera point de penser que le paysage de1830a peut-être été plus logique, plus véridique et plus durable que le paysage impressionniste. Il a considéré le «motif» comme un véritable «portrait de nature», et nous pourrions observer à ce propos ce que nous serons amenés à observer plus loin relativement au portrait de figure. Le paysage de1830 a été assez peu soucieux de l’enveloppe atmosphérique et de la radiation solaire; il a, avant tout, cherché à exprimer le côté sculptural d’un site, les plans, les volumes, la densité, l’aspect cubique des trois dimensions, et en effet un paysage est une sculpture, et c’est par là que nous nous en souvenons, bien plutôt que par tel ou tel effet de lumière. Dans noire mémoire, un site aimé apparaît revêtu d’une sorte de moyenne des effets solaires, qu’on pourrait appeler «la lumière des jours ordinaires» et c’est sa densité, sa structure qui restent surtout dans notre esprit. En faisant de l’effet lumineux, et autant que possible de l’effet insolite, original, subtil, le motif essentiel, l’impressionnisme a amoindri le style et le caractère, il a depersonnalisé le site. Quand nous voyons sous un tableau de1830la mention «Route d’Arras à Douai», ou «Vue de Valenciennes», l’impressionniste est bien près de penser que cela n’a aucun intérêt artistique et qu’une photographie, un levé de plan, un cadastre peuvent seuls exiger ces précisions. Mais il méconnaît par là que cette désignation doit entraîner, pour le vrai peintre, l’évocation profonde de tel ou tel territoire français, restitué aussi fidèlement qu’un visage, et ayant son caractère spécial. Par contre, la plupart des paysages impressionnistes peuvent se passer n’importe où. Quand Monet indique «Peupliers au bord de l’Epte», ou Sisley «Bords du Loing», rien n’évoque l’Epte ou le Loing, mais simplement une qualité de lumière qu’on observe partout en Normandie, dans l’Ile-de-France ou dans l’Yonne. Les arbres, les cultures, sont peu reconnaissables. Tout se résout en une féerie chromatique d’où le dessin est presque absent, et l’œuvre pourrait porter la mention: «Etude de lumière entre dix heures et onze heures, ou entre une heure et trois, sous le ciel d’ouest français.» Nous forçons l’exemple pour bien faire comprendre le renversement symétrique qui s’est produit, en soixante années, dans la façon d’envisager l’intérêt du paysage. Les paysagistes de1830eussent été aussi mécontents de cette appellation horaire et climatérique que ceux de1890de la précise mention de lieu; c’était bien le portrait d’un lieu qu’ils entendaient peindre et faire reconnaître par tous ses détails, tout en tâchant d’en extraire une émotion générale, et sans doute l’avenir pensera-t-il qu’ils avaient plus profondément raison. Ils venaient d’une longue école d’art physionomique appliqué même aux «vues de villes» dont les vieilles géographies nous ont laissé de si admirables et si naïves gravures. Nous pourrons encore observer que cette dépersonnalisation du paysage a coïncidé à celle du portrait, traité de plus en plus comme un thème de lumière et de moins en moins comme une révélation de caractère personnel. Pour Rousseau et encore pour Courbet, qui fut un si merveilleux paysagiste-réaliste. un chêne était un être vivant et personnel, dont ils se fussent fait scrupule de changer la moindre branche. Et pour Corot lui-même, intermédiaire entre les deux conceptions, la vérité de ses paysages d’Italie et d’Ile-de-France ne résidait pas seulement dans la qualité atmosphérique, mais dans la soigneuse restitution du moindre détail. Par l’impressionnisme tout cela n’est plus guère qu’une fête de nuances, et il y a là un laisser-aller dangereux qui a conduit trop d’artistes actuels à ne plus respecter le caractérisme éloquent de la nature, à ne lui demander qu’une vague armature des feux d’artifice de palette, à en oublier l’émotion intérieure et à la dissoudre dans un souci exclusivement décoratif.