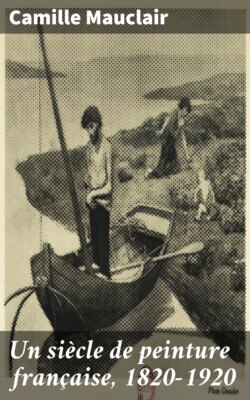Читать книгу Un siècle de peinture française, 1820-1920 - Camille Mauclair - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE II
EUGÈNE DELACROIX ET SES DISCIPLES
(1799-1863)
ОглавлениеTable des matières
Dans ses qualités, dans ses défauts, il n’a dépendu que de son âme. Avec celle de Liszt, c’est la plus noble que le romantisme ait connue. L’homme fut de ceux qui ne peuvent respirer que sur les cimes.
Il n’eut ni l’habileté commerciale et publiciste d’un Hugo, ni le désordre et les sempiternelles fureurs d’un Berlioz. A ces deux hommes on l’a comparé parce qu’il était dans son art un chef comme eux dans les leurs, servait un idéal analogue et encourait les mêmes risques: mais il fut tout autre, et moralement très supérieur. Il se sépara vite de Hugo, et son musicien, son ami, ce fut Chopin. Son éducation était d’un homme du XVIIIe siècle, son goût pour les classiques littéraires l’éloignait des romantiques. Il les domine de toute la hauteur de son esprit orageux et serein à la fois, détestant l’outrance et le hasard, ne considérant l’audace que comme la sanction d’une réflexion lente, au milieu des plus fiévreuses hardiesses. Il travailla formidablement et on ne le sut tout à fait qu’après sa mort en découvrant avec stupeur, dans les six mille dessins classés par Burty, la preuve des recherches minutieuses nécessitées par une création soi-disant spontanée.
Dans ce malade qui lutta de rapidité avec le destin, toutes les émotions de l’histoire, toutes les formes de la passion humaine, toutes les splendeurs de la grande poésie parlaient et passaient et il transposait instantanément en couleurs et en plans le monde en lui contenu. Personne depuis Rubens en effet ne se trouva pour créer avec cette volonté de puissance: mais si Rubens fut le coloriste incomparable de la vie heureuse, exubérante, sensuelle, il s’attacha peu à la vie intérieure et à l’expression de l’âme, encore que ses Christs morts révèlent une foi sincère et le sens du pathétique.
Delacroix tendit à exprimer la vie intellectuelle et passionnelle, à inscrire le concept de Rembrandt dans la ligne décorative des Vénitiens: et il fut, surtout, le premier dans son siècle à comprendre la nécessité d’oser un art de synthèse empruntant à tous les autres leurs sources émotives, l’art que Wagner, conseillé par Liszt et deviné par Baudelaire, devait réaliser à Bayreuth. Lettré, musicien, passionné de poésie, de philosophie, d’histoire politique et religieuse, préoccupé d’écrire, il voulut non pas ravaler la peinture au rang de l’illustration d’un sujet, comme l’école davidienne et les mauvais romantiques, mais la mettre au service de sentiments généraux dont l’expression serait le but essentiel d’un artiste satisfaisant en même temps à la passion de peindre. C’est en cela que chacun de ses grands tableaux est non seulement une belle création picturale, mais un acte de volonté dont le magnétisme exalte le cœur et l’imagination, et sollicite dans notre âme tout ce que la poésie, la musique et la culture des idées générales savent y émouvoir. C’est ce que Wagner a tenté. C’est ce que Liszt entrevit en créant le poème symphonique.
La musique symphonique de Delacroix, ce fut non pas l’harmonie linéaire telle que la concevait Ingres, mais la couleur. Il fut un merveilleux musicien du ton, et notre plus grand depuis et avec Watteau. Comme Watteau, qu’il étudia et dont sa grande âme somptueuse et triste dut comprendre si intimement l’âme, il considéra ia couleur non comme le plaisir des yeux mais comme un langage. Les Vénitiens et Rubens, qu’il semble recommencer simplement pour quiconque ne va pas au fond des choses, étaient des maîtres-peintres choisissant des sujets propres à prétexter le jeu admirable du coloris qui était tout leur idéal. Delacroix a approprié le langage muet du chromatisme aux idées et aux passions qu’il concevait non en peintre mais en penseur. Mais ce qui a fait de lui un grand peintre, et non pas un poète ou un philosophe dévoyé, se servant de la couleur pour exprimer des rêves abstraits, c’est qu’il concevait la forme et la vision chromatique de ses idées en même temps qu’elles-mêmes. Il demandait à la couleur le secret de l’émotion psychologique, tandis qu’Ingres la demandait aux seules inflexions de sa ligne merveilleuse. Delacroix a souvent été accusé de dessiner mal, et en effet il y a de grandes défaillances du dessin dans son œuvre, si on conçoit le dessin dans le sens de perfection ingresque: l’accusation tombe si l’on considère la question sous un autre aspect. Delacroix ne croyait pas à la perfection immanente du dessin, notion abstraite et froide à ses yeux. Il voulait avant tout exprimer la vie d’une humanité héroïque, et concevait à ce point de vue le mouvement comme la première et presque l’unique qualité du dessin. Amené ainsi à ne plus séparer la ligne de la couleur et à concevoir le dessin d’un être animé par les volumes et les plans, comme un sculpteur, les valeurs des objets et des êtres étaient pour lui tout le dessin, et on peut dire que là il n’a jamais fait une faute; il indiquait une valeur avec une sûreté prodigieuse alors qu’Ingres n’y parvenait qu’avec une pénible patience. La querelle du mauvais dessin de Delacroix se confond avec celle du dessin par contours et du dessin par volumes, querelle qui dure encore. Enfin, Delacroix était très préoccupé de faire sentir l’atmosphère autour des êtres, de faire réagir la coloration de l’ambiance sur les personnages: tout, les six mille dessins, les lithographies, les eaux-fortes, était conçu dans le sens de l’accentuation du mouvement et du caractère plutôt qu’avec le désir de la reproduction exacte des choses. Il les voyait non pour elles-mêmes, mais en tant qu’éléments dramatiques.
La main du génial malade parfois trembla, et on trouve en son œuvre nombre de figures que la force de l’intention malmène et déséquilibre. Mais des morceaux comme l’étudiant mort de la Barricade, la femme nue des Croisés, la captive liée à la croupe du cheval turc dans les Massacres de Scio, la Liberté au torse nu, la négresse des Femmes d’Alger, le Trajan, certains lions, égalent Delacroix aux plus admirables dessinateurs de tous les âges. Ses petites toiles et ses dernières œuvres, traitées en esquisses, notent avant tout le chant du coloris dans ses concordances avec le sentiment: il se sent pressé par la mort, sa nature de décorateur s’impatiente des raffinements d’exécution propres au tableau de chevalet. Il faut le deviner, être, comme lui, plus attiré par l’idée que par la facture. Mais toujours la couleur est admirable.
En lui comme en Watteau, elle devient un élément psychologique; elle n’est pas un vêtement bariolé agrémentant une conception, elle s’y incorpore, et jamais Delacroix, grand coloriste, esprit lyrique épris de toutes les somptuosités de la vie extérieure, n’a pourtant peint un morceau pour le seul plaisir de le peindre. Beaucoup d’artistes ont vu dans ce plaisir instinctif toutes les fins de leur art: lui a constamment sacrifié ce plaisir à son idée, autrement mais aussi sévèrement qu’Ingres lui-même. Coloriste merveilleux, mais non pas coloriste avant tout, il a inféodé la tonalité à l’idée générale, il a dédaigné le morceau de bravoure. Mais dans ces volontaires assourdissements, dans cette mélancolie grandiose, dans ce crépuscule perpétuel qui est la couleur même du pessimisme romantique, et où il a voulu se maintenir en harmonie avec ses thèmes, éclôt un monde de nuances d’autant plus riches et savoureuses, accusant une inouie sensibilité optique. Ce sont bien là ces couleurs de l’orage et de la pourriture dont a parlé Baudelaire à propos d’Edgar Poe en saluant en Delacroix un homme «qui élevait son art à la hauteur de la grande poésie». Là, celui qui venait de Véronèse, de Rubens, de Constable, a présagé toute notre intellectualité douloureuse.
Il n’est ni peintre à programmes littéraires, ni peintre d’histoire coloriant des illustrations documentées. Il emprunte à l’histoire réelle, à l’histoire inventée par les grands poètes.
Hamlet est pour lui aussi réel que les Croisés, Don Juan aussi vrai que les Turcs ou les soldats du Téméraire, Dante aussi vivant que les insurgés de1830. Il est le peintre de la passion, de l’héroïsme et de la douleur à travers les siècles et les envisage en solitaire ému par tous les grands sentiments. Il les refond dans le creuset de sa cervelle brûlante, en nourrit sa fièvre, en exalte sa raison: il les exprime par la peinture, mais son dessin est un rythme, sa couleur une musique, sa composition un bas-relief. Nul n’a mieux groupé les êtres, jeté la lumière sur la figure essentielle, ménagé dans les intervalles laissés par les personnages l’insertion des sites et des figures secondaires. Toutes ses formes convergent à un seul point où elles entraînent le regard. Il n’a pas admis qu’un peintre fît pardonner l’insuffisance de ses moyens par l’ingéniosité de son intention, car il a follement travaillé et s’est jugé avec la plus scrupuleuse sévérité, mais il n’a point admis davantage qu’expert à copier adroitement un peintre tirât vanité de ce talent d’imitation. Profondément vrai, jamais réaliste, il a peint les accessoires avec exactitude, au prix de grandes recherches en un temps où, l’une et l’autre école étant conventionnelles, Ingres était seul avec lui à montrer ce souci du détail vrai. Mais, si ses héros sont vêtus et armés comme il convient, du moins l’idée et la passion sont tout, l’accessoire n’est juste et n’intervient que pour renforcer le caractère général des types.
Rien de médiocre, de photographique en cette exactitude transfigurée par le lyrisme. Delacroix sait qu’aux esprits modernes la vérité du détail impose mieux une vision. Mais chez lui la restitution de l’âme par la force communicative de l’émotion nous rapproche des êtres disparus, et non l’illusion facile d’une copie de leur intérieur ou de leur vêture. Nous ne les regardons pas avec une curiosité froide à travers la lunette d’une diorama, nous vivons leur vie cérébrale, ils se mêlent à nous. La contemplation d’un Delacroix est pour un jeune homme la plus belle leçon d’histoire héroïsée. Au Louvre, de telles œuvres entonnent le chant de la gloire française.
L’orientalisme de Delacroix témoigne du même désir de synthèse. Si d’autres ont été plus véridiques, plus curieux, plus sensibles à l’atmosphère, au charme purement chromatique, il reste le plus grand par la fougueuse interprétation de la fureur et de la morbidesse orientales, et on n’ira jamais plus loin que ses combats de cavaliers, et ses lions, et ses chevaux syriens, merveilles de vitalité affolée. Par lui s’est animée une multitude d’êtres humains et de créatures animales en qui la vie et le rêve s’amalgament indissolublement, et dont la chevauchée épique traverse le XIXe siècle. Fécond comme Hugo, concentré comme Baudelaire, il a toujours été droit à l’essentiel, il a, selon la belle expression de Taine «dit la seule chose dont nous ayons besoin». Il reste le premier dans toutes les hautes manifestations de son art. Dans son temps il fait les plus beaux tableaux héroïques, avec les Croisés, les Massacres de Scio et la Barricade, les plus beaux tableaux d’animaux avec ses lions et ses chevaux, les plus belles interprétations de poèmes avec ses planches sur Faust et Hamlet, le plus beau tableau religieux avec sa Pieta, le plus beau plafond avec son Apollon. Il ne laisse à faire aux autres que des morceaux plus poussés, des notations plus curieuses, des études réalistes et chromatiques plus serrées, des reconstitutions plus minutieuses. Tout ce qui est grànd, il le fait.
Il fut, avec Ingres, l’un des deux maîtres de son époque.
Delacroix, confondu avec ses imitateurs indignes, n’influa pas sur une génération décidée à rejeter l’histoire et l’allégorie. La clarté, la véracité des portraits ingresques apparurent bien plus conformes aux désirs nouveaux. Par une étrange ironie des théories et des inquiétudes, ce fut l’ennemi implacable du grand libéral Delacroix, ce fut Ingres, devenu un dieu de l’école qui autorisa le mouvement libéral et antiscolastique de Manet.
Mais ce fut au moment où, après le réalisme caractériste de Manet, l’exemple de Claude Monet entraînait Manet lui-même dans l’étude du plein-air, qu’un nouveau retour de la fortune diminua l’influence d’Ingres et remit Delacroix en honneur. La théorie des complémentaires fit comprendre les audaces des Croisés à l’instant où l’insuffisance d’Ingres coloriste écartait et décevait les chercheurs. En même temps le XVIIIe siècle ressuscitait, on y retrouvait les premières indications du modernisme, les premières recherches d’expression de l’ambiance. On comprit alors que Delacroix avait été le seul à discerner dans Watteau et Chardin la valeur de la technique nouvelle, reliant ces grands oubliés à son siècle. Ainsi marqua-t-il de son droit d’aînesse la seconde période du mouvement créé par Manet, comme Ingres avait marqué du sien la première; et ce fut la revanche posthume des deux rivaux contre l’art officiel qui s’était servi de l’un pour nuire à l’autre.
Mais de nouveau on le méconnaît, on l’oublie. Nous vivons dans une débauche d’études, de procédés. Par haine contre l’esthétique poncive, on ne fait plus de compositions, on affecte de confondre la «peinture pensée» avec sa caricature, la «peinture littéraire». Le désir du succès rapide dissuade des œuvres de longue préparation. Le plaisir et surtout la surprise des yeux sont tout le souhait du public. Cependant on se trouvera bientôt en face du dilemne: considérer la peinture comme un art en déchéance, ou revenir à la grande composition exprimant les passions et les idées générales de la récente humanité.
Ce jour-là, lorsqu’on cherchera, par un mouvement instinctif, éternel, à relier au passé les pressentiments de l’avenir, à donner à l’effort nouveau ses lettres de noblesse, l’art entier se tournera vers Delacroix. Il n’a pas été seulement un grand peintre: il a été un grand homme, une haute intellectualité polyvalente. La publication de son journal, que tout jeune peintre devrait lire, et de ses admirables études sur Raphaël, Poussin, Puget, Prudhon, de ses fragments sur la philosophie, l’esthétique, l’art militaire même (il a prévu les tanks dès1857!), montre la puissance de méditation d’une nature supérieure en possession d’une conception et d’une méthode unitaires: cet ami de George Sand et de Chopin fut, enfin, un profond connaisseur de la musique. Aucun artiste français n’a eu plus de génie.
C’est sans doute parce que ce génie était aussi profondément original qu’il n’a pu susciter que des imitateurs, cependant moins médiocres que ceux d’Ingres. En face d’une école académique stérile, le romantisme a cru qu’il suffisait de l’improvisation, de l’instinct individuel, même sans souci de la vérité observée, du goût et du style. Nous assistons depuis le cézannisme au développement d’une erreur de ce genre, intronisée par les impressionnistes. A un siècle de distance, on s’est figuré et on se figure que le caprice personnel peut et doit être la condition librement créatrice, alors qu’il ne vaut que selon la mesure de l’individu lui-même. De là les absurdités confondues avec l’audace, la carence de la technique, les débuts vite avortés: nous les constatons parmi nos «fauves», et les romantiques groupés autour de Delacroix (intentionnellement tout au moins, car ce grand dédaigneux vécut toujours solitaire et ne joua jamais le rôle d’un «chef» à clientèle et à séides).
Eugène Devéria (1805-1865) ne tint guère les brillantes promesses de sa Naissance de Henri IV. Louis Boulanger (1806-1867), si vanté par Victor Hugo, ne fut guère qu’un Delaroche plus fougueux mais moins savant, un illustrateur de sabbats, d’assassinats, d’orgies et de chasses infernales, d’un sentiment turbulent et d’une facture molle. Il y eut beaucoup plus de talent chez deux peintres moins connus, élèves de Gros, Léon Riesener (1808-1878) et Debon (1807-1872), chez Jean Gigoux (1806-1894), chez Champmartin, bon portraitiste (1797-1883), chez Deroy, qui peignit Baudelaire à vingt arts, chez Félix Trutat (1824-1848) qui présageait un autre Géricault. Ary Scheffer (1785-1858), de naissance hollandaise, transfuge de l’atelier de Guérin, connut des succès éphémères avec ses peintures d’histoire et de mysticité. Des hommes comme Pengnilly L’haridon (1811-1872), Boissard de Boisdenier (1813-1866), Robert Fleury (1797-1890), Guignet (1817-1854) ont mieux honoré l’exemple de Delacroix. Camille Roqueplan (1802-1855), Alfred de Dreux (1808-1860), Eugène Isabey (1804-1886), fils du célèbre miniaturiste, et surtout Eugène Lami (1800-1890), et Tassaert (800-1874), qui eurent les plus beaux dons.
Les deux peintres des gloires et des douleurs de la Grande Armée, Charlet (1792-1845) et Raffet (1804-1860), ont été, le second surtout, d’admirables illustrateurs. Enfin, au-dessus de tous, il faut placer Decamps (1803-1860), animalier, orientaliste, d’une magnifique technique, surpassant infiniment ceux qu’on a appelés «les voltigeurs» du romantisme, les frères Alfred et Tony Johannot (1800-1837, 1803-1852), et Célestin Nanteuil (1813-1873). On peut même rattacher à cette lignée de Delacroix le merveilleux statuaire Barye (1795-1875), à cause de ses peintures et aquarelles de grands fauves en des paysages farouches, qui s’égalent souvent aux œuvres que Delacroix a faites en ce sens. Il est donc juste de noter les quelques personnalités qui comprirent la leçon de ce maître et se soutinrent quelque temps à cause de lui. Mais le romantisme pictural ne tarda guère à rejoindre les davidiens et les ingristes dans l’éclectisme académique jusqu’à ce que Manet, après Courbet, en déterminât l’ébranlement et la ruine.